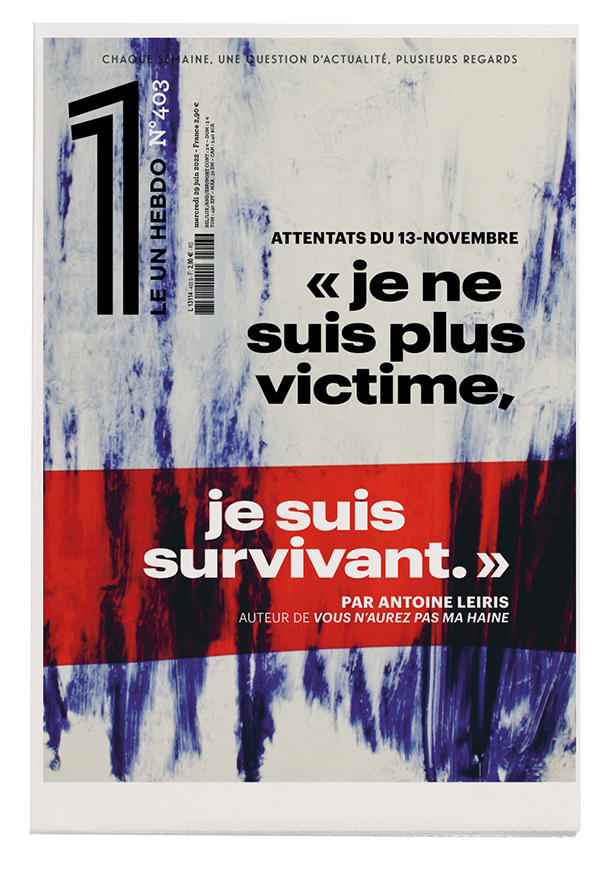Vérité et réparation
Blessée au Grand Véfour à Paris en 1983, elle fonde SOS Attentats trois ans plus tard. Jusqu’à son décès en mai dernier, elle n’a cessé d’œuvrer à une meilleure reconnaissance des victimes du terrorisme. Elle est revenue sur ce combat dans Triple peine, paru en 2004. Extrait.Temps de lecture : 5 minutes
J’ai su très vite que la reconstruction après l’attentat ne passerait pas seulement par des soins et des indemnités. Il me semblait que le processus judiciaire, l’instruction puis le procès étaient des étapes essentielles pour en finir avec la hantise, les cauchemars. C’était une question de vérité et de réparation, de compréhension et de deuil à terminer. Je ne saurais dire d’où je tenais cette conviction. Sûrement pas de mon expérience puisqu’un grand silence avait entouré l’attentat du Grand Véfour. Mes études, mon amour du droit m’ont toujours fait considérer l’existence de règles collectives comme un grand bienfait des sociétés démocratiques. J’allais m’en convaincre encore davantage. […]
Je savais à quel point se retrouver dans l’enceinte d’un prétoire, face à des juges, des avocats, serait difficile. Je savais qu’entendre évoquer à nouveau les moments douloureux, affronter ceux qui avaient posé la bombe pourrait être traumatisant. Je savais que cette épreuve risquait de rouvrir provisoirement les peurs et les angoisses, la difficulté d’aller vers les autres. Je pressentais aussi que le procès avec sa conclusion formelle pourrait être la meilleure façon d’en finir.
Marie-France voulait continuer d’oublier. Mais dans son cas, l’amnésie était une illusion, évidemment
S’il y avait une personne pour laquelle je craignais et j’espérais cette épreuve, c’était Marie-France Vilela. En 1995, elle était retournée vivre au Portugal, auprès de sa mère. Treize ans plus tôt, la bombe posée par Action directe (AD) rue de la Baume contre un importateur de légumes israélien l’avait rendue quasiment aveugle, la privant de son métier de couturière. Marie-France, malgré les années, était toujours aussi déprimée. Je voulais absolument qu’elle revienne en France assister au procès de la branche lyonnaise d’Action directe responsable d’une trentaine d’attentats, dont celui de la rue de la Baume. Marie-France ne voulait pas quitter le Portugal, elle voulait continuer d’oublier. Mais dans son cas, l’amnésie était une illusion, évidemment.
J’ai dû batailler au téléphone, à plusieurs reprises, pour la faire changer d’avis. J’ai agi dans son seul intérêt. La responsabilité d’André Olivier et de Max Frérot, chefs de l’Affiche rouge, le groupe lyonnais d’AD, était tellement engagée qu’on pouvait se passer d’amener des victimes à la barre, cela n’aurait rien changé. Mais j’étais persuadée que sa présence au procès aiderait Marie-France à évacuer sa douleur. Elle a finalement accepté. J’ai tremblé de lui avoir infligé une épreuve inutile, je l’ai entourée du mieux que j’ai pu. Je ne me suis pas trompée.
Marie-France constata d’abord qu’elle n’était pas la seule victime des méfaits d’Action directe. Mais le partage des souffrances n’est pas venu d’où elle l’attendait. Ce ne furent pas d’autres victimes du groupe terroriste mais l’ancienne compagne d’André Olivier en personne, une infirmière, qui montra le vrai visage du chef de ces révolutionnaires enflammés qui prétendaient accoucher un monde meilleur. Il était en fait un violent et vulgaire machiste qui battait sa femme […]. Pour le reste, il suffisait d’écouter l’ancien professeur pour comprendre son antisémitisme, sa mégalomanie.
« Je suis dans une prison sans barreaux »
D’autres membres du groupe d’Action directe, enrégimentés contre leur gré, racontèrent aussi les tortures morales endurées. Je sentais Marie-France un peu détendue par ces récits mais je craignais le moment de sa déposition, j’avais peur qu’elle craque, qu’elle ne supporte pas la confrontation avec ceux qui avaient brisé sa vie. Mais elle fit front, vaillamment. Elle raconta cette soirée d’été où, après une longue journée de travail, elle promenait son labrador et puis l’éclair bleuté, l’effet de souffle, la perte de connaissance. « J’ai maintenant 51 ans. Depuis 1982, je ne fais plus de projets, tous mes rêves ont été brisés… J’aimais sortir, danser, voyager. Maintenant je suis dépendante, je ne suis plus la même femme… Je suis une pharmacie ambulante, je ne sers plus à rien. Je suis dans une prison sans barreaux. »
Pendant toute sa déposition, je vis le juge Gilbert Thiel, absorbé par ce que disait Marie-France, ne cessant de prendre des notes. Je vis aussi Frérot et Olivier interrompre un instant leur comédie ridicule de terroristes sur le retour. L’un d’eux concéda : « Nous sommes fiers de nos actions politiques tout en regrettant l’accident survenu à Mme Vilela. » Un complice assura : « Mme Vilela, je sais que vous ne serez pas d’accord avec ce que je dis. On a fait des repérages sur une semaine ou dix jours. On s’est profondément trompés. Jamais on n’aurait imaginé que vous passeriez par là, on ne vous avait jamais vue sortir après onze heures et demie le soir. » Marie-France ne voyait pas, et pour cause, ce second couteau soudain penaud, elle ne l’écoutait pas non plus. […]
L’ancienne couturière reprit sa canne, elle retrouva son banc, elle en avait terminé, son visage était serein
Quand le couplet des regrets bien tardifs prit fin, Marie-France se tourna vers le box des accusés d’où provenaient les cris et maintenant les plaintes. D’une voix extrêmement claire, elle dit : « La politique, ça ne m’intéresse pas. Quand on pose des bombes, c’est toujours très lâche. C’est pour tuer des gens. » Et l’ancienne couturière reprit sa canne, elle retrouva son banc, elle en avait terminé, son visage était serein. Je remarquai même qu’un sourire s’accrochait à son regard. En dix ans, c’était la première fois que je voyais Marie-France se détendre, quitter sa mine triste et renfermée. J’avais eu raison d’insister, j’étais tellement heureuse pour elle. Elle pourrait retourner au Portugal, délivrée d’une partie de ses angoisses.
Triple peine © Calmann-Lévy, 2004
Illustration Stéphane Trapier
« Construire un récit choral, nourri par les mémoires individuelles »
Denis Peschanski
Francis Eustache
L'historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache nous expliquent le rôle que le procès joue et va jouer pour les victimes et pour la société.
[Partie civile]
Robert Solé
À l’ouverture du procès hors norme du 13-Novembre, ils étaient déjà 1 800. Par la suite, quelque 700 autres rescapés, blessés ou proches des victimes se sont également constitués partie civile.
Un vaccin antiterrorisme ?
Sandrine Lefranc
Pour la politiste et sociologue Sandrine Lefranc, le procès du 13-Novembre ne devrait pas fondamentalement modifier notre lecture des attentats, faute d’être sorti des analyses caricaturales.