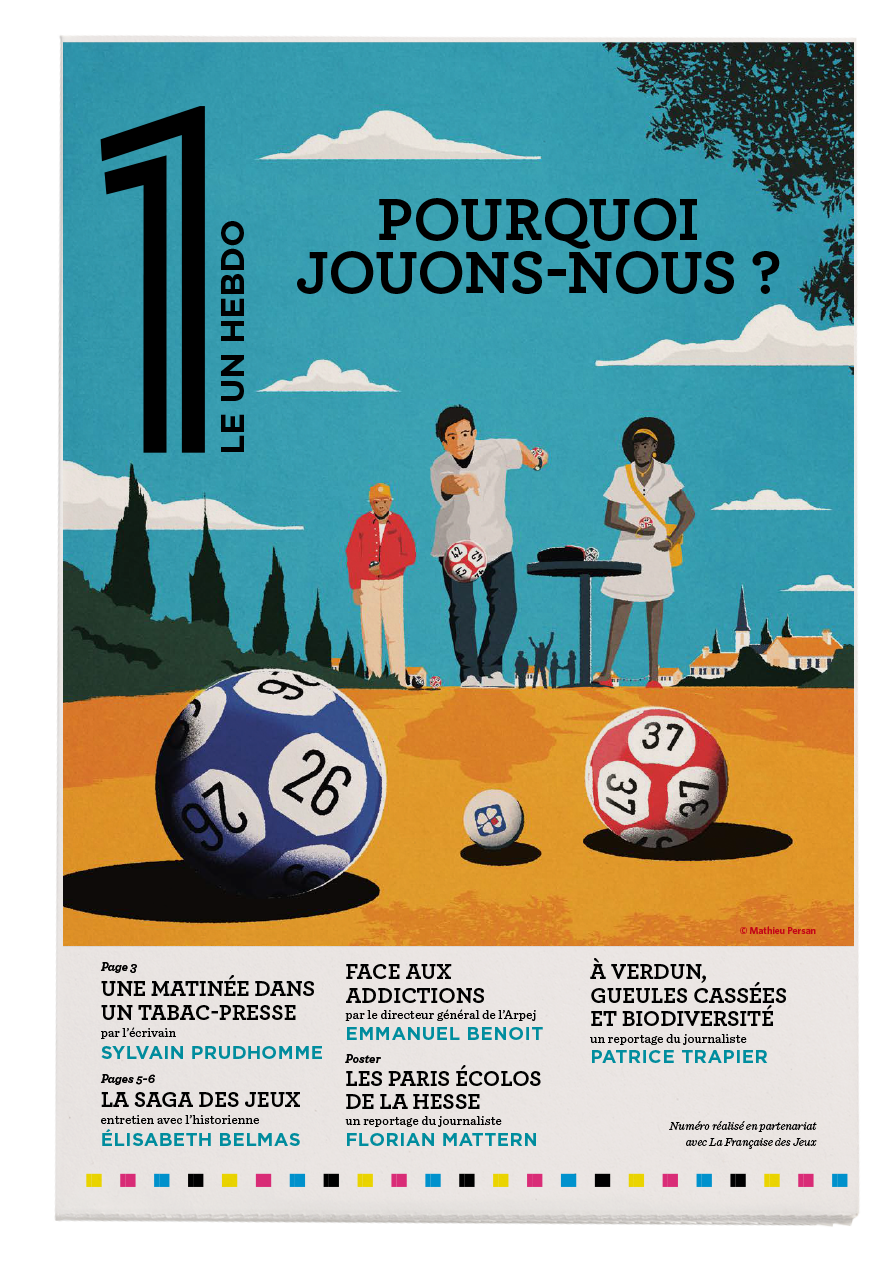Avorter en zone rurale : un parcours de la combattante
Temps de lecture : 8 minutes
Ariane* est sous stérilet lorsqu’elle tombe enceinte. Ironie du sort, elle venait de décider, avec son compagnon, de ne pas avoir d’enfant. La trentenaire, employée territoriale dans une petite commune du Limousin, est sous le choc, mais résolue. Elle avortera. « C’est là que commence mon parcours de la combattante », témoigne la jeune femme. Alors qu’une femme sur trois sera amenée à avorter au cours de sa vie, l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) demeure en effet très inégal sur le territoire métropolitain. Et pour les 11 millions de femmes qui vivent dans des zones rurales en France, faire valoir ce droit peut vite devenir un calvaire.
Un chemin semé d’embûches
Premier écueil : la distance. Ariane vit sur le plateau de Millevaches, à la frontière entre la Creuse et la Corrèze. Le centre d’IVG le plus proche de chez elle est un hôpital, situé à une heure de route. Or, une IVG nécessite plusieurs rendez-vous : un entretien préalable, la procédure, la visite de contrôle, et souvent une consultation psychosociale, obligatoire pour les mineures. Un casse-tête logistique pour Ariane, qui doit s’absenter de son travail pendant des journées entières. « C’était difficile à justifier auprès de mon employeur, se souvient-elle, et mon compagnon n’a pas pu m’accompagner. Heureusement, j’ai une voiture. Sinon, ç’aurait été impossible. » Une situation qui pénalise tout particulièrement les mineures ou les jeunes adultes, qui sont statistiquement moins mobiles et dépendent souvent de leur famille pour les conduire. « Cela met à mal la confidentialité des avortantes, et parfois même leur sécurité », alerte Justine Chaput, doctorante en démographie à l’Institut national d’études démographiques (Ined) et spécialiste de l’avortement.
Une partie importante des gynécologues qui réalisent des avortements sont proches de la retraite
Deuxième difficulté : le choix. Il existe aujourd’hui deux techniques d’avortement : d’une part, l’IVG médicamenteuse, qui peut être réalisée à domicile jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, sous l’encadrement d’un médecin généraliste conventionné ou d’une sage-femme ; et d’autre part, l’IVG dite « instrumentale », autorisée jusqu’à quatorze semaines, qui nécessite une hospitalisation en ambulatoire. « Les deux procédures diffèrent par plusieurs aspects comme la durée, les saignements, la douleur ou le degré d’autonomie. Elles ont leurs points positifs comme négatifs, et les deux peuvent comporter un élément traumatisant pour la femme », explique la chercheuse. Il est donc crucial de pouvoir choisir. Mais dans certaines zones rurales, c’est souvent impossible. Pour Ariane, l’hôpital s’est imposé, car la Corrèze ne compte en tout et pour tout qu’un seul médecin de ville pratiquant des IVG médicamenteuses. Dans d’autres départements, c’est l’IVG chirurgicale qui n’est pas une option. « En théorie, on devrait avoir le choix, rappelle Justine Chaput. Mais le manque d’offre en zone rurale fait souvent que l’on se contente de ce que l’on trouve. »
Cela vaut également pour les praticiens. Ariane connaît le gynécologue qui exerce dans l’hôpital le plus proche de son domicile. Elle a déjà eu une mauvaise expérience avec lui. À tel point qu’elle serait prête à faire davantage de route pour avorter dans un autre établissement. Mais, faute de créneaux disponibles ailleurs et contrainte par le temps, elle n’a d’autre choix que de réaliser son IVG avec lui, « dans des conditions de jugement et de culpabilisation » qui laissent la jeune femme « traumatisée ». « Si ma grossesse et son interruption n’ont finalement duré que quelques semaines, il m’a fallu suivre une thérapie pour surmonter ce qui m’a été dit », conclut la jeune femme.
Là réside le problème, nous explique la chercheuse. Car une offre d’IVG satisfaisante implique de pouvoir avorter selon ses choix, sans obstacle et sans jugement. « Et en cela, la situation dans de nombreux territoires ne correspond pas aux standards auxquels nous pouvons prétendre. »
Zones blanches
Que ce soit dans le Massif central, dans l’Est, en Bretagne ou dans les Hauts-de-France, les déserts médicaux en sont les principaux responsables. Selon les conclusions d’un rapport réalisé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes en 2020, l’un des premiers facteurs d’inégalité d’accès à l’IVG est le manque de structures médicales en zone rurale. On estime que 70 centres d’IVG ont fermé en France métropolitaine entre 2007 et 2017. Les établissements privés se sont désengagés, par manque de rentabilité, et ne pratiquent plus que 5 % des IVG en 2020, contre un tiers en 2001. En conséquence, plus de 1,3 million de femmes de 15 à 50 ans vivent désormais à plus de trente minutes d’un établissement pratiquant l’avortement chirurgical. Entre les gynécologues qui font valoir leur clause de conscience et ceux qui ne pratiquent pas d’IVG au-delà de douze semaines malgré l’allongement du délai légal, on se retrouve avec des zones entières sans praticiens. Une situation d’autant plus critique que, d’après le rapport de l’Assemblée, une importante partie des gynécologues qui réalisent des avortements sont des militants de la première heure, et sont donc proches de la retraite.
En 2020, les sages-femmes ont prescrit un quart des IVG réalisées dans un cadre libéral
La situation n’est pas meilleure du côté de la médecine de ville, qui prend en charge environ un tiers des IVG en France. En 2018, 37 départements comptaient moins de cinq médecins pratiquant des avortements médicamenteux. La docteure Marion Pakey est l’une d’entre eux. Médecin généraliste dans une petite commune des Cévennes, elle et ses collègues sages-femmes sont les seules professionnelles à plus de cinquante kilomètres à la ronde à avoir sauté le pas. « Il faut savoir qu’un généraliste ne peut pas automatiquement réaliser des IVG », nous rappelle-t-elle. Il leur faut faire une formation spécifique, puis demander une convention à l’hôpital de secteur. « Ce n’est pas comme l’échographie ou l’électrocardiogramme, qui nécessitent simplement de se procurer la machine. Là, il doit y avoir une démarche proactive. » Pour la docteure Pakey, se conventionner était une évidence, l’IVG faisant à ses yeux « partie intégrante de la santé de la femme ». Mais, pour beaucoup d’autres généralistes, ce n’est pas une priorité. Car, au-delà de la démarche à réaliser, l’acte médical en lui-même n’est pas valorisé, comme le révèle le rapport de l’Assemblée, qui déplore une « faible considération » de l’IVG en raison de la simplicité technique du geste. « C’est pourquoi, si l’on n’est pas un peu sensibilisé ou un peu militant, il y a de grandes chances que l’on passe à côté », explique la docteure, appelant de ses vœux l’inclusion d’une formation à l’IVG dans le cursus des jeunes médecins.
Une pratique militante
Depuis 2016 cependant, un nouvel acteur est entré dans le paysage médical, qui aide à lutter contre ces « zones blanches » : les sages-femmes. Depuis sept ans, en effet, les sages-femmes libérales sont elles aussi autorisées à prescrire les IVG médicamenteuses. Relativement bien implantées dans les territoires ruraux et trois fois plus nombreuses que les gynécologues, elles ont prescrit en 2020 un quart des IVG réalisées dans un cadre libéral. Encouragé par ce succès, le ministère de la Santé vient même d’autoriser les sages-femmes à pratiquer l’IVG instrumentale. « L’effet de cette réforme s’est fait ressentir très rapidement », observe Nathalie Sage-Pranchère, historienne et spécialiste des professions de la santé. Elle rappelle qu’en 2009 une réforme avait élargi les compétences des sages-femmes au suivi gynécologique et à la prescription de contraceptifs. « Elles étaient donc déjà devenues des interlocutrices privilégiées pour les femmes, en particulier dans les zones rurales où la demande est très forte. » Amélie B. fait partie de ces sages-femmes libérales qui se sont immédiatement formées à l’IVG. Exerçant désormais dans une petite commune de Bretagne, elle est convaincue que le combat des femmes est aussi celui des sages-femmes. « Pour moi, on ne peut pas être sage-femme sans être, d’une certaine manière, militante et féministe. On reçoit toutes ces femmes avec leur histoire, leur intimité, leur parcours personnel, de violences, de violences médicales aussi, parfois. On est amenées à traiter les femmes dans leur globalité. Et pour beaucoup d’entre nous, l’IVG fait partie de la santé de la femme, il fait partie de ce tout. »
Dernier chaînon essentiel du maillage territorial, les plannings familiaux sont chargés d’accueillir les femmes, de les conseiller et de les rediriger vers les praticiens. Mais, dans les zones rurales, ils font en réalité bien plus. De la création d’annuaires recensant tous ceux qui pratiquent les IVG dans la région au « lobbying informel » auprès des médecins des environs pour les convaincre de se conventionner, c’est souvent aux militants des plannings qu’il incombe de trouver des solutions. Avec les moyens du bord. Au planning de Peyrelevade, créé par des militants dans une petite commune corrézienne de 800 habitants, David Lahoule se souvient d’une jeune femme enceinte depuis douze semaines et demie, qui lui a été envoyée par le centre de planification voisin. Son hôpital ne pouvait pas la prendre en charge, et l’avait redirigée vers Limoges, alors qu’elle ne pouvait pas se déplacer. « J’ai pris ma voiture, je suis allée la chercher chez elle à Tulle, et je l’ai conduite à Limoges moi-même pour la procédure, nous raconte-t-il. Il n’y avait pas d’autre solution. C’est cela aussi, notre militantisme. »
Dans le Morbihan, Mélanie Normandin, salariée du planning familial de Questembert et référente du numéro vert IVG pour la Bretagne, en profite pour faire de l’éducation et de la prévention. « Il y a encore un tabou. Nous essayons d’expliquer aux femmes que l’IVG est non seulement leur droit, mais aussi une part importante de leur santé sexuelle », dit-elle. « Et c’est d’autant plus important que l’on assiste à la montée en puissance de groupes anti-IVG très organisés qui font de la désinformation », alerte la jeune femme.
Alors que la proposition de loi pour inscrire le droit de recourir à l’IVG dans la Constitution française a été adoptée en première lecture par l’Assemblée et le Sénat, le combat continue pour que ce droit soit garanti, dans les faits, pour toutes les femmes et sur tout le territoire.
* Le prénom a été changé.
« #MeToo a rendu à la rue le combat contre les violences »
Bibia Pavard
L’historienne Bibia Pavard réinscrit #MeToo dans l’histoire du féminisme et montre comment ce mouvement fait encore bouger les lignes.
[Pionnières]
Robert Solé
Les premières journalistes françaises, au début des années 1830, n’étaient pas des bourgeoises ou des intellectuelles, mais des lingères, des couturières, des brodeuses, rappelle Robert Solé.
Dans les cités, un féminisme d’avenir ?
Manon Paulic
Notre journaliste Manon Paulic a interrogé des militantes de générations et de sensibilités diverses pour comprendre comment un féminisme inclusif et intersectionnel fait aujourd’hui entendre sa voix dans les quartiers populaires.