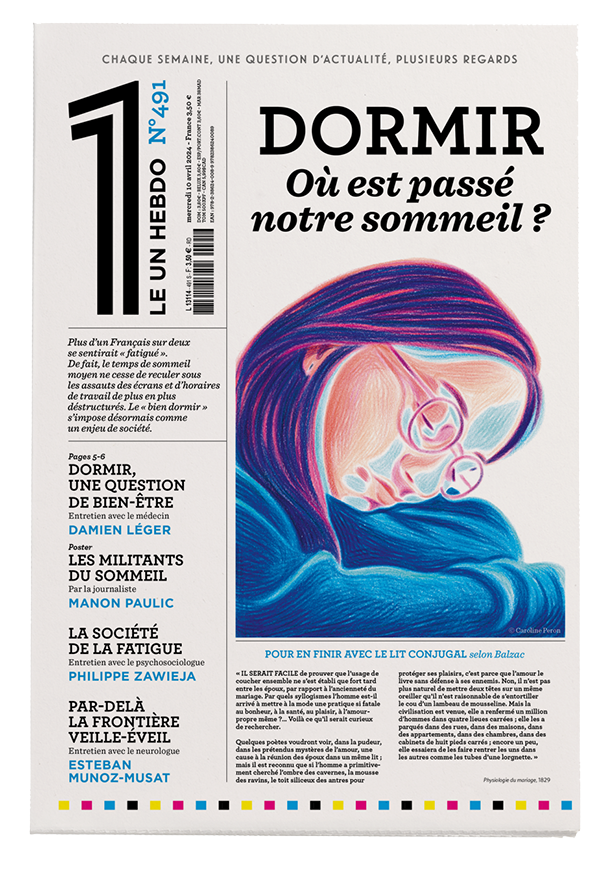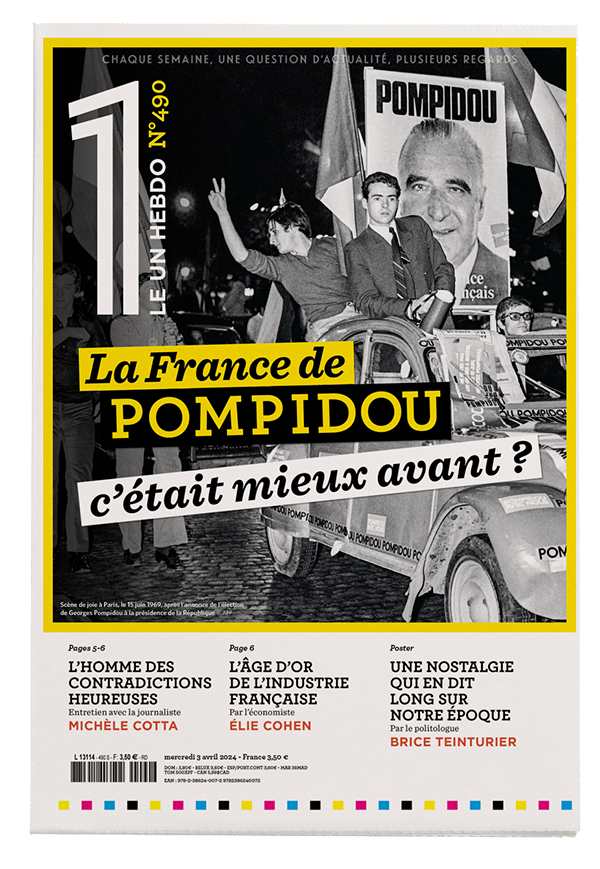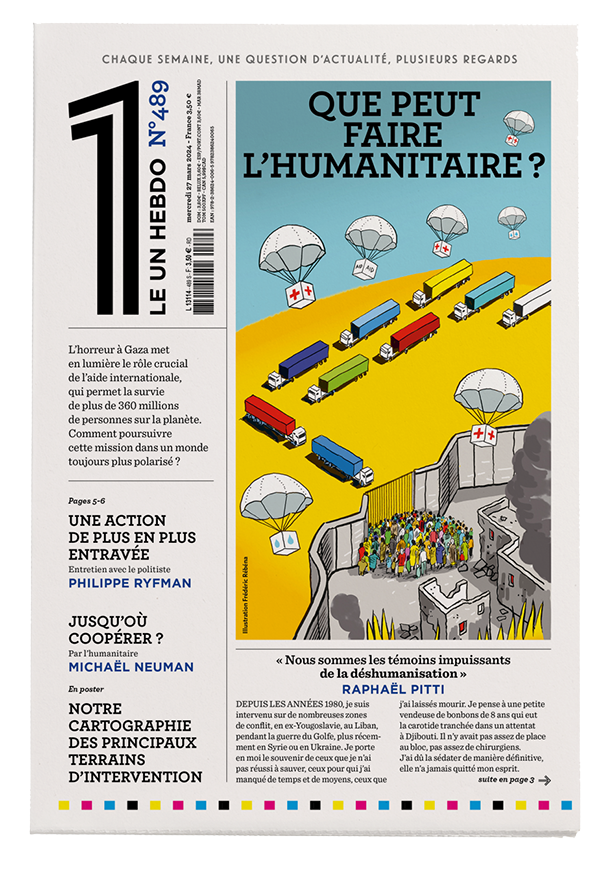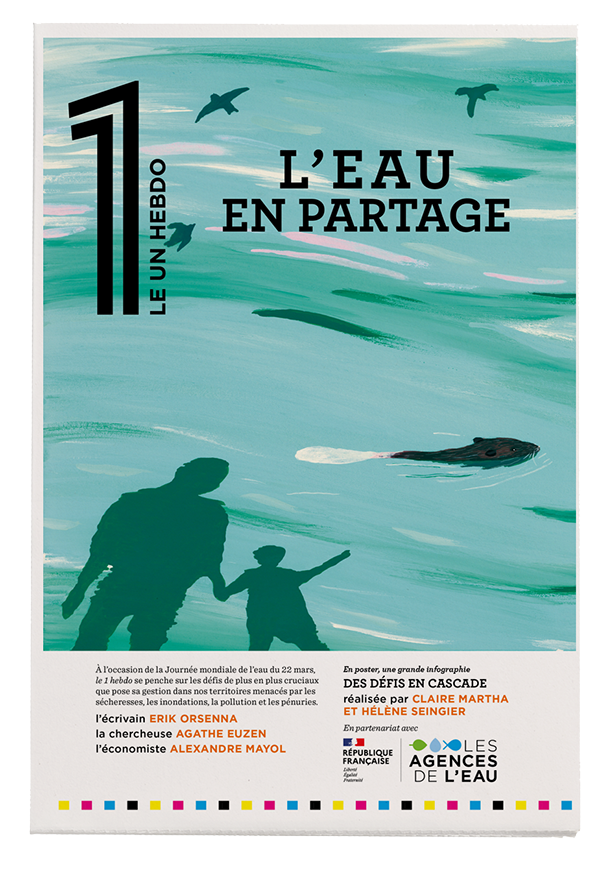Des prostituées chinoises en bande organisée
Temps de lecture : 7 minutes
C’est un féminisme fait de bric et de broc qui se construit sur le trottoir des rues de Belleville. Un réseau solidaire, tissé par les petites mains d’un groupe de femmes à la fois visibles et invisibles. Celles que l’on croise tous les jours, le long du boulevard de la Villette, sans jamais leur adresser la parole – à moins que l’on ne cherche à recourir à leurs services. Elles sont chinoises, parlent peu le français, et se prostituent à leur compte pour vivre dans la capitale française.
À Paris, les travailleuses du sexe chinoises vivent isolées. Elles ne connaissent souvent personne avant d’atterrir à Charles-de-Gaulle, ne sont pas coutumières de la langue et ont à l’esprit une image faussée du pays dans lequel elles vont tenter leur chance. Au pays, certaines ont cru aux louanges d’une France fantasmée, où l’argent et le travail couleraient à flots. Mais lorsqu’elles découvrent cette société française dans l’espoir de gagner suffisamment pour mettre de côté et améliorer les conditions de vie d’une famille laissée en Chine, elles se heurtent à une violente précarité. Elles sont seules, dans un pays inconnu. En situation irrégulière, qui plus est. Et sans papiers – tout juste ont-elles un visa touristique, acheté au prix fort à des « passeurs » chinois –, impossible de trouver un travail sur le marché de l’emploi formel. Mais il faut bien payer le loyer – souvent exorbitant, les appartements étant loués au noir –, vivre et subvenir aux besoins de la famille. D’où le recours à la prostitution. « Au moins, ça n’est pas illégal », fait valoir l’une d’entre elles. La nature de ce travail, de plus en plus concurrentiel, les pousse à l’isolement : il faut aller chercher les clients – ils se raréfient – toujours plus loin des autres consœurs. Quelques-unes s’organisent même des séjours en province où la concurrence est moins forte. Elles prennent plusieurs rendez-vous sur Internet, louent un Airbnb, reçoivent leurs clients et remontent sur la capitale quelques jours avant de repartir.
Elles dénoncent le harcèlement policier et la répression qui les visent
Marginalisées, les travailleuses du sexe chinoises pâtissent du stéréotype d’une communauté discrète, qui ne fait pas de vagues… jusqu’en 2014. Une lettre ouverte, signée par une centaine de femmes de la communauté, est alors adressée aux élus bellevillois (le quartier de Belleville est à la frontière de quatre arrondissements : le 10e, le 11e, le 19e et le 20e). Elles dénoncent le harcèlement policier et la répression qui les visent. Les « bleus » sont constamment sur leur dos : contrôles d’identité, interpellations, intimidations, placements en centre de rétention… Certains seraient allés jusqu’à apprendre à prononcer le mot « pute » en chinois dans le seul but d’injurier les femmes. Beaucoup d’entre elles craignent de se faire arrêter et expulser en allant faire leurs courses. Elles n’osent plus sortir dans leur propre quartier.
La lettre fait son effet auprès d’un adjoint au maire du 10e arrondissement. Stéphane Bribard reçoit alors une délégation de travailleuses du sexe chinoises, accompagnée de membres de l’équipe du Lotus Bus, un programme de Médecins du monde spécialisé dans le suivi de ce public. Il écoute leurs doléances. À la fin du rendez-vous, l’élu souffle une idée aux Chinoises : pourquoi ne pas former une association pour défendre leurs droits ? Les Roses d’Acier naissent ainsi quelques mois plus tard. Rapidement, cette petite communauté qui alimente les fantasmes les plus fous se retrouve sous le feu des projecteurs. Elle tente de se faire sa place dans le débat public. Les Roses d’Acier – elles ont choisi ce nom en référence à une chanson populaire chinoise – manifestent, sont auditionnées, interviewées… Les travailleuses du sexe chinoises de Paris ont enfin voix au chapitre.
Les Roses d’Acier multiplient aussi les actions dans le quartier de Belleville, espérant se faire mieux accepter des riverains
On se rappelle notamment la première fois qu’elles ont battu le pavé. C’était en décembre 2015. Le visage caché par des masques blancs, elles ont suivi le tracé de la ligne 2 du métro, de Belleville jusqu’à Jaurès, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire en français comme en chinois : « Pour nos droits, contre la violence ». Quelques jours plus tard, le quotidien Libération leur consacrait un long article dans lequel plusieurs de ces femmes se livraient sur leur parcours. Le reportage revenait sur cette première sortie en public : « L’association a réuni une centaine de femmes masquées, un flambeau à la main. Au niveau de la station Jaurès, les migrants qui traînent sous le métro aérien ont rigolé d’étonnement et, à Barbès, une foule d’hommes les a sifflées. Le lendemain, la presse des Chinois de Paris les couvrait d’insultes. »
Les Roses d’Acier multiplient aussi les actions dans le quartier de Belleville, espérant se faire mieux accepter des riverains. Certains leur sont carrément hostiles. Ils n’hésitent pas à l’afficher lors des conseils de quartier. En mai 2015, les femmes de l’association balaient les rues, masquées – la préservation de leur anonymat, du fait de leur activité, est impérative. Pendant ce temps, Aying, la présidente, prononce un discours adressé aux passants. « Nous vivons ici. Nous rions ici, nous pleurons ici, nous travaillons ici, nous faisons nos courses ici et prenons le soleil ici. […] Nous voulons montrer que nous faisons partie de ce voisinage. C’est quoi une “belle ville” ? On nous dit qu’à cause de nous, Belleville n’est plus belle, parce que nous sommes laides, sales, ignobles. Mais qui sont-ils pour nous juger ? Sont-ils plus beaux que nous ? Plus propres, plus nobles ? »
De petits appareils pour donner l’alerte en cas d’agression
Ces actions publiques n’ont pas l’effet escompté. Les contrôles de police continuent. Les pressions des habitants du coin, aussi. Et puis, la proposition de loi sur la pénalisation des clients menace. Le texte prévoit de remplacer le délit de racolage, dont les prostituées se rendent coupables en hameçonnant des clients dans la rue, par une amende destinée aux clients. Les associations de défense des droits des travailleuses du sexe alertent sur une future dégradation de leurs conditions de travail. Les Roses d’Acier en font partie. Elles sont reçues au Sénat et à l’Assemblée nationale pour faire entendre leur point de vue. Le texte est pourtant voté en avril 2016. Une défaite au goût amer pour elles qui s’étaient tant mobilisées. Une personne de l’association, lassée de voir son parcours étalé dans les journaux, fait un burn out. Les Roses d’Acier décident alors de quitter la lumière de l’exposition publique. De retourner dans l’ombre de la communauté, recentrer leurs actions autour de ses besoins. Fini les interviews, les manifestations, les auditions…
Les Roses d’Acier œuvrent donc depuis plus de huit ans à la défense des droits de leurs jiemei – sœurs. Elles sont près de 190 à avoir rejoint l’association, active à Belleville, principalement, mais aussi dans le 12e arrondissement et dans le 13e, où les travailleuses du sexe chinoises sont bien implantées. En Île-de-France, Médecins du monde, par le truchement du Lotus Bus, estime à 900, voire 1 000, le nombre de travailleuses du sexe chinoises. Ce nombre n’est pas exhaustif ; il ne chiffre que la file active du programme, c’est-à-dire les femmes avec lesquelles le Lotus Bus est en contact.
Fin 2019, les Roses d’Acier ressurgissent timidement. Cette année-là, les violences ciblant la communauté ont flambé. Au point où trois consœurs sont assassinées. L’association décide alors de prendre le problème à bras-le-corps. Avec ses modestes moyens, elle organise un financement participatif dans le but d’équiper ses adhérentes d’alarmes personnelles. De petits appareils permettant d’alerter un contact en cas d’agression. L’opération est un succès : 100 alarmes sont ainsi achetées et distribuées.
L’argent récolté permet d’alimenter une cagnotte à destination de celles dont la maladie a entraîné une incapacité de travail
Aujourd’hui, les Roses d’Acier se retrouvent dans un petit local associatif de Belleville, à quelques pas des Buttes-Chaumont. Des permanences sont organisées ici deux fois par semaine. Toutes les femmes de la communauté peuvent passer papoter autour d’un thé, d’un café ou de sucreries. Ce temps d’échange leur permet de se raconter leurs tracas, et les membres les plus expérimentées s’occupent de rediriger celles dont la situation nécessite une prise en charge : en cas d’agression ou de maladie, par exemple.
Au local se tient un atelier de tricot, où Hegui – la doyenne de l’association – apprend à ses consœurs à broder des fleurs en fil de laine coloré. Celles-ci sont ensuite cousues sur des sacs mis en vente sur Internet ou lors d’événements autour du travail du sexe. L’argent récolté permet d’alimenter une cagnotte à destination de celles dont la maladie a entraîné une incapacité de travail de trois semaines ou plus. Ce fonds « U-Care » a été créé en 2021 en réponse au nombre croissant de femmes de la communauté atteintes d’un cancer de l’utérus. Les travailleuses du sexe n’ayant pas accès aux congés payés, le pécule distribué par les Roses d’Acier leur permet d’amortir les dépenses pendant la période de convalescence où elles ne peuvent plus toucher d’argent. Un bel exemple de cette solidarité intracommunautaire qui est devenue le credo des Roses d’Acier.
« #MeToo a rendu à la rue le combat contre les violences »
Bibia Pavard
L’historienne Bibia Pavard réinscrit #MeToo dans l’histoire du féminisme et montre comment ce mouvement fait encore bouger les lignes.
[Pionnières]
Robert Solé
Les premières journalistes françaises, au début des années 1830, n’étaient pas des bourgeoises ou des intellectuelles, mais des lingères, des couturières, des brodeuses, rappelle Robert Solé.
Dans les cités, un féminisme d’avenir ?
Manon Paulic
Notre journaliste Manon Paulic a interrogé des militantes de générations et de sensibilités diverses pour comprendre comment un féminisme inclusif et intersectionnel fait aujourd’hui entendre sa voix dans les quartiers populaires.