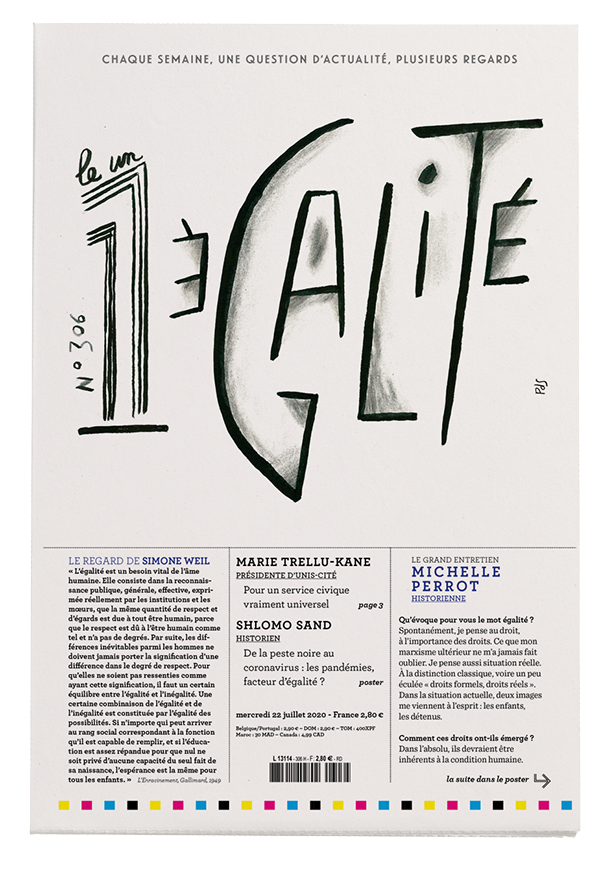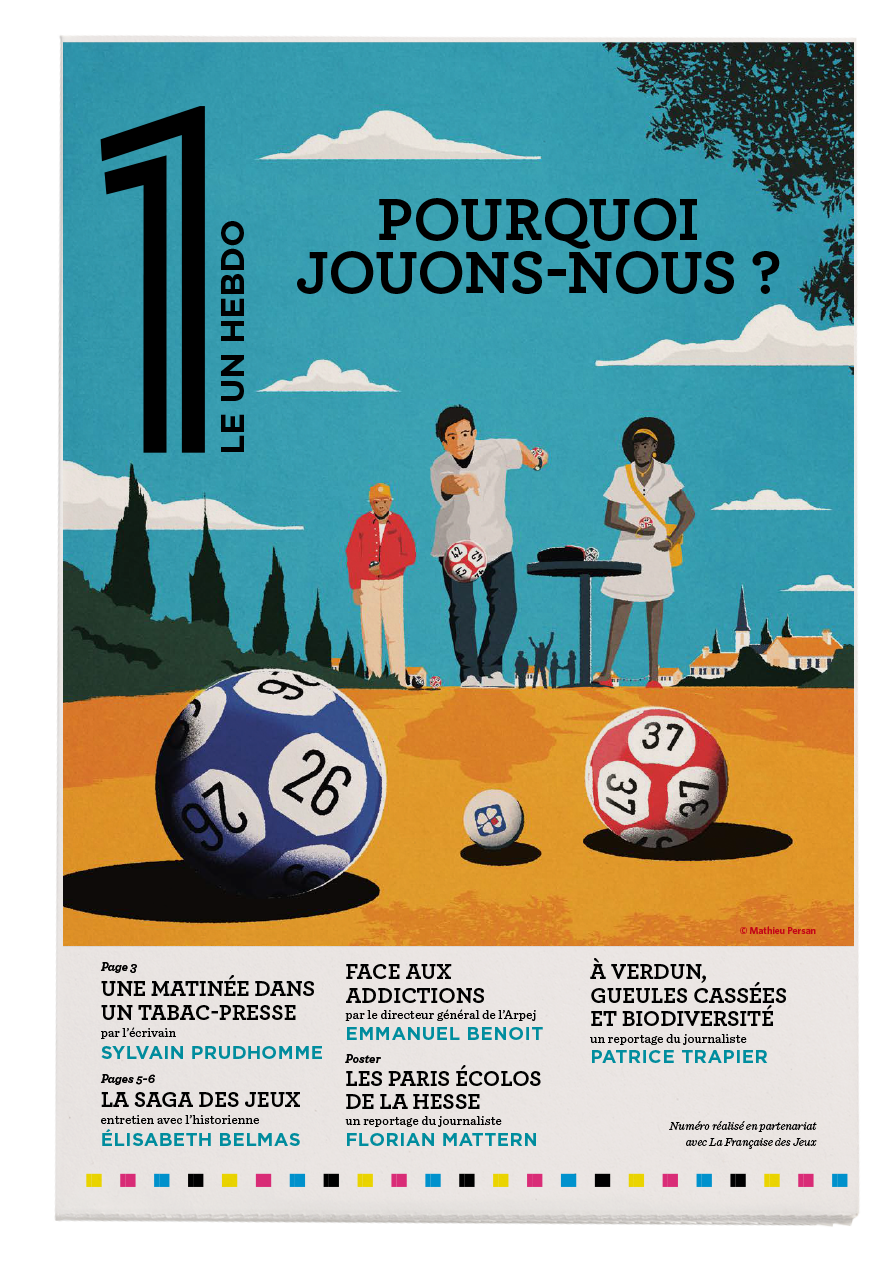Réflexions sur l’égalité de la peste noire au coronavirus
Temps de lecture : 8 minutes
Des trois termes étendards de la Grande Révolution : « Liberté, Égalité, Fraternité », l’égalité apparaît comme le plus moderne. Avant la révolte des puritains dans l’Angleterre du XVIIe siècle, l’aspiration à l’égalité n’avait jamais été formellement exprimée par les couches inférieures de la société. La revendication de la « liberté » figure déjà dans le mythe biblique de la sortie d’Égypte, et dans les révoltes d’esclaves à Rome, et l’on peut voir dans la « fraternité » une version moderne de la miséricorde et de la grâce chrétiennes, tandis que le concept d’égalité est apparu dans l’imaginaire humain il y a seulement un peu plus de trois cents ans. Aristote a certes traité de l’égalité, mais il ne s’agissait que de l’égalité entre égaux : autrement dit, de l’égalité entre des hommes propriétaires d’esclaves, et non pas de tout le genre humain. C’est aussi l’occasion de rappeler que non seulement la philosophie grecque, mais aussi les trois religions monothéistes, judaïsme, chrétienté et islam, ne se sont jamais opposées à l’esclavage.
Comment l’égalité est-elle née à l’orée de l’ère moderne ? On peut pointer un ensemble de circonstances : liée à l’amélioration significative des techniques de culture de la terre et à l’introduction de nouveaux dispositifs de production, l’augmentation de la productivité agricole a permis une nouvelle répartition du travail, avec une parcellisation accrue, qui s’est accompagnée d’une mobilité sociale sans précédent. Beaucoup de gens ont vu leur statut et leur situation évoluer considérablement, évidemment pas toujours pour le mieux. Il en est résulté de nouveaux états d’esprit, totalement inconnus des sociétés agricoles traditionnelles dans le reste du monde.
Il faut souligner que l’ordre féodal ne s’est pas désintégré sous le coup de révolutions. La déstabilisation des relations de dépendance et de protection a préparé le terrain pour une série de soulèvements et de révoltes populaires. La détérioration des dispositifs d’allégeance et de vassalité féodales, tout comme le recul du servage, avec la croissance des cités, le développement du capitalisme commercial, la constitution de couches nouvelles d’artisans, ont contribué à transformer totalement la morphologie des rapports de force socio-économiques, et, par là même, la mentalité et la sensibilité des humains envers leurs congénères, vivant et travaillant à leurs côtés ou face à eux.
Pour beaucoup, l’identité, qui toujours se construit face aux autres, a connu des transformations décisives qui ont hâté le bouillonnement du malaise. Et si, durant des siècles, la stratification sociale du monde agraire semblait éternelle, la nouvelle configuration plus fluide, qui commençait à s’établir a pu paraître moins normale et beaucoup moins légitime. La période d’instabilité sociale, avec les premières fissures dans les convictions religieuses, qui jusqu’alors avaient corseté l’ordre hiérarchique considéré comme naturel, a indirectement contribué à créer un regard comparatif d’où a jailli le sentiment d’inégalité, qui n’a pas cessé de se manifester dans toute la dynamique des rapports sociaux de l’ère moderne.
Jean-Jacques Rousseau et, par la suite, Alexis de Tocqueville furent les deux seuls penseurs à avoir bien compris que l’aspiration à l’égalité n’a rien de « naturel », mais qu’elle trouve son origine dans la mobilité sociale. C’est ainsi que Rousseau et Tocqueville s’avérèrent meilleurs psychologues que, par exemple, Marx et Nietzsche, plutôt myopes quant au poids de l’identité de groupe dans l’apparition des tensions sociales. Rousseau et Tocqueville ont compris que se comparer à l’autre recèle le potentiel du changement à venir. L’un s’en est réjoui, toute sa vie durant ; l’autre y a vu un motif d’inquiétude.
Tous les deux ont peut-être ignoré que le processus historique de recul du servage a été accéléré par une épidémie. Beaucoup a déjà été écrit sur le rôle de la peste noire dans le changement des rapports de production féodaux. La peste, qui s’est étendue au XIVe siècle sur presque toute l’Europe, a exterminé près d’un tiers de sa population. Venue d’Asie, elle a traversé la presqu’île de Crimée pour atteindre les cités méditerranéennes. De là, elle a migré vers le nord, et, traversant la France et les Pays-Bas, elle a atteint les îles britanniques.
L’épidémie mortelle a paralysé le commerce, réduit l’agriculture et fait reculer l’artisanat. Les besoins en main-d’œuvre des aristocrates propriétaires terriens n’ont cessé de croître, mais les champs sont restés en jachère, tandis que les prix du blé et de l’orge ont doublé jusqu’à l’année 1350. La peste noire a causé une terrible famine, une énorme mortalité, une déferlante de haine et de peur des étrangers (dont les Juifs), et a provoqué une hécatombe parmi les riches et les pauvres, les vieillards et les nouveau-nés. Cependant, un autre phénomène important s’est produit : nombre de serfs ont osé quitter leurs terres, pour partir travailler vers d’autres lieux éloignés, et, ce qui n’est pas sans importance dans l’histoire : ils sont devenus des paysans ou des artisans libres. Ce processus n’a pas touché toute l’Europe ; beaucoup de serfs sont demeurés sur leur site habituel. En fin de compte, l’épidémie n’a pas modifié la direction du développement, elle n’a fait que l’accélérer.
Lors des révoltes paysannes de l’époque et aussitôt après, diverses revendications économiques furent formulées. Toutefois, l’exigence de l’égalité politique ou juridique, et a fortiori sociale, n’a pas percé. Comme dit précédemment, c’est dans la frange radicale de l’insurrection puritaine, au milieu du xviie siècle, notamment parmi les « niveleurs », qu’est apparue explicitement, pour la première fois dans l’histoire, la revendication d’égalité devant la loi, et pour le choix du souverain. Les philosophes du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau en tête, formulèrent dans leurs écrits l’idée qui, lors de la Grande Révolution, deviendra l’un des principes fondamentaux de la République, voire du monde entier, et sera accolée à la Liberté et à la Fraternité.
D’autres épidémies frappèrent la société humaine, mais aucune ne marqua l’histoire (de l’Occident) à l’instar de la peste noire. Et voici qu’en 2020 est arrivé le coronavirus. Personne, au début, n’a soupçonné qu’il parviendrait effectivement à ébranler la civilisation actuelle. L’assurance face à la nature avait certes fléchi du fait d’inquiétants signaux d’alerte écologique, mais, à l’exception de cercles marginaux, la majorité de l’humanité ne se souciait guère des rapports « harmonieux » de l’homme avec la planète sur laquelle il est né et sur laquelle il vit. Lorsque des fusées satellites, lancées il y a quelques décennies, photographièrent de loin notre petite planète, la majorité de l’humanité s’est persuadée que l’harmonie régnait et régnerait éternellement sur la Terre.
Il est trop tôt pour juger si la crise du Covid-19 est uniquement sanitaire et économique, ou s’il s’agit aussi d’un séisme politique, culturel, et peut-être même de civilisation. Il est tout aussi difficile d’évaluer, à ce stade, quel sera l’impact sur la situation et la progression de l’égalité dans le monde. Lorsque la pandémie s’est déclarée, les inégalités de revenus et, par conséquent, d’opportunités étaient déjà paroxystiques. Si l’on en croit nombre d’historiens, les épidémies, tout comme les révolutions et les guerres, par-delà leur coût humain terrible, ont, en règle générale, contribué à réduire les inégalités économiques. De nos jours, toutefois, les conséquences de l’actuelle pandémie ne laissent entrevoir ni une quelconque remise en cause de la puissante domination du capital sur le travail, ni une diminution des profits des banques, et encore moins une réduction des écarts socio-économiques.
Ce qui se manifeste d’ores et déjà sous nos yeux est l’inégalité sur le plan sanitaire ! En divers endroits, les conditions de vie des différentes classes sociales ont pesé très directement sur le fait de contracter la maladie. L’absence de système développé d’assurance maladie dans de nombreux pays, et notamment dans le plus riche d’entre eux, les États-Unis, a voué beaucoup d’habitants à la mort. En 1966, deux ans avant d’être assassiné, Martin Luther King déclarait : « De toutes les formes d’inégalité, l’injustice dans la prise en charge des soins de santé est la plus choquante et la plus inhumaine. » Cela est encore valable aujourd’hui, et le sera peut-être encore plus demain si la société humaine venait à subir de nouvelles épidémies.
A-t-on vu se lever des mouvements pour l’égalité médicale ? Pour le renforcement de l’État providence et l’extension des services publics ? Pour un revenu de base universel afin que personne ne meure de faim à la suite d’une catastrophe ? De telles revendications, pour le moment, n’existent qu’aux marges politiques. Et si la recherche médicale pour un vaccin a bien pris une dimension globale, la sensibilité politique immédiate dégage, en revanche, davantage de fortes émanations paranoïaques que d’expressions de fraternité universelle. Dans le passé, lors d’épidémies dont on ignorait le facteur disséminant, les étrangers étaient pointés comme les coupables. Aujourd’hui, malgré le progrès des connaissances scientifiques, on constate une tendance similaire : le président des États-Unis désigne les Chinois comme responsables de la dissémination du virus ; en France, des personnalités d’extrême droite voient les immigrés comme les principaux porteurs de la contamination ; en Inde, on accuse les musulmans et, au Brésil, les indigènes.
Naturellement, tout le monde est pour l’égalité ! Mais, pour en revenir à la formule d’Aristote : « une égalité seulement entre égaux ». Une égalité des Français entre eux, des Américains entre eux, des Hongrois entre eux, et, en tant qu’Israélien je me dois de le souligner : une égalité des Juifs entre eux, dans un État juif, dont 25 % des citoyens ne sont pas considérés comme juifs.
Traduit de l’hébreu par MICHEL BILIS
« L’égalité est un but, un chemin, une bataille »
Michelle Perrot
À la lumière de son parcours d’historienne de la condition ouvrière et féminine, Michelle Perrot évoque le combat toujours en cours pour l’égalité entre les individus, quels que soient leur classe, leur sexe et leur couleur de peau, sans faire l’impasse sur les difficultés et les ambiguïtés de ce…
[Blanc]
Robert Solé
Faut-il l’attribuer aux hasards de l’histoire ou à la passion des Français pour la symétrie ? Toujours est-il qu’après de nombreuses péripéties, la République a fini par se donner deux emblèmes, sous forme de triades, que l’on croirait sorties du même moule : d’un côté, lib…
Réflexions sur l’égalité de la peste noire au coronavirus
Shlomo Sand
L’historien israélien Shlomo Sand retrace l’élargissement de la revendication d’égalité d’Aristote à nos jours, en insistant sur le rôle des épidémies.