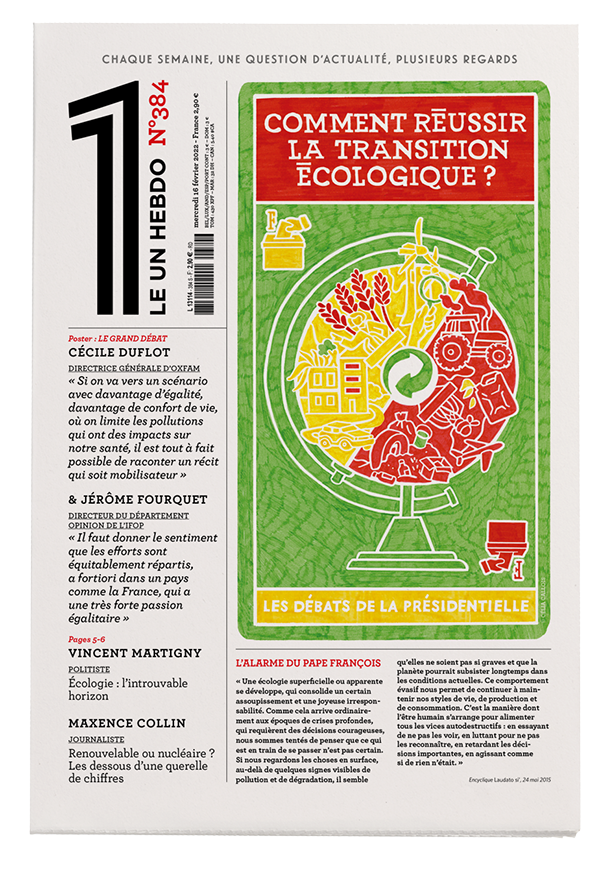Une société écolo est-elle possible ?
Temps de lecture : 30 minutes
Le thème de la transition écologique peine à s’imposer dans cette campagne présidentielle. Pourquoi un tel désintérêt ?
Jérôme Fourquet : La prise de conscience de l’urgence climatique et l’intérêt à son égard sont toujours bien présents dans la société française et dans l’opinion publique. Néanmoins, ces thématiques ne parviennent pas, pour l’instant, à franchir une espèce de mur du son, pour plusieurs raisons. La première, c’est que toute une partie de l’opinion, même si elle est sensibilisée à ces questions, considère qu’il reste encore un peu de temps et que, dans l’échelle des urgences, celle-ci marque le pas face à la question du pouvoir d’achat, de l’identité ou de la sécurité. Il y a peut-être également un problème de portage politique, avec un candidat écologiste qui est englué dans la bataille pour le leadership à gauche et qui ne bénéficie pas d’une véritable dynamique. Ces dernières semaines, chaque fois que Yannick Jadot était invité dans une émission ou sur un plateau, on ne l’interrogeait pas d’emblée sur l’urgence climatique, mais sur son éventuel désistement. Ce n’est pas de nature à faire émerger la thématique.
Cécile Duflot : Soyons clairs : techniquement, nous n’avons déjà plus le temps. On sait qu’on n’évitera pas un réchauffement global d’au moins 1,5 degré, voire davantage, par rapport à la période préindustrielle. Et au-delà de 2 degrés, les scientifiques ne sont pas en mesure de déterminer exactement l’ensemble des impacts que cela peut avoir, car il y aura des effets d’emballement, des boucles de rétroaction, une fois que certains équilibres naturels seront rompus. La question devrait donc s’imposer aux futurs dirigeants politiques ! Ça n’enlève rien à ce que dit Jérôme Fourquet sur la situation conjoncturelle du candidat de l’écologie politique, mais je crois qu’il existe aussi une vraie stratégie d’évitement. Pour plusieurs raisons.
D’abord, si l’on veut expliquer les politiques à mener, il faut d’abord expliquer la gravité de l’enjeu. Or, les politiques sont dans un discours de réassurance : « Avec moi, vous êtes protégés. » Et c’est plus facile de dire : « Je vais vous protéger des musulmans, des délinquants ou des terroristes » que de dire : « Je vais vous protéger du dérèglement climatique. » Deuxième point : un certain nombre de mesures à instaurer pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre font plutôt l’objet d’un consensus – isoler les logements, faciliter la réparation des objets, diminuer le gaspillage de façon générale. Or, c’est le clivage qui fait l’intérêt d’une proposition avant une élection. Le troisième élément, enfin, c’est que les retombées d’une bifurcation écologique ne seront pas directement appréciables. D’un point de vue temporel, les bénéfices des décisions à prendre sont à attendre au-delà de l’échéance du mandat des gouvernants, ce qui n’est pas des plus motivants. Et le problème est également spatial, puisque même si la France était exemplaire, ça ne voudrait pas dire qu’elle ne subirait pas les conséquences du dérèglement. Tout cela explique cette situation absurde. Je pense néanmoins que les adultes de demain, lorsqu’ils reliront les débats actuels sur la blouse à l’école, ou sur les immigrés dans les logements sociaux, se diront que c’était totalement lunaire : il y avait un éléphant dans le couloir, et on débattait à propos des fourmis.
A-t-on évacué ce débat lors de la Convention citoyenne pour le climat ?
Cécile Duflot : Pour moi, cette Convention est l’un des apports les plus intéressants du quinquennat Macron, dont le bilan écologique reste très faible. Elle a montré que des citoyens très divers, s’ils sont correctement informés, en viennent à promouvoir le projet écologiste le plus traditionnel, voire le plus radical – avec l’interdiction des trajets courts en avion, l’interdiction de la publicité pour les objets les plus polluants, etc. Cela a aussi permis d’imaginer qu’on puisse s’appuyer sur des porte-parole qui ne soient pas forcément des élus. Si un concessionnaire automobile est convaincu qu’il faut limiter ou interdire l’utilisation des SUV, ça a une portée bien plus forte que si ça vient du monde politique.

Jérôme Fourquet : Emmanuel Macron avait promis de reprendre telles quelles les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, à trois jokers près. Pourtant, pas grand-chose n’a été mis en œuvre. Cela n’aide pas les Français à aller de l’avant sur ce sujet. Beaucoup, pourtant, ont compris que l’affaire est sérieuse ; beaucoup constatent, de manière très empirique, que le climat change : dans les territoires viticoles, par exemple, les vendanges commencent un mois plus tôt qu’auparavant ! Mais, quand une initiative comme la Convention pour le climat accouche d’une souris, cela douche les ardeurs de la population et la conforte dans une forme d’inertie. Je pense qu’il y a, de manière plus ou moins inconsciente, un certain nombre de verrous psychologiques dans une partie de la population, qui se trouve un peu tétanisée face à l’ampleur de cette menace. Ce qui doit être mis en branle pour essayer d’éviter ce choc majeur du dérèglement climatique relève quand même d’un changement majeur de mode de vie, d’un changement de société. Une partie de la population fait l’autruche. Dans certaines enquêtes, les gens nous disent : « Oui, c’est grave », et pourtant les candidats qui promeuvent des solutions ne sont pas forcément les plus entendus.
Quelles sont les mesures urgentes à prendre aujourd’hui pour mener cette transition écologique ?
Cécile Duflot : Évacuons tout d’abord la question financière, désormais secondaire : le coût estimé de la catastrophe climatique est bien supérieur à l’investissement nécessaire pour essayer de la freiner. Donc, même en réfléchissant à la façon de Bercy, on a intérêt à investir dans la transition, car ce sera toujours moins cher que de laisser faire. C’est un peu comme de ne pas constituer de stocks de masques avant une pandémie : quelles « économies » cela a-t-il permis de faire ?
« Investir dans la transition sera moins cher que de laisser faire »
Une fois ce point tranché, on passe à la question du mode de vie. Et pour moi il y a trois chantiers majeurs à lancer. Le premier, la rénovation des bâtiments, ne devrait pas rencontrer trop d’opposition : vivre dans un logement mieux isolé, vous permet de dépenser moins d’énergie pour vous chauffer ; c’est plutôt de nature à améliorer votre confort. Le deuxième, la transition de notre modèle agricole, peut également se révéler assez consensuel : avoir une nourriture qui vient de moins loin, qui repose moins sur les cultures intensives, c’est une amélioration de votre qualité de vie. Reste la question des transports, qui est épineuse pour deux raisons. Déjà, les distances se sont rallongées, en raison de la société de l’automobile – laquelle n’aura duré, à l’échelle de l’histoire de l’humanité, que très peu de temps. Beaucoup de gens sont obligés de prendre leur voiture, même pour aller acheter du pain ! Par ailleurs, passer son permis et avoir sa voiture restent fortement associés à une forme de liberté individuelle, au point qu’il est impossible de penser notre société sans cette logique de transport extrêmement fluide et facile.
Comment, alors, faire évoluer les choses ?
Cécile Duflot : À travers la hausse manifeste des dépenses contraintes, liées notamment au logement, et l’augmentation du prix de l’essence en raison de l’épuisement des ressources fossiles, les gens voient bien que ce mode de fonctionnement ne va pas tenir très longtemps. Donc que fait-on ? Quel chemin propose-t-on pour aller vers un monde qui fonctionne différemment, et quelles étapes suivre ? Il est absolument fondamental que le monde politique puisse répondre à ces questions. Admettons que je renonce à ma voiture. Comment vais-je aller acheter des meubles ? Déménager mon fils ? On raisonne en termes de réseau de transport, d’infrastructures, d’investissements, y compris dans le discours des écologistes, mais les projections abordent très peu tous ces détails du quotidien – même lorsqu’on s’éloigne du cadre des grandes métropoles, très bien desservies en transports en commun. Assener qu’il faut rouler en vélo-cargo quand vous êtes à Die, dans la Drôme, ça n’a pas de sens. En revanche, il existe dans ce territoire un service de taxi à la demande, financé par le département, qui, pour le prix du bus, vous emmène où vous voulez depuis la gare. Si vous pouvez prouver aux gens qu’il y a une solution sans voiture, ce n’est plus la même histoire.
Jérôme Fourquet : La Drôme est un cas très intéressant, car à quelques dizaines de kilomètres d’écart, nous avons deux modes de vie, deux visions de la société qui s’opposent. Il y a toute cette région très rurale du Diois, qu’on appelle la Biovallée, où les écologistes font de bons scores et qui s’est engagée collectivement dans la transition écologique. Un nombre significatif des emplois relève de l’économie sociale et solidaire, la proportion de la surface agricole utile en bio est très importante, de même que la part de néoruraux – qui vont des premiers soixante-huitards aux adeptes de Pablo Servigne et de la collapsologie. Et, à quelques kilomètres de là, dans la partie du département qui correspond à la vallée du Rhône, on est encore dans ce qu’on pourrait appeler la France d’avant : un territoire avec des infrastructures autoroutières très importantes, des installations nucléaires, beaucoup de zones périurbaines, pavillonnaires, commerciales, un entrepôt Amazon, et qui a été très marqué par la crise des Gilets jaunes. On est dans cette France qu’évoque Pablo Servigne lorsqu’il parle de son enfance : le triptyque « télé, bagnole, Nutella » – c’est un peu réducteur, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Cette partie de la Drôme et toute une partie de la France vivent encore dans ce triptyque-là.

Quand la ministre du Logement actuelle, Emmanuelle Wargon, a indiqué que le modèle du pavillon avec jardin non mitoyen n’était pas soutenable et menait à une impasse, ça pouvait se comprendre d’un point de vue écologique. Mais ça a entraîné une levée de boucliers immédiate, car ce que nous avons appelé dans La France sous nos yeux « l’idéal Plaza majoritaire », en hommage à l’agent immobilier le plus célèbre de France, est un modèle qui fait rêver 75 % de nos concitoyens. Et ce rêve a encore été conforté par la pandémie et l’exode urbain qu’elle a provoqué. La ministre était même en retard d’une guerre en parlant de maison avec jardin : dans de très nombreux territoires, dans le Sud mais pas seulement, il faut ajouter la piscine au package – et le changement climatique joue un rôle dans ce phénomène. La France compte trois millions de piscines individuelles, ce qui la place au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis. La crise du Covid a certes joué comme un révélateur de l’urgence écologique, mais un des éléments de réponse a consisté à renforcer son cocon individuel, avec des pratiques qui ne vont pas dans le sens de l’écologie. On est là face à des choix de vie et de société qui sont extrêmement compliqués.
« Quand une initiative comme la Convention pour le climat accouche d’une souris, cela douche les ardeurs »
Cécile Duflot : Je fais partie de ceux qui défendent la densité confortable, qui n’est pas forcément une densité urbaine. Les villes qui ont la cote, aujourd’hui, ce sont les toutes petites villes, avec une supérette, un petit cinéma, des commerces de proximité, un endroit où l’on peut se faire livrer des colis, une école où l’on peut se rendre à pied et un collège pas trop loin. Cette maison avec jardin qu’évoquait Emmanuelle Wargon peut se trouver à l’extrémité de Marne-la-Vallée, ville symbolique de l’étalement urbain, où tout doit se faire en voiture, mais elle peut aussi bien être à Labouheyre, petit bourg des Landes de 2 700 habitants. Ce n’est pas du tout la même chose. Le modèle du bourg traditionnel, qui a été complètement abandonné, est en fait très résilient et tout à fait soutenable écologiquement. On crispe les débats sur ces sujets-là alors qu’il y a énormément de choses à imaginer : de la même manière qu’on va à Kiloutou louer la machine à barbe à papa pour le baptême du petit dernier, on pourrait avoir un parc de voitures à moins d’un quart d’heure du centre-bourg où l’on irait emprunter un véhicule quand on en a besoin. Il faut penser en termes de changement d’usages. Est-ce que le bon modèle, c’est la voiture individuelle mais électrique ? Les écologistes et les scientifiques disent que ce n’est pas soutenable. Si l’avenir est aux transports en commun, est-ce qu’on est sûr de pouvoir être transporté depuis n’importe quelle gare jusqu’à n’importe quel point du territoire français ? Est-ce que le prix du train est suffisamment bas pour ne pas me donner envie de prendre l’avion à la place ?
Pensons maintenant à l’accès aux services publics : puisqu’une bataille politique a été menée pour sauver tous les bureaux de poste, pourquoi ne pas faire sauter les barrières, qui sont essentiellement administratives, et les transformer en « maisons des services publics » ? Si vous n’avez plus besoin de prendre votre voiture pour aller à Pôle emploi, parce que Pôle emploi c’est à côté de la mairie, ça change complètement la donne !
Jérôme Fourquet : C’est assez séduisant, mais il y a quand même la question des trajets domicile-travail. Parmi les gens qui vont habiter dans ces bourgs, tous n’auront pas un emploi sur place ou qui se prête au télétravail. Bien sûr, on peut envisager des systèmes de navette, d’autopartage, de covoiturage – ce qui se pratique déjà dans certains territoires –, mais cette question de la mobilité individuelle demeure quand même un vrai défi dans les territoires non densément peuplés.
Cécile Duflot : En étant attentif, on se rend compte que, souvent, des solutions existent déjà. Prenons la marque de vêtements 1083, qui s’est installée dans une ancienne usine de chaussures : ce site est desservi par le rail. Et c’est le cas de quasi toutes les friches commerciales ou industrielles. Le réseau n’est souvent plus utilisé, tout part en camion, mais on peut très bien imaginer des navettes en train entre des lieux d’habitation et des lieux de travail. On bride trop notre réflexion ! Et cela vaut aussi pour les écologistes. On doit réfléchir à ce qu’on fait avec ce qu’on a aujourd’hui, pas à ce qu’on aurait fait si on n’avait pas bâti une société comme ceci ou comme cela. Il faut sortir de notre paresse sur ces sujets, ou de nos carcans idéologiques. Le Covid a beaucoup changé nos représentations collectives parce qu’il a montré que des embardées extrêmement fortes étaient possibles au niveau de nos modes de vie – avec le dispositif de chômage partiel massif, on a tout de même nationalisé les salaires ! Six mois plus tôt, même Jean-Luc Mélenchon n’aurait pas pu envisager cela, et maintenant cette hypothèse paraît totalement normale. Bruno Le Maire lui-même l’a défendue, et c’était une très bonne décision. Une trappe s’est ouverte sur la possibilité de changer nos politiques publiques de façon extrêmement forte.
Parmi les mesures à mettre en place, lesquelles seraient les plus susceptibles de hérisser la population ?
Jérôme Fourquet : Tout ce qui touche à la liberté de mouvement associée à la voiture individuelle reste assez sanctuarisé. Rappelez-vous la levée de boucliers autour de la limitation de la vitesse à 80 kilomètres par heure, qui n’impliquait pourtant pas un effort surhumain.
Dans les enquêtes, d’autres sujets semblent plus consensuels. Diminuer la place de l’alimentation carnée dans les cantines ou passer davantage par des circuits courts, c’est relativement bien accepté. Vivre dans une maison bien isolée, personne ne peut être contre – à condition que cette rénovation énergétique s’accompagne d’aides publiques.
Sur le développement des bourgs, une loi contraint très fortement l’étalement urbain et la poursuite de la construction pour limiter l’artificialisation des terres. Certains maires vous disent ainsi : « Beaucoup de ménages veulent venir s’installer dans ma commune, mais je dois construire sur le bâti qui existe déjà. » C’est peut-être une bonne chose, parce que ça oblige à repenser la ville de manière plus économe en espace. Mais, dans certains endroits, ça peut générer de l’insatisfaction, par exemple quand une partie de la population se voit refuser la possibilité de construire un logement.

Cécile Duflot : Dans l’immense majorité du territoire français, on construit du neuf en nécrosant le cœur de ville ou de village, parce qu’on ne transforme pas les habitations existantes. La question est donc de savoir comment on rénove les centres-bourgs, sachant que cela renforcerait leur attractivité. Il faut en finir avec ce modèle des élus locaux qui décident de construire un centre commercial pour encaisser la taxe professionnelle ou laissent bâtir des pavillons parce que ça fait plaisir aux promoteurs immobiliers. La construction en France est shootée à la défiscalisation immobilière, ce qui est absurde et scandaleux. Les bâtiments des cœurs de bourg, construits pour la plupart entre 1890 et 1950, ne sont pas les pires en termes de consommation d’énergie, au contraire des immeubles des années 1960 et suivantes, quand on poussait à installer du chauffage électrique en raison de l’énergie nucléaire peu chère.
La question du coût reste centrale : qui doit payer pour que les gens remplacent leur voiture polluante, rénovent leur logement, etc. ?
Cécile Duflot : L’incitation doit venir de l’État. Il faudra payer de toute façon ! Les réflexions politiques sont trop court-termistes. En 2012, par exemple, nous avions travaillé sur l’hypothèse de remplacer les trois millions de chaudières au fioul que compte le pays. Ça se justifiait écologiquement et budgétairement, puisque le déficit de notre balance commerciale est massivement causé par nos achats d’hydrocarbures. J’avais fait calculer que, si l’État payait intégralement le remplacement de ces chaudières, la dépense aurait été compensée en quelques années grâce aux économies sur les importations de fioul. Mais ça a achoppé à cause des rentrées fiscales issues de la taxe sur les produits pétroliers ! On ne pouvait prétendument pas s’en passer, comme pour les taxes sur le tabac. Voilà l’analyse budgétaire de Bercy. Quand on alertait sur le climat dans les années 1990-2000, on pouvait nous répondre qu’on se trompait peut-être. Mais là, ce qui se passe en matière de catastrophes climatiques correspond au pire scénario parmi ceux que le Giec envisageait en 1990. Donc, il est déraisonnable de ne rien faire. Et il est intéressant d’agir au niveau français, car on sous-estime à quel point l’exemplarité fonctionne : quand vous faites quelque chose, vous poussez les autres à aller dans le même sens – déjà parce que vous prouvez que c’est possible, et surtout parce que ça donne envie aux autres de faire aussi bien que vous.
Jérôme Fourquet : L’idée d’une taxe carbone a tout de même déclenché le mouvement des Gilets jaunes…
Cécile Duflot : Je pense que toute augmentation des dépenses contraintes aurait entraîné le mouvement des Gilets jaunes. Si vous aviez eu une augmentation soudaine du tarif des assurances à la suite d’une gigantesque catastrophe naturelle, ç’aurait eu le même effet. Le vrai nœud, c’est l’évolution du poids des dépenses de logement, qui est un besoin vital. C’est pourquoi il ne faut plus se contenter de réguler les loyers, il faut les faire diminuer. La rente immobilière est devenue déraisonnable.
Concernant la taxe carbone, il ne faut pas oublier que l’outil fiscal n’est qu’un des trois leviers de la politique publique, avec l’outil réglementaire – la législation – et l’outil de la commande publique – les choix d’investissement. Il faut jouer sur les trois leviers, pas seulement sur la taxation. Si vous ne voulez plus que les gens s’achètent des SUV, ces voitures hautes, lourdes et très polluantes dont on n’a absolument pas besoin partout, il faut interdire leur vente. Pourquoi les voitures sont-elles conçues pour rouler à 160 à l’heure alors que la vitesse est limitée à 130 ? L’homme est un animal bizarre, il a besoin de contraintes. Pour qu’il accepte de sauver sa propre vie en voiture, il a fallu rendre la ceinture obligatoire, en le menaçant d’une amende et de retraits de points de permis ! Donc, il ne faut pas avoir peur des contraintes parce qu’on sait optimiser sous contrainte, c’est là qu’on est les meilleurs.
La justice sociale est-elle une condition pour que ces contraintes soient acceptées par le plus grand nombre ?
Jérôme Fourquet : Tout à fait. Lors de la crise des Gilets jaunes, une des premières revendications qui a émergé sur les ronds-points consistait à aligner la taxation du kérosène sur celle du diesel et du gazole. En résumé et en langage Gilet jaune : « Qu’ils taxent le kérosène des avions des bobos au même niveau que le gazole que je mets dans ma Dacia pour aller travailler. » Il faut donner le sentiment que les efforts sont équitablement répartis, a fortiori dans un pays comme la France, qui a une très forte passion égalitaire. D’ailleurs, les politiques eux-mêmes doivent donner l’exemple.
Cécile Duflot : Je suis absolument d’accord. Pendant longtemps, j’ai cru qu’on pouvait établir des bonus-malus en fonction du caractère écologique ou non d’un produit. Mais en réalité, tout un tas d’objets, comme le plastique jetable, doivent simplement être bannis. Sinon ceux qui ont les moyens de payer le malus, finalement, seront autorisés à continuer à polluer. Oui, les dosettes de lait en plastique, c’est « tellement pratique », les lingettes aussi. Mais il ne faut plus que ça existe. Et si ça n’existe plus, on fera autrement. S’il n’y a plus de ligne aérienne Paris-Toulouse, soyez sûr qu’on rendra le train de nuit confortable ! D’ailleurs, le débat se polarise sur l’avion, mais une immense majorité de gens ne le prend pas.
Vous avez tout à fait raison également sur l’exemplarité nécessaire des politiques : il m’est arrivé une fois dans ma vie, c’était un voyage surprise, d’aller aux Maldives. Et cette polémique resurgit régulièrement : « La preuve qu’il ne faut pas lutter contre le dérèglement climatique, c’est que Cécile Duflot a pris l’avion une fois pour aller aux Maldives. » C’est assez spectaculaire. À l’inverse, un jour où j’étais dans un bus, un monsieur me reconnaît et me demande si je n’ai pas de chauffeur. Je lui réponds : « Si, c’est le même que vous : le chauffeur du bus. » Il a ri et d’autres passagers m’ont remerciée. Ils m’ont remerciée de prendre le bus !

Jérôme Fourquet : Pour que les choses se lancent, il est aussi nécessaire de montrer qu’elles sont possibles et de créer un effet d’entraînement. « La politique par la preuve », comme disait Ségolène Royal en 2007. Surtout par rapport aux questions environnementales, qui appellent des changements de modèle. Lorsque des politiques expérimentales sont menées avec succès, les territoires voisins ou similaires ont tendance à les imiter. Voyez comme le phénomène des pistes cyclables a essaimé dans de nombreuses villes, par exemple.
Autre ingrédient de la recette : la posture de ceux qui vont prendre ces décisions. Elle ne doit absolument pas être en surplomb, donneuse de leçons, selon la caricature des « bobos des villes qui vont expliquer la vie aux beaufs du périurbain ». S’il y a cette sensation de mépris, la population va instantanément se braquer. Certains politiques font preuve d’une méconnaissance de la vie quotidienne de pas mal de nos concitoyens, notamment dans ces fameux territoires périurbains ou pavillonnaires. C’est pour cela que des mesures symboliques sont parfois perçues comme blessantes ou vexatoires, typiques d’un mépris de classe qui peut venir de différents endroits de l’échiquier politique, y compris parfois de certains écologistes.
Cécile Duflot : Bien sûr. Personne ne peut estimer que son mode de vie est le bon et l’imposer au reste du monde. Quand on parle d’un enjeu si énorme qu’il est vital à l’échelle de la planète et de l’humanité, on ne peut pas, de toute façon, avoir le luxe de rester dans son petit coin en étant soi-disant éclairé sur ces questions. Ce ne seront pas 10 000 ou 100 000 écologistes qui réussiront à mettre en branle la société. Si on veut engager la transition écologique, il faut une alliance très large, qui implique le public comme le privé, Oxfam comme les salariés de Total !
Est-ce que tous les candidats, en dehors de Yannick Jadot dont c’est l’ADN, vont se déclarer écologistes à un moment donné ?
Jérôme Fourquet : Oui, sans doute. Après, Cécile Duflot et d’autres seront là pour décerner les brevets d’honnêteté et de sincérité écologiques des uns et des autres [rires]. À gauche, en tout cas, ces thématiques ont essaimé en dehors du périmètre traditionnel d’Europe Écologie Les Verts. Jean-Luc Mélenchon parle de planification écologique depuis 2017 Anne Hidalgo et le Parti socialiste se revendiquent d’une « social-écologie »… Le travail d’évangélisation a été fait, en partie. À droite et au centre, c’est moins évident, même si l’on se revendique souvent d’une écologie pragmatique, concrète, sur le mode : « L’écologie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux écolos. » On a vu la fameuse sortie d’Emmanuel Macron sur l’écologie, selon laquelle il ne voulait pas d’un « modèle amish ». Ce sont des propos que ne renieraient pas, à mon avis, des gens comme Valérie Pécresse.
La voie à suivre pour cette transition est-elle toute tracée ou y a-t-il encore des arbitrages à faire, par exemple au sujet de technologies nouvelles ou de nouvelles sources d’énergie ?
Cécile Duflot : Je vais faire référence à Don’t Look Up, ce film dans lequel des scientifiques alertent sur un cataclysme imminent, mais se heurtent soit au déni, soit à la certitude qu’une solution technologique va tout résoudre : nous n’avons pas de solution magique. À un horizon proche, on ne voit pas de saut technologique qui nous permettrait, par exemple, de transmuer le CO2 en excès dans l’atmosphère, de découvrir une source d’énergie totalement propre, de réaliser une fusion nucléaire qui apporterait de l’énergie aux habitants de la planète, etc. Aucun scientifique ne dit que c’est à portée de main, même à échéance de trente, quarante ou cinquante ans. Peut-être qu’un jour on saura faire voler des avions uniquement avec l’énergie solaire, en ayant recyclé des métaux qu’on sera allé rechercher dans nos décharges des années 1950 ! Quand Clément Ader s’est élancé sur son premier avion, ce n’était pas évident d’imaginer qu’un jour nous aurions des Airbus A380 ! Mais le temps dont on dispose est trop court pour qu’on spécule uniquement sur une solution technologique. Il nous faut donc engager une politique massive de sobriété dans l’usage des ressources fossiles. Pour imaginer la société de demain, j’apprécie la « théorie du donut » de Kate Raworth : imaginez des cercles concentriques, avec des seuils naturels critiques à ne pas dépasser – c’est la limite haute – et des besoins humains critiques – c’est la limite basse. Entre les deux, cet espace en forme de donut constitue la zone à la fois sûre du point de vue écologique et juste du point de vue des besoins humains. C’est dans cette zone qu’il faut raisonner : si certains besoins augmentent, d’autres doivent décroître. Mais sobriété énergétique ne veut pas nécessairement dire privations dans tous les domaines : si on développe l’agroécologie, par exemple, on peut créer de l’emploi, faire en sorte que les sols aillent mieux et fournir une nourriture de meilleure qualité. Il y a vraiment des modèles alternatifs qui n’entament pas notre confort de vie.
Jérôme Fourquet : L’électeur moyen n’a pas ce niveau de connaissances pointues. Ce qu’il perçoit dans les offres qui lui sont proposées, c’est plutôt une gradation : certains veulent aller très loin, très vite, d’autres développent une approche plus raisonnée, ou plus timorée. Le contre-exemple étant la question énergétique : est-ce que, finalement, pour remplir nos obligations, on va continuer à miser sur le nucléaire ou en sortir totalement ? Là, il peut y avoir des différences qui sont identifiées par le grand public.
Quelles sont les lignes de fracture dans la population sur cette question de la transition écologique ?
Jérôme Fourquet : Elles sont de natures diverses et ne se superposent pas parfaitement, ce qui rend les choses un peu compliquées à analyser. Un des a priori les plus communs, c’est de dire : « Les CSP+ sont beaucoup plus conscientes des sujets écologiques, et les catégories populaires s’en moquent. » Or, ce n’est pas si évident. S’il fallait retenir une variable pertinente, ce serait la différence générationnelle, même s’il faut se méfier des jugements à l’emporte-pièce : on n’a pas une « génération climat » et toute la jeunesse française n’a pas Greta Thunberg comme sainte patronne. On rappellera ainsi que Jordan Bardella n’est pas très âgé, Marion Maréchal non plus ! Mais les jeunes générations sont tout de même plus sensibles à ces questions-là, tandis que les plus de 65 ans, sans s’en désintéresser, sont moins réceptifs. Ce sont des générations certes très sensibles au patrimoine, aux paysages (qu’ils voient se modifier), mais qui ont été formatées idéologiquement, culturellement et même anthropologiquement, dans une France des Trente Glorieuses où croissance, énergie peu chère et consommation allaient de soi. Revenir là-dessus est plus compliqué psychologiquement pour ces générations, d’autant plus qu’une partie du discours écolo les culpabilise en affirmant que si on en est là aujourd’hui, c’est à cause de leur attitude passée.

Par ailleurs, on observe une ligne de clivage transversale et fondamentale en fonction du mode de vie et du rapport à la consommation. Nous sommes dans une société qui, majoritairement, ne croit plus tellement en Dieu et au paradis, ni au Grand Soir. Le bonheur, c’est donc ici et maintenant, c’est ce que je peux m’offrir et ce que je peux payer à mes enfants. La consommation est appréhendée à la fois de manière hédoniste – je me fais plaisir – et de façon éminemment statutaire et identitaire : beaucoup estimant que leur place dans la société va être déduite de ce qu’ils peuvent s’offrir et posséder. C’est notamment le cas pour les Français qui étaient sur les ronds-points, qui disent en substance et pour parodier Séguéla : « Si à 40 ans tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes gamins, t’es un cassos’. » Rappelons que quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, on avait quand même assisté à ce que d’aucuns avaient appelé les émeutes du Nutella, lorsque Intermarché avait fait une grosse promotion sur ce produit. On était le 20 du mois et, à cette date, toute une partie de la France ne peut plus se payer de la marque. Cela avait été la ruée dans les rayons. C’est un vrai sujet pour la transition écologique – notamment chez les jeunes qui, encore plus que leurs aînés, ont baigné dans cette société de l’hyperconsommation : quel rapport ont-ils avec les produits neufs ? Quel rapport aux marques ? La question se pose sérieusement pour faire accepter une forme de sobriété.
Cécile Duflot : Je trouve qu’il y a quand même une révolution à bas bruit avec la montée de la consommation d’occasion. Parmi les licornes françaises, on trouve l’entreprise Vestiaire collective, une plateforme de luxe de seconde main. Et dans une autre catégorie, les vêtements qui se vendent sur Vinted montrent que le rapport au neuf évolue : ça ne change pas la consommation, on consomme toujours autant, mais on n’achète plus neuf, ce qui a un impact bien inférieur en termes écologiques.
Jérôme Fourquet : Certes, mais les consommatrices qui revendent leurs vêtements sur Vinted disent que 70 % de l’argent gagné sert à racheter… du neuf ! S’il y a bien un côté très vertueux, attention tout de même au revers de médaille. Le prisme de l’hyperconsommation a pénétré très profondément dans notre société et nos comportements quotidiens.
Faut-il interdire la publicité des produits les plus polluants, comme l’a proposé la Convention citoyenne ?
Cécile Duflot : Absolument. La publicité est le moyen qu’a trouvé le productivisme pour susciter des besoins de consommation et trouver des débouchés à la production, au lieu de satisfaire des besoins existants. Il faut donc organiser le sevrage progressif de la société de consommation. Sans compter qu’on ne mesure pas l’impact de la publicité en termes de surstimulation cognitive : quand vous vivez en ville, vous êtes exposés à des centaines de messages quotidiens qui sont faits pour attirer votre attention, votre oreille, votre regard, votre cerveau, etc. Le lien avec une sorte d’épidémie de mal-vivre et de maladies psychologiques commence à être établi par certains scientifiques. Notre cerveau n’est pas fait pour être tenu en permanence de se positionner par rapport à quelque chose qui clignote. Il faut faire diminuer cette pression, notamment sur les enfants, pour se désintoxiquer du productivisme, mais aussi pour la santé des individus.
Si on imagine que ce n’est pas la consommation qui donne un statut social, quel récit, quel contre-modèle proposer en alternative ?
Jérôme Fourquet : Le grand historien Jean-François Sirinelli, en parlant de la société française des années 1950-1960, a dit que c’était une société du bonheur différé. Beaucoup de gens avaient des racines paysannes et savaient qu’avant de récolter, il fallait semer. C’était une époque où un tiers des gens allaient à la messe tous les dimanches, où 20 % votaient communiste aux élections, donc il y avait des horizons d’attente – le paradis ou bien la société communiste. Aujourd’hui, il y a cette très forte emprise de l’instantanéité, du présentéisme, de l’idée que le bonheur, c’est ici et maintenant. Un grand défi pour le combat écologique consiste à trouver comment remettre du temps long, à la fois dans les décisions publiques et dans la réflexion de l’individu.
« Le collectif et le plaisir sont aujourd’hui très souvent absents de l’horizon écologiste, et c’est une erreur »
Cécile Duflot : Remettre du temps long, mais aussi du collectif et du plaisir. En France, on a une aspiration au cocon, comme vous dites, mais c’est également une forme de substitution à la disparition des temps collectifs de ceux qu’on pouvait avoir lorsqu’on était militant au Parti communiste – qui visait à transformer complètement la société – ou lorsqu’on participait à des rituels religieux. Cette dimension de transcendance et de plaisir est aujourd’hui très souvent absente de l’horizon écologiste, et c’est une erreur. On pourrait imaginer des quartiers où on relève le défi de diminuer les consommations d’énergie non pas en taxant ceux qui ne le font pas, mais en insufflant une sorte de motivation collective. Cela marche étonnamment bien, ça s’est vu au niveau de l’adhésion à l’impôt, par exemple. Je pense aussi que notre capacité de solidarité est bien plus forte que ce qu’on imagine. Lors des grandes grèves de 1995, tous les transports en commun étaient à l’arrêt. Pour les personnes qui avaient besoin de se déplacer et n’avaient pas de voiture, il était devenu absolument normal de toquer à la fenêtre d’une voiture au feu rouge et de monter à bord si la destination de cette personne nous arrangeait. La norme sociale selon laquelle votre voiture est un espace privatif, où on ne prend quasiment plus d’auto-stoppeur, s’était quasi instantanément effacée. Cette capacité de mobilisation du corps collectif est totalement sous-exploitée. On a l’idée que tout est descendant, qu’un chef va faire notre bonheur commun et qu’il lui revient de décider, de façon très centralisée, bêtement présidentialisée, d’un changement uniforme. Je crois au contraire qu’il faut fixer des objectifs aux gens, par exemple en termes de réduction des déchets ou de consommation d’énergie, et ensuite laisser à chaque entreprise, par exemple, le soin de déterminer la façon la plus adaptée d’y arriver. Si l’objectif collectif est tenu, peu importe la façon dont on y parvient !
La transition écologique est-elle un récit qui peut apporter une unité à la société autour d’un effort collectif, ou, au contraire, contribuer à la fragmenter davantage ?
Jérôme Fourquet : Dans mon livre L’Archipel français, j’avais fait le diagnostic de l’effondrement de ce qu’on a appelé les grandes vieilles matrices structurelles, le catholicisme et le communisme. Est-ce que ce qui se passe autour de l’écologie peut correspondre à l’émergence d’une nouvelle matrice structurante, qui pourrait nous permettre d’embarquer toute une partie de la société ? Je suis assez frappé de voir que des gens de différents milieux sociaux, du cœur de « boboland », le 11e arrondissement de Paris, jusque dans certains territoires ruraux excentrés, peuvent communier dans une même vision par rapport à cet enjeu écologique et à la façon d’y répondre. Donc, il y a peut-être une matrice en gestation. D’ailleurs, la transition écologique emploie un vocabulaire religieux : quand un agriculteur conventionnel passe en bio, on dit qu’il fait sa « conversion », et on parle aussi de « sanctuaires » de biodiversité. On peut même dire que l’écolo qui se respecte fait carême toute l’année, en ne mangeant pas de viande ! Mais pour que cette nouvelle matrice fédère, il faut soit une adversité – le réchauffement climatique en est une –, soit un adversaire, c’est-à-dire un autre bloc de la société qui a une vision totalement antagoniste. C’est le cas aux États-Unis, avec un bloc climatosceptique très constitué et très puissant, mais pas en France, où on a plutôt des gens qui attendent que ça se passe.
« Un grand défi, c’est de remettre du temps long »
Cécile Duflot : Il faut aussi donner de l’espoir aux gens. Montrer que quand on arrête de dégrader un écosystème, quand on arrête de truffer un sol de pesticides, les vers de terre y reviennent assez vite. Si vous abandonnez un endroit qui a été complètement goudronné, en deux ans vous avez des graines qui font éclater le bitume et vous retrouvez de la végétation. Il n’y a pas besoin de faire énormément pour éviter l’immense catastrophe ; je ne crois pas à l’effondrement. Si on va vers un scénario avec davantage d’égalité, davantage de confort de vie, où on limite les pollutions qui ont des impacts sur notre santé, il est tout à fait possible de raconter un récit qui soit mobilisateur. Les statistiques montrent que nombre de Français vivent sans se chauffer suffisamment pour faire des économies. Si on avait ce grand plan de rénovation thermique bien financé, on vivrait tous plus confortablement. Si on décidait de faire classe à l’extérieur dès que c’est possible, on pourrait libérer des bâtiments scolaires pour organiser des ateliers avec les retraités… De nombreux scénarios mènent ainsi à une vie collective beaucoup plus exaltante et beaucoup plus confortable que la vie actuelle, qui se double en plus de l’angoisse de la catastrophe. Ça demandera des efforts, mais, en fin de compte, le point d’arrivée sera plus sympathique que le point de départ. Cela nécessite de trouver cet horizon collectif. L’inconvénient de l’écologie, c’est que vous ne pouvez pas regarder un océan dans les yeux et dire : « Descends. » Il se moque bien de l’autorité jupitérienne. En revanche, si quelqu’un passe à l’acte, on ne lui fera pas le reproche de ne pas avoir été écologiste pendant vingt-cinq ans. À partir du moment où il mettra en œuvre les politiques qui permettent de répondre à la crise écologique, de fait, il deviendra écologiste. Ça n’est pas un statut qui se gagne à coups de Pater et d’Ave, mais, tout simplement, dans les actes.
Propos recueillis par JULIEN BISSON, ÉRIC FOTTORINO & HÉLÈNE SEINGIER
Une société écolo est-elle possible ?
Jérôme Fourquet
Cécile Duflot
Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement, aujourd’hui directrice générale d’Oxfam, fait face dans ce débat à Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie d’entreprise de l’Ifop.
[Uniforme]
Robert Solé
Yannick Jadot s’est résigné à porter une cravate. Mais l'histoire politique nous montre que l’habit ne fait pas le moine.
L’alarme du pape François
Dans cette encyclique de 2015, le pape alertait sur le danger de ne pas regarder en face la réalité du désastre écologique.