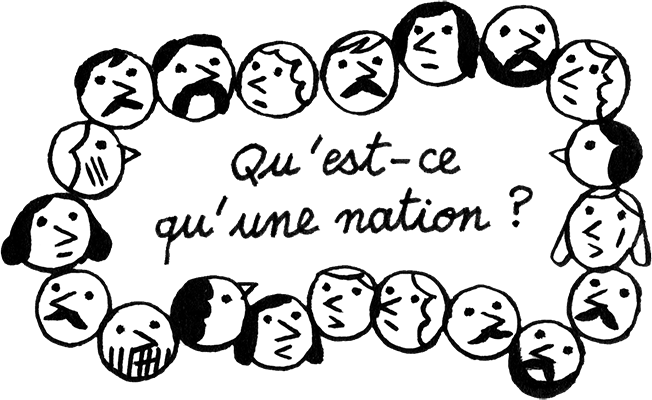« On arrive à refaire une société avec les récits imaginaires »
Temps de lecture : 11 minutes
Comment résonne en vous cette question du « revivre-ensemble » ?
J’ai la sensation que mon métier pose quotidiennement cette question. Un rideau qui se lève, au moment où il se lève, c’est l’aveu que nous sommes tous vivants au même endroit en même temps. Cet aveu-là est particulier au théâtre, avec un rassemblement face à une œuvre. Au-delà de ce que raconte la pièce, c’est un bout de vie partagé en commun. Comment revivre ensemble est relié à ce moment particulier. Pendant la période du confinement, je me suis dit que nous devrions partager des objets de culture vivante qui ne sont pas simplement du divertissement, mais l’expérience d’une réalité imaginaire à laquelle nous adhérons collectivement le temps d’un spectacle.
C’est ainsi que vous vous êtes retrouvé à jouer la scène du balcon de Roméo et Juliette… sur votre balcon. Pourquoi ?
C’était au début de la crise, en plein désarroi. J’étais sur mon balcon. Je voyais les fenêtres allumées. Je me disais que derrière chaque fenêtre se tenaient des gens qui, comme moi, ne pouvaient pas sortir de chez eux. En regardant mes pieds, je me suis dit que ce balcon pourrait ressembler à une petite scène. Et que ces familles derrière les fenêtres seraient des spectateurs.
Que s’est-il passé ?
Mon conjoint, qui n’est pas acteur, jouait Juliette à l’étage du dessus. Moi, je jouais Roméo à l’étage du dessous… J’avais un trac fou. Je joue d’habitude devant des spectateurs qui sont d’accord, qui ont acheté un billet. Là, j’allais imposer quelque chose. Au fur et à mesure de ces dix minutes de jeu, les gens sont arrivés dans la rue. Mes voisins, mais aussi des passants qui se sont arrêtés, des livreurs Uber. Tout le monde s’est tu. Puis il y a eu des applaudissements. Nous avons partagé cette réalité imaginaire de Shakespeare, nous y avons adhéré. On a échangé avec les voisins à qui je n’avais jamais parlé, et aussi sur les réseaux sociaux. Cela fait partie de l’être humain d’avoir à partager à plusieurs ces réalités imaginaires. L’être humain a inventé l’art. Ce n’est pas qu’une question esthétique ou intellectuelle, ou de divertissement. C’est un besoin vital comme boire ou manger. Je comprends pourquoi notre Premier ministre a décidé que nos théâtres fermeraient parce qu’ils n’étaient pas des lieux essentiels à la nation. Je comprends mais, au fond, je ne comprends pas…
Dans un texte que vous avez publié sur Facebook sous le titre « Théâtre corona-compatible », vous rappelez ce mot de Jean Vilar : « Il s’agit d’abord de faire une société après quoi, peut-être, nous ferons du bon théâtre. » Comment refaire une société ?
L’art et la culture y participent au même titre que bien d’autres domaines. Les objets culturels ont été des alliés des gens confinés. Les films, les captations, les livres. Mais le théâtre participe d’une forme de réconciliation et de consolidation du vivre-ensemble. On se concentre souvent sur la dimension politique du contenu d’une pièce. Mais je crois que le théâtre est politique par son contenant. Le fait même de se rassembler, de ne pas connaître son voisin, sa voisine, le temps du spectacle, est politique. On arrive à refaire une société avec les récits imaginaires, car notre récit contemporain est flou au niveau écologique, économique, politique, et maintenant sanitaire. Cela se vérifie toujours : dans les grands moments de flou de notre histoire, c’est l’art qui prend le relais. Les poètes réinventent les récits dans lesquels on se réfugie. C’est cela, l’idée du revivre-ensemble que peut porter le théâtre public. Shakespeare émerge dans un moment bouleversé de l’humanité, avec l’imprimerie qui change tout, le protestantisme qui bouscule la religion, l’héliocentrisme qui est enfin prouvé – la Terre n’est pas plate mais ronde. Ce n’est pas un hasard.
En quoi le théâtre est-il une réconciliation ?
La même petite phrase me revient : être vivant au même endroit en même temps. Je suis troublé en tant qu’artiste qu’on veuille échapper à cette réalité, qu’on veuille penser l’autre comme l’étranger, le différent. Se pose aussi la question des droits culturels, qui remet chaque singularité au cœur du processus global de culture. On a inventé sous Malraux les Maisons de la culture. Or, il n’y a pas une culture mais des cultures qui doivent forcément trouver comment vivre ensemble : il n’y a pas d’autre choix.
Vous vous référez dans le texte précité à Jeanne Laurent, pourquoi ?
Jeanne Laurent était responsable des spectacles et de la musique au ministère de l’Éducation nationale en 1946. Dans une France meurtrie par la guerre, elle a eu la volonté d’irriguer le territoire d’œuvres d’art et de lieux de culture. Sa belle idée fut de s’appuyer sur les compagnies présentes sur le territoire pour leur donner des moyens, des murs mais aussi des missions. Elle a inventé le service public de la culture en créant les premiers centres dramatiques : Saint-Étienne, Rennes, Toulouse, Tourcoing et Aix-en-Provence. Le public existait, mais il n’était pas encore constitué. Le maillage initié par Jeanne Laurent a créé le public en tant qu’entité. Et pour revenir à l’idée de réconciliation, Jean Vilar a proposé une pièce d’un auteur allemand – La Mort de Danton, de Georg Büchner – dès la deuxième édition du Festival d’Avignon, en 1948.
À quoi pensez-vous en parlant de créations « corona-compatibles » ?
La vraie force de notre pays est cette armée culturelle que sont les artistes dispersés sur le territoire. Tout le monde a un théâtre à moins d’une heure de chez lui. Depuis toujours les artistes sont allés au-devant de la population, à l’instar de Firmin Gémier qui vers 1910, avec son Théâtre national ambulant, se déplaçait de village en village pour planter son chapiteau. Puisque nos salles ne sont plus adaptées aux conditions sanitaires, c’est le moment de se consacrer davantage à ce type de rapport au public, de création, de répertoire. L’expérience grandeur nature va démarrer en juillet. Je suis persuadé que nous allons ainsi œuvrer à l’élargissement et à la diversification des publics.
Quels publics visez-vous d’abord ?
Cette diversification des publics est mon grand combat depuis longtemps. Je pense que le théâtre est un outil utile à chacun et à chacune, si on écarte les a priori comme : c’est trop cher, je ne vais pas comprendre, ce n’est pas pour moi. Cet été à Angers, il y aura trois types de spectacles pour des publics différents. Au siège du théâtre, la salle vide sera un décor. Les spectateurs seront sur scène, dans les coulisses avec les acteurs, et verront ainsi le point de vue depuis la scène. Pour les spectacles en extérieur, on a repéré des fermes, des champs, des parcs de châteaux. Nous serons à Angers et en itinérance dans les territoires ruraux pour des représentations. Enfin, nous aurons des propositions impromptues dans l’espace public… Personne n’est au courant de rien, le spectacle surgit pour ceux qui sont là. C’est la possibilité d’aller jouer sous les fenêtres des Ehpad, dans les cours d’immeuble, sur les balcons, sur les places des marchés, avec des durées assez courtes pour ne pas provoquer de grands rassemblements. Tout le monde sera décalé dans ses habitudes. Je pense que ce décalage sera vertueux.
Le virus viendrait-il à point nommé pour interroger la démocratisation culturelle en panne ?
Le temps viendra des procès que l’on pourra légitimement intenter à nos institutions et aux politiques culturelles pour leurs dysfonctionnements. Mais je ne crache pas dans la soupe. Né en 1982, je suis un enfant de la décentralisation, du service public culturel. L’option théâtre dans les lycées, la Fête de la musique, les musées nationaux gratuits le dimanche, toute cette politique Lang-Mitterrand a fait de moi quelqu’un, avant même d’être un artiste. Depuis Lang, il n’y a pas eu de grand geste de politique culturelle, de grande ambition, de vision. Si on ne s’appuie pas sur notre maillage culturel, on sera juste un divertissement, pas essentiel à la nation, alors que ce dispositif national a précisément été conçu parce qu’il était jugé indispensable pour rebâtir et réconcilier le pays. Le virus permet d’expérimenter grandeur nature d’autres façons de créer, mais aussi de s’adresser au public. Ce virus demande aux institutions culturelles d’être alternatives. En cela, il peut être considéré comme une « aubaine ». Cet été, il y aura des ratés mais également des imprévus heureux dont on pourra se saisir dans la nécessaire mise à jour des institutions culturelles.
Comment attirer ces publics plus populaires ?
On n’y arrivera pas sans exigence. J’ai monté la trilogie Henry VI, le tout durait dix-huit heures, ça parlait de la guerre de Cent Ans, de la guerre des Deux-Roses… Dix-huit heures de Shakespeare. A priori, je ne partais pas gagnant en termes de popularité. Pourtant des gens sont venus au théâtre pour la première fois, prendre dix-huit heures de représentation dans la figure. Shakespeare, c’est assez simple. Ce n’est pas un auteur de cour, il écrit pour le peuple. Il met dans la bouche des rois des images de paysannerie, et dans la bouche des paysans des images royales. Il utilise ce que chacun connaît. « Nous nous séparons comme une barque se brise en deux », tout le monde comprend… Cette façon d’allier la popularité avec une grande exigence artistique, c’est ce que je m’évertue à proposer au public, qui est aventureux. À nous artistes de trouver les moyens de faire en sorte que nos œuvres soient recevables. Le boulot est là.
En quoi le théâtre peut-il être vital pour vivre mieux ensemble ?
Le théâtre est un outil d’art et de discernement. Il ne donne pas de réponses. Il pose à chacun les bonnes questions. Mon objectif est que le public sorte d’une salle de spectacle avec des outils citoyens. En cela, je pense que nous sommes essentiels à la nation. On constate quotidiennement la difficulté à vivre ensemble, à se comprendre, à accepter l’autre dans toute sa singularité… Arrivions-nous déjà à vivre ensemble avant ? Soyons clairs : le théâtre ne sauvera pas le monde. Mais il peut apporter cette petite graine de discernement à chacun. C’est pourquoi la culture devrait être un pilier plus structurant. Dans les premières démocraties, le stade et le théâtre étaient premiers pour la bonne santé de la cité.
Certains auteurs d’hier nous parlent-ils de la crise d’aujourd’hui ?
Je pense bien sûr à George Orwell et à sa Ferme des animaux. Mais aussi aux grands récits de certains auteurs romains – Sénèque – ou des Grecs Eschyle, Euripide, Sophocle. S’ils sont encore là aujourd’hui, c’est qu’ils ont des choses à nous dire. On peut monter Thyeste de Sénèque comme je l’ai fait et projeter à l’intérieur toutes ses obsessions du moment. Au milieu de la pièce, il est dit : « Faire vouloir au peuple ce qu’il ne veut pas, voilà la vraie puissance. » Une phrase écrite au Ier siècle…
Il faudrait aussi que les théâtres soient pareils à de grands forums citoyens. On ne peut concevoir seulement nos maisons comme des garages à spectacles. Elles pourraient devenir les refuges où se reconstruirait la pensée de l’être-ensemble.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO
« On arrive à refaire une société avec les récits imaginaires »
Thomas Jolly
Comment résonne en vous cette question du « revivre-ensemble » ?
J’ai la sensation que mon métier pose quotidiennement cette question. Un rideau qui se lève, au moment où…
[Ensemble(s)]
Robert Solé
Pourquoi Emmanuel Macron, champion du « en même temps », a-t-il appelé son mouvement En Marche ? N’aurait-il pas dû le baptiser Ensemble ? Ce mot est en effet issu du latin impérial insimul qui signifi…