En Suisse, sept siècles de démocratie participative
Temps de lecture : 4 minutes
J’avais 10 ans au moment du deuxième référendum suisse sur le droit de vote des femmes. Ma grand-mère faisait campagne pour le non auprès de son mari et de ses fils. En homme des sixties, mon père vota dans le sens de l’histoire. Il était temps. Nous étions en 1971, le non l’avait emporté à deux contre un en cinquante-neuf.
Cette lenteur des Suisses à accorder le droit de vote aux femmes était encore raillée à Paris quand je m’y suis installée. Piquée, j’essayais de pondérer : si les Françaises avaient dû compter sur leurs pères ou conjoints pour acquérir ce droit fondamental, elles auraient certainement dû patienter bien au-delà de quarante-cinq. Mais je ne me faisais pas comprendre. Nous étions les héritiers de pratiques démocratiques si radicalement différentes.
Pour mes amis français, c’était de la poltronnerie politique que de soumettre au référendum une question aussi cruciale. En Suisse, c’est une obligation constitutionnelle. À l’inverse, l’usage opportuniste du référendum à la française, où du coup l’enjeu n’est pas là où il devrait, me semble entretenir les citoyens dans une sorte d’immaturité politique. On se prononce par sympathie ou opposition au gouvernement plus que sur la question posée.
Par sa pratique séculaire de la démocratie directe, le Suisse, quand il se prononce (l’abstentionnisme est grand), répond à la question. Pas toujours de façon progressiste, du moins à mon goût, mais selon ses convictions, souvent indépendamment des consignes du parti pour lequel il vote par ailleurs, assez régulièrement dans l’intérêt d’autrui (le droit à l’avortement, l’équivalent du PACS plus proche du mariage pour tous) ou dans le sens du bien commun (la hausse des impôts).
Le débat se fait sur le concret des décisions à prendre, rarement sur les questions de dogme, encore moins sur les personnes. Il n’y a pas d’homme fort en Suisse. Il n’y a surtout aucun désir ni nécessité d’en avoir. Les reproches faits à Hollande laissent perplexe la Suissesse que je suis restée. Croyait-on vraiment qu’un homme ou un parti ferait baisser le chômage ? Dans la conception suisse, les problèmes se règlent en commun, chacun faisant sa part et les sacrifices nécessaires (voter pour les augmentations d’impôts), le personnel politique également, rompu à un exercice du pouvoir si humble et singulier.
Selon une formule non écrite et dite « magique », les partis se répartissent les sept sièges de Conseillers fédéraux [équivalents des ministres français] en fonction de leur poids politique. Une fois nommés, les Conseillers sont réélus par le Parlement tous les quatre ans, à de rares exceptions près, jusqu’à ce qu’ils se retirent eux-mêmes. Adapté à la France, cela donnerait un gouvernement composé de Hollande, Royal (qui, soit dit en passant, aurait été présidente dès 1999 sans que cela fasse une ligne dans la presse internationale), Juppé, Copé, Duflot, Le Pen et Aliot. Tous ayant la rondeur nécessaire pour s’entendre, s’accommoder de leur faible pouvoir par rapport aux cantons, et accepter de se voir retoquer par les urnes les réformes proposées, ou s’en faire imposer de bien embarrassantes par voie d’initiative populaire, comme récemment celle contre l’immigration de masse. On en a parlé en France, mais sans mesurer il me semble ce qui se joue d’unique et de passionnant. Gouvernement, partis – sauf extrême droite –, médias, milieux financiers et économiques… avaient appelé à voter contre. Le peuple n’en a pas tenu compte. Pour le mettre face à ses responsabilités, le gouvernement a choisi d’appliquer la réforme à la lettre, aussi dommageable que ce soit pour le pays et son économie.
Une grève du zèle en quelque sorte pour protester contre une réforme décidée par le peuple…


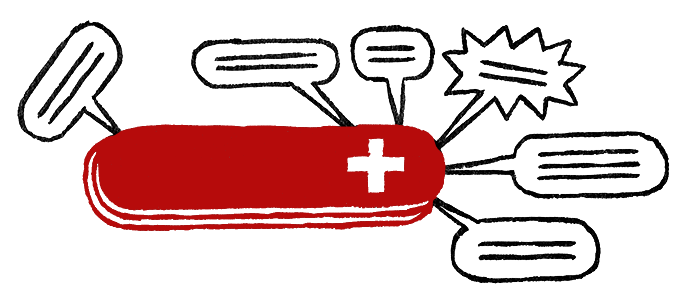
« La proportionnelle serait un gain pour la démocratie française »
Daniel Cohn-Bendit
Pour redonner aux citoyens français le sentiment d’être mieux représentés, êtes-vous favorable à une dose de proportionnelle ?
Une dose ? Non ! Je suis pour une proportionnelle intégrale comme en Allemagn…
Votations
Robert Solé
Jamais la France n’aura autant voté. À chaque instant, à tout propos, je suis invité à donner mon avis, sur tout et sur rien, d’un simple clic. « Pensez-vous que le secrétaire général de l’Élys&e…
Notre ennemi
Ollivier Pourriol
– Une cigarette ?
– Non merci.
– Je sais que vous fumez. Les cigarettes de flic ne sont pas assez bien pour vous ? Peut-être que c’est moi qui ne suis pas assez bien pour vous ?
– Les gens comme vous, q…







