Ne servez plus et vous voilà libres
Temps de lecture : 5 minutes
Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien ! Vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, voler vos maisons, et les dépouiller de vos meubles anciens et paternels. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez vous vanter que rien ne soit à vous, et il semblerait que désormais ce serait un grand bonheur pour vous que de n’être que les gardiens de vos biens, de vos familles et de vos viles vies, sans les posséder. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous viennent non pas des ennemis, mais certes oui bien de l’ennemi, et de celui que vous avez fait si grand, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a aucune autre chose que ce qu’a le moindre des hommes de toutes vos si nombreuses villes, si ce n’est l’avantage que vous lui faites pour vous détruire. D’où a-t-il pris tant d’yeux dont il vous épie, si vous ne les lui donnez ? Comment a-t-il pris tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de vous ? Les pieds dont il écrase vos cités, d’où les a-t-il s’ils ne sont les vôtres ? Comment a-t-il un quelconque pouvoir sur vous, sinon par vous ? Comment oserait-il vous assaillir s’il n’avait aucune complicité chez vous ? Que pourrait-il vous faire, si vous ne receliez point le brigand qui vous pille, si vous n’étiez complices du meurtrier qui vous tue, et traîtres à vous-mêmes ? Vous semez vos fruits afin qu’il les gâte, vous meublez et remplissez vos maisons, afin de fournir ses pillages, vous nourrissez vos filles afin qu’il ait de quoi satisfaire sa luxure, vous nourrissez vos enfants afin qu’au mieux il les mène en ses guerres, il les conduise à la boucherie, il les fasse administrateurs de ses convoitises, et exécuteurs de ses vengeances. Vous tuez vos propres personnes à la peine afin qu’il puisse se ravir en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez, afin de le rendre plus fort et plus ferme pour vous tenir la bride plus serrée. De tant d’indignités que les bêtes même soit ne les sentiraient point, soit ne les supporteraient point, vous pouvez vous délivrer si vous essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez décidés à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l’ébranliez, mais seulement : ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse à qui l’on a dérobé la base, de son poids même s’effondrer au sol et se rompre. […]
Mais à la vérité il est tout à fait vain de débattre pour savoir si la liberté est naturelle, puisqu’on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire de tort, et qu’il n’y a rien au monde de plus contraire à la nature, qui est en tout point raisonnable, que le tort. Il en résulte donc que la liberté est naturelle, et si je suis le même raisonnement, j’en déduis que nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre liberté, mais aussi avec une propension à la défendre.
Or si d’aventure nous émettons quelques doutes sur ce propos, et si nous sommes si abâtardis que nous ne puissions reconnaître nos biens ni, de même, nos penchants naturels, il faudra que je vous fasse l’honneur qui vous appartient, et que je fasse monter, si je puis dire, les bêtes brutes en chaire pour vous enseigner votre nature et condition.
Les bêtes, – qu’ici Dieu me vienne en aide – si les hommes font trop les sourds, leur crient « vive la liberté ». Il y en a plusieurs, parmi elles, qui meurent sitôt qu’elles sont prises : comme le poisson quitte la vie aussitôt que l’eau, pareillement ces bêtes-là quittent la lumière, et ne veulent point survivre à leur naturelle liberté. Si les animaux posaient entre eux quelque prééminence, ils feraient de ces bêtes-là leur plus noble caste. Les autres, des plus grandes jusqu’aux plus petites, font lorsqu’on les prend si grande résistance d’ongles, de cornes, de bec et de pieds, qu’elles déclarent assez combien elles estiment cher ce qu’elles perdent. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes apparents de la conscience qu’elles ont de leur malheur, qu’il est aisé de voir qu’à partir de ce moment il s’agit pour elles de dépérir plutôt que de vivre, et qu’elles continuent leur vie plus pour regretter leur aise perdue que pour se plaire en servitude.
[...] Nous nourrissons le cheval dès sa naissance pour l’apprivoiser à servir. Et pourtant nous qui pensons savoir le flatter quand vient le moment du dressage, nous le voyons mordre le frein, se ruer contre l’éperon, comme pour montrer à la nature, semble-t-il, et témoigner au moins par là que s’il sert, ce n’est pas se son gré mais par notre contrainte.
[...] Ainsi donc, puisque tous les êtres qui ont la faculté de sentir sentent systématiquement le mal de la sujétion, et courent après la liberté, puisque les bêtes qui pourtant sont faites pour le service de l’homme ne peuvent s’accoutumer à servir qu’en protestant d’un désir contraire, quelle malchance a donc eu lieu qui a pu dénaturer l’homme, seul né véritablement pour vivre libre, au point de lui faire perdre et le souvenir de son être premier, et le désir de le retrouver ?
Discours de la servitude volontaire © Éditions Gallimard, 2008, pour l’adaptation en français moderne par Myriam Marrache-Gouraud


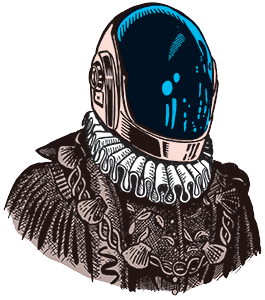
« La proportionnelle serait un gain pour la démocratie française »
Daniel Cohn-Bendit
Pour redonner aux citoyens français le sentiment d’être mieux représentés, êtes-vous favorable à une dose de proportionnelle ?
Une dose ? Non ! Je suis pour une proportionnelle intégrale comme en Allemagn…
Votations
Robert Solé
Jamais la France n’aura autant voté. À chaque instant, à tout propos, je suis invité à donner mon avis, sur tout et sur rien, d’un simple clic. « Pensez-vous que le secrétaire général de l’Élys&e…
Notre ennemi
Ollivier Pourriol
– Une cigarette ?
– Non merci.
– Je sais que vous fumez. Les cigarettes de flic ne sont pas assez bien pour vous ? Peut-être que c’est moi qui ne suis pas assez bien pour vous ?
– Les gens comme vous, q…







