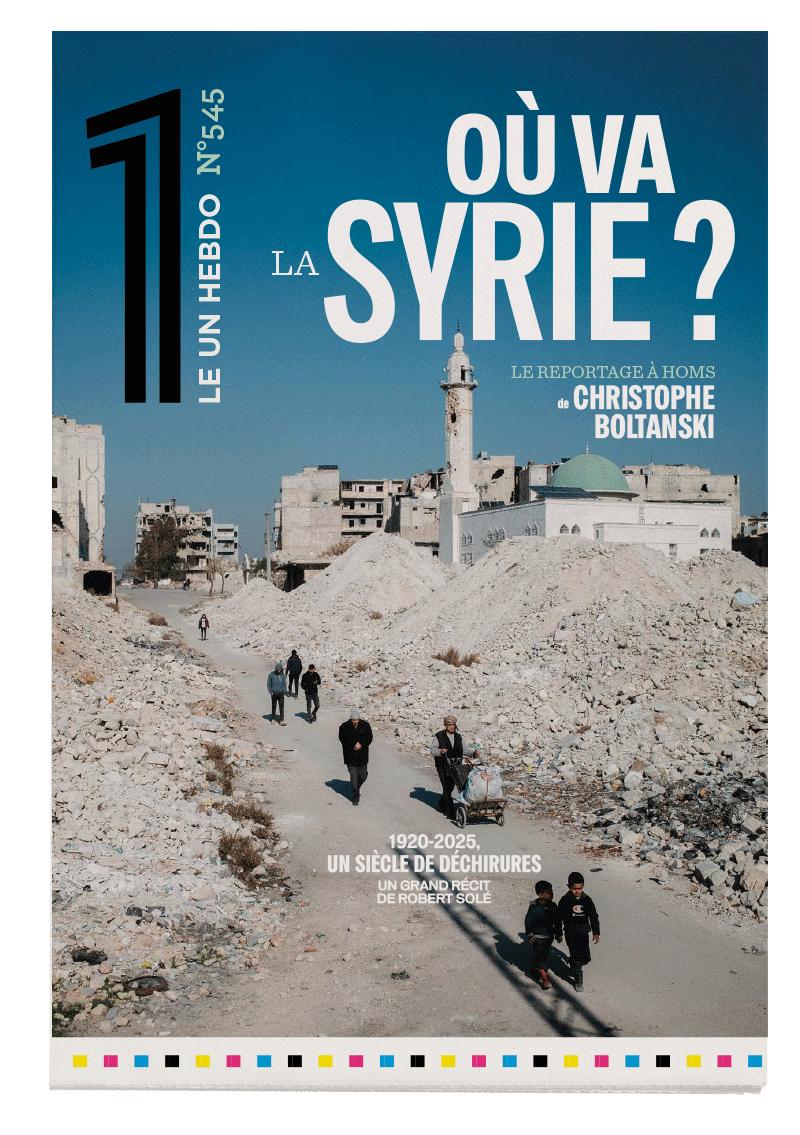Société de mobilité contre société de places
Temps de lecture : 6 minutes
Le débat pour savoir si Emmanuel Macron est de droite ou de gauche est l’illustration que le commentaire politique manque de vocabulaire. Non que les cultures politiques ne revêtent de l’importance – elles jouent indéniablement un rôle décisif au moment du vote. Mais cette catégorisation échoue à traduire un clivage profond, dans lequel l’ex-ministre de l’économie occupe une position marquée, et qui plonge au cœur de l’imaginaire français : celui qui oppose la société de mobilité à la société de places. Depuis son arrivée à Bercy en août 2014, le probable futur candidat à l’élection présidentielle se pose en défenseur du mouvement. Il a multiplié depuis deux ans les éloges de la réussite et de l’entrepreneuriat, les critiques des 35 heures, du statut des fonctionnaires et de la gauche qui « préfère défendre les statuts, qui explique que défendre la justice dans notre pays c’est conserver les choses telles qu’elles sont et telles qu’elles ont été ». Ces déclarations forment une vision sociale cohérente qui structure En marche ! Celle d’une société où des individus libérés de positions sociales figées évoluent dans des structures souples, dynamiques, affranchies de règlementations trop lourdes qui plombent leur énergie, et occupent des places temporaires en fonction de leur motivation pour entreprendre et construire des projets.
Dans cette perspective symbolisée par l’allégorie de la start-up, plus d’insiders ni d’outsiders, mais des travailleurs-électrons libres qui collaborent entre eux ou entrent en compétition, cette dernière étant présentée comme une saine émulation par le travail. Cette société d’(auto-)entrepreneurs, refusant les statuts et les rentes, est le produit d’un imaginaire qu’on ne saurait réduire à l’expression du libéralisme de marché. Elle a des accents de la « nouvelle société » de Jacques Chaban-Delmas, elle évoque les appels de Jack Lang à « libérer les énergies » dans les années 1980 et les discours de Ségolène Royal qui, avec Désirs d’avenir en 2007, présentait, de même qu’Emmanuel Macron, la société française comme percluse de conservatismes et voyait dans l’« agilité » sociale et entrepreneuriale une issue vers leur fin.
Le rêve d’Emmanuel Macron est-il un « rêve français » ? Il séduit en tous cas incontestablement une partie de la jeunesse – et, au-delà, tous ceux qui considèrent que la société actuelle, protégeant excessivement certains de ses membres, en laisse trop d’autres sur le bas côté de la route. Mais il s’oppose à un autre imaginaire national : celui de la société de places. Celle des contrats à durée indéterminée, des droits sociaux rattachés à des positions fixes et pérennes, des RTT et des comités d’entreprise, de la sécurité d’un emploi protégé par un statut. Celle des organisations collectives de défense des travailleurs, des luttes sociales, produit d’une histoire de France qui remonte au moins à la révolution de 1848. Cette France-là a ses récits, ses héros et ses rêves : une société où l’harmonie collective dépend de la possibilité pour chacun de disposer d’un emploi stable, digne, rattaché à des droits, qui lui permette de construire, dans son temps libre, une vie équilibrée. Elle est aussi, et c’est là où le bât blesse, la France qui a porté la gauche au pouvoir en 1981, en 1997 et en 2012.
Emmanuel Macron ne manque jamais de souligner les limites de cette société. Son combat contre les rentes et les privilèges est également une lutte contre les places acquises, fixes, inamovibles. Ses rapports tumultueux avec la CGT sont le reflet de cet agacement pour une organisation qu’il perçoit comme le symbole de l’immobilisme français. Il met en exergue le décalage entre une société obnubilée par l’imaginaire des Trente Glorieuses, celui du plein emploi et de la croissance à plus de 3 %, et la réalité sociale dans laquelle trop de Français se contentent de « faire des heures » et cumulent les contrats précaires. Il pourfend le partage du travail défendu par les seuls titulaires de contrats stables, les autres étant exclus du système de négociation des partenaires sociaux. Moyennant quoi, il passe sous silence les impasses de la société de mobilité qu’il défend, et notamment la permanence des classes sociales. Dans la société française, tous les citoyens ne sont pas en mesure – ou en désir – de se mettre « en marche », et il est plus facile de le faire pour un jeune énarque devenu banquier que pour les ouvrières de Gad. Héraut d’une mondialisation heureuse, Emmanuel Macron doit encore prouver que la société de mobilité qu’il promeut ne va pas se contenter de servir les mêmes intérêts qui, société de places ou pas, tiennent déjà le haut du pavé : n’est pas Mark Zuckerberg qui veut.
La société de mobilité défendue par Macron témoigne en fait d’une autre fracture, longtemps dissimulée mais aujourd’hui pleinement révélée : le clivage générationnel. Les jeunes reprochent aux anciens de s’accrocher égoïstement à des places sans penser à leur succession, pendant que les aînés observent avec inquiétude l’individualisme de leurs cadets. Quand il déclare que l’économie actuelle est façonnée pour les statuts et les protections, alors que « la vraie injustice ce sont les 10 % de chômeurs, la vraie injustice ce sont les jeunes […] ou celles et ceux qui sont condamnés à tourner autour du système et qui sont au fond les outsiders, les perdants », Emmanuel Macron a probablement raison. Mais il oublie que beaucoup de Français sont attachés aux places et que leur représentation du monde est très largement structurée par les droits rattachés à ces dernières. En s’opposant à eux, il prend le risque de se confronter bientôt à l’une des dures lois de la politique : dans une société où persiste un « cens caché », selon l’expression de Daniel Gaxie, ce ne sont pas les perdants qui votent.
Une victoire possible, juste possible
Olivier Duhamel
Emmanuel Macron veut porter son « mouvement […] jusqu’en 2017 et jusqu’à la victoire » – il l’a dit le 12 juillet 2016 dans sa prédéclaration de candidature à l’élection présidentielle. …
[Macronie]
Robert Solé
On l'a bien compris : c’est d’abord « pour créer de la mobilité » qu’Emmanuel Macron a appelé son mouvement En marche ! Mais comment désigner les marcheurs qui lui emboîtent le pas ? De Gaulle a engendr&…
Un coucou ne fait pas plus le printemps qu’une hirondelle
Natacha Polony
Certes, ils sont nombreux, ceux qui souhaiteraient, ceux qui rêveraient… Ah, s’il se passait enfin quelque chose ! Si l’on pouvait voir bouger les lignes, se déployer des énergies nouvelles pour bousculer un système institutionnel exsangue ! Et voil&a…