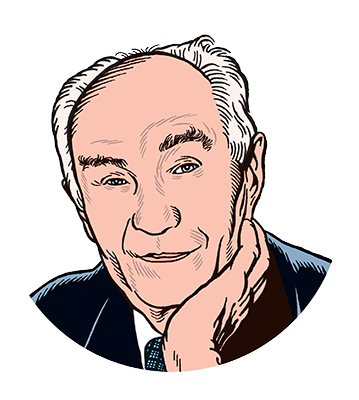Un être radical
Temps de lecture : 5 minutes
Comment narrer cette première entrevue ? Je ne veux pas parler de son aspect physique (elle n’était pas laide, comme on l’a dit, mais prématurément voûtée et vieillie par l’ascétisme et la maladie, et seuls ses yeux admirables surnageaient dans ce naufrage de la beauté) ni de son accoutrement et de son bagage invraisemblables (elle ignorait royalement non seulement les canons de l’élégance, mais jusqu’aux usages élémentaires qui permettent de passer inaperçu) ; je dirai seulement que ce contact initial suscita en moi des sentiments très différents sans doute de l’antipathie, mais pour le moins aussi pénibles. J’eus l’impression de me trouver en face d’un être radicalement étranger à toutes mes façons de sentir et de penser, à tout ce qui représente pour moi le sens et la saveur de la vie. Ce fut, en un mot, la révélation de mes propres antipodes : je me trouvais dépaysé devant une terre nouvelle et des étoiles inconnues. J’ignorais encore que, si nous n’étions pas guidés par les mêmes astres, nos âmes se rejoignaient dans le même ciel. Ma seule impression positive fut un sentiment de respect inconditionnel pour un être dont, à travers toutes nos divergences intellectuelles et affectives, je devinais obscurément la grandeur unique.
Chaque soir, elle me lisait longuement Platon. Ses dons pédagogiques étaient prodigieux
Une face plus rugueuse de son caractère m’apparut dès qu’il fallut procéder à son installation chez moi. Trouvant notre humble maison trop confortable, elle refusa la chambre que je lui offrais et voulut à tout prix dormir à la belle étoile. Ce fut moi alors qui me fâchai et, après de longues discussions, elle finit par s’incliner. Le lendemain, un compromis intervint : mes beaux-parents possédaient alors une petite maison à demi ruinée au bord du Rhône, et nous l’y installâmes, non sans quelques complications pour tout le monde : tout aurait été tellement plus simple autrement ! Je pourrais citer cent traits de la même espèce : elle qui, pour son plaisir ou son besoin, n’aurait pas accepté le plus mince sacrifice de son prochain, semblait ne pas tenir compte des complications, voire des souffrances qu’elle introduisait dans la vie des autres dès qu’il s’agissait de réaliser sa vocation à l’anéantissement. Sa propre recherche de l’inconfort dans les petites choses et du malheur dans les grandes lui faisait négliger les éclaboussures d’inconfort et de malheur qui pouvaient en rejaillir sur son entourage. Peut-être aussi son humilité pensait-elle que, n’étant pas digne d’être aimée, elle ne risquait guère de faire souffrir.
Elle refusa la chambre que je lui offrais et voulut à tout prix dormir à la belle étoile
Nos premiers contacts furent assez durs. Nos tempéraments se ressemblaient fort peu, et nous étions loin d’avoir les mêmes goûts en art et les mêmes opinions en philosophie et en politique. Je l’entends encore qualifier Victor Hugo de sonore imbécile et pousser les hauts cris toutes les fois que j’exprimais mon admiration pour Nietzsche. Mon estime pour la pensée d’un illustre philosophe contemporain – dont je m’abstiens de citer le nom, car il a cessé depuis longtemps d’être mon ami – ne la hérissait pas moins : elle saisit un jour un de ses ouvrages, lut quelques phrases à haute voix et conclut d’un air de défi : « Avouez qu’il est impossible d’avoir une belle âme quand on écrit aussi mal ! » Tout l’apriorisme passionné de Simone Weil tient dans cette apostrophe… Sur le plan politique, les choses n’allaient guère mieux. On sait quel climat de division régnait alors en France. Sans être mêlé directement à l’action politique, j’admettais la légitimité du gouvernement de Vichy, tandis que Simone Weil était déjà « résistante » de toute son âme. Ce n’était pas là un élément d’entente, mais je dois reconnaître que ce ne fut jamais un motif de discorde. Simone Weil, consciente du caractère éminemment relatif de l’option politique qui consiste à rechercher, non la perfection, mais le moindre mal, ne manifesta jamais la moindre intolérance à mon égard et ne me tint pas rigueur de mes préférences.
Elle savait se mettre au niveau de n’importe qui pour lui enseigner quoi que ce soit
Ainsi se déroulaient nos travaux et nos jours. Simone Weil remontait chaque matin de sa « maison de conte de fées » des bords du Rhône ; je l’initiais aux travaux des champs où sa gaucherie n’avait d’égale que sa bonne volonté – celle-ci finissant à la longue de triompher de celle-là ; nous causions interminablement ; chaque soir, elle s’asseyait sur un banc de pierre, près de la fontaine – à la place même où, pour la première fois, elle avait senti la réalité de Dieu en récitant le Pater – et là, elle me lisait longuement Platon, en soutenant, par mille explications, la démarche tâtonnante du pauvre helléniste que je suis. Ses dons pédagogiques étaient prodigieux ; si elle surestimait volontiers les possibilités de culture de tous les hommes, elle savait se mettre au niveau de n’importe qui pour lui enseigner quoi que ce soit. Je la vois tout aussi bien remplir les fonctions d’institutrice de cours élémentaire que celles de professeur d’université ! Qu’elle enseignât la règle de trois à un gamin arriéré du village ou qu’elle m’initiât aux arcanes de la philosophie platonicienne, elle y apportait elle-même et essayait d’obtenir de son disciple cette qualité d’attention extrême qui, dans sa doctrine, s’identifie à la prière.
Extraits de J.-M. Perrin et G. Thibon, Simone Weil telle que nous l’avons connue, La Colombe, 1952 (D.R.)
« Pour elle, l’homme plonge également ses racines dans le terrestre et le céleste »
Florence de Lussy
Florence de Lussy, qui a dirigé l’édition des œuvres complètes de Simone Weil, nous donne ici les clés pour comprendre la philosophe et sa pensée qui creuse avec courage et opiniâtreté un sillon singulier.
« À 10 ans, j’étais bolcheviste »
Maxence Collin
Le journaliste Maxence Collin retrace l’itinéraire de Simone Weil, intellectuelle au parcours hors-norme qui, après avoir défendu une révolution, aspirait à refonder rien de moins que l’esprit de notre civilisation.