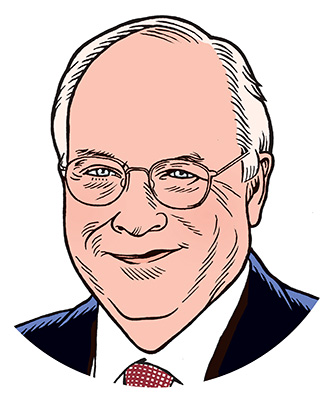Un idéologue comploteur
Temps de lecture : 5 minutes
Dick Cheney, le Raspoutine du mythe des armes de destruction massive
« Mes pieds ne touchaient plus le sol », racontait souvent Dick Cheney. Longtemps, le vice-président a ressassé ce moment du 11-Septembre où les agents du Secret Service étaient entrés dans son bureau et l’avaient embarqué sans ménagement pour le mettre en sécurité. Ce matin-là, son patron George Bush errait dans les cieux à bord d’Air Force One, à 20 kilomètres d’altitude pour éviter les avions-missiles d’Al-Qaïda. Et son second, Richard Bruce « Dick » Cheney, un briscard redouté de Washington revenu six mois plus tôt à la Maison-Blanche en qualité de mentor d’un président balourd et inexpérimenté, semblait, lui, voler dans les escaliers menant au bunker, ballotté comme une peluche par ses gardes du corps.
Les témoins de ce matin meurtrier le revoient plutôt au summum de ses responsabilités, fût-ce à 30 mètres sous terre, donnant calmement l’ordre d’abattre si nécessaire un Boeing détourné par un quatrième commando terroriste, avec 160 passagers à bord ; ou campé comme un fauve à la table du command center, concoctant la vengeance américaine alors que s’effondraient les tours jumelles de New York. Pourtant, Dick Cheney revenait à ces instants de chaos et d’indignité dans les escaliers de la Maison-Blanche, comme s’ils pouvaient justifier la genèse du plus puissant vice-président de l’histoire américaine…
L’affront fait au pouvoir de la première puissance mondiale ou le spectacle de son impuissance pourraient expliquer la métamorphose d’un haut commis de l’État américain et de l’establishment républicain, entré à 29 ans dans l’administration Nixon, bombardé à 34 ans chief of Staff (« chef de cabinet ») du président Ford, puis ministre de la Défense de Bush père, en charge à ce titre de la première guerre du Golfe. Un roc de raison d’État et de loyauté politique doublé d’un manager respecté, six ans patron de l’énorme groupe de travaux publics Haliburton, s’est mué après le 11-Septembre en comploteur sans scrupule de l’invasion de l’Irak, en Raspoutine du mythe des armes de destruction massive de Saddam, puis en tortionnaire en chef de la « guerre contre le terrorisme » – il est le bâtisseur de la prison de Guantanamo Bay, la caution et le garant du secret des black sites, les sites clandestins d’incarcération et de torture de la CIA.
Parmi les protagonistes de l’époque, Donald Rumsfeld et Condoleezza Rice en tête, il est le seul que l’on dépeint toujours comme l’incarnation du mal. Sa discrétion, ses rares sourires en coin de taiseux élevé dans les montagnes du Wyoming, son parcours de super apparatchik républicain étrangement dénué de la moindre ambition présidentielle suggèrent encore une âme d’idéologue comploteur.
Certes, Dick Cheney aurait vu dans le 11-Septembre une « opportunité », celle de rehausser le pouvoir de l’exécutif américain, flétri depuis le Watergate. George W. Bush, novice, indécis, et ignare en affaires internationales, était mal équipé pour incarner le retour de la présidence impériale. Cheney ne demandait qu’à lui prêter main-forte… Après le 11-Septembre, le vice-président entre dans une frénésie stratégique, montant une administration parallèle, des structures de renseignement qui contournent les conseillers traditionnels du président, distillent des informations biaisées et parviennent à imposer des décisions cruciales au Bureau ovale.
Lors de la guerre du Golfe, quand il était ministre de la Défense, il argumentait contre la poursuite de l’offensive vers Bagdad ; vice-président, il milite pour une déferlante américaine sur l’Irak. L’homme qui, dans les années 1960, multipliait les sursis d’étudiant pour éviter la conscription, s’acharne en 2001 à éradiquer le « syndrome du Vietnam » dans l’opinion et prêche pour le déploiement décomplexé de la puissance américaine à l’étranger. Ce dirigeant chevronné des bureaucraties de Washington règle maintenant ses comptes à la manière des voyous. Joe Wilson, un ancien diplomate en mission en Afrique, dément que Saddam Hussein ait acheté de l’uranium au Niger comme le clament les services du vice-président. Cheney, en représailles, dévoile que la femme de Wilson, Valerie Plame, est une agente clandestine de la CIA…
Le vice-président dérive. Son parcours s’affranchit de tous jalons moraux. Ce fils d’un fonctionnaire du département de l’Agriculture de Casper, Wyoming, a décroché une bourse pour la prestigieuse université Yale. Mais il revient au bercail en 1962 sans diplôme ni argent, étoffant son CV de deux condamnations pour conduite en état d’ivresse. Lynne Cheney, son épouse, le pousse à reprendre ses études, mais il abandonne son doctorat pour rejoindre l’équipe du gouverneur républicain local, et amorcer son ascension au sein du parti.
« Dick Cheney a donc un cœur », persiflaient les humoristes en mars 2012, après l’annonce de sa greffe réussie, remède à ses quelque cinq crises cardiaques depuis l’âge de 37 ans. En 2007, à la fin de l’ère Bush, la santé du vice-président s’était tant dégradée qu’il gardait en permanence une lettre de démission signée dans son bureau. Une précaution en cas d’incapacité soudaine, qui reflétait aussi ses relations de plus en plus exécrables avec George Bush. Le président, ulcéré par la catastrophe qu’était l’occupation de l’Irak aussi bien que par la remontée électorale des démocrates depuis les élections de 2006, avait écarté Cheney de son premier cercle, confiant jusqu’à la fin de son mandat les affaires stratégiques à sa conseillère Condoleezza Rice. Affront supplémentaire, Bush refusera à son départ de la Maison-Blanche d’accorder une grâce complète à l’un des collaborateurs du vice-président, Lewis « Scooter » Libby, impliqué dans l’affaire Valerie Plame. « Vous abandonnez un bon soldat sur le champ de bataille », avait protesté le vice-président. Dick Cheney avait perdu sa guerre. Il n’a plus jamais reparlé à George W. Bush.
« Ben Laden, un clignotant sur le radar de l’histoire »
Francis Fukuyama
« Je reste persuadé que cette période, qui a duré en tout huit ans, est une aberration dans l’histoire des États-Unis. » L’auteur de La Fin de l’histoire et le dernier homme fut longtemps un des phares intellectuels du néoconservatisme, avant de prendre ses distances av…
[Mémorial]
Robert Solé
LE VOL 93 de United Airlines a décollé de Newark avec vingt-cinq minutes de retard. Les 37 passagers apprendront ainsi, au-dessus des nuages, par des appels téléphoniques de leurs proches, que deux autres appareils se sont écrasés sur les tours du World Trade Center.
Un consensus international illusoire ?
Jenny Raflik
Le 11 septembre 2001 marque une étape dans l’internationalisation de l’antiterrorisme. Les Européens ont, dès avant cette date, commencé à s’organiser face à la menace commune à laquelle ils font face depuis les années 1970, mais l’ONU bute encore sur la question palestinienne q…