« Il est important de connaître les camps, de dire leurs noms »
Temps de lecture : 9 minutes
À combien s’élève le nombre de réfugiés dans le monde ?
Il y a aujourd’hui autour de 70 millions de personnes « victimes de déplacement forcé » : 16 millions de réfugiés stricto sensu, c’est-à-dire ayant passé une frontière, 30 millions de déplacés internes, autrement dit réfugiés dans leur propre pays, et entre 22 et 30 millions de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles. Soit un total qui va de 68 à 76 millions de personnes selon les évaluations de diverses organisations de l’ONU. Mais les chiffres sont l’enjeu de conflits pour des raisons politiques ou économiques et peuvent être gonflés ou diminués selon les cas.
Pour ce qui concerne les personnes fuyant des pays en guerre ou des situations graves de violence, on est très au-dessous de la réalité. Au Liban, par exemple, le HCR dénombrait l’an dernier moins de 800 000 réfugiés syriens alors qu’il y en avait déjà 1,5 million sur une population de 4,5 millions d’habitants. D’autres réfugiés comme les Congolais (RDC, ex-Zaïre) en Ouganda ou au Congo-Brazzaville, ne sont pas pris en compte parce qu’ils ne se déclarent pas ou ne vivent pas dans les camps du HCR.
Quels sont les critères qui définissent un réfugié ?
Officiellement, le terme « réfugié » fait référence à un statut créé après la Seconde Guerre mondiale par les Nations unies. Pour obtenir ce statut, les réfugiés doivent justifier leur départ, prouver que le danger qui les menaçait était bien réel. Mais peut-on quantifier la peur ? Et comment catégoriser ceux qui, au contraire, dans les pires conditions de violence, choisissent de rester chez eux et trouvent des solutions pour survivre, comme en Colombie ou dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) ? Ils voient leur espace de vie se réduire considérablement, ne peuvent plus sortir de leur village ou de leur quartier et se retrouvent, eux aussi, dans une situation d’enfermement. C’est souvent comme cela qu’on perçoit la violence sans la voir.
Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur du nombre actuel de camps de réfugiés ?
J’ai tenté, avec l’aide de géographes et de cartographes, d’estimer le nombre de camps aujourd’hui dans le monde. En collectant des données auprès d’organisations internationales, nous sommes parvenus à un total d’au moins 450 camps officiels, dont les 60 camps palestiniens. Ce chiffre ne comprend pas les camps de déplacés internes qui sont au moins un millier. Il y en a 400 rien qu’en Haïti quatre ans après le tremblement de terre de janvier 2010, qui abritent près de 400 000 personnes. Les campements informels, généralement moins grands, sans prise en charge administrative ou humanitaire, sont encore bien plus nombreux. On en trouve sur tous les continents, près des frontières ou dans les interstices urbains. Ils abritent de 50 à 2 000 migrants.
Tous les camps de réfugiés se ressemblent-ils ?
Les camps du HCR sont généralement construits sur le même modèle : un plan orthogonal et de larges rues pour faciliter la circulation des 4×4. Ils sont implantés dans des espaces vides, comme les déserts ou les forêts. Lorsqu’ils sont très importants, les camps s’organisent en plusieurs divisions. C’est le cas de Dadaab au Kenya, le plus grand camp du monde, qui accueille plus de 450 000 réfugiés. L’entrée abrite les infrastructures du HCR, à côté d’un poste de santé ou d’une maternité gérés par des organisations comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde. Une grande rue principale regroupe quelques échoppes où il est possible de trouver des fruits, des légumes et des parts de rations alimentaires du PAM (Programme alimentaire mondial). Des écoles primaires s’organisent sous des tentes. Certains camps, ouverts depuis longtemps, disposent aussi de coffee shops ou video shops. Avec les années, les camps grossissent ; leur espace finit par devenir un lieu de vie durable. Les camps palestiniens, largement urbanisés, deviennent des quartiers de villes et sont la meilleure représentation de ces camps contemporains.
Comment s’organise la vie à l’intérieur des camps ?
Le HCR missionne 575 ONG dans le monde, dont 150 internationales, pour participer à la gestion des camps. Chaque organisation a sa spécialité. Des ONG scandinaves, allemandes ou japonaises très puissantes assurent, par exemple, la distribution des tentes, le transport des réfugiés vers les camps. L’arrivée des réfugiés se déroule ensuite selon un protocole bien établi. À la descente du camion, ils sont soumis à un contrôle d’identité et un contrôle de santé. On leur attribue ensuite un emplacement à l’intérieur du camp et une tente, qu’ils devront monter eux-mêmes. Puis, la vie s’organise : alors que les femmes, les enfants et les personnes âgées restent à l’intérieur, beaucoup d’hommes vont et viennent pour chercher du travail.
Les camps ne sont donc pas fermés ?
S’il est possible d’y entrer et d’en sortir sous certaines conditions, les camps de réfugiés restent des espaces clos. Il faut en franchir les portes, les barrières, parfois les murs, voire les barbelés. Pour sortir et circuler provisoirement hors des camps, les hommes doivent négocier des passe-droits ou verser un peu d’argent aux policiers.
Les réfugiés sont-ils autorisés à travailler ?
En principe non, mais beaucoup cherchent des petits boulots dans les villages pour compléter leur ration alimentaire, dépourvue de protéines, ou mettre un peu d’argent de côté. Certains réfugiés travaillent pour les organisations humanitaires à l’intérieur des camps, moyennant un petit salaire. Ils représentent aussi une main-d’œuvre bon marché pour les entreprises aux alentours. Au Liberia, dans les années 2000, les camions de la compagnie de pneumatiques Firestone venaient régulièrement chercher des hommes des camps proches pour les faire travailler quinze jours dans les plantations d’hévéas, puis les ramenaient sous l’œil complice des administrateurs des camps.
Que se passe-t-il lorsqu’un camp n’a plus de raison d’exister ? Ferme-t-il ?
Aujourd’hui, il est rare que les camps ferment, comme ça, d’un coup. Ils se transforment plutôt. Leurs habitants, qui ont fini par s’approprier le lieu, cherchent souvent à négocier avec le HCR et les ONG pour continuer à vivre sur place. Lorsque la fermeture du camp de Maheba, en Zambie, a été annoncée en 2002, moins de 3 000 Angolais sur les 58 000 occupants, ont accepté de repartir dans leur pays d’origine. Le camp avait ouvert en 1971, plusieurs générations de réfugiés et enfants de réfugiés en avaient fait leur lieu de vie, l’avaient aménagé. Les obliger à partir créait un « surdéplacement » si l’on peut dire. Les rapatriements forcés existent, sous la responsabilité du HCR et des administrations nationales. Mais dans plusieurs pays, des négociations s’ouvrent aussi pour faire accepter l’établissement durable des camps et de leurs habitants.
Peut-on parler de villes pour qualifier ces camps durables?
Je parle plutôt de « camps-villes ». En réalité, il n’existe pas de terme adapté. Ce ne sont plus vraiment des camps, car ils ne dépendent plus seulement des organisations humanitaires et l’habitat, la vie quotidienne se sont transformés, banalisés. Censés être des lieux de transition éphémères, ils sont devenus de véritables lieux de vie. Des enfants y naissent, des mariages y sont célébrés, et souvent des remariages.
La pérennité des camps est donc une réalité. Est-elle assumée par la communauté internationale ?
Cette pérennité est l’objet d’un conflit. Depuis 2004-2005, des organisations ont commencé à réfléchir à l’urbanisation des camps. Le HCR possède ses propres bureaux d’urbanisme où les plans des camps sont dessinés. L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, s’est engagée avec des architectes et les habitants dans la reconstruction du camp de Nahr al-Bared au Liban, détruit en 2007. Quant aux camps de déplacés internes, ils peuvent se fondre dans le paysage des périphéries urbaines si les administrations nationales leur reconnaissent ce « droit à la ville », comme on le voit avec les camps de déplacés de Khartoum. Ce droit-là s’oppose à l’obligation du « retour ». J’ai le souvenir d’un vieil homme dans un camp en Guinée qui, à l’entrée de sa hutte, avait accroché une petite pancarte qui disait : « Chez moi, c’est là où je vis. »
Bientôt, on devra s’interroger sur le droit à la mémoire pour ces lieux, le droit à la publicité ou le droit à ce que la philosophe Hannah Arendt avait appelé la célébrité : « Seule la célébrité peut éventuellement fournir la réponse à l’éternelle complainte des réfugiés… » Il est important de connaître les camps, de dire leurs noms, comme des lieux parmi les plus anticipateurs du monde à venir : Dadaab, Maheba, Chatila, Mae La, Lukole, Tindouf, Kacha Garhi, Canaan, Kofinou, Le Hanul…
Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER et MANON PAULIC


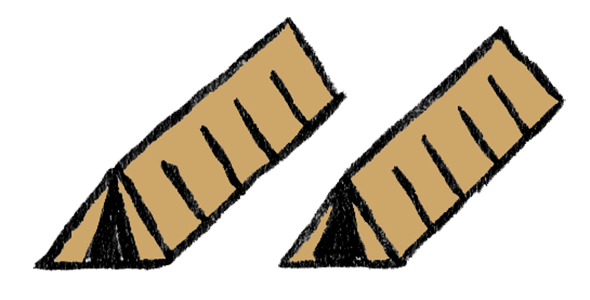
« Il est important de connaître les camps, de dire leurs noms »
Michel Agier
À combien s’élève le nombre de réfugiés dans le monde ?
Il y a aujourd’hui autour de 70 millions de personnes « victimes de déplacement forcé &raq…
Coincés dans la jungle
Elsa Delaunay
Irakiens, Syriens, Iraniens... ils ont fui leur pays dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. Nous avons rencontré Hassan, Adam et Jamileh (les prénoms ont été modifiés) dans les camps de migrants de la banlieue de Dunkerque.
Asile
Robert Solé
Se rendent-ils compte, tous ces gens bien au chaud chez eux, du drame que vit un réfugié ? Peuvent-ils seulement imaginer sa douleur, son désarroi ?
Je ne pensais pas qu’un jour les circonstances m’obligeraient à fuir à l’étrange…
Heureux qui comme Ulysse
Ollivier Pourriol
– Pourquoi pleures-tu, mon amour ? Parle-moi.
– Je ne pleure pas.
– Pourquoi ne pleures-tu pas, alors ? Je t’ai entendu crier dans ton sommeil. Laisse couler tes larmes, elles te soulageront. Voilà, comme ça, c’e…







