Une impossible régulation, vraiment ?
Temps de lecture : 7 minutes
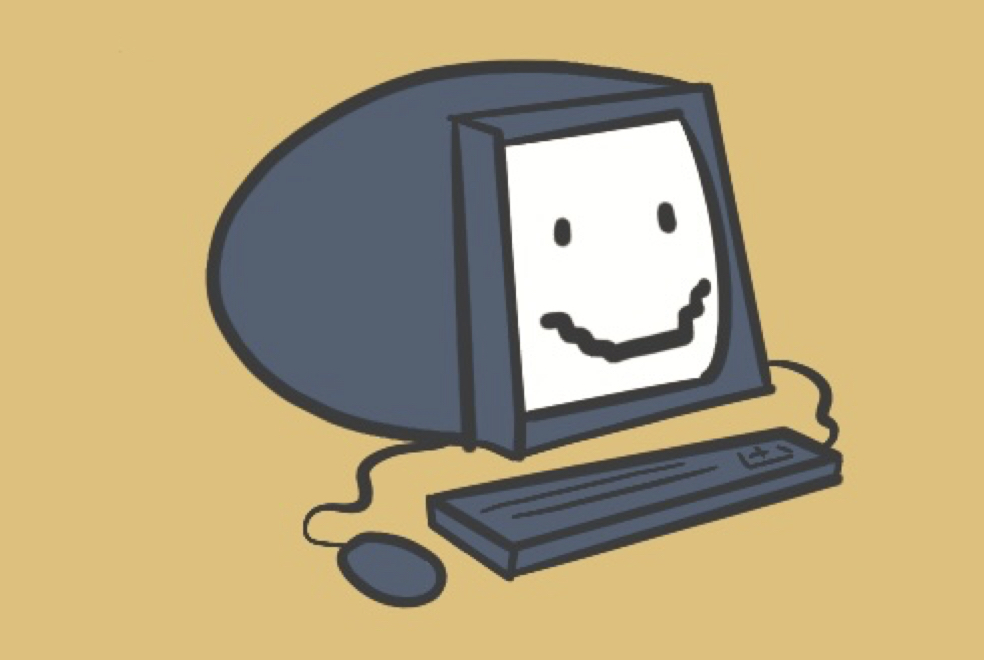
Peut-on réguler les réseaux sociaux et, si oui, comment ? Pour répondre à cette question qui ne cesse de réapparaître dans le débat public, sans doute faut-il commencer par préciser ce que l’on entend par « réseaux sociaux ». Il est important de distinguer, d’un côté, les messageries interpersonnelles, qui servent à entretenir des correspondances privées, type Signal, et, de l’autre, les réseaux sociaux, qui, eux, permettent de communiquer avec un nombre potentiellement indéterminé de personnes de manière publique, comme Instagram ou Facebook. Cette définition, qu’a adoptée le droit européen, est assez large, puisqu’elle implique qu’une section de commentaires sur YouTube soit catégorisée comme un réseau social. Cette ouverture est très utile, car elle permet d’englober les réseaux sociaux qui se présentent comme des messageries, mais qui comportent aussi des canaux publics. C’est le cas de Telegram par exemple, pour qui les canaux publics sont donc soumis au même type de régulation que Facebook, Instagram ou TikTok.
UNE RÉGULATION EUROPÉENNE EN DEMI-TEINTE
Cependant, tous les réseaux sociaux ne sont pas régulés exactement de la même manière. Le Digital Services Act (règlement sur les services numériques, ou DSA) et le Digital Markets Act (règlement sur les marchés numériques, ou DMA), tous deux adoptés en 2022 par l’Union européenne, ont réformé le cadre juridique européen sur le numérique, en insistant sur la nécessité de transparence et sur la concurrence libre pour l’ensemble des plateformes. Ces deux règlements distinguent celles-ci en fonction de deux seuils, créant trois catégories. La première est celle des « très grandes plateformes », dans le DSA, ou « contrôleurs d’accès », dans le DMA. Un ensemble de critères confère ce statut, notamment le nombre d’utilisateurs par mois (à partir de 45 millions dans l’Union européenne). Ces plateformes, parmi lesquelles on compte Meta (propriétaire de Facebook) et ByteDance (propriétaire de TikTok), sont soumises à des régulations supplémentaires et tombent directement sous l’autorité de la Commission européenne. À l’inverse, les autres plateformes, elles, sont contrôlées par des régulateurs des États membres et sont soumises à des obligations moins strictes. Enfin, il y a une troisième catégorie, qui rassemble les très petites plateformes, lesquelles bénéficient d’exceptions : par exemple, l’interdiction de publicité aux mineurs ne s’applique pas dans leur cas.
Dans l’ensemble donc, le DSA et le DMA encouragent la transparence des plateformes, tentent de les inciter à modérer leurs contenus, et donnent aux chercheurs accès aux algorithmes qu’elles emploient. Aussi, grâce au DSA, les utilisateurs peuvent signaler plus facilement les contenus illicites, ce qui responsabilise les plateformes, celles-ci ne pouvant se voir reprocher le contenu illégal qui circule sur leurs réseaux tant qu’elles ne sont pas au courant de son existence. En théorie, ces régulations sont donc plutôt positives, même si, dans les faits, il est difficile d’évaluer leur impact dans le domaine de la modération, car elles laissent une marge de manœuvre trop importante aux plateformes dans la définition des contenus problématiques.
RENDRE LE POUVOIR AUX UTILISATEURS
Les insuffisances du DSA et du DMA sont surtout liées au fait que ces mesures ne résolvent en rien le problème de fond, à savoir que les réseaux sociaux ont des intérêts commerciaux à mettre en avant des contenus problématiques. Pour contrer ce modèle, il faut imposer l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité pour différents systèmes de communiquer entre eux. Cela revient à exiger des réseaux sociaux qu’ils donnent la possibilité à leurs utilisateurs de discuter avec des utilisateurs d’autres plateformes. C’est le principe qui guide les échanges de mails par exemple : si l’on a un compte chez Microsoft, on peut très bien écrire à quelqu’un qui a un compte Gmail. Or, en dehors des rares réseaux sociaux ouverts à l’interopérabilité, type Mastodon, il est impossible de communiquer entre différents réseaux sociaux. Ce qui est assez problématique, car quand on est, par exemple, un internaute sur X, qui est devenu un repaire de l’extrême droite, on peut être tiraillé entre l’envie de quitter la plateforme, que l’on identifie comme nocive, et la peur de se couper des contacts que l’on y a accumulés. C’est d’autant plus le cas pour des plateformes, comme Facebook, qui facilitent l’organisation d’événements militants, qui permettent aux étudiants de réunir leur promotion, etc. L’objectif de l’interopérabilité est donc simple : encourager une décentralisation des réseaux sociaux pour rendre le pouvoir aux utilisateurs et utilisatrices, afin qu’ils puissent choisir de participer aux discussions qui les intéressent sans qu’ils soient pollués par des contenus problématiques et sans qu’ils aient à s’extraire des communautés en ligne auxquelles ils appartiennent.
Un lobbying anti-interopérabilité féroce de la part de Meta et autres
Il est assez probable que les plateformes soient contraintes de changer de modèle économique si elles se trouvent un jour confrontées à l’obligation d’interopérabilité. Mais au sein de la Quadrature du Net, notre position est claire : nous refusons de mettre en balance les intérêts économiques de géants qui prospèrent sur la surveillance de masse au mépris des libertés fondamentales et des intérêts publics – car c’est bien de cela qu’il s’agit ici. La position des géants en question est elle aussi très claire, puisque Meta, entre autres, a investi beaucoup d’énergie dans un lobbying anti-interopérabilité féroce. L’argument mis en avant était celui du respect de la vie privée : d’après les représentants de Meta, l’interopérabilité permettrait aux plateformes tierces d’accéder plus facilement aux données privées des utilisateurs. Non seulement cette ligne de défense est assez ironique venant de leur part, mais le raisonnement ne tient pas la route, puisqu’un service malhonnête qui voudrait récolter des données publiques est déjà en mesure de le faire aujourd’hui, l’interopérabilité n’y changerait rien. Toutefois, Meta a dû sentir le vent tourner puisqu’en 2023 elle a lancé Threads, une plateforme de microblogging qui vise à concurrencer X, et qui est le premier service géré par l’un des Gafam à être partiellement interopérable. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour autant, car comme ce domaine n’est pas encore régulé, cela signifie que, via Threads, Meta va tenter d’utiliser son nombre important d’utilisateurs pour imposer ses conditions et ses règles techniques, au détriment des petites plateformes, et in fine des utilisateurs. Il est donc nécessaire que l’obligation d’interopérabilité s’accompagne d’une régulation de ce secteur.
DÉCENTRALISER POUR MIEUX MODÉRER
La décentralisation des réseaux sociaux permettrait à chaque communauté de choisir le type de contenu qu’elle véhiculerait et de définir ses propres règles de modération. Cette approche serait plus vertueuse que celle que l’on applique aujourd’hui, puisque quand on censure des contenus problématiques, on ne s’intéresse pas à la réalité qui se trouve derrière ces contenus, on se contente de masquer leur expression – tout en renforçant la centralisation et l’hégémonie des réseaux par des sanctions verticales. Il serait en effet beaucoup plus simple de modérer des contenus problématiques si ceux-ci étaient réunis dans des pôles et des communautés distincts, puisque cela les rendrait plus repérables. Par exemple, dans le fédivers, à savoir le réseau social qui permet à plusieurs réseaux d’opérer entre eux (de l’anglais fediverse, mot-valise entre « fédération » et « univers »), il y a une instance d’extrême droite qui s’appelle Gab. Celle-ci est très bien identifiée, ses utilisateurs peuvent donc facilement être bloqués par les autres utilisateurs.
On a tendance à penser que la régulation arrive toujours avec un train de retard et qu’elle est incapable de cadrer convenablement les réseaux sociaux qui, eux, évoluent rapidement, innovent sans cesse et changent perpétuellement de fonctionnement. Or c’est faux : la Commission européenne a déjà montré qu’elle pouvait agir vite et efficacement avec le DSA et le DMA. Ainsi, si l’on avait une obligation d’interopérabilité des réseaux sociaux accompagnée d’une régulation de ce secteur, on pourrait espérer l’émergence d’échanges plus libres et de réseaux davantage régis par leurs utilisateurs.
Conversation avec MANON DE LA SELLE
« Un miroir déformant de la réalité »
David Chavalarias
Le mathématicien décrypte le fonctionnement des réseaux sociaux, les logiques économiques et les manœuvres politiques qui en font des instruments de polarisation à outrance des débats. Il montre néanmoins qu’un autre modèle de développement pourrait être emprunté par ces plateformes, renouant ave…
[Old is gold]
Robert Solé
CHÈRE MÉMÉ,
Tu t’étonnes que je ne sois pas devenu ton ami sur Facebook. Je n’ai pas répondu à ton invitation pour la simple raison que je viens de clôturer mon compte. Je m’en vais au moment où tu arrives… Désolé, mais j’en avais marre de recevoir des nouvelles insi…
Une arme contre les mollahs
Mahnaz Shirali
Pourquoi, sans les réseaux sociaux, la jeunesse iranienne ne pourrait plus affirmer sa liberté et lutter contre le régime des mollahs, par la sociologue et politiste Mahnaz Shirali.








