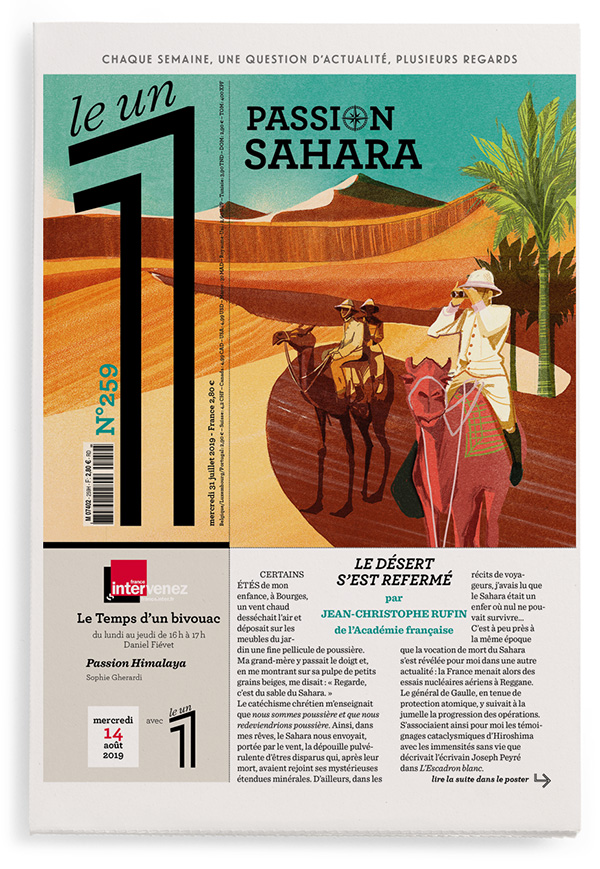« Le mythe du Sahara et de l’homme bleu date des années 1920 »
Temps de lecture : 10 minutes
Nous sommes dans votre bibliothèque, vous avez là quelque deux mille ouvrages consacrés au désert. D’où est née cette passion ?
Je suis issu de cinq générations de Français nés en Algérie, où ma mère et sa famille ont choisi de rester après l’indépendance. J’allais à l’école en France et je rentrais pour les vacances. Vers 14 ans, j’ai eu un coup de foudre pour le désert. Je me suis tellement passionné qu’un ancien méhariste français a décidé de me guider dans mes lectures et de me faire rencontrer Théodore Monod. Je suis allé le voir au Muséum d’histoire naturelle et nous avons parlé pendant trois heures – pour un gamin de 17 ans, vous imaginez ! Nous avons été amis jusqu’à sa disparition en 2000. J’étais autodidacte, et c’est lui qui m’a poussé à approfondir mes connaissances, à étudier l’histoire du Sahara, sa faune, sa flore, sa géologie. Et surtout à oser écrire ! Il a préfacé plusieurs de mes ouvrages et nous avons réalisé ensemble le livre Déserts.
C’est comme si le Sahara avait été « découvert » il y a deux siècles, comment l’expliquer ?
Dire que le Sahara au milieu du XIXe siècle est une terra incognita pour les Européens n’est pas une simple formule. Une grande coupure s’est installée avec la conquête musulmane et, pendant des siècles, l’Afrique du Nord est oubliée. Les récits arabes comme ceux d’Al-Idrîsî ou d’Ibn Battûta ne sont pas lus. Les seuls à voyager entre les deux rives sont des juifs qui fournissent les portulans (cartes maritimes). La Description de l’Afrique de Dapper, un imposant in-octavo publié à la fin du XVIIe siècle, offre la somme des savoirs disponibles à l’époque, mais il n’est pas d’un grand secours pour les voyageurs. L’ensemble du continent africain n’est alors connu que par les côtes. Théodore Monod disait que c’était « une Afrique de marins ». Lui-même avait commencé sa vie de scientifique comme océanographe, avant de se tourner vers le Sahara dans les années 1920.
L’histoire de l’exploration du désert est liée à la conquête coloniale de l’Afrique ?
Très directement. Les deux « grands fauves » que sont l’Angleterre et la France ont commencé à s’intéresser à l’Afrique après avoir dû renoncer à leurs ambitions en Amérique. Des industriels britanniques fondent l’African Association en 1788, tout de suite après l’indépendance des États-Unis. La rivalité avec les Français s’installe avec l’expédition de Bonaparte en Égypte. Un litige né à ce moment-là aboutira d’ailleurs à la conquête de l’Algérie. L’armée française avait acheté du blé à l’Algérie ottomane, mais ne l’avait pas payé. En 1830, le dey d’Alger réclame le paiement de la dette au chargé d’affaires français, et sa réponse lui paraît si insolente qu’il le frappe de son éventail. Ce fameux « coup de chasse-mouches » justifiera l’attaque d’Alger par la flotte de Charles X et le début de la colonisation du littoral.
L’intérêt pour le désert viendra plus tard ?
Oui, pour la bonne raison que le Sahara ne présente aucun intérêt sur le plan économique. Jusqu’à la découverte du pétrole, de l’uranium, des phosphates, on le considérait comme une masse inerte. Il y a bien quelques aventuriers comme René Caillié, ce fils de bagnard qui se met en tête d’atteindre Tombouctou pour toucher une récompense. Parti du Sénégal, il manque mourir du scorbut mais réussit cet exploit en 1828 – le temps de découvrir qu’il n’y a pas d’or, contrairement à la légende – et parvient à rentrer vivant via le Maroc. Son Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l’Afrique centrale le rend célèbre.
À quand remontent les premières explorations scientifiques ?
La première tentative date des années 1850, c’est celle de l’Allemand Heinrich Barth, le plus grand explorateur de l’Afrique avec David Livingstone. Lorsqu’il part pour le Sahara, il ne peut s’appuyer que sur Hérodote, savant grec du Ve siècle avant notre ère ! Commandité par le gouvernement britannique, Barth effectue un périple de cinq ans entre Tripoli et Tombouctou et rentre seul après avoir frôlé plusieurs fois la mort. Il a laissé la première description moderne du Sahara, cinq volumes magnifiques, qui restent une référence. En 1860, un Français de 19 ans, Henri Duveyrier, arrive au Sahara et passe deux ans avec des nomades : auteur du premier livre sur les Touaregs, il se verra plus tard reprocher d’avoir caché le caractère belliqueux des tribus, qui se révélera face aux colonnes françaises ! Ensuite, en l’espace de cent ans, une véritable pluie de livres s’abat sur le désert. Aux alentours de 1960, L’Essai de bibliographie du Sahara français et des régions avoisinantes du commandant Blandin de Thé comporte 10 000 références, livres ou articles, rien qu’en français.
Un siècle d’engouement littéraire ?
Non, plutôt un enchaînement de périodes très différentes. Au début, ce sont des militaires qui écrivent des livres au fur et à mesure de leurs découvertes : ils décrivent la topographie, les escarmouches avec les nomades, les modes de vie, c’est assez plat et ça sent la propagande, puisqu’il s’agit de montrer aux Français qu’on est en train de construire un empire. Dans les années 1880, quand la course à l’Afrique commence à intéresser en métropole, sur le terrain, la concurrence fait rage entre Français. Basés à Saint-Louis du Sénégal, ceux qu’on surnommera « les Coloniaux » – et qui sont au départ des troupes de marine – entreprennent la remontée vers le Niger : en 1894, Tombouctou sera prise par des bateaux, acheminés en pièces détachées à dos d’hommes ! Et puis il y a l’Armée d’Afrique, ceux qui sont basés en Algérie et qui descendent vers le sud. Le Sahara est pris en étau par les deux armées qui cherchent à conquérir le maximum de territoire. Le résultat, ce sont les frontières d’aujourd’hui, tracées sans tenir aucun compte des populations et des cultures. Les Touaregs résistent et la conquête du Sahara par le sud va devenir très brutale.
Quand le Sahara est-il finalement conquis ?
Un peu avant la Première Guerre mondiale. La France se met à « extraire des hommes » pour suppléer sa faiblesse démographique face à l’Allemagne – c’est le thème de La Force noire, livre du futur général Mangin. Mais dès que le contrôle se relâche parce que les officiers sont rapatriés sur le front en France, des révoltes éclatent. Après la guerre, Paris dit aux militaires de dépenser le moins possible pour ce Sahara qui ne rapporte rien – à l’époque, les matières premières stratégiques que deviendront le pétrole et l’uranium sont encore inconnues. Pour que les tribus se tiennent tranquilles, on les met sous une cloche de verre, on les isole du monde extérieur : à cause de ça, les Touaregs rateront le coche des indépendances quatre décennies plus tard. Le mythe du Sahara et de l’homme bleu date des années 1920. Comme les militaires n’ont rien à faire, ils se promènent partout, observent, étudient. Et comme ils ont du temps, ils écrivent. Les Touaregs avec leur poésie, leur amour courtois, leurs boucliers, leurs lances et leurs épées leur rappellent les romans de chevalerie. Une très belle littérature lyrique coloniale est publiée par des officiers, et inspire des écrivains comme Joseph Peyré, auteur de L’Escadron blanc. L’engouement orientaliste pour le Sahara bat son plein dans l’entre-deux-guerres. Le cinéma et les livres de reportage prennent le relais de la littérature populaire : on est dans le fantasme absolu, qui sert la propagande coloniale.
La Seconde Guerre mondiale met-elle un terme à cette période-là ?
Oui, après 1945, l’image mythique du Sahara commence à pâlir. Il y a bien un sursaut après Diên Biên Phu. On favorise alors quelques livres sur le Sahara qui sont de la propagande pure et dure, sur fond de guerre d’Algérie. Il n’y a qu’à lire les titres : Notre Sahara. Une terre qui ressuscite ; La France, le pétrole et la dune… Le gouvernement français a espéré un moment garder le contrôle du Sahara pour exploiter les hydrocarbures et continuer les essais nucléaires. C’était l’idée de l’Organisation commune des régions sahariennes, créée en 1957, bien trop tard : l’expérience tourne court avec les accords d’Évian. Après les indépendances, la production éditoriale sur le Sahara connaît une chute vertigineuse. Cette véritable amnésie volontaire du désert, j’en ai été le témoin.
Et pourtant, vous avez publié 38 ouvrages, de photo ou de texte, sur les déserts…
C’est le rallye Paris-Dakar, lancé en 1978, qui a tout changé. Soudain le public français découvre à la télévision, en couleur, des paysages qu’il n’avait jamais vus. Le tourisme saharien prend son essor. Je me mets alors à publier un à deux livres par an, qui se vendent à plus de 10 000 exemplaires. Alors que La Caravane du Sel, que nous avions publié avec Théodore Monod en 1976, n’avait pas dépassé les 2 000 exemplaires ! Il y a alors une explosion de romans ; même des thèses austères, comme celle d’Edmond Bernus sur les Touaregs du Niger, s’écoulent à des milliers d’exemplaires. Pendant quinze ans, ça a été du délire. Et puis, une fois encore, la géopolitique est venue bouleverser la donne. Les révoltes des Touaregs, le banditisme, et bientôt l’installation du djihadisme armé rendent des régions entières du Sahara de plus en plus dangereuses. Moi-même je n’y retourne plus. Je garde une immense nostalgie de ses paysages, mais surtout de ses habitants que j’aime profondément. Il y a une anecdote que j’adore. Un jour, Saint-Exupéry dit à un Maure qui contemplait son avion : « Tu vois, avec ça je mets deux heures à faire un trajet qui, à toi, te prend deux mois en caravane. » L’autre a cette réponse magnifique : « Et le reste du temps, qu’est-ce que tu fais ? »
Propos recueillis par SOPHIE GHERARDI
« Le Sahara est le grand sablier de notre imaginaire »
Bruno Doucey
Pourquoi sommes-nous fascinés par le Sahara, génération après génération ?
Le Sahara, c’est l’immense tache blanche de la conscience occidentale. Terre inconnue, mais aussi surface de pr…
Un sable qui ne sert à rien...
Aline Richard Zivohlava
Les marchands de sable boudent le Sahara. Et pourtant, le grand désert africain est le premier gisement de la planète pour cette ressource minérale indispensable au BTP et à nombre d’industries. Le paradoxe n’est qu’apparent : il y a sable et sable et les caractéristiques physico-chimi…
Un sable qui ne sert à rien...
Aline Richard Zivohlava
Les marchands de sable boudent le Sahara. Et pourtant, le grand désert africain est le premier gisement de la planète pour cette ressource minérale indispensable au BTP et à nombre d’industries. Le paradoxe n’est qu’apparent : il y a sable et sable et les caractéristiques physico-chimi…