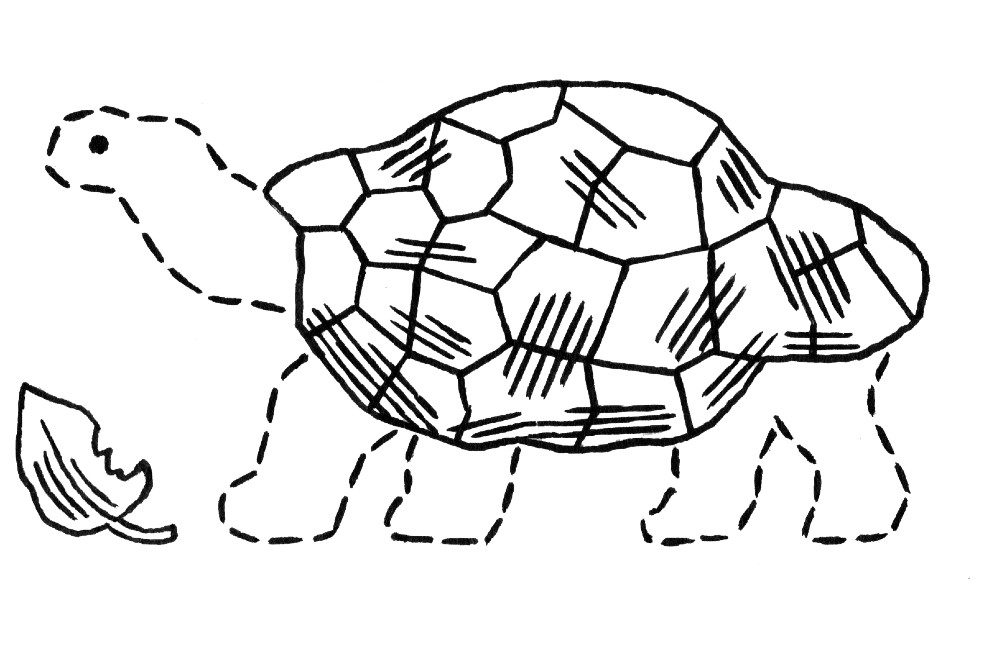« Moins un écosystème contient d’espèces, plus il est fragile »
Temps de lecture : 9 minutes
Quelle définition donneriez-vous de la biodiversité ?
C’est un terme qui a émergé à la fin des années 1980 et qui a connu un grand succès à partir du Sommet de la Terre en 1992, au point qu’il paraît désormais près de 30 000 articles scientifiques par an faisant référence à la « biodiversité ».
Or, la réalité qui se cache derrière ce terme est assez complexe. La biodiversité, c’est d’abord la biosphère, soit l’ensemble du tissu vivant de la planète. On peut ensuite l’observer avec différentes lunettes : cette biodiversité se caractérise-t-elle par sa richesse – soit le nombre d’espèces que l’on a sous les yeux – ou par des abondances – soit le nombre d’individus présents dans chaque espèce ? Et quel poids représentent ces différentes espèces dans le tissu total ? Sur la Terre, on sait aujourd’hui que la biodiversité pèse au total 550 milliards de tonnes, en poids carbone. Sur ces 550 milliards, les plantes en pèsent 450, les bactéries 70, et les animaux seulement 2 milliards de tonnes. Et encore, sur ces 2 milliards, la moitié de ce poids est occupée par les arthropodes [des invertébrés parmi lesquels les araignées, les insectes, les crustacés, etc.], devant les poissons et les mollusques.
Et enfin, si l’on se concentre sur les mammifères seuls, alors l’humanité ne représente que 0,06 milliard de tonnes, les animaux domestiqués 0,1, et les mammifères sauvages seulement 0,007. Cela signifie que le poids total des mammifères sauvages, dont l’ensemble des éléphants ou des baleines, est aujourd’hui quinze fois inférieur à celui des animaux que nous élevons pour notre usage !
Assiste-t-on à un recul de cette biodiversité ?
Depuis quelques décennies, nous sommes en mesure de quantifier objectivement les évolutions de la biodiversité. En Allemagne, par exemple, on sait désormais scientifiquement que 76 % des insectes ont disparu en une trentaine d’années. Mais il faut comprendre ce que signifie ce chiffre : aucune espèce d’insectes n’est éteinte, mais au sein de chaque espèce les abondances sont en fort déclin. En 2019, l’IPBES (l’équivalent en matière de biodiversité de ce que le Giec est dans le domaine climatique) a publié un rapport anticipant que 500 000 à 1 million d’espèces seraient menacées d’extinction. Ce chiffre est marquant, car il souligne l’ampleur des déclins d’abondance. Mais il gagne à être affiné.
« Si la biodiversité des sols était détruite, plus rien ne pourrait y pousser correctement »
Prenons les oiseaux : en France, depuis trente ans, le nombre d’oiseaux communs est en progression, car quelques espèces se portent bien. Pour des espèces emblématiques protégées, comme le héron ou le vautour fauve, les populations vont même nettement mieux. Mais cela ne doit pas faire oublier le fort déclin d’une foule d’autres espèces, notamment en raison des pesticides employés par l’agriculture qui finissent par déstabiliser des écosystèmes entiers. La richesse en oiseaux peut rester la même, mais pour combien de temps si les abondances s’effondrent ? Si l’on voulait tenter une analogie, on pourrait dire que les écosystèmes sont à l’image de la tour Eiffel : si vous retirez un rivet, voire une poutrelle, il y aura des reprises de charge qui peuvent maintenir l’ensemble, mais seulement jusqu’à un certain point. Moins un écosystème contiendra d’espèces, plus il sera fragile, jusqu’à risquer l’effondrement.
Toutes les espèces sont-elles essentielles ?
J’affirme dans mon livre, avec pas mal de provocation, qu’il vaudrait mieux voir l’éléphant disparaître que le ver de terre. Je ne souhaite en rien la disparition des éléphants, bien au contraire, mais leur absence ne déstabiliserait pas gravement l’équilibre de la planète. En revanche, si la biodiversité des sols était détruite, alors plus rien ne pourrait y pousser correctement, ce qui serait autrement plus sérieux.
La crise de la biodiversité que nous traversons est-elle vraiment comparable aux cinq grandes extinctions de masse que la planète a déjà connues ?
Tous les indicateurs signalent que nous sommes sur la trajectoire d’une grande crise, même si nous n’en sommes qu’au tout début. Lors des extinctions de masse du passé, 80 à 90 % des espèces ont disparu. Si l’on reprend le chiffre d’un million d’espèces menacées évoqué par l’IPBES, cela représente la moitié des espèces décrites par la science, mais seulement 10 % des espèces qui peuplent la Terre selon les estimations que l’on peut en faire. Nous serions donc encore loin de l’ampleur des extinctions passées. Mais se rassurer à bon compte serait ignorer que la vitesse des déclins et des disparitions est beaucoup plus rapide ! En seulement deux cents ans, nous avons éradiqué environ 3 % des espèces, alors que les grandes extinctions de masse en ont supprimé 80 % en l’espace d’un million d’années ! Nous ne sommes qu’à l’aube de cette sixième extinction, et sur une pente si forte qu’il est urgent d’agir.
Quelles sont les principales raisons de ces disparitions d’espèces ?
Le premier des « facteurs de pression », le plus important, est l’usage des espaces – c’est-à-dire l’artificialisation globale induite par la construction des routes, des villes, des parkings, des abris de jardin, des piscines, ou par les transformations agricoles intensives qui détruisent presque tout. Le deuxième facteur est la pollution, notamment de l’atmosphère, des océans ou des sols où se retrouvent ces mêmes intrants qui annihilent les insectes, les oiseaux, les vers de terre…
« Plus une espèce est complexe, plus elle sera fragile »
Il y a ensuite la surexploitation des ressources, essentiellement en mer où la surpêche est extrêmement problématique. Puis les déplacements d’espèces, qui conduisent à l’introduction de certaines potentiellement invasives qui déstabiliseront les écosystèmes. Et, enfin, il y a le changement climatique, qui vient notamment perturber la survie des individus. Toutes ces menaces finissent par s’accumuler et interagir, à l’image du changement climatique qui peut amplifier l’effet des pollutions ou l’arrivée de nouvelles espèces sur un territoire.
Y a-t-il des familles d’animaux plus fragiles que d’autres face à ces menaces ?
Il est difficile de prédire quelles sont les capacités d’acclimatation des individus et d’adaptation des populations. Les écosystèmes sont régis par des processus complexes, difficiles à appréhender dans leur globalité. Mais, en général, plus une espèce est complexe, plus elle sera fragile. Ce n’est pas un hasard si les amphibiens sont particulièrement touchés par la destruction des zones humides : c’est un groupe qui a besoin d’eau, d’un équilibre entre température et humidité, et qui est donc plus volontiers soumis aux perturbations.
Et nous, les humains ? Cette crise de la biodiversité doit-elle nous inquiéter ?
D’abord, sur un plan purement éthique, avons-nous le droit de priver nos descendants de la présence de telle ou telle espèce sur Terre ? Nous présentons en ce moment au Muséum une exposition, « Revivre », qui permet de voir des espèces disparues en réalité augmentée. Ces espèces, nos ancêtres nous ont privés de leur présence. On peut difficilement le leur reprocher, parce qu’ils n’avaient pas conscience de ce qu’ils faisaient. Nous n’avons plus cette excuse. Ensuite, sur un plan strictement utilitaire, il faut bien réaliser que nous utilisons une pharmacopée qui vient à 98 % du monde vivant. On ne part pas de zéro, on fait appel à des plantes, à des champignons, à des animaux, à des micro-organismes qui produisent des substances que l’on a appris à maîtriser et à utiliser.
« La vie ne peut pas se mettre en équations, elle s’adapte, elle évolue, elle n’obéit à aucune règle prédéterminée »
Donc, de manière très égoïste, faire fondre la biodiversité, c’est supprimer les molécules du futur qui pourraient nous aider à nous soigner. Si l’on avait fait disparaître avant Fleming certaines moisissures, jamais nous n’aurions disposé de la pénicilline. De même, jamais nous ne pourrions utiliser la ciclosporine, une molécule qui permet d’éviter les rejets de greffe, si nous ne l’avions pas d’abord retirée d’un champignon microscopique de Scandinavie. Nous-mêmes appartenons au vivant et interagissons avec lui. Notre microbiote intestinal est indispensable à notre digestion, tout comme la pellicule de bactéries qui protège notre peau. L’oxygène de l’air que nous respirons dépend de la biodiversité, continentale et en partie marine. Il ne faut donc surtout pas nous croire tout-puissants.
Serions-nous capables de vivre dans un écosystème artificiel, sans aucun élément sauvage ?
L’expérience a été tentée avec Biosphère II, un dôme immense, construit dans le désert américain, dans lequel on avait inséré plusieurs écosystèmes différents censés maintenir un équilibre permettant la survie d’humains en totale autarcie. Et l’opération a été un échec, les conditions se sont détériorées et le dôme est devenu impropre à la survie. Cela nous a rappelé à quel point il est difficile d’appréhender la complexité d’un écosystème dans sa globalité. La vie ne peut pas se mettre en équations, elle s’adapte, elle évolue, elle n’obéit à aucune règle prédéterminée. Nous n’avons jamais su anticiper, entre autres, les conséquences de l’introduction, volontaires ou non, de certaines espèces dans des territoires : aux îles Kerguelen, l’arrivée de rats, de lapins et de chats a mis en péril bon nombre d’espèces endémiques.
Dans quelle mesure l’homme est-il responsable du monde sauvage et de sa préservation ?
Pendant longtemps, nous nous sommes considérés comme extérieurs au reste du monde, avant de réaliser que nous sommes une espèce parmi d’autres, en interaction permanente avec le reste du vivant. Et c’est pour cela qu’en protégeant la biodiversité, nous nous protégeons nous-mêmes.
« Le véritable problème de la crise de la biodiversité est qu’elle est moins spectaculaire que la crise climatique »
Mais nous ne pouvons pas non plus abandonner le dualisme homme-nature d’hier pour basculer dans un monisme total – l’homme n’est qu’un animal parmi d’autres et rien ne le sépare des autres –, une vision qui ferait de nos actions le simple produit de l’évolution et qui nous déresponsabiliserait totalement. Notre gros cerveau, qui nous sert à produire des usines, des routes et des avions, doit aussi nous imposer un devoir de réflexion. Oui, nous appartenons au vivant, mais nous avons une responsabilité envers lui.
Pourquoi est-ce difficile de sensibiliser à cette crise de la biodiversité ?
Pendant des siècles, les changements étaient si lents qu’ils étaient imperceptibles. Le déclin des oiseaux, par exemple, a commencé au milieu du XIXe siècle, avant de s’accélérer. Mais le véritable problème de la crise de la biodiversité est qu’elle est moins spectaculaire que la crise climatique, car elle n’est pas jalonnée par des événements extrêmes. Les canicules, les inondations, les sécheresses nous marquent profondément ; les souvenirs que nous en avons constituent des alertes par rapport au changement climatique. En ce qui concerne la biodiversité, c’est très différent : il n’y a pas d’hécatombes brutales, pas de cadavres d’animaux qui jonchent le sol, mais des générations de moins en moins abondantes qui s’éteignent peu à peu. La moitié des moineaux parisiens ont disparu en vingt ans, sans que l’on s’en rende compte, car nous n’avons pas vu des masses de cadavres. Cela explique qu’en matière de biodiversité, nous souffrons d’amnésie environnementale.
Comment y remédier ?
En s’appuyant sur la science, sur les données que le Muséum et d’autres continuent de recueillir pour établir la trajectoire sur laquelle nous nous situons, mais aussi en rappelant à la population quelques souvenirs marquants. Il y a quelques décennies, vous ne pouviez pas faire un long voyage en voiture sans avoir le pare-brise couvert d’insectes. C’est maintenant fini. De même que les hérissons écrasés sur le bord des routes, vous n’en voyez plus. Et ce n’est pas, hélas, parce qu’ils ont appris à traverser.
Propos recueillis par JULIEN BISSON
« Moins un écosystème contient d’espèces, plus il est fragile »
Bruno David
Un milliard. C’est le nombre d’animaux marins, coquillages et crustacés notamment, décimés en quelques jours dans le nord-ouest de l’Amérique, terrassés par la vague de chaleur de début juillet et son mercure approchant les 50 degré…
[Barbatruc]
Robert Solé
POURQUOI chercher midi à quatorze heures alors que le sauvetage des espèces menacées a été brillamment résolu dès 1974, il y a plus de quarante ans ? Rappelez-vous : dans L’Arche de Barbapapa, les petits personnages qui peuvent prendre toutes les formes défendent les animaux pourchassés …
Une sixieme extinction ?
Au cours des dernières décennies, le rythme de disparition de la faune sauvage a crû à un rythme alarmant. Sont désormais concernées des espèces de toute taille, dans tous les milieux naturels, à commencer par les zones tropicales humides, riches en biodiversité. Assiste-t-on à un phénomène compa…