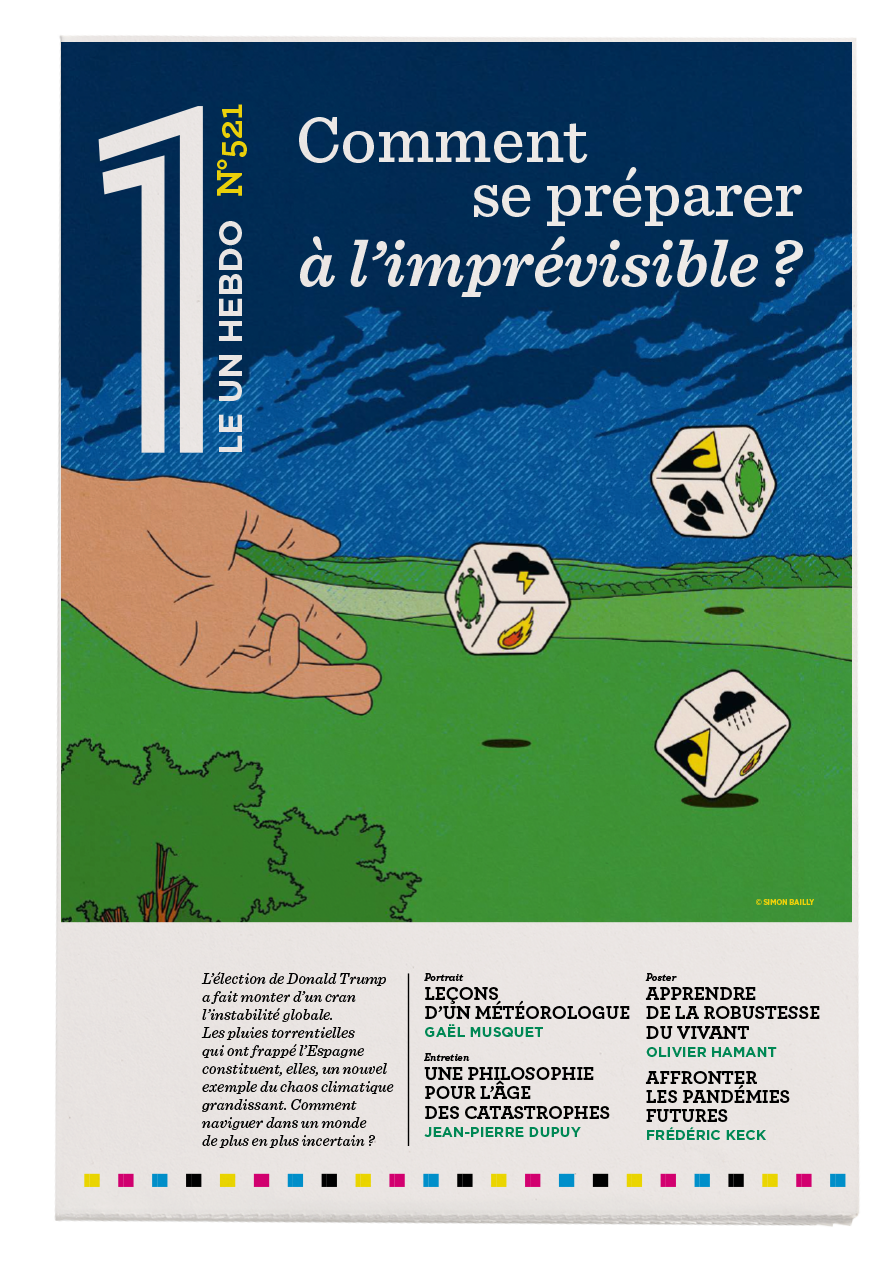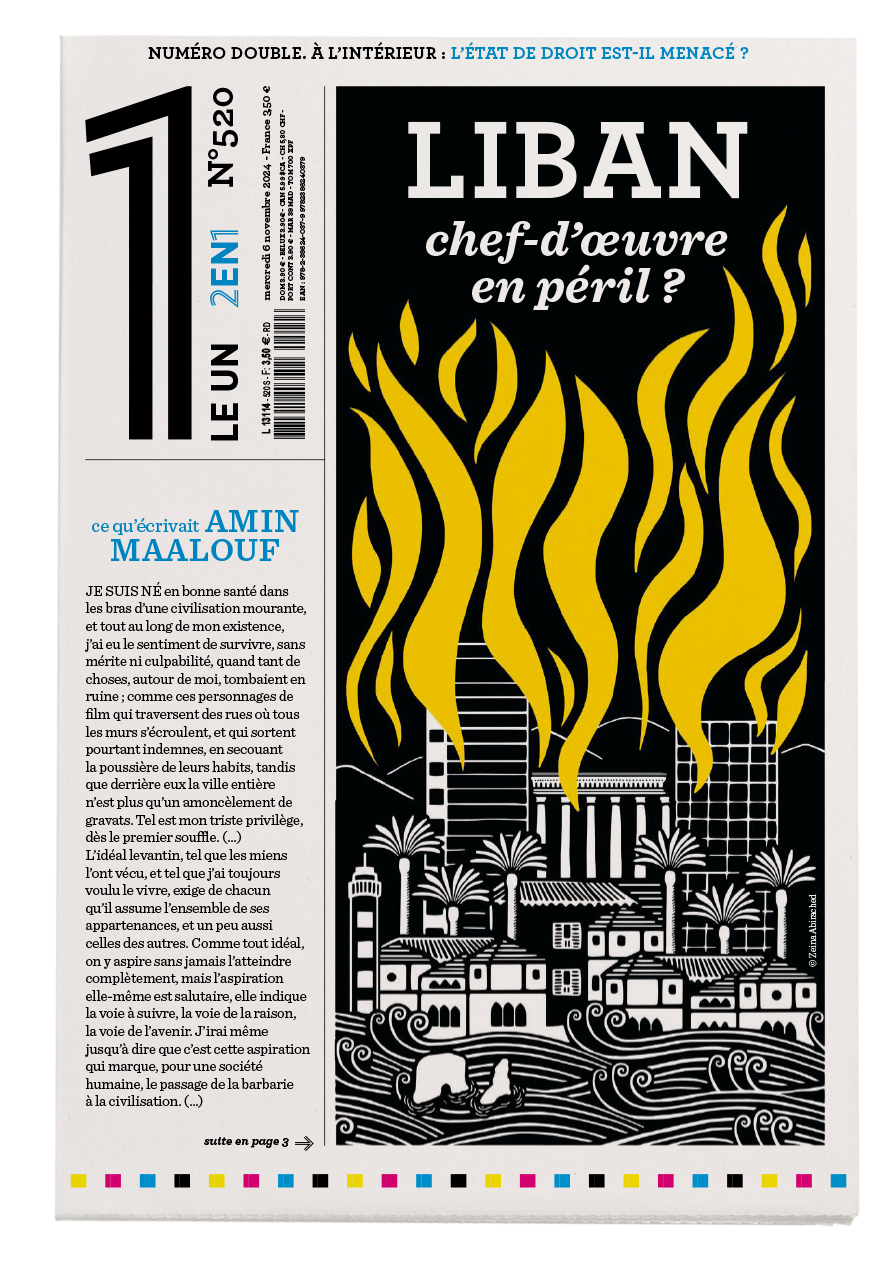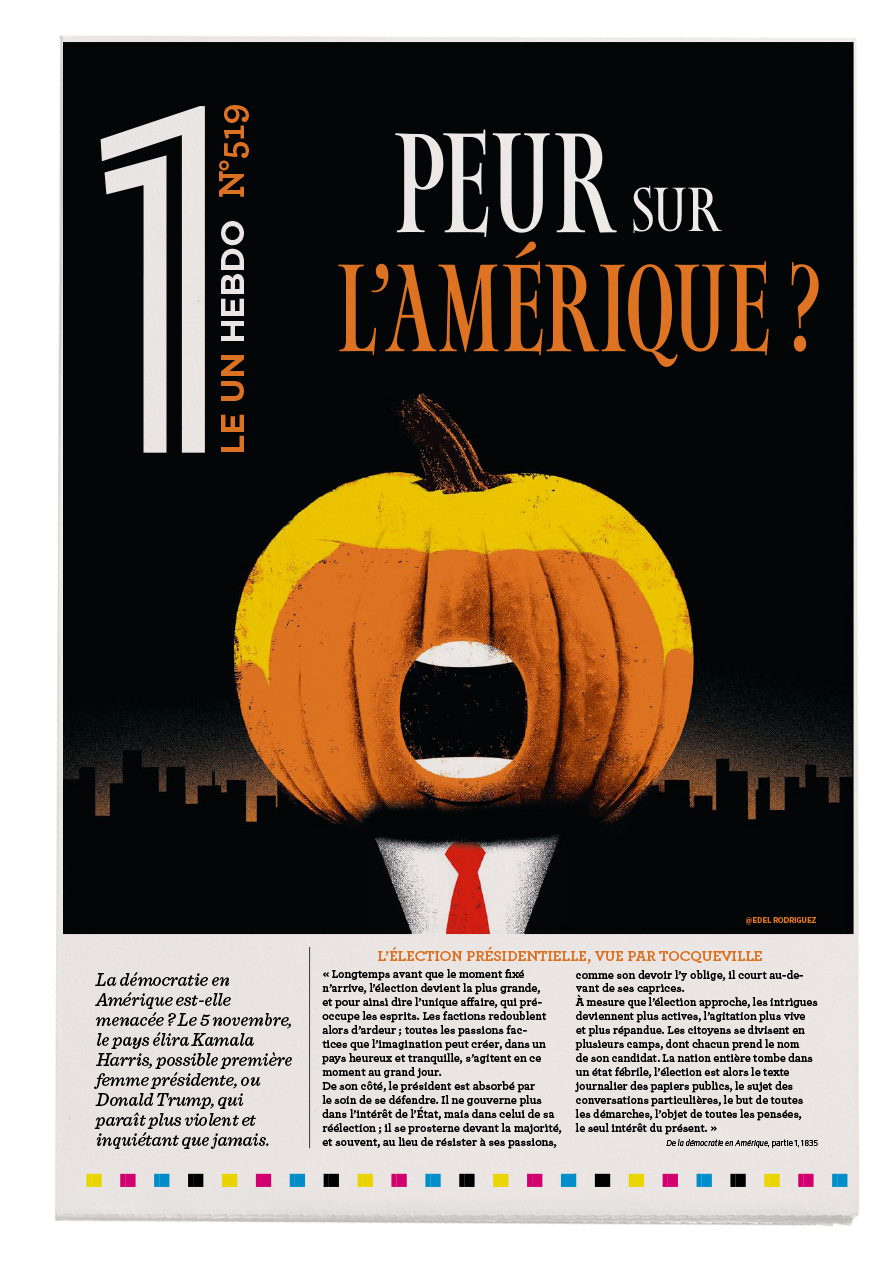Écran, mon bel écran !
Temps de lecture : 8 minutes
Connectez-vous sur Instagram et prenez le temps de naviguer sur des comptes d’influenceuses beauté. Vous y trouverez, par milliers, des clichés étroitement cadrés sur un œil maquillé, une bouche aux lèvres rouges parfaitement ourlées, ou une main aux ongles peints avec un soin infini. De nos jours, la beauté est devenue synonyme d’ultraprécision, et se maquiller un travail du microdétail assumé. Dans Jewish Matchmaking, la dernière téléréalité de Netflix dans laquelle de jeunes Juifs recherchent, avec l’aide d’une entremetteuse professionnelle, leur âme sœur, une candidate exige, face caméra, que les sourcils de son futur époux soient « aussi beaux que les [s]iens ».
L’apparition des écrans dans nos vies explique en grande partie ce phénomène, mais celui-ci s’inscrit dans une histoire plus longue, quoique relativement récente. Jusqu’au tournant du XXe siècle, la plupart des gens n’avaient qu’une vague idée de leur propre apparence physique. Trois inventions sont alors venues modifier considérablement notre rapport à nous-mêmes, à quelques décennies d’intervalle. D’abord, la démocratisation du miroir, jusqu’alors réservé aux élites. Les milieux populaires ne se contentent plus d’un minuscule accessoire de mauvaise qualité acheté auprès du colporteur. Le miroir est introduit dans toutes les chambres à coucher, puis dans toutes les salles de bains. À la même époque, l’arrivée de l’éclairage électrique dans les foyers permet de se scruter avec encore plus de précision et de prêter davantage d’attention aux couleurs. Enfin, l’accès au portrait photographique finit de modifier profondément le rapport à soi, causant parfois un véritable choc psychologique. Le grand photographe Nadar raconte que certains clients refusaient leur portrait ou le confondaient avec celui d’un autre. Beaucoup demandent à être embellis, et la retouche constitue rapidement une part considérable du travail des studios. Le « nouveau Narcisse » est né, selon l’expression de l’ethnologue Élisabeth Azoulay. Mais il n’a pas dit son dernier mot.
« Depuis peu, les maquilleuses professionnelles se voient demander un "effet iPhone 13" »
Un siècle plus tard, les écrans accentuent la tendance de manière débridée. Ces rectangles numériques remplacent nos miroirs. On se regarde et on se donne à voir à travers eux. On apprend à connaître son visage au pixel près et on publie en ligne ses microdétails pour obtenir des autres l’approbation et la reconnaissance de notre beauté, mais également des techniques employées pour la mettre en valeur. Car grâce aux réseaux sociaux, l’art du make up est sorti de l’ombre. Sur YouTube, des millions de tutoriels font du processus de transformation un véritable spectacle. Ce même processus qui, parce qu’il permettait à la femme de passer « de la laideur à la beauté », dégoûtait les auteurs antiques. Pour désigner une femme maquillée, Socrate parlait d’« une guenon tout enduite de céruse ». Quant à Ovide, il conseillait aux hommes qui voulaient réfréner leurs pulsions de surprendre leur dulcinée pendant sa toilette. « Vous verrez alors ses boîtes de pommade aux mille couleurs. […] Aussi, que de fois elles m’ont soulevé le cœur. » Avec les tutoriels, Ovide est renvoyé au placard. Le maquillage passe du boudoir à la place publique, de la honte à la fierté. On partage ses techniques, son savoir-faire, et les clichés en gros plan sont là pour les mettre en lumière.
Quand les écrans dictent leur loi à l’industrie
L’industrie cosmétique qui, contrairement à celle de la mode, n’a jamais cherché à développer le discours du « consommez moins, mais mieux » a largement profité de cette levée de tabou autour du maquillage. Les tutoriels ont conduit à une explosion de la quantité de produits cosmétiques consommés. Mais pour profiter au maximum de cette évolution, l’industrie a aussi été contrainte de s’adapter. Le smartphone n’est pas seulement un outil d’observation de soi. La qualité des écrans évoluant un peu plus chaque année, il devient aussi source d’inspiration. Depuis peu, les maquilleuses professionnelles se voient demander un « effet iPhone 13 », que l’on pourrait décrire comme une peau sans défauts et particulièrement lumineuse, avec un « teint glowy », c’est-à-dire une légère brillance sur certaines parties du visage, comme les pommettes, le coin intérieur de l’œil et le bout du nez.
Le maquillage est sommé de se perfectionner au rythme de la technologie car, de plus en plus, on se maquille pour plaire directement aux écrans. En 2019, lors du lancement de sa collection de cosmétiques, l’ex-Spice Girl Victoria Beckham confiait qu’elle avait cherché à créer une poudre en mesure de réagir parfaitement à toutes les lumières, y compris celle des appareils photo. Car dans notre monde envahi d’écrans, pense-t-elle, mieux vaut toujours être prête à être photographiée. Personne n’avait contesté.
« L’idée que le visage que l’on a dans la vraie vie et le visage que l’on présente au monde en ligne n’est pas le même est désormais admise »
Même pendant la pandémie, qui aurait pu sonner le glas de l’industrie cosmétique, celle-ci a su garder le cap. Les femmes ont certes arrêté de se maquiller, mais elles n’ont pas passé moins de temps à se scruter. Celles qui ont eu la possibilité de télétravailler ont même dû supporter leur image à travers une webcam, souvent bas de gamme, plusieurs heures dans la journée. La peau est devenue un objet d’intérêt particulier. Nous avons cessé de la camoufler, mais nous avons eu le temps de la badigeonner de toutes sortes de soins. Nous n’avons pas consommé moins, nous avons simplement changé notre manière de le faire. Les hommes, aussi, se sont parfois vus pour la première fois. Ils ont été nombreux à se tourner vers des gels teintés pour lutter contre l’image déprimante que la caméra leur renvoyait. Cette tendance du no make up perdure aujourd’hui sur les réseaux. Des tonnes d’influenceuses, généralement jeunes et belles, se montrent au naturel tout en omettant de mentionner que pour continuer à répondre aux canons de beauté actuels, elles dépensent tout leur temps et leur argent dans le sport, une alimentation archi-saine et des soins pour la peau aux prix inaccessibles pour la plupart d’entre nous.
L’industrie cosmétique n’a pas été la seule à profiter des conséquences de la pandémie de Covid-19. Certains médecins esthétiques ont observé une augmentation des demandes. Celles-ci ont principalement porté sur le regard, zone où se voit la fatigue, signe de maladie particulièrement malvenu en ces temps troublés, mais également dernière zone du visage visible alors que nous étions tenus d’avoir un masque en public. La blépharoplastie, une chirurgie des paupières qui donne un air beaucoup plus éveillé, a connu un boom. Cette intervention a souvent été accompagnée d’un traitement des cernes qui, en fonction de leur forme, peuvent être modifiés dans leurs contours ou comblés avec du gras.
Vers une libération ?
Qu’il s’agisse de maquillage, de filtre ou de chirurgie, il est de plus en plus accepté de ne plus vraiment se ressembler soi-même. L’idée que le visage que l’on a dans la vraie vie et celui que l’on présente au monde n’est pas le même est désormais admise, notamment par les jeunes générations qui n’hésitent plus à montrer ces deux facettes en ligne comme dans la vraie vie. Un nouveau réseau social baptisé BeReal oblige même, à une heure donnée, à s’exposer sans filtre dans sa vie quotidienne.
« Les réseaux sociaux avaient permis, grâce aux influenceurs et aux influenceuses, d’ouvrir le spectre de la beauté »
Les écrans vont-ils pour autant nous libérer de notre image ? C’est ce que pensent les plus optimistes. En apprenant à dissocier notre image numérique de notre image réelle, peut-être pourrons-nous d’un côté nous permettre de la modifier avec plus de liberté et d’excentricité, et de l’autre accepter davantage ce que la nature nous a donné. Pour une femme, ne pas se maquiller deviendra ainsi un choix aussi valable que celui de le faire. La version plus pessimiste consiste à penser que puisque les écrans vont nous renvoyer une version de plus en plus modifiée de nous-mêmes, nous serons de plus en plus tentés de devenir cette image. Les deepfakes, basés sur l’intelligence artificielle, nous mènent sur cette voie. Né il y a quelques mois sur TikTok, le filtre à succès « Bold Glamour » permet de changer son visage non plus sur une image mais sur une vidéo. La qualité de la technologie est époustouflante. Véritable promoteur du maquillage et de la chirurgie esthétique, ce filtre fait ressembler tout utilisateur à l’un des membres de la famille Kardashian : des lèvres plus pulpeuses, des sourcils arqués et sombres, un maquillage soutenu et des traits chirurgicalement modifiés.
Les réseaux sociaux avaient permis, grâce aux influenceurs et aux influenceuses, d’ouvrir le spectre de la beauté, d’en pirater les normes. Le maquillage, en particulier, n’était plus l’apanage des femmes blanches, des figures comme Kim Kardashian ayant universalisé des techniques de mise en beauté comme le contouring, initialement pratiqué par les femmes racisées et transgenres. Les hommes commencent aussi à se faire leur place. Mais, avec l’évolution de l’intelligence artificielle, un retour en arrière pourrait s’opérer. Ces technologies restent biaisées par les préjugés des gens qui les conçoivent – pour la plupart des Blancs – et la beauté pourrait tendre vers encore plus d’uniformité. Il est aujourd’hui trop tôt pour connaître les conséquences précises de l’IA sur l’univers de la beauté, mais il est certain que, comme le miroir, l’électricité, la photographie et les écrans, celle-ci va continuer de faire évoluer fortement notre rapport à la manière dont on se voit, dont on s’embellit, et dont on s’apprécie. Pour le meilleur, ou pour le pire.
Conversation avec MANON PAULIC
« La beauté est un langage sans mots »
Élisabeth Azoulay
Entre kaléiodoscope historique et donnée universelle, l'anthropologue Élisabeth Azoulay revient sur notre éternelle quête de la beauté.
[Retouches]
Robert Solé
Salut les filles ! Merci pour tous vos likes. Après ce lipofilling fessier, j’ai hâte de montrer mon petit body à mes followers.
Une coïncidence à soi
Camille Froidevaux-Metterie
La philosophe Camille Froidevaux-Metterie analyse la façon dont le souci esthétique de soi peut, chez les femmes, s’affranchir des diktats patriarcaux pour, au contraire, devenir un moyen de reprendre possession d’un corps objectivé et asservi.