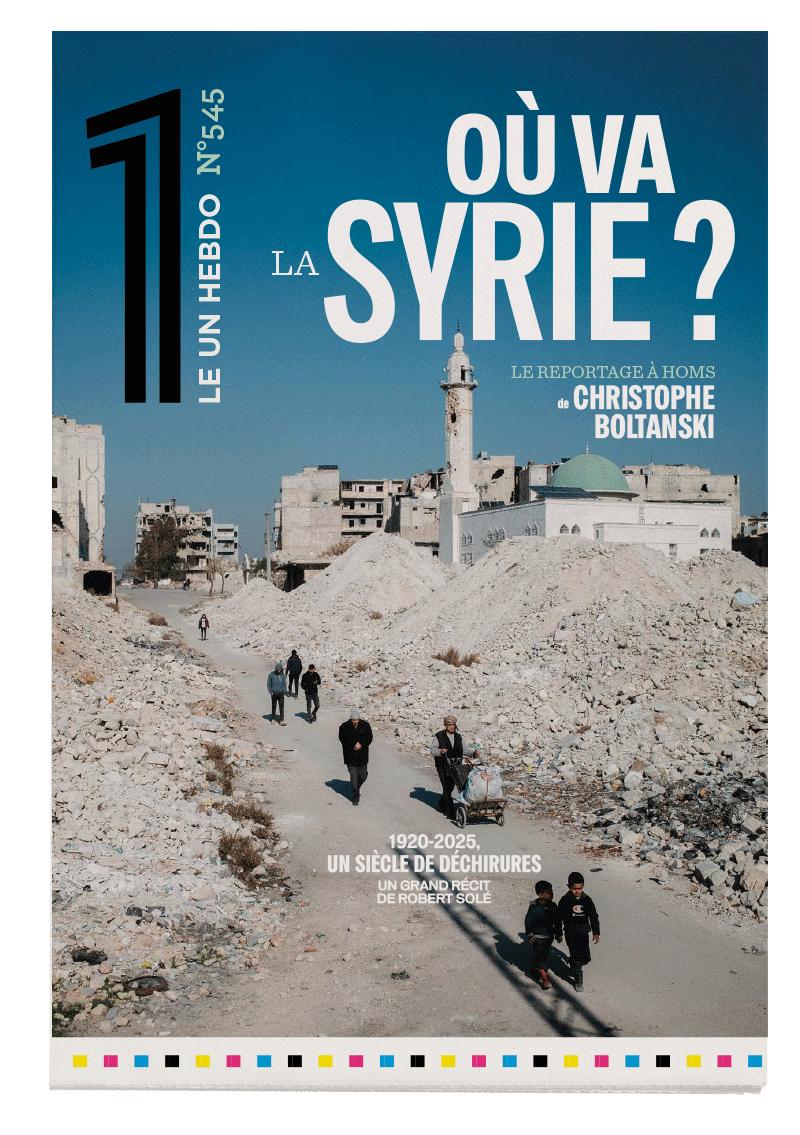Le pays que j’ai gagné
Temps de lecture : 6 minutes
J’ai rêvé de la France.
Je n’imagine pas ma vie sans ce rêve.
Je suis né en Roumanie sous la dictature de Ceausescu. Un beau pays, mais conquis par la peur. Une Roumanie francophone, latine, littéraire. Je suis né à Bucarest, que Paul Morand appelait « le petit Paris ».
Mon père était rédacteur en chef du plus grand journal culturel roumain. Ma mère éditait des livres pour la jeunesse. Je me souviens d’un soir où un ami français de mon père, journaliste au Monde, est venu à la maison. Mes parents avaient invité plein d’intellectuels roumains. Tous parlaient le français. Même entre eux, afin que l’ami étranger ne se sente pas mal à l’aise.
Mon père, traducteur des œuvres de Malraux, avait fini par se lier d’amitié avec le grand écrivain, alors ministre de la Culture. De temps en temps, il effectuait des voyages à Paris. D’abord on lui refusait le visa. Malraux appelait, on lui délivrait alors un passeport sous la menace qu’il allait nous arriver malheur, à nous, le restant de la famille, si mon père avait la mauvaise idée de demander l’asile politique là-bas. La France était son oxygène. Il rapportait des cartes postales. On refaisait le voyage avec lui. Il rentrait aussi avec des cartons remplis de livres qu’il cachait sous la banquette du train. à l’époque on voyageait en train ; Bucarest-Paris : trois jours et trois nuits. Sous la banquette, car les livres étaient interdits. Ma mère et lui lisaient tous ces livres, jusqu’au dernier, c’était leur croisière à eux. Toute prison a des portes de sortie invisibles. Ils les prêtaient aussi à leurs amis. Un livre français ne sortait de chez nous qu’enveloppé dans du papier journal afin qu’on ne puisse pas voir la couverture. Puis, rentré à la maison, le livre trouvait sa place dans les bibliothèques de mes parents. Bibliothèques organisées sur deux rangées : devant, les livres roumains autorisés ; derrière, cachés, les livres interdits. Tout intellectuel roumain avait à l’époque une bibliothèque profonde.
Nos parents nous posaient souvent la question, comme un jeu, à mon frère et à moi : « Si demain vous quittiez le pays, où iriez-vous ? » La France l’emportait haut la main. Tout y était : la liberté, la culture, les cafés, les belles femmes, le vin, la gastronomie, la folie, la joie de vivre, la Côte d’Azur, Louis de Funès, Truffaut, Brigitte Bardot, Alain Delon, le Louvre, la tour Eiffel, les Champs-Élysées, le champagne, le cancan, Coco Chanel, les Folies-Bergère, Malraux, Camus, Sartre, Duras, le mont Blanc, la Renault 16, la Citroën DS, le Tour de France… La France était la Beauté, le Paradis qu’on rêvait d’atteindre, nous qui faisions la queue pour du papier toilette.
J’ai atterri en France le 4 décembre 1980. Paris était vêtu en père Noël, des ampoules allumées et des lumières colorées souriaient de partout. Alors qu’à Bucarest, le cher Conducator faisait des économies d’électricité en coupant le chauffage et l’éclairage des rues. Même les agresseurs avaient peur. Un sentiment étrange m’a soudain envahi : cette richesse était indécente. J’avais atterri dans un conte de fée et cela me chagrinait. Ce n’était pas la faute de la France si Bucarest était plongé dans le noir.
Le lendemain je suis allé à l’IDHEC (l’Institut des hautes études cinématographiques, l’actuelle Fémis) en costume trois pièces. Vous imaginez le ridicule. Le calvaire s’est poursuivi car, dans cette ambiance très post-soixante-huitarde, les étudiants refusaient le cours proposé par le professeur. La journée s’est écoulée sans qu’on ait parlé de cinéma. Je me revois encore : bouillonnant, je me lève, je m’énerve, et, brillamment servi par le peu de mots de mon vocabulaire et par mon accent à faire fuir cinq partis de Le Pen, je me dis indigné d’avoir eu tant de mal à atteindre la France et cette grande école pour être témoin de cette perte de temps. Je reçois un tsunami d’insultes, dont la plus féconde pour mon avenir dans le pays des droits de l’homme : « Rentre chez toi si tu n’es pas content ! ». Franchement, cette phrase m’a aidé. Je me suis mis à écouter la radio, à copier des textes, à soigner mon français. Je ne voulais plus être différent. Je voulais écrire et parler aussi bien qu’eux, sinon mieux. Je pensais qu’un jour ils allaient m’accepter, que je serais français.
J’aime ce pays, car il ne m’a pas été donné à la naissance, je l’ai « gagné ». J’aurai toujours en France le gros plan du Français que je suis devenu, et le plan large de l’étranger que je demeurerai. Je m’étonne toujours quand on nous reproche d’être les seuls à défendre la culture, « ah vous, les Français ! ». Eh oui, nous, moi, le Français, comment pourrais-je ne pas continuer le combat des Voltaire, Beaumarchais, Malraux, Lang ? Se battre pour le sens et la liberté d’expression : c’est ça être français.
Depuis, j’ai parcouru le monde pour tourner mes films et aussi pour défendre la « diversité culturelle ». J’ai découvert ce que je savais déjà petit en Roumanie : la France est fantasmée par la majorité des citoyens du globe. Seuls les Français oublient combien ils sont riches, combien les gènes de leur pays sont forts. Trop gâté par ce cadeau que j’ai gagné, suis-je devenu sourd et aveugle aux difficultés de mon pays ? Je ne pense pas. Mais j’ose croire qu’on ne guérit jamais le mal par le pire, mais par le rêve, la volonté, la solidarité, l’intelligence.
Alors, râlez, râlons, car c’est aussi cela, être français. Réjouissons-nous de pouvoir le faire.



Tombe la neige
Duong Thu Huong
Nous commençons à rêvasser dès notre jeune âge. Cela commence souvent vers nos treize, quatorze, quinze ans ou un peu après vers nos seize ou dix-sept ans. Mais nos rêves les plus grands, les plus fous, ceux qui seraient si puissants qu’ils pour…
Source
Erik Orsenna
Au commencement est la source. C’est elle qui engendre le rêve. Et si se tarit la source, meurt le rêve.
Mais, par nature, les sources sont vagabondes. Elles peuvent décider d’arrêter de couler ici pour resurgir ailleurs.
Ainsi le rêve français.
Sa source fut l’État. Qui s…
Une nuit au Panthéon
Ollivier Pourriol
– À quoi tu rêves, Voltaire ?
– Et toi, Jean-Jacques ?
– À rien. Enfin, si. Je me dis que si on rêve, c’est qu’on dort. Et que si on dort, on devrait finir par se réveiller. Non ?