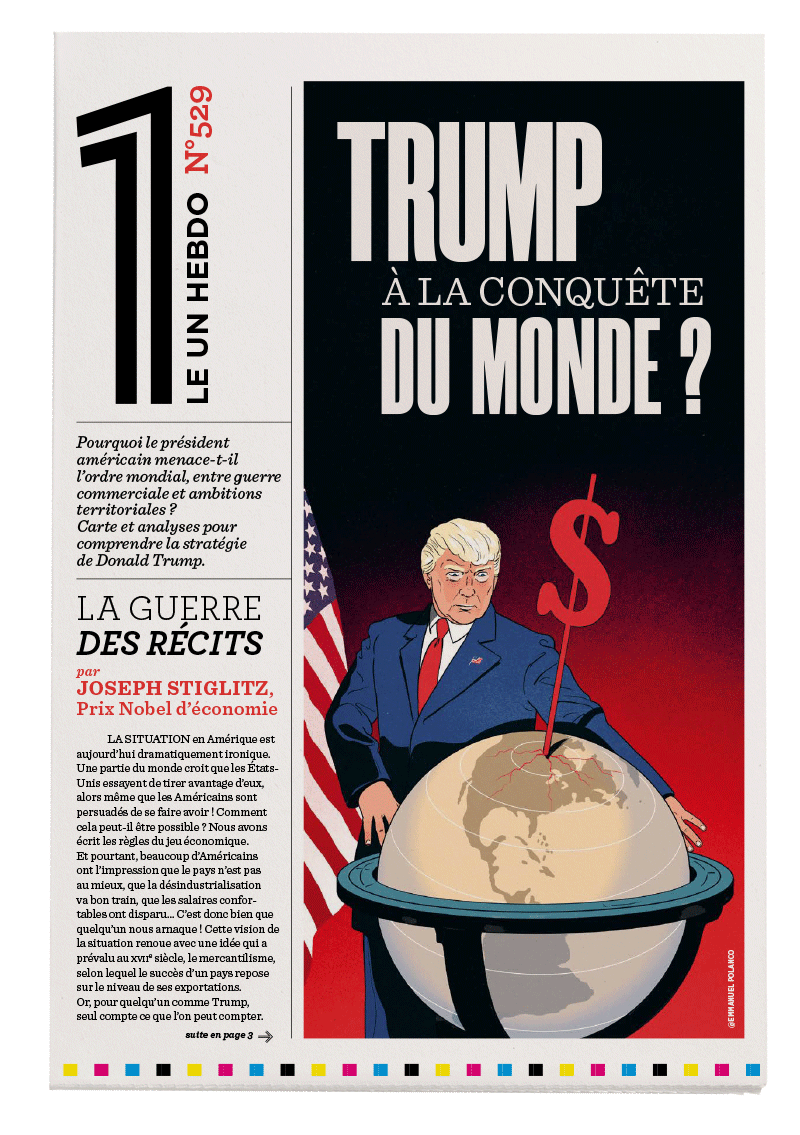Une révolution sur le marché du travail
Temps de lecture : 6 minutes
Doit-on craindre que l’intelligence artificielle génère ce que Keynes appelait un « chômage technologique » ?
Depuis les débuts de la modernité il y a près de trois cents ans, on assiste à intervalles réguliers à des bouffées d’inquiétude quant au développement de la technologie et au remplacement des humains. Ces inquiétudes se sont, pour la plupart, révélées fausses : il y a toujours eu assez de travail pour tout le monde ; et quand il n’y avait pas assez de travail, ce n’était pas la faute de la technologie, mais en raison d’autres facteurs, politiques ou économiques. Je ne crois donc pas qu’il faille céder à une forme de panique et croire que les robots pourraient nous remplacer du jour au lendemain. Pour autant, il apparaît légitime de se préoccuper des impacts forts qu’aura cette révolution-là sur le marché du travail.
Pourquoi ?
En raison de la capacité des intelligences artificielles à prendre en charge des tâches qu’on imaginait jusqu’alors dévolues seulement aux humains : diagnostic médical, conduite de voitures, composition musicale, dessin architectural, rédaction de textes juridiques ou encore d’articles de presse… L’IA fait irruption, de manière progressive, dans des secteurs d’activité où pendant longtemps les travailleurs se sentaient nécessaires et protégés.
En l’occurrence, on parle là de métiers typiques des cols blancs, et non plus des cols bleus, touchés il y a quelques décennies par la robotisation des usines…
C’est l’un des paradoxes de l’intelligence artificielle, connu sous le nom de « paradoxe de Moravec », du nom du futurologue Hans Moravec : « Le plus difficile en robotique est souvent ce qui est le plus facile pour l’homme. » En l’occurrence, des activités manuelles très simples sont très compliquées à reproduire par des robots, alors que des activités intellectuelles qui nous paraissent complexes peuvent être désormais prises en charge de façon efficace par des programmes informatiques. On n’aura pas de coiffeurs ou de jardiniers robotiques, mais on pourra avoir des tâches accomplies par des experts juridiques, des graphistes ou des écrivains virtuels. Et ce paradoxe pose plusieurs problèmes. D’abord pour notre modèle éducatif : plus le niveau formel d’éducation augmente, plus la tâche pour laquelle vous avez été formé est susceptible d’être prise en charge par une machine. Cela va à l’encontre de nos représentations habituelles et peut bouleverser la façon de concevoir les études. Ensuite, cela joue sur la structure même du marché du travail, en aggravant une tendance déjà forte en Occident, qui est la polarisation croissante entre le bas et le haut de l’échelle, avec un affaiblissement des échelons intermédiaires.
«On risque de se concentrer d’un côté sur des jobs non qualifiés mais toujours nécessaires, dans le domaine du travail manuel ou du soin par exemple, et de l’autre sur des professions extrêmement qualifiées, difficiles à automatiser»
On risque de se concentrer d’un côté sur des jobs non qualifiés mais toujours nécessaires, dans le domaine du travail manuel ou du soin par exemple, et de l’autre sur des professions extrêmement qualifiées, difficiles à automatiser, celles-là, parce qu’elles exigent des talents en matière de communication ou de résolution de problèmes. C’est un enjeu essentiel, car si on laisse le marché du travail se structurer ainsi, on rend difficile toute possibilité de mobilité sociale.
Est-ce que cela signifie que de nombreux métiers vont être détruits dans les décennies à venir ?
Non, ce serait trop simpliste de poser les choses ainsi. Dans l’histoire des derniers siècles aux États-Unis, un seul métier a officiellement disparu de la classification : celui de liftier. Les autres ont subsisté, mais la nature des tâches effectuées a évolué. On peut penser qu’il en sera de même avec l’IA. Une récente étude du cabinet McKinsey a conclu qu’aux États-Unis, seuls 5 % des 820 métiers étudiés pourraient être entièrement automatisés ; en revanche, dans la majorité des autres, une proportion significative des tâches – au moins 30 % –, est susceptible de l’être. Cela signifie qu’il faudra se préparer à voir ces métiers évoluer profondément. Or, et c’est là pour moi une vraie source d’inquiétude, nous ne semblons pas prêts à mettre en place les outils nécessaires en matière d’éducation ou de formation continue pour faire face à ces évolutions majeures. Il y a un siècle, au moment où s’est mise en place l’éducation de masse, il était possible d’apporter à tous un bagage de connaissances minimales pour pouvoir passer des champs aux usines, puis des usines aux bureaux. Mais songez à un chauffeur de taxi que la voiture autonome mettrait demain au chômage : il faudrait beaucoup de temps et de moyens pour lui permettre de devenir programmateur informatique, capable de coder ces technologies ! Et comment se reconvertir aussi drastiquement quand on est en milieu ou en fin de carrière ? Ce sont des exigences qui paraissent irréalistes, et qui rappellent que l’éducation ne pourra pas être la panacée.
«Comment distribuer un revenu aux gens dans un monde où le travail pourrait être de plus en plus souvent automatisé ?»
Y a-t-il un risque d’accroissement des inégalités ?
Oui, et je ne crois pas d’ailleurs qu’il y ait une coïncidence dans le double mouvement actuel d’accroissement des inégalités et d’accroissement des inquiétudes. Il y a ce sentiment que non seulement le produit des efforts fournis n’offre plus le même niveau de revenu, avec une concentration dans les mains de ceux qui détiennent les outils de production, mais aussi que l’automatisation vient mettre en péril l’existence même de ces revenus. La réponse à cette inquiétude est évidemment politique. Comment distribuer un revenu aux gens dans un monde où le travail pourrait être de plus en plus souvent automatisé ? L’expérience de la pandémie nous a indiqué la voie, en montrant le rôle crucial de l’État dans la répartition équitable de la prospérité, avec des filets de secours qui se sont révélés essentiels. Dans un monde où le travail se raréfierait, on peut imaginer, par exemple, la distribution d’un revenu universel sous conditions. Mais cette raréfaction n’est pas qu’un problème économique, c’est aussi un enjeu de sens : comment bâtir une société quand ce qui a si longtemps fait le cœur de la vie des hommes s’évapore peu à peu ?
«Très vite, nous allons réaliser que l’expansion de ces technologies va moins dépendre de leur faisabilité technique que de notre propre volonté de les intégrer ou, au contraire, de les ralentir ou de les refuser»
Le développement de ces technologies présente-t-il un caractère inexorable ?
Il y a une réalité technologique : l’accroissement rapide des potentialités de ces outils. Mais ce n’est pas la seule dimension, il y a aussi une question culturelle. Que sommes-nous prêts à accepter en termes d’automatisation ? Aux États-Unis par exemple, on prévoit déjà des algorithmes qui aident à déterminer si un prisonnier doit bénéficier d’une libération conditionnelle. Pourquoi pas ? Mais sommes-nous d’accord pour qu’une intelligence artificielle décide de peines d’emprisonnement à vie ? Très vite, nous allons réaliser que l’expansion de ces technologies va moins dépendre de leur faisabilité technique que de notre propre volonté de les intégrer ou, au contraire, de les ralentir ou de les refuser. De ce point de vue, la pandémie et le confinement ont servi d’immense expérience sociale en matière d’usage de la technologie dans notre quotidien ; l’une des conséquences de la période semble être le recul d’une forme de conservatisme culturel à son égard. Avant la pandémie, 4 à 5 % des gens travaillaient à distance. C’est monté à 60 % durant la pandémie, et ça n’est retombé qu’à 30 % ensuite. C’est un exemple parmi d’autres de l’évolution de notre rapport à ces technologies informatiques, mais aussi du déclin des réticences que nous pouvions avoir au nom de la vie privée ou des données personnelles. Si l’intelligence artificielle finit à son tour par s’immiscer largement dans nos vies, c’est aussi parce que nous l’aurons voulu.
Propos recueillis par JULIEN BISSON
« Les ordinateurs n’ont pas de volonté propre »
Jean-Gabriel Ganascia
Tout en balayant certains fantasmes, dont celui des machines conscientes, Jean-Gabriel Ganascia, philosophe, informaticien et membre du conseil d’éthique du CNRS, évoque les dangers réels dont sont porteuses ces innovations et s’interroge sur les moyens de les réguler.
[Ordinatrice]
Robert Solé
Mon ordinateur commençait à avoir la grosse tête. Il se permettait de comparer son intelligence à la mienne.
L’IA en 6 techniques
SYSTÈME EXPERT
Logiciel conçu pour simuler le savoir et le raisonnement d’un expert dans un domaine bien précis. Le système, qui repose sur une base de données spécialisée, va poser des questions à l’utilisateur, intégrer ses réponses à son raisonnement et en inférer un d…