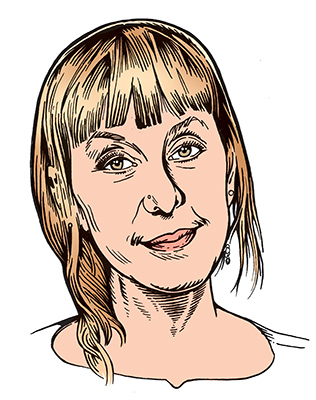Le loup, l’épée & les étoiles
Temps de lecture : 6 minutes
Il y a un an j’ai refermé la porte d’un monde qui m’a révélée à moi-même dans ce que j’ai de plus misérable. Je m’y suis découverte en arrogante fillette de CM1 qui rejette une demande d’amitié sans raison. Je m’y suis découverte bateleuse (encore qu’un bateleur soit divertissant) de la littérature soucieuse de ne rater aucun lecteur ni lectrice, annonçant la moindre rencontre dans les festivals, les librairies. Loin de m’avoir fait céder au nostalgico-réactionnaire « c’était mieux avant », mon expérience de ce réseau se conclut plutôt par « c’est bien mieux après » m’être vue si triste en ce miroir.
Contrairement à Gregor Samsa, le personnage de Kafka, je ne me suis pas réveillée un matin incapable de me lever, emprisonnée dans une carapace rigide. La mienne, de métamorphose, a été progressive et, longtemps, j’en ai ignoré les prémices. Si j’ai commencé par échanger des articles politiques ou culturels, prise d’une boulimie heureuse d’informations, celle-ci s’est rapidement transformée en passion voyeuse, j’ai vite cédé à la tentation de lire tel ou tel texte d’un ami d’amis racontant par le menu sa rupture amoureuse, me suis émue de la mort d’une femme jamais rencontrée, recliquant sur la petite icône bleue tard le soir en dépit d’une journée entière hantée par les commentaires sexistes lus au moment de l’affaire Weinstein ou des échanges furieusement racistes sur ma page, ce jour où j’ai posté quelques lignes à propos du burkini.
Bien sûr, on m’objectera que Facebook ne fait que révéler ce qui est déjà là, qu’il nous reflète donc, que tout dépend de la façon dont on s’en sert. J’ai moi-même usé de cet argument face à ma mère quand celle-ci m’a demandé ce qu’on y « faisait », dans cet espace. Je n’avais pas encore conscience qu’on y restait, on y errait sans le plaisir de se perdre : on y sombrait.
On m’affirme que Facebook présente les avantages et les inconvénients de la démocratie puisque tout le monde peut s’y inscrire et que chacun est en mesure de lire et de commenter les écrits de qui il veut. Cette « démocratie » ne résiste pas à mon chien : il y règne, comme n’importe quel chaton. Mon chien vaut, sur le terrain du « like », environ mille fois une manif et deux mille fois une photo de migrant. À moins que ledit migrant ne soit un enfant, plutôt blond, au regard implorant.
La mine que je m’y découvre et la vôtre, mes amis, ceux et celles que je connais dans « la vraie vie », m’effarent, vous dont le « mur » m’emplit d’une gêne semblable à celle qui s’emparerait de moi si j’ouvrais par mégarde la porte de votre salle de bains ou si j’assistais à votre séance de psychothérapie.
Facebook transforme les écrivains en de savants marchands d’émotions qui pèsent leurs épices au gramme près et hèlent les badauds à grand renfort d’articles qui leur sont consacrés. Facebook transforme les parents en directeurs de casting qui cherchent le meilleur angle de leur progéniture et ne posteront jamais aucune photo de leur enfant boutonneux. Facebook transforme n’importe qui en auto-entrepreneur d’un soi-même capable d’exhiber devant des inconnus l’échographie de son enfant à venir ou d’annoncer le décès d’une tante pour susciter des « likes ».
C’est vrai, certains l’utilisent comme une tribune politique et leurs textes sont brillants. Un temps. Très vite, les mots transpirent le désir d’être approuvé, arborant un savoir-écrire qui ne laisse rien à un hasard interdit de séjour au pays des réseaux.
Nos ombres virtuelles me peinent. Cette quête de compliments, ce ton suffisant qui assène, ce don d’ubiquité de notre conscience qui sait tout pour l’oublier aussitôt, de la surveillance qu’exerce le réseau à l’utilisation des données personnelles. Personne ne pourra dire que nous n’avons pas été avertis. Nous avons acquis une capacité nouvelle qui nous permet de tout faire à la fois : s’indigner des censures virtuelles tout en continuant à les nourrir, être partie prenante de ce qu’on dénonce. Sean Parker l’ex-président du réseau social l’a d’ailleurs avoué dans plusieurs interviews, l’objectif premier de Facebook était d’être addictif, de susciter en nous un besoin sans fond. Bingo.
Des habitants de l’Arctique piègent les loups en enterrant dans la neige une épée couverte de sang, dont reste visible un morceau de lame. Un loup trouve l’épée, se met à la lécher. Très vite, il se coupe la langue, trop affamé pour se rendre compte, avant de perdre connaissance, que c’est son propre sang qu’il est en train de boire, il ne tarde évidemment pas à mourir.
Facebook a le mérite de refléter l’état de manque dans lequel nous nous trouvons tous et toutes, affamés que nous sommes, qui déroulons le fil d’actualité sans savoir ce que nous y cherchons, menés par un besoin, mais un besoin de quoi, on n’a pas le temps d’y réfléchir. Facebook promet la satiété, quand on ne sait pas de quoi on a faim, ce qu’on désire. Étymologiquement, le mot « désir » évoque la nostalgie d’un astre disparu, du latin desiderare, « regretter l’absence de quelqu’un ou quelque chose », lui-même dérivé de sidus, l’« étoile ». Aucun algorithme n’a prévu de se mettre à la recherche de nos étoiles égarées, la place est libre, elle est à nous.
« Sur Facebook, l’information est structurellement défavorisée »
Bruno Patino
Pouvez-vous quantifier l’impact des réseaux sociaux sur la population ? Combien de temps passons-nous devant les écrans ?
Les études indiquent qu’il y a 6,5 écrans branchés par foyer en moyenne. Les personnes interrogées sous-estiment généralement ce…
[Infox]
Robert Solé
Selon l’ONG internationale Avaaz, les fake news circulant sur Facebook dans les groupes de Gilets jaunes ont été vues plus de 105 millions de fois entre novembre 2018 et mars 2019. En anglais, comme chacun sait,&nbs…