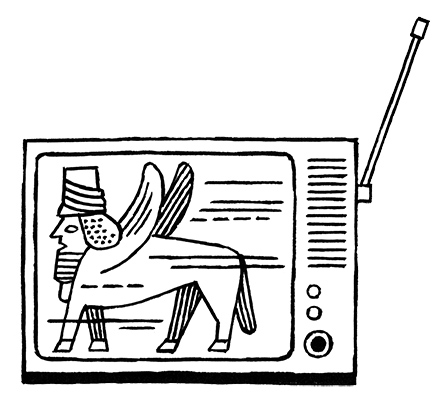« Je fais le pari que l’appétit de culture sera renouvelé »
Temps de lecture : 9 minutes
Comment évaluer la crise actuelle ?
Le problème est complexe parce que la culture en France est un puzzle difficile à cerner. On estime, par exemple, qu’il y a 25 000 points de ventes de livres mais, des véritables librairies, on en compte seulement mille cinq cents importantes et entre trois et cinq mille plus modestes. Au sens strict, on établit le poids de la culture à 2,3 % du PIB (44 milliards d’euros en 2016, 600 000 emplois ; pas très loin des 55 milliards et du million d’emplois de l’hôtellerie-restauration), mais cela recouvre une très grande diversité de métiers et un large champ d’activités. Est-ce qu’on y inclut l’architecture ou le design, dont l’importance est croissante dans nos sociétés contemporaines ? Est-ce que l’on compte le patrimoine historique ? Et le patrimoine naturel ? Et la publicité, qui constitue un mode de financement pour certains biens culturels, mais pas pour tous ?
N’est-on pas capable, par exemple, de mesurer l’impact de l’annulation des festivals ?
C’est très surprenant, mais le lien très fort entre culture et tourisme n’a jamais été véritablement documenté. La culture est génératrice de nombreuses activités connexes que nos outils de comptabilité nationale mesurent très mal. On a coutume de dire que le Festival d’Avignon représente cent millions d’euros de recettes pour la région. Mais en 2003, après l’annulation d’Avignon et d’Aix du fait du mouvement de protestation des intermittents, un économiste avait regardé les choses de près et n’avait pas constaté de pertes très importantes. Il y avait alors eu de nombreux reports sur un tourisme moins culturel. Cette fois, les touristes étrangers ne viendront pas, les annulations entraîneront des pertes sèches. Et la myriade de petites compagnies qui investissent le off d’Avignon vont faire partie des sinistrés de la crise. En temps normal, ce festival peut leur permettre de vendre quarante ou cinquante dates, ce qui fait leur année. Il faudrait donc permettre à ces compagnies de montrer leur travail sur une plateforme afin que des théâtres puissent acheter leur spectacle.
En dehors des intermittents, qui réclament une année blanche pour leurs droits, le monde culturel n’avance pas uni dans cette bataille.
Il est vrai qu’on ne sait pas encore combien de temps va durer cette crise ; on en est toujours à faire les comptes. Incapable de chiffrer l’étendue du désastre, Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l’édition, a envoyé des questionnaires aux libraires et aux éditeurs. Au niveau du marché de l’art, une enquête est en cours pour savoir si les commissaires-priseurs ont pu réaliser quelques ventes via Internet.
En Allemagne, pays pourtant décentralisé, les autorités ont annoncé un plan de 50 milliards pour la culture. Et en France ?
La décision allemande a frappé les esprits, mais il faut rappeler qu’il n’y a pas, là-bas, de protection pour les intermittents du spectacle. Chez nous, il y a tout un tas d’aides qui viennent de l’État ou des collectivités territoriales. On peut tout de même regretter une chose : quitte à être un pays centralisé, on pourrait avoir une vue d’ensemble de la manière dont le ministre voit ce qui se passe – les priorités, les plus grosses difficultés… Il conviendrait que les mesures d’urgence ne soient pas l’addition désordonnée de réponses à chaque demande, et que le plan de relance, quand il viendra, soit accompagné d’une véritable stratégie, qui semble pour l’instant introuvable.
Craignez-vous que les déficits abyssaux qui menacent ne remettent en cause l’exception culturelle française ?
Peut-être que je me trompe et que je tomberai de ma chaise, mais j’imagine mal que le ministère de la Culture fasse des économies sur un budget loin d’être colossal (un peu moins de 4 milliards d’euros), et je ne vois pas les collectivités locales lâcher les offres qu’elles ont contribué à créer. Il y aura sans doute des révisions de programmes, mais je pense que l’offre culturelle demeurera. Un abandon reviendrait à accentuer la crise sociale dans un secteur où de nombreux emplois sont précaires. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que la réponse actuelle n’est pas à la hauteur, mais la réflexion en est encore à ses débuts. La culture a accompagné les Français dans la crise par la mise à disposition de contenus numériques. Son importance symbolique est très supérieure à son poids économique.
Elle est pourtant la grande oubliée du déconfinement. Et le 18 mars, les librairies n’ont même pas été considérées comme des commerces de première nécessité.
Quand cela a été évoqué par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, le Syndicat de la librairie française a estimé ne pas être prêt. J’espère néanmoins que les responsables de librairies et des bibliothèques réfléchissent à l’étape suivante. La table du libraire est absolument centrale, il va falloir qu’elle soit plus petite, qu’on choisisse plutôt dans les rayonnages afin de mieux circuler en gardant les distances nécessaires. Idem pour les salles de spectacle : il va falloir donner envie au public de revenir, qu’il soit heureux et pas inquiet. Les directeurs de théâtre travaillent sur les conditions sanitaires de réouverture des salles, mais les équations économiques seront difficiles à équilibrer, avec parfois seulement un tiers du nombre habituel de spectateurs. Cela passera par des ouvertures à perte, mais nécessaires pour réenclencher des dynamiques. Je veux retenir une hypothèse optimiste : les gens vont mettre du temps pour retourner dans les salles parce que cet acte de partage ne se vit pas la peur au ventre, mais quand ils y seront retournés, peut-être y aura-t-il un formidable rebond. Et pour peu qu’on ne connaisse pas de nouvelle pandémie, je fais le pari que les festivals de l’année prochaine seront incroyables. L’appétit de culture sera complètement renouvelé.
Comment voyez-vous le monde de l’édition rebondir ?
Je crains qu’il soit tenté de se replier sur les valeurs sûres, les auteurs reconnus qui ont leur public. Ce serait une bêtise, une erreur stratégique. Ce qui fait la vitalité d’un éditeur ou d’un producteur de cinéma, c’est la prise de risque. Je sais qu’il va y avoir une file d’attente de livres non publiés. Il sera tentant de vendre beaucoup d’Amélie Nothomb, mais il ne faut pas oublier que les succès ne viennent jamais d’où on les attend. Quand l’offre se standardise, la demande finit par s’essouffler.
Quelles évolutions de long terme imaginez-vous ?
Le spectacle vivant et l’art, qui se sont beaucoup mondialisés, vont devoir être repensés : ces programmes globalisés – les grandes expositions blockbusters dont les tableaux viennent des quatre coins du monde accompagnés de conservateurs, les artistes lyriques et les concertistes qui chantent entre deux avions –, tout cela va subir un coup d’arrêt, au moins provisoire. Ces dernières années, les grands établissements n’ont cessé de battre des records de fréquentation. Le Louvre est pratiquement arrivé à dix millions de visiteurs en 2019, dont 75 % d’étrangers. S’il rouvre dans un délai raisonnable, ce sera probablement uniquement avec des visiteurs franciliens, voire hexagonaux. À l’inverse, on peut craindre que les salles de spectacle, déjà engagées dans un mouvement de concentration, soient la proie de nouvelles offres des grands groupes comme Live Nation, AEG, Vivendi ou Fimalac.
Quels effets durables l’offre numérique culturelle actuelle pourrait-elle avoir ?
On dit du numérique qu’il est à la fois un poison et un remède. Un poison parce qu’il casse les possibilités de valorisation, et un remède parce qu’il propose de nouvelles offres. Les travaux des chercheurs montrent que le numérique ne démocratise pas la consommation culturelle mais, cette fois, il y a eu un effort si massif et divers qu’on peut se demander s’il n’y aura pas un frémissement à la marge grâce à l’intérêt suscité par cette offre généreuse et attractive. Cela dépend évidemment des enseignants. Si j’étais professeur dans un lycée, tenue de travailler en télé-enseignement, j’inciterais mes élèves à regarder des captations de la Comédie-Française et je leur donnerais des devoirs à partir de ces œuvres. Je ne suis pas certaine, malheureusement, que les ministères de l’Éducation et de la Culture aient pu, dans ces circonstances, travailler main dans la main. En tout cas, je trouverais tout à fait intéressant qu’on fasse, dans quelques mois, une grande enquête auprès des Français pour voir ce qui reste de tout cela. Peut-être que certains vont utiliser ces outils de manière durable et que quelque chose sortira de ce grand choc.
On parle d’un nouveau monde. Et dans la culture ?
Je suis très méfiante. À chaque crise, on fait cette réflexion et, finalement, on ne passe pas véritablement à un autre monde, même en termes économiques. Ceux qui pensent qu’il n’y a pas assez d’État vont continuer à le penser, et ceux qui pensent qu’il y a trop d’État expliqueront qu’il n’a rien su prévoir, qu’il est impuissant et incapable. Des changements vont certes s’opérer mais par la force des contraintes. Il va falloir, pendant quelques années, penser à des programmations qui tiennent compte des pertes subies, qu’elles soient publiques ou privées ; il va falloir retomber sur ses pieds. Cela conduira probablement à plus de modestie dans les programmations. On assistera sans doute à une certaine reterritorialisation des consommations culturelles.
Comment vivez-vous cette période, aussi bien en tant que spécialiste de l’économie de la culture que comme consommatrice d’œuvres culturelles ?
Comme beaucoup, je m’étais fait un incroyable programme de lectures, des romans et des essais… J’avais oublié le temps qu’il fallait pour tout cela. En revanche, j’ai regardé des ballets sur mon ordinateur et je suis tombée sur des pépites. J’aime aller voir des spectacles de danse en salle. Grâce au numérique, j’ai admiré le travail des danseurs comme je ne l’avais jamais vu auparavant.
Propos recueillis par PATRICE TRAPIER
« Je ne crois pas au tout-numérique »
Guillaume Pfister
Comment la consommation de musique en streaming a-t-elle évolué depuis la création de Deezer et de Spotify en 2007 ?
Le marché du streaming musical est probablement le seul à avoir …
[Créations]
Robert Solé
Festivals annulés ; salles, musées et médiathèques fermés ; intermittents du spectacle encore plus fragilisés… Un vrai désastre. On se console un petit peu en se disant que les grandes catastrophes accouchent de chefs-…
Ministère amer
Vincent Martigny
Le ministère de la Culture est-il appelé à figurer sur la longue liste des victimes du Covid-19 ? À en croire le silence qui règne rue de Valois depuis le début de l’épidémie, on est tenté de le croir…