« Les déviants politiques sont nécessaires. »
Temps de lecture : 11 minutes
L’ancien Premier ministre vous invite à vous asseoir face à lui. Il vous fixe en écoutant attentivement vos questions, allume une gauloise en s’excusant pour la fumée, puis se lance dans des phrases longues et amples, semées de formules qui font mouche. Son esprit se rassemble, cerne le sujet, le décortique, l’approfondit. La parole tente de suivre une pensée qui fuse, pleine d’images frappantes et d’ellipses. Voici le fruit d’une de ces conversations avec un homme pour qui réfléchir à haute voix est une gymnastique stimulante, un mouvement perpétuel.
Dans la crise du politique que nous vivons, les dirigeants ont singulièrement perdu en leadership. Pourquoi cette perte de crédibilité ? Peuvent-ils la retrouver ?
Commençons par réfléchir sur la bizarrerie du concept de légitimité… La légitimité résulte de l’impression qu’a l’opinion de la carrière d’une personnalité, dans sa continuité, et surtout de sa lisibilité. En temps de guerre, la lisibilité est facile. On sait où est le mal, c’est l’autre. Point ! Tout ce que l’on fait, c’est le bien ! La peur et l’angoisse règnent, donc chaque victoire rassure, devient un triomphe. Les légitimités naissent en temps de guerre. Elles sont en béton armé. Il arrive qu’une légitimité du temps de guerre soit transférée vers le politique en temps de paix. Winston Churchill ? Un vainqueur. Eisenhower ? Un général en chef victorieux avant que d’être un président de compromis. Staline ? Il a survécu en grande partie en raison de sa légitimité du temps de guerre. De Gaulle ? Pure légitimité du temps de guerre, conservée par son talent durant toute son activité politique… Mandela ? Tout bien considéré, une légitimité du temps de « guerre ».
Quand on vit longuement dans la paix, pire quand on vit en démocratie, adieu la gloire ! Le succès ne s’obtient que par le compromis et tout compromis comporte des sacrifices. Terminé, tirez l’échelle. Cette légitimité ne peut être que médiocre. Depuis de Gaulle, personne n’a retrouvé en France une légitimité qui frise 10 % de la sienne.
À quoi pourrait donc tenir la légitimité aujourd’hui ?
Tous les dirigeants politiques en temps de paix civile ont une légitimité qui est liée à la qualité des compromis qu’ils ont successivement passés. Or aucun n’est parfait, par définition, aucun n’est sans bavure, aucun ne peut être un succès complet. C’est un premier élément que je crois majeur.
Second élément : le politique est absolument polyvalent et doit répondre à tout problème dans l’ordre de la santé, de la sécurité, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, des transports, etc. Pour chacune de ces questions prises isolément, il y a un savoir humain, une technique, parfois une science. Vraiment ? Nous constatons aujourd’hui la crise d’un certain nombre de savoirs. Commençons par l’urbanisme, les banlieues monstrueuses, les grands ensembles où il n’y a plus d’espaces sociaux. Cela produit un chaos social ! Ce ne sont pas les politiques qui l’ont inventé ! Mais ce sont eux qui payent les conséquences.
Placez-vous l’économie et les économistes dans cette même crise des savoirs ?
L’économie a osé prétendre au rang de science ! Vous vous rendez compte d’une énormité. Nous vivons dans un monde maintenant qui ne sait plus assurer le plein emploi à ses habitants et qui les renvoie à la charité publique et à la police. Je parle des pays développés. Or le chômage, c’est le sida. Le sida, c’est une maladie grave, honteuse, on n’ose pas l’annoncer à ses voisins, à sa famille. Et c’est une maladie honteuse pour laquelle le médicament est encore dans le laboratoire. La société est donc impuissante. Je devrais dire : la politique est impuissante puisqu’elle est censée répondre à tout. Par conséquent, puisqu’elle est inefficace, elle n’est plus légitime.
Vous avez en plus un autre facteur qui n’est pas le fait des politiques actuels, mais de leurs prédécesseurs. Nous ne disposons pas des outils pour répondre aux situations difficiles. Il nous faudrait une régulation mondiale. Tant pour les guerres et l’Ukraine que pour le chômage. Dans ces conditions, je pense tout sobrement que le politique n’est plus en état de prétendre à de la légitimité. Le vrai leadership, c’est fini.
Le travail programmatique qui consiste à réfléchir, trouver des solutions et les faire accepter à l’opinion, dès l’instant que cela s’étage sur plusieurs années… c’est hors de portée !
Vous pointez le temps court politique et le temps long nécessaire. Est-ce l’un des paramètres qui contribuent à ruiner la perspective de leadership ?
Cela achève le dispositif. Le fait d’être passé au temps court en ignorant le temps long n’est qu’une aggravation.
Faut-il penser que le monde d’aujourd’hui doit apprendre à se passer de leaders ?
Il existe des variations nationales considérables. La France est restée monarchique. Le malheur, c’est que derrière de Gaulle et l’institution d’une monarchie élective, Pierre Mendès France n’a pas voulu suivre. Il aurait pu emprunter les habits du monarque, mais il était tellement contre l’idée de monarchie qu’il a même voté contre la Constitution et refusé de se présenter à la présidence.
En vérité, la France est petite et ne croit plus en elle-même. Elle n’a plus les ressources pour faire de grandes affaires. Sa survie et celle des autres pays dépendent d’une solution économique aux contradictions dans lesquelles nous nous trouvons. Les inégalités sociales, la disparition d’une référence au bien public, c’est cela la clé. Même un leader talentueux, quelqu’un qui serait à l’économie ce que de Gaulle a été à la guerre et à la géostratégie, ne pourrait rien tout seul…
Il y a tout de même des peuples qui ne supportent pas le pouvoir individuel et qui aiment porter à leur tête des collectifs. La Scandinavie, les Pays-Bas, la Suisse… Donc, ce n’est pas si simple.
Vous avez pour votre part incarné le « parler-vrai ». Vous l’avez même théorisé.
On l’a théorisé pour moi (sourire). C’est le titre du premier livre d’une trilogie, un recueil de discours. Je crois bien que le titre m’avait été conseillé par Jacques Julliard, mon éditeur à ce moment-là. J’ai pris ce titre sans précaution… parce que naturellement, c’est une connerie ! Je ne connais aucun couple qui puisse résister au parler-vrai à domicile ! Dans les rapports sociaux collectifs, c’est pareil. Le parler-vrai n’est possible que sur les faits objectifs, les chiffres, etc. Cela ne fonctionne pas pour les rapports humains.
Le temps médiatique se caractérise par les « petites phrases » et les « effets d’annonce », le temps court. Quelle serait la part de responsabilité des médias dans la décrédibilisation de la politique ?
Le monde des médias a concouru à ce que l’humanité cesse de penser. Point ! Prenez le monde de la recherche et de l’université réputé sérieux. Tous les chercheurs, dans leurs disciplines, analysent et maîtrisent fort bien les données de leur matière. Mais dès qu’ils sortent de leur alimentation intellectuelle quotidienne, pour tout le reste, ils sont informés par les médias. Donc leur connaissance de tout le reste tient au temps court, donc ils ne comprennent rien et profèrent autant de sottises que les autres. D’où l’imbécillité qu’il y a à faire parler des scientifiques sur tout et sur rien. La première fois que j’ai écrit sur ces questions, en 1987, je n’étais pas encore devenu Premier ministre. Si j’avais eu cette expérience, j’aurais été bien plus sévère, sauvage.
François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé peuvent-ils être encore utiles à la France ?
Malheureusement, chacun d’entre eux est tué par l’absence de savoirs permettant de répondre aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes dans une crise qui est d’abord celle de la pensée. Une personnalité modérée, sage, consciente, démocratique qui a réussi un coup de temps en temps sans jamais en rater de gros, peut disposer d’un espace porteur d’espoir. Mais s’il ne sait pas comment utiliser cet espace ? Nous en sommes là, sachant que nous avons toujours besoin d’une entité qui s’appelle l’État et qui fixe les normes. Et nous avons toujours besoin qu’il soit commandé.
Il n’y a de savoir que s’il est partagé par beaucoup. Si les scientifiques se divisent, s’ils ne dégagent pas de consensus, il n’y a aucune raison pour que les politiques sortent de leur paralysie. Nos règles du jeu ont quelque chose d’étouffant. Je veux attirer votre attention sur une règle bizarre : les vrais changements sont toujours l’œuvre des « déviants ». Cela peut donner de grandes choses. Deng Xiaoping ! Deux fois cassé par le système chinois… Cinq ans à répandre du lisier dans les champs. Trois ans assigné à résidence. Chaque fois, Zhou Enlai le sauve. Il a changé la Chine.
L’inertie des grands systèmes est telle qu’on ne peut les faire évoluer que par le viol de leurs règles. Les déviants sont nécessaires. Songez à Khrouchtchev, à Gorbatchev ! De Gaulle, même chose… Quand Juppé et moi avons été nommés pour faire des propositions sur l’enseignement supérieur et la recherche, nous avons procédé à un coup d’État extralégal pour les sauver. C’était à la demande de Sarkozy. Qu’a-t-il fait ? Il nous a donné les pleins pouvoirs hors toute réglementation, hors toute obéissance à une hiérarchie connue. Le leadership aide dans ces cas. Sarkozy s’est servi du sien en nous disant : réveillez-moi l’université et les laboratoires, prenez autant d’argent qu’il vous faut. L’argent viendra par emprunt. Faites comme vous voulez, on préviendra les ministres compétents après. Il faut être gonflé. Il y a une manière de génie là ! La France a besoin de ça.
Ce génie, après tout ce que vous nous avez dit, peut-on encore l’imaginer ?
Non, parce que le double jeu d’entraves est trop grand. Premier jeu : la paralysie macroéconomique du système. Nous en avons parlé. En second lieu : la paralysie interne dans les partis politiques. Dans les circonstances très graves, il peut arriver des moments où l’essentiel d’une population politique peut se dire : je ne suis pas de taille. Alors une ou deux figures peuvent s’imposer. Lorsque ce n’est plus le cas, vous avez quatre-vingts candidats aux fonctions supérieures… qui se tuent les uns les autres. Il ne peut pas émerger de véritables talents. Pour surnager, il ne faut s’occuper que de tactique. Il ne faut s’occuper que de l’accessoire, la merde, et non pas acquérir des savoirs nouveaux et s’occuper du long terme. De toute façon, l’échelle française n’est plus la bonne. C’est à l’échelle européenne que cela se joue.
Un homme s’y emploie. C’est fascinant. Il n’a pas le droit de le dire. Il n’existe qu’à condition de se taire. Il est magicien ! Il s’appelle Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. C’est la meilleure place pour peser sur le système en cours. Il passe son temps à le violer. Deux ou trois fois, il s’est assis sur les limites réglementaires, une fois ou deux en bluffant le Conseil des ministres européen. Il est accusé devant la Cour suprême allemande pour viol de son mandat. Les premières audiences ont eu lieu. C’est ainsi…
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO et LAURENT GREILSAMER


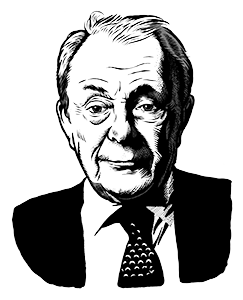
« Les déviants politiques sont nécessaires. »
Michel Rocard
Dans la crise du politique que nous vivons, les dirigeants ont singulièrement perdu en leadership. Pourquoi cette perte de crédibilité ? Peuvent-ils la retrouver ?
Commençons par réfléchir sur la bizarrerie du concept de…
La spirale du discrédit
Christian Salmon
Dans son célèbre article des lucioles de 1975, Pasolini parlait du discrédit qui frappait la classe politique italienne en ces termes : « Ils n’ont en rien soupçonné que le pouvoir réel agit sans eux et ils n’ont entre les mains qu&…
Girouettes
Robert Solé
Accusé d’opportunisme, le regretté Edgar Faure avait joliment zozoté : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent. » Au-delà de l’humour et du cynisme, ce pilier de la IVe République, …
La coupe est pleine
Ollivier Pourriol
– C’est le désert. Imagine... Alexandre le Grand avec ses cavaliers à la poursuite du grand Darius, roi des Perses. Emporté par son élan, il manque d’eau. Après onze jours, la soif est terrible. Le découragement gagne. Une fois enco…







