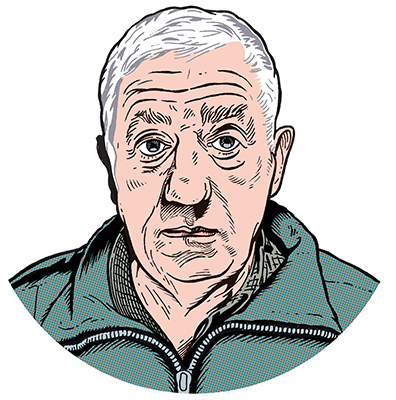« On se trompe de combat »
Portrait par MANON PAULICTemps de lecture : 6 minutes
Vingt-sept ans qu’il porte le gilet jaune pour défendre ses droits. Mais lui l’accompagne d’un bonnet assorti. « C’est le symbole de notre syndicat depuis sa création, en 1992 », rappelle Alain Sambourg, ponctuant ses propos d’un regard chaleureux, par-dessus ses lunettes en demi-lune. Assis à la table de sa cuisine, le sexagénaire feuillette les pages de l’Index Acta phytosanitaire, un manuel qui répertorie l’intégralité des pesticides homologués en France et fournit des conseils d’utilisation. Ses larges mains d’agriculteur céréalier, usées et rougies par le froid, s’immobilisent soudain. « Glyphosate », prononce-t-il posément. Un herbicide qu’il connaît bien puisqu’il en utilise « à très petites doses » pour ses champs où poussent blé, orge et féveroles. S’il reconnaît le caractère potentiellement cancérogène du produit, Alain milite cependant pour son utilisation raisonnable en milieu agricole. Au point d’avoir récemment rendossé sa chasuble fluorescente et revissé un bonnet jaune sur son crâne.
Novembre 2017, Lorient. Aux côtés de quelques centaines de camarades agriculteurs, Alain pénètre illégalement dans le port de commerce de Kergroise. Tous sont adhérents de la Coordination rurale, syndicat fondé par des dissidents de la FNSEA en opposition à la PAC. L’opération, baptisée « #balancetonport », vise à prélever des échantillons de soja OGM importé d’Amérique pour évaluer leur concentration en glyphosate. Avec l’expertise du laboratoire Eurofins Analytics, les agriculteurs voient leur intuition confirmée : les résultats indiquent que les récoltes américaines préalablement traitées au Roundup, un puissant herbicide à base de glyphosate, contiennent des résidus de ce dernier, tandis que les graines traitées par le même produit phytosanitaire sur le sol français en sont exemptes.
L’explication ? Deux méthodes différentes appliquées de part et d’autre de l’Atlantique, selon l’agriculteur, vice-président de la section Seine-et-Marne du syndicat. « Aux États-Unis et en Amérique du Sud, ils ont créé des plantes résistantes au glyphosate, ce qui leur permet de balancer de l’herbicide à haute dose directement sur les cultures, sans risquer de les détruire. Ils épandent parfois en avion et se fichent des gens qui vivent à côté. C’est le principe des OGM. En France, c’est différent parce qu’on utilise le Roundup en interculture, c’est-à-dire après une récolte et avant de semer de nouveau. Et nos doses sont nettement inférieures. » Alain estime que cette pratique particulière ne met pas en danger la santé des consommateurs français et constitue une solution plus satisfaisante que des produits de remplacement, « peut-être plus nocifs ».
« On se trompe de combat », explique-t-il, regrettant que les médias et les militants environnementaux aient érigé le glyphosate en symbole de l’agriculture intensive. Sa fixette à lui, ce sont les coformulants, les éléments mêlés à la substance active pour composer les produits phytosanitaires. Ce serait eux, la bête noire. Pour homologuer son produit, une entreprise doit transmettre sa composition détaillée à l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui décide des conditions dans lesquelles le produit est utilisable sans danger. Or, « on n’a aucune idée de l’impact de ces substances sur l’environnement et sur la santé », les coformulants n’étant jamais dévoilés au public. « Secret de fabrication, qu’ils disent ! » Cette opacité, qui l’a toujours rendu méfiant, lui est de moins en moins tolérable. « Je pense à la génération d’après, explique-t-il. La terre ne m’appartient pas ! J’ai pour devoir de la rendre en bon état. »
Pour s’affranchir autant que possible de la chimie, Alain a réduit ses doses de glyphosate dès les années 1990, avant de passer d’une agriculture conventionnelle, caractérisée notamment par l’usage de pesticides et par le recours au labour, à une agriculture dite « de conservation », en semis direct. Cela consiste à ne jamais travailler le sol pour protéger la biodiversité, garante de sa richesse. Exit les fongicides et les insecticides. Il a même mélangé des variétés de blé sur un même champ pour éviter que les faiblesses de l’une ne mettent en péril l’intégralité d’une récolte. Mais dans le système qu’il a choisi, « la seule manière d’éradiquer les mauvaises herbes aujourd’hui, c’est le glyphosate ». Toujours « à petite dose » : un litre par hectare.
Alain le reconnaît, se passer totalement de traitement phytosanitaire est difficile mentalement pour l’agriculteur d’aujourd’hui. « J’ai un cousin qui ne peut pas s’en empêcher : s’il ne traite pas, il pète les plombs. On a mis un disque dur chez le paysan, on l’a programmé pour utiliser la chimie. Il faut passer à l’agronomie, c’est fini, la chimie. »
Pour ce qui est de l’agriculture biologique, Alain y a songé, mais il faut des bras, et de l’argent pour les rémunérer. « Les primes à l’hectare baissent et les rendements aussi. En 2016, à cause d’une récolte catastrophique, notre chiffre d’affaires est passé de 100 000 à 40 000 euros. On est encore en train de rembourser les dettes. Alors, payer une personne à l’hectare quand un litre de glyphosate coûte le prix d’une boîte de Doliprane… » Et puis, « il faut les trouver, ceux qui vont venir biner, arracher à la main. Y’a pas grand monde dans le coin. Maintenant, on fait venir des étudiants chinois pour la cueillette des fraises. Pendant un mois et demi, ils se lèvent tous les matins à 4 heures pour payer leurs études ». Pour faire du bio tout en se passant de main-d’œuvre, il faudrait réduire la taille des champs, mais les primes, dont les agriculteurs dépendent, les incitent toujours à produire plus. Alain a envisagé toutes ces options. Sans glyphosate, il est coincé.
Une botte dans le passé, l’autre dans l’avenir
Manon Paulic
NOIRLIEU, MARNE. Une rivière bordée d’arbres et de bandes enherbées embrasse la partie basse du champ, formant une barrière protectrice. En amont, la route départementale prend le relais jusqu’à la maison paren…
[Pissenlit]
Robert Solé
Y'en a marre des pissenlits ! Chaque début d’été, dans notre maison de famille à la campagne, c’est le même problème : comment se débarrasser de cette fichue plante à feuilles dentées qui s&rsquo…
Une botte dans le passé, l’autre dans l’avenir
Manon Paulic
NOIRLIEU, MARNE. Une rivière bordée d’arbres et de bandes enherbées embrasse la partie basse du champ, formant une barrière protectrice. En amont, la route départementale prend le relais jusqu’à la maison paren…