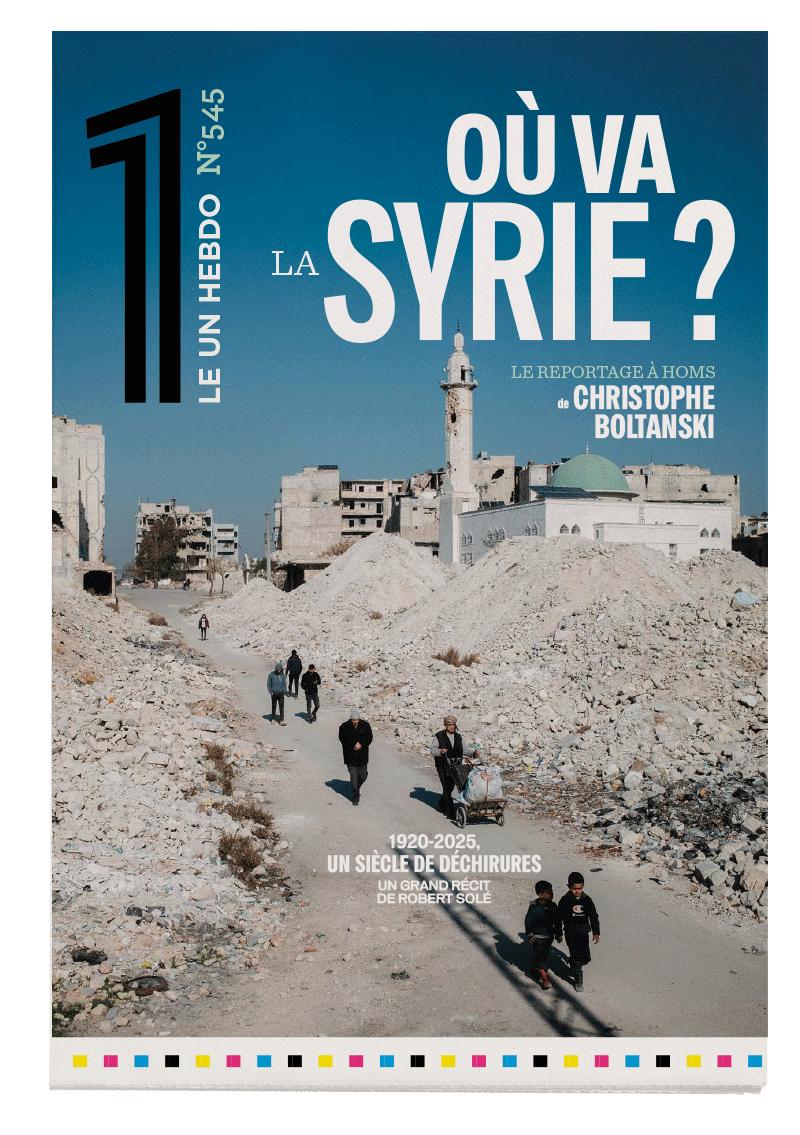Comment le climat est devenu l’affaire du siècle
Temps de lecture : 12 minutes
L’été 2019 nous a fait assister à de l’inédit : le mois de juillet a été classé mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde tandis qu’en août, l’Islande procèdait à un geste spectaculaire de commémoration d’un des plus grands glaciers d’Europe, désormais disparu de son territoire.
La question climatique est une question phare de cette rentrée. Son intensité s’est accrue grâce aux efforts des acteurs sociaux pour la rendre publique. Son acuité est aujourd’hui renforcée par l’expérience que nous en faisons, qui fait sortir les chiffres de l’abstraction et leur donne une réalité tangible. Le climat se vit à fleur de peau dans ces épisodes caniculaires qui ont perdu leur caractère exceptionnel – moments éprouvants de réorganisation des modes de vie, de travail, de transport, moments d’ébranlement des corps et de réveil de fragilités oubliées. Le changement climatique n’est plus seulement un chiffre, une courbe, ni même un thème du cinéma engagé ou de la littérature catastrophiste (on se souvient que l’astronome, romancier et vulgarisateur Camille Flammarion avait publié en 1894 un roman annonciateur du genre, intitulé La Fin du monde), il est devenu une véritable expérience individuelle et collective.
Dans l’histoire de la préoccupation environnementale, le climat tient aujourd’hui une place centrale, éclipsant quelque peu les problèmes de pollution et de biodiversité. Au cœur d’une discussion mondiale sur les conditions de vie sur Terre, il a cessé d’être une question scientifique au long cours, éloignée de nous. Il n’est plus envisagé dans la perspective du temps long ni indépendamment des activités humaines. Il devient notre affaire, ici et aujourd’hui, affaire de degrés devenue affaire du siècle, mobilisant des questions morales (interrogeant les conditions de la vie humaine), politiques (mise en avant de principes de justice et de solidarité), économiques (mise en question des modèles de croissance) et esthétiques (saccage ou disparition des paysages).
Il n’y a pas de problème public en soi mais des problèmes devenus publics, sous l’effet de l’intervention de groupes d’acteurs qui se les approprient et les façonnent, chacun à sa manière. La question climatique est marquée autant par la convergence que par la divergence : convergence des publics qui s’en emparent et la placent au centre, divergence des analyses et des préconisations. Elle est structurée par un mouvement à la fois centripète (qui rassemble) et centrifuge (qui distend et divise). L’accord et le désaccord sur ce sujet sont en balance permanente, reposant sur l’imbrication subtile du savoir et du vouloir, de l’état des connaissances et de la volonté politique. La question climatique est située à mi-chemin entre savoir scientifique et choix politique et c’est dans cet entre-deux que prend place le travail d’information, de sensibilisation, d’alerte, d’éducation et d’invitation au débat ou à l’action. Énonciation et dénonciation se conjuguent dans un monde d’information dopé par les réseaux sociaux, où le vrai côtoie le faux, où le statut des sources est souvent incertain, où s’opposent information et désinformation.
La publicisation du dérèglement climatique se fait par déconfinement et enrôlement de différents groupes sociaux. Autour du climat se développent des cercles concentriques qui résonnent du plus loin au plus près : des instances internationales, qui attestent la dimension planétaire du sujet, à l’expérience ordinaire de chacun, concrétisée par des écogestes, parfois guidés par des écocalculateurs. La question climatique dépasse le cercle des milieux scientifiques qui en sont les premiers définisseurs ; elle est relayée par des acteurs sociaux et institutionnels divers qui, à leur manière, la cadrent, la qualifient et l’amplifient.
Milieux associatifs et militants de la protection de la nature d’une part, institutions internationales (notamment onusiennes) d’autre part, se sont ainsi saisis du sujet.
Le mouvement associatif s’est fait le relais des revendications écologiques, a mené des campagnes, développé une presse militante au style décalé. L’image caricaturale du barbu chevelu ou de certaines figures charismatiques masque le niveau de formation et de savoir de l’univers associatif, étroitement lié aux milieux scientifiques. Elle s’estompe toutefois avec la montée en puissance du professionnalisme associatif, désormais force de proposition et d’évaluation de l’action publique. Devenu aujourd’hui une sorte d’« écopouvoir », il a su développer une expertise pratique qui a progressivement été prise en compte dans les décisions publiques, nationales et internationales. La division souvent raillée des acteurs associatifs n’interdit pas leur union dans les moments décisifs : ce fut le cas dans la préparation du Grenelle de l’environnement, où quatre-vingt-deux associations se sont regroupées au sein de l’influente Alliance pour la planète.
La création en 1988 du GIEC, instance rassemblant les experts du climat travaillant à travers le monde, exprime le besoin d’asseoir la prise de décision sur un socle de connaissances rassemblées dans de volumineux rapports publiés à échéance régulière depuis 1990. Ces rapports exposant les causes, les conséquences et les scénarios possibles du changement climatique sont destinés aux décideurs publics et servent de base aux négociations internationales. Exerçant sous l’égide de l’ONU et basé à Genève, au siège de l’Organisation météorologique mondiale, le GIEC mène une activité à l’intersection de la production de savoirs et de la prise de décision. Sa double nature, scientifique et politique, lui confère un rôle majeur dans le façonnage de la question mais en fait aussi une cible de choix pour les sceptiques et autres instigateurs de doute qui cherchent à relativiser l’importance du sujet ou son lien avec l’activité humaine. La consécration du GIEC lorsqu’il s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix en 2007, l’a conforté dans son rôle de définisseur primaire, mais elle l’a aussi fragilisé. C’est précisément à partir de ce moment que se sont multipliées les attaques à son égard, visant aussi bien ses prises de position que sa réputation. La mise en doute des personnalités, des chiffres, des manières de travailler semble quasiment orchestrée, à l’image du Climategate survenu en 2009 à la veille de l’ouverture du sommet de Copenhague, après le piratage des courriers et fichiers d’un centre de recherche. La guerre de l’information sur le sujet climatique fait rage, conduisant les scientifiques à intervenir directement, sous forme d’interviews, de documentaires et d’autres manifestes (tel celui de novembre 2017, signé par plus de 15 000 scientifiques de 184 pays). Leur intervention, cet été, au sujet des incendies de la forêt amazonienne a permis de faire reculer sur bien des points le gouvernement brésilien.
Le cadrage institutionnel de la question climatique se fait sur un plan international et national à partir des années 1970, marqué par la création du Programme des Nations unies pour l’environnement (1972) et la création dans différents pays de ministères de l’Environnement (1971 en France). La question environnementale s’installe dans le débat public de manière quasi rituelle, via un cycle de conférences internationales qui ponctuent l’agenda politique, médiatique et social. Se constitue ainsi une gouvernance environnementale mondiale marquée par des moments phares : sommets de Rio en 1992 et de Johannesburg en 2002 (« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », y déclare Jacques Chirac, figure de style reprise dans son sens propre par Emmanuel Macron cet été au sujet de l’Amazonie), organisation annuelle depuis 1995 de Conférences des parties (COP) qui donnent lieu à certains accords retentissants, tels celui de Kyoto en 1997 ou celui de Paris en 2015, destiné à contenir le réchauffement planétaire en dessous de deux degrés. Le rôle et les publics de ces rendez-vous politiques s’étendent : construction d’accords internationaux, engagements gouvernementaux, rôle de pression sur les politiques publiques des pays concernés, mise en valeur de thèmes majeurs et émergents, organisation de débats à leur sujet, entrée en scène d’acteurs de la société civile qui interpellent la vision unique d’un modèle de croissance au nom d’autres principes. Une lecture Nord-Sud pointant le rôle des grandes firmes transnationales et des pays occidentaux se ravive à l’occasion de chaque sommet. D’âpres discussions opposent alors pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de biens communs indivis (l’air, l’eau, les océans), la vie et le bien-être des peuples dans le monde.
Ces événements que certains décrivaient comme trop encadrés et verticaux, voire comme confisqués par l’ONU, dessinent au fil des ans une vaste tribune politique, un espace public mondial, ouvert et tumultueux de discussions, de propositions, de polémiques que les médias du monde entier relaient.
La COP21 a mobilisé à Paris 150 chefs d’État, 10 000 délégués, 40 000 participants… et 3 000 journalistes invités, qui sont les capteurs et les relais d’une information démultipliée par les médias des pays dont ils sont issus. Ils sont à la source d’un travail de reprise, de sélection, de commentaire, de citation auprès d’une opinion publique désormais régulièrement interrogée sur ce sujet (aux États-Unis, le thème du climat a fait son entrée dans les sondages en 1980 et il a été introduit dans l’Eurobaromètre en 2008). L’espace médiatique consacré au climat augmente de manière exponentielle… et dans le plus grand désordre. Le sujet déborde la rubrique dédiée, créée dans la presse généraliste entre 1990 et 2000, et s’invite dans d’autres rubriques : société, international, économie, illustrant la transversalité du sujet. Parallèlement se développe une profusion de médias spécialisés qui fleurissent dans les kiosques et sur le Web. Dans un contexte de défiance envers les médias traditionnels, les réseaux sociaux offrent pour beaucoup une alternative commode, immédiate et ouverte. La question de la parole autorisée vole en éclats, les propos se démultiplient, mobilisant des contenus et des tonalités de toutes sortes. Tout le monde s’autorise à parler du climat ; les « gens ordinaires » le font en ligne, à travers une anecdote, un souvenir, un témoignage qui illustre, incarne, concrétise, atteste à sa manière. Le propos du jardinier côtoie le propos du scientifique dans une quasi-indistinction de statut et une immédiateté virale. La logique du « je sais » est bousculée par la logique du « je sens ».
La question climatique s’invite aussi dans la rue et dans l’espace urbain, sous forme d’événements, de marches et de festivals, rassemblant physiquement des populations nombreuses sur un mode spectaculaire et rituel, du jour international de la Terre, qui fêtera en 2020 son 50e anniversaire, à l’heure de la Terre, marquée chaque année par l’extinction momentanée des lumières de grandes capitales de la planète. La marche des jeunes à travers le monde marque en 2018 l’entrée en scène puissante d’un nouveau groupe social qui reprend les codes classiques de la revendication et les conjugue avec les possibilités techniques du monde numérique. Figure de proue du mouvement Youth for Climate, Greta Thunberg inaugure une approche générationnelle et genrée de la question climatique. Amnesty International a cette année attribué à la jeune écolière suédoise le prix d’« ambassadrice de conscience », suscitant un buzz important où se mêlent louange et dénigrement. Le geste politique ancien de la marche retrouve une actualité, tandis que la pratique inédite de la grève climatique éloigne les jeunes de l’école à jour fixe. Sit-in dans la rue, marche mondiale du 16 mars 2019, plateforme Fridays for Future… Autant d’initiatives qui s’imbriquent et dont l’idée circule à l’échelle de la planète. Espace physique et espace numérique sont mobilisés conjointement et démultiplient l’impact du mouvement qui, de plus, n’hésite pas à se présenter devant les instances politiques internationales et nationales, de Paris à New York.
En devenant publique, la question climatique est devenue polémique, voire agonistique. La gravité et l’urgence de l’enjeu, de l’ordre d’une mutation mondiale (le passage à l’Anthropocène), suscitent autant une globalisation qu’une différenciation des postures, des revendications et des préconisations. Ce moment d’incertitude, dans un monde dit de post-vérité, est propice à une guerre informationnelle où tous les coups sont permis, même au plus haut niveau, comme le montrent Trump ou Bolsonaro. De Silent Spring – premier livre visant à alerter le grand public des dangers environnementaux – à « L’été qui ne finit jamais » – titre de une du magazine Der Spiegel le 4 août 2018 –, les visions les plus sombres circulent sur le sujet. Il n’est toutefois pas impossible d’espérer, si l’on en juge par l’ampleur des délibérations en cours, la force des acteurs mobilisés et la vigilance qui ne cesse de se développer pour lutter contre les pratiques d’amalgame, de mensonge ou de manipulation en vogue sur les réseaux.
« Le fonctionnement du système Terre est très peu enseigné »
Hervé Le Treut
Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser au climat ?
La géologie et ce qui touche à la planète Terre m’ont toujours attiré. Bon élève, j’ai réussi le concours de mathématiques pour entrer à Normale sup,…
[Ça chauffe !]
Robert Solé
Pour attirer l’attention sur le réchauffement climatique, les Amis de la Terre avaient prévu, le 29 juin dernier, une marche entre deux villages de Bourgogne aux noms prédestinés : Chaux et Bouilland. Les participants étaient…
Démagogie nationale contre justice climatique
Pierre André
Démystifier les fake news sur le changement climatique est essentiel. Mais il est peut-être plus important encore de comprendre à quelles fins elles sont utilisées. À qui profitent-elles ?