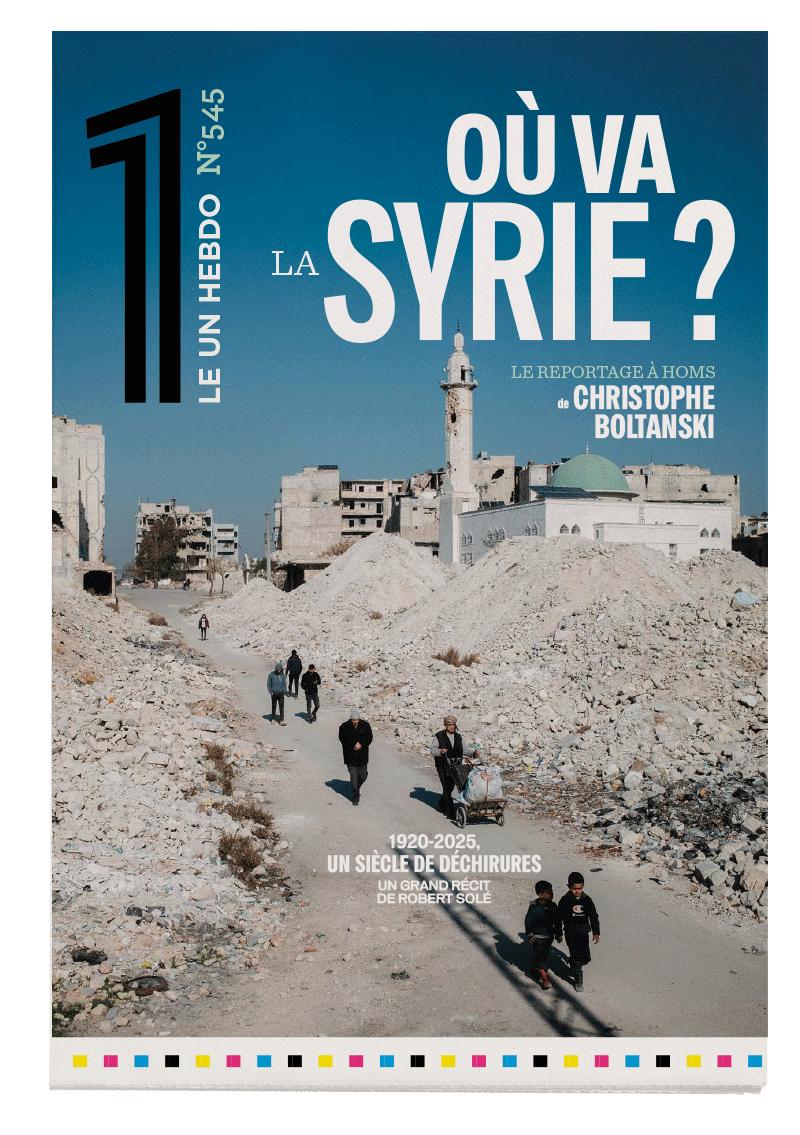Le choix de la radicalité
Temps de lecture : 10 minutes
Face à la politique, Sartre a longtemps pratiqué l’art de l’esquive. Son projet au sortir de l’École normale : « D’abord écrire, et, à côté de ça, vivre agréablement*. » Agrégé de philosophie, il séjourne un an en Allemagne au moment où Hitler installe son pouvoir, sans s’y intéresser. Il sympathise en 1936 avec le Front populaire, mais il ne vote pas ; il assiste à ses manifestations « debout sur le trottoir ». Pendant l’Occupation allemande, ses exploits de résistant sont modestes : « Dieu sait pourtant la résistance que j’ai faite […], mais elle ne m’a pas coûté grande chose. » C’est au sortir de la guerre que Sartre devient alors et définitivement un écrivain engagé.
Un mot s’impose dans sa profession de foi politique : la radicalité. « Pour moi, dit-il dans sa dernière interview en 1980, la radicalité m’a toujours paru un élément essentiel de l’attitude de gauche. Si nous repoussons la radicalité, selon moi nous contribuons, et pas peu, à faire mourir la gauche. »
Cette radicalité a pris plusieurs formes. Celle, notamment, d’un manifeste littéraire implacable avec le lancement des Temps modernes en décembre 1945 : « L’écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi. » C’est également l’adhésion à l’espérance révolutionnaire. Après un certain nombre de tâtonnements, il juge au début des années 1950 que seul le Parti communiste incarne cette espérance. Quand il devient nettement un compagnon de route du PCF, en 1952, il établit une double équation. La première pose que l’URSS est la « chance historique de la révolution ». La seconde est l’assimilation du Parti communiste à la classe ouvrière : sans le premier, la seconde n’existe pas. « Comment pouvez-vous croire à la fois à la mission historique du Prolétariat et à la trahison du Parti communiste, si vous constatez que l’un vote pour l’autre ? »
C’est en des termes quasi léninistes que Sartre assigne au Parti la direction du mouvement ouvrier et révolutionnaire. Dans Que faire ? (1902), Lénine confiait aux intellectuels, issus de la bourgeoisie, la direction du Parti, car les masses livrées à elles-mêmes tendaient spontanément au « trade-unionisme », c’est-à-dire aux revendications concrètes, partielles, sans perspective révolutionnaire. Que dit Sartre ? « En un mot, l’essence même des masses leur interdit de penser et d’agir politiquement. » Le prolétariat n’existe que par le Parti. Il est l’instrument du Parti qui, seul, détient la conscience politique.
Le philo-communisme du Sartre d’alors cadre mal avec sa prétention à être toujours « resté anarchiste ». Cependant, la double équation qu’il a posée est brutalement remise en question par la révolte des Hongrois en 1956. Les insurgés sont en grand nombre des ouvriers : le prolétariat existerait donc en dehors du Parti communiste. Et ces ouvriers insurgés sont écrasés par les chars de l’armée soviétique. Certes, les communistes restés fidèles expliquent l’événement par une tentative fasciste subventionnée par l’impérialisme américain. Sartre ne s’y laisse pas prendre : « On ne nous aura plus avec le chantage au fascisme. »
Quand bien même Sartre dira qu’un anticommuniste est un chien, les chars soviétiques de 1956 ont ébranlé sa foi dans l’URSS et le PCF
Quand bien même Sartre dira, en 1960, qu’un anticommuniste est un chien, les chars soviétiques de 1956 ont ébranlé sa foi dans l’URSS et le PCF. Pendant quelques années, il reprendra l’idée initiale selon laquelle, des deux camps de la guerre froide, il fallait choisir en dernier ressort celui qui portait un avenir pour l’homme, malgré toutes ses imperfections. Cependant, en 1968, il rompt définitivement avec le Parti communiste, à la suite du mouvement de Mai et de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Il a acquis la conviction que le PCF n’est rien moins qu’une force révolutionnaire : « Le Parti communiste a trahi la révolution de mai. [Il] a adopté une attitude qui n’était pas révolutionnaire, qui n’était même pas réformiste… Le PC s’est trouvé dans une situation de complicité objective avec de Gaulle. » Les PC occidentaux, selon lui, ont été dressés depuis 1945 à ne pas prendre le pouvoir.
La politique du PCF pendant la crise de Mai, la volonté de Georges Marchais et de la CGT de ne pas laisser les ouvriers se laisser entraîner par le mouvement étudiant et, ajoutons, l’explosion libertaire propre au mouvement, l’amènent à rallier l’idée d’une révolution hors des partis. La radicalité sartrienne s’investit alors dans le gauchisme, que Lénine qualifiait de maladie infantile du communisme. À la Sorbonne, le 20 mai, il célèbre la « démocratie sauvage » des étudiants « qui dérange toutes les institutions » : « Ce qui est en train de se former, c’est une nouvelle conception d’une société [fondée] sur la pleine démocratie, une liaison du socialisme et de la liberté. »
La guerre d’Algérie en fait un de ses porte-parole intraitables
Sartre devient le protecteur, le parrain, le tuteur des maoïstes traqués par le pouvoir. Le 1er mai 1970, il prend la direction de leur journal La Cause du peuple. Il entend réhabiliter la violence en politique en citant Mao : « Le pouvoir est au bout du fusil. » En janvier 1973, alors que la gauche s’est rassemblée l’année précédente sur un programme commun de gouvernement, Sartre, dans son article « Élections, piège à cons », s’en prend au suffrage universel avec des arguments que n’auraient pas reniés les maîtres de la contre-révolution. « En votant demain, écrit-il, nous allons, une fois de plus, substituer le pouvoir légal au pouvoir légitime » – tout comme le théoricien d’extrême droite Charles Maurras qui, lui, opposait le pays légal et le pays réel. Ce qui compte cependant pour Sartre, c’est « le vaste mouvement antihiérarchique et libertaire qu’on rencontre partout mais qui n’est point encore organisé ».
« Organiser » un « mouvement antihiérarchique et libertaire », n’était-ce pas une contradiction dans les termes ? L’aspect insurrectionnel du gauchisme a fait long feu, et Sartre a dû le constater, sans se résigner pour autant à une politique réformiste, et, dans son ultime interview au Nouvel Observateur en mars 1980, il redira son espoir dans un avenir révolutionnaire, « la suppression de la société présente par une société plus juste ».
La radicalité de Sartre s’exerce dans un autre domaine encore, celui de l’anticolonialisme. La guerre d’Algérie en fait un de ses porte-parole intraitables : « Le colonialisme est en train de se détruire lui-même, déclare-t-il en 1956, au cours d’un meeting salle Wagram. Mais il empuantit encore l’atmosphère : il est notre honte, il se moque de nos lois ou les caricature ; il nous infecte de son racisme […], il oblige nos jeunes gens à mourir malgré eux pour les principes nazis que nous combattions il y a dix ans ; il tente de se défendre en suscitant un fascisme jusque chez nous, en France. » Et d’ajouter : « Notre rôle c’est de l’aider à mourir. Non seulement en Algérie, mais partout où il existe. »
D’où lui vient cette radicalité ? Assurément d’un refus absolu de la société bourgeoise et de la morale bourgeoise.
Dans la préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon, il franchit encore un stade en septembre 1961 : « L’arme d’un combattant, c’est son humanité. Car, en ce premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un Européen c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre ; le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. » Cet engagement contre la guerre d’Algérie et le colonialisme lui vaut le plasticage de son appartement rue Bonaparte par des partisans de l’Algérie française.
D’où lui vient cette radicalité ? Assurément d’un refus absolu de la société bourgeoise et de la morale bourgeoise. Toute sa vie, il aura pu dire : « Je [voue] à la bourgeoisie une haine qui ne finira qu’avec moi. » On peut avancer une explication psychologique que Sartre lui-même nous suggère dans Les Mots. Le petit Sartre, Poulou, a perdu son père alors qu’il n’avait pas un an : « Eût-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m’eût écrasé. Par chance, il est mort en bas âge […] ; j’ai laissé derrière moi un jeune mort qui n’eut pas le temps d’être mon père et qui pourrait être, aujourd’hui, mon fils. » La loi paternelle ne lui est pas transmise. La mort précoce du père aurait permis à Sartre d’échapper à son destin bourgeois.
Mais il y a plus : le jeune Poulou, aimé et chéri par sa mère Anne-Marie, a vécu, à 11 ans, le drame de son remariage. Il a détesté son beau-père, un polytechnicien, directeur des chantiers navals, incarnant à ses yeux tous les caractères de la bourgeoisie. « Ç’a été constamment le type contre lequel j’écrivais. Toute ma vie. » On peut comprendre le drame que l’enfant a vécu, un drame – celui du petit prince détrôné – qu’il a en quelque sorte sociologisé : le meurtre du beau-père étant impossible, c’est sa classe qu’il a haïe, qu’il a tuée symboliquement.
Sartre a conscience que son antibourgeoisisme est ambigu, car il est lui-même un bourgeois, qui écrit pour un public bourgeois
Sartre a néanmoins conscience que son antibourgeoisisme est ambigu, car il est lui-même un bourgeois, qui écrit pour un public bourgeois. Le travail d’arrachement à sa classe s’est fait de plusieurs façons, d’abord par son genre de vie : le refus du mariage, la vie de bohème. Il a toujours habité des appartements modestes, d’abord avec sa mère, puis à l’hôtel, dans des logements assez étroits. Tout de même, c’était à Saint-Germain-des-Prés ou à Montparnasse, pas à Aubervilliers ou à Gentilly. Il gagne de l’argent avec ses droits d’auteur, se promène toujours avec une liasse de billets dans la poche. Certes, il est généreux, insouciant, panier percé, mais il en a les moyens. Il vit hors des normes, collectionne les femmes – ce qui pourrait être bourgeois –, mais en signant un pacte avec sa partenaire principale, distinguant l’amour nécessaire des amours contingentes – ce qui, pour le coup, n’est pas bourgeois. Jusqu’à une certaine époque, il porte costume, chemise et cravate, mais c’est parce que sa maman est là qui veille sur Poulou. Celle-ci disparue, il s’habille à la va-comme-je-te-pousse. Tout cela est très compliqué, contradictoire. Une situation de bâtard, dirait Sartre. Et c’est pourquoi l’adhésion à la cause du prolétariat devient pour lui la manière la plus tranchante de couper avec sa classe. Le prolétariat, il ne le fréquente guère. C’est une abstraction, une entité, mais c’est l’antithèse de la bourgeoisie. En adhérant à la cause révolutionnaire, Sartre a le sentiment d’échapper enfin à la bourgeoisie.
Son anarchisme des années 1930 s’accommodait du monde bourgeois qu’il vomissait. Le Sartre de l’après-guerre a changé son fusil d’épaule : ce monde, toujours aussi ignoble, toujours aussi pourri, il faut l’abattre. C’est la découverte du social et le mouvement révolutionnaire qui l’ont amené à cette résolution. Il n’y a point de liberté si les autres hommes ne sont pas libres. Il devient l’homme du grand refus. Son rejet du prix Nobel de littérature en 1964 prend une dimension symbolique : « L’écrivain doit refuser de se laisser transformer en institution. » Comme le dit un journal suédois, Sartre n’a pas voulu « faire de distinction entre ses actes et ses paroles ».
« Ma position, je le sais, est purement morale »
Il existe pourtant une situation politique devant laquelle Sartre a exclu sa radicalité : le conflit israélo-palestinien. La radicalité implique le manichéisme : Bien vs Mal, amis vs ennemis… Or, face aux Israéliens et aux Palestiniens, il n’a pas choisi son camp. Ou plutôt il a choisi les deux camps. Il se proclame l’ami des uns et des autres. Il considère que l’État d’Israël est un État légitime et que l’aspiration des Palestiniens à construire leur État est aussi légitime. Et va plus loin. Il admet que les Palestiniens ont le droit de pratiquer le terrorisme comme en ont le droit tous les peuples opprimés, comme il l’a expliqué dans la préface aux Damnés de la terre. En 1972, il justifie les attentats perpétrés aux Jeux olympiques de Munich. Mais, parallèlement, il comprend parfaitement que les Israéliens se défendent contre le terrorisme – c’est une question de vie ou de mort. Serait-il partisan de la guerre ? Non, et il s’active en faveur d’une conciliation, d’une négociation entre les deux camps. Au moment de son compagnonnage avec les maos, il se heurte à eux parce qu’ils remettent en question le droit d’Israël à l’existence en tant qu’État. Cela, il ne l’admet pas, et jusqu’à la fin de sa vie il défendra le droit d’Israël à exister. Le seul honneur qu’il ait jamais accepté, ce sera d’être nommé, en 1976, docteur honoris causa par l’université de Jérusalem.
Ce positionnement qui admet et prescrit le compromis est chez lui exceptionnel. Sa vision politique du monde, de la société, de l’histoire s’arrache d’ordinaire à la complexité du réel et s’exprime par un dualisme de combat, à la poursuite d’un ordre imaginaire où le socialisme se réconcilierait avec la liberté. Il en a fait lui-même l’aveu : « Ma position, je le sais, est purement morale. » Raymond Aron, son condisciple de l’École normale supérieure, ajoutera in fine : « Un moraliste perdu dans la jungle politique. »
* Les citations de Jean-Paul Sartre proviennent pour l’essentiel des volumes II, V, VI, VIII et X de la série Situations, publiée chez Gallimard.
« Sartre est du côté de l’irrespect »
Annie Cohen-Solal
Spécialiste de Sartre, la chercheuse Annie Cohen-Solal nous donne les clés pour comprendre sa pensée, en montrant ce qu’elle doit à son enfance bourgeoise et protestante. Elle évoque également sa postérité, déplorant que celle-ci soit assez faible dans le monde universitaire français alors qu’ell…
« Sartre est du côté de l’irrespect »
Annie Cohen-Solal
Spécialiste de Sartre, la chercheuse Annie Cohen-Solal nous donne les clés pour comprendre sa pensée, en montrant ce qu’elle doit à son enfance bourgeoise et protestante. Elle évoque également sa postérité, déplorant que celle-ci soit assez faible dans le monde universitaire français alors qu’ell…