L’itinéraire d’un insoumis
Temps de lecture : 11 minutes
Révolutionnaire pratiquant, Guy Debord a consacré nombre de pages au récit de sa vie héroïque. Rester maître de son image, n’est-ce pas l’objectif premier de tout autoportrait ? De sa biographie, il a fait une arme contre le règne de la marchandise et la société du spectacle. Le gros volume de ses œuvres paru en « Quarto » ressemble autant à un pavé qu’à un bloc de savon. Car les concepts qu’il énonce s’avèrent fuyants, comme si c’était la condition de leur survie : pas de théorie sinon d’utile à la révolution ! Aussi, les événements de son existence ressemblent parfois aux vies des saints d’autrefois servant à l’instruction populaire : une légende dorée mais à l’envers, celle d’un exemplaire insoumis.
Ce fut, paraît-il, un remarquable joueur de poker. Un jeu où, expliquait-il, il faut moins réfléchir aux éventuels bluffs de l’adversaire que connaître l’état réel de ses propres forces. Guy Debord est un stratège du langage qui connaît le pouvoir de la parole dite en son temps – les détournements, l’ironie, le ton péremptoire et les non-dits : tout lui est outil de lutte. Impossible alors de feuilleter son parcours comme un objet neutre. C’est un bloc de savon vraiment, selon la description qu’en donne Francis Ponge : « point de pierre aussi glissante, et dont la réaction entre vos doigts soit une bave aussi volumineuse et nacrée ».
« Je suis né virtuellement ruiné », écrira Guy Debord dans Panégyrique I en 1989. Mais les déboires financiers sont étrangers à son enfance. Quand il vient au monde le 28 décembre 1931, sa famille possède une usine de chaussures et une pharmacie dans le 20e arrondissement parisien. Il faudra du temps avant que ne s’épuise le produit de leur vente. Son père meurt alors qu’il a 4 ans ; sa mère a deux autres enfants d’une longue liaison avec un moniteur d’auto-école, avant d’épouser un riche notaire. Guy Debord grandit à Nice, Pau et Cannes, il est le favori de sa grand-mère, qui fait office de cheftaine. Dans Vie et mort de Guy Debord, le biographe Christophe Bourseiller signale que l’enfant s’adonne à une passion obsessionnelle : le découpage, dont il fera plus tard un médium de prédilection. On peut aussi voir dans son entourage oisif la source de son futur dégoût du travail. « Ne travaillez jamais » est l’une de ses premières œuvres : un graffiti rue de Seine, à Paris, en 1953. « Vivre sans temps mort, jouir sans entraves », diront les murs en mai 1968.
De son adolescence, il écrit : « Les gens que j’estimais plus que personne au monde étaient Arthur Cravan et Lautréamont. » D’un côté, le poète-boxeur, neveu d’Oscar Wilde, spécialiste de l’insulte publique. De l’autre, l’auteur des Chants de Maldoror, expert en découpages et collages. Deux révoltés contre l’art et l’ordre établis : Guy Debord parfait son goût du scandale. C’est un élève brillant mais dissolu, adepte des canulars. Les anciennes promesses du Premier manifeste du surréalisme flottent encore dans l’air : l’histoire d’une révolution de l’art indissociable de celle de la vie.
Alors, quand les lettristes viennent projeter en marge du Festival de Cannes le Traité de bave et d’éternité d’Isidore Isou, Guy Debord, à 19 ans, est prêt pour l’aventure.
À 19 ans, il entre dans une vie de bohème et de marginaux, de mini-revues et de bistrots
Il part à Paris, s’inscrit en droit pour rassurer sa famille (des études qu’il abandonne bientôt) et entre dans cette vie de bohème et de marginaux, de mini-revues et de bistrots qu’est le Saint-Germain de l’époque. Les lettristes font partie des petits groupes d’avant-garde qui veulent détrôner les vieux surréalistes. Leur messie, Isidore Isou, promeut une poésie d’onomatopées pour combattre le dictionnaire, ce grand niveleur : « Coumquel quergl coumquelcanne ! MAGAVAMBAVA ! »
C’est un précurseur de la poésie sonore, qui privilégie la performance corporelle au sens. Son premier film, Traité de bave et d’éternité, aligne des plans sans rapport avec lesquels le son n’a rien à voir. Jean Cocteau, Jean-Louis Barrault apparaissent au détour d’une image. La pellicule est griffée.
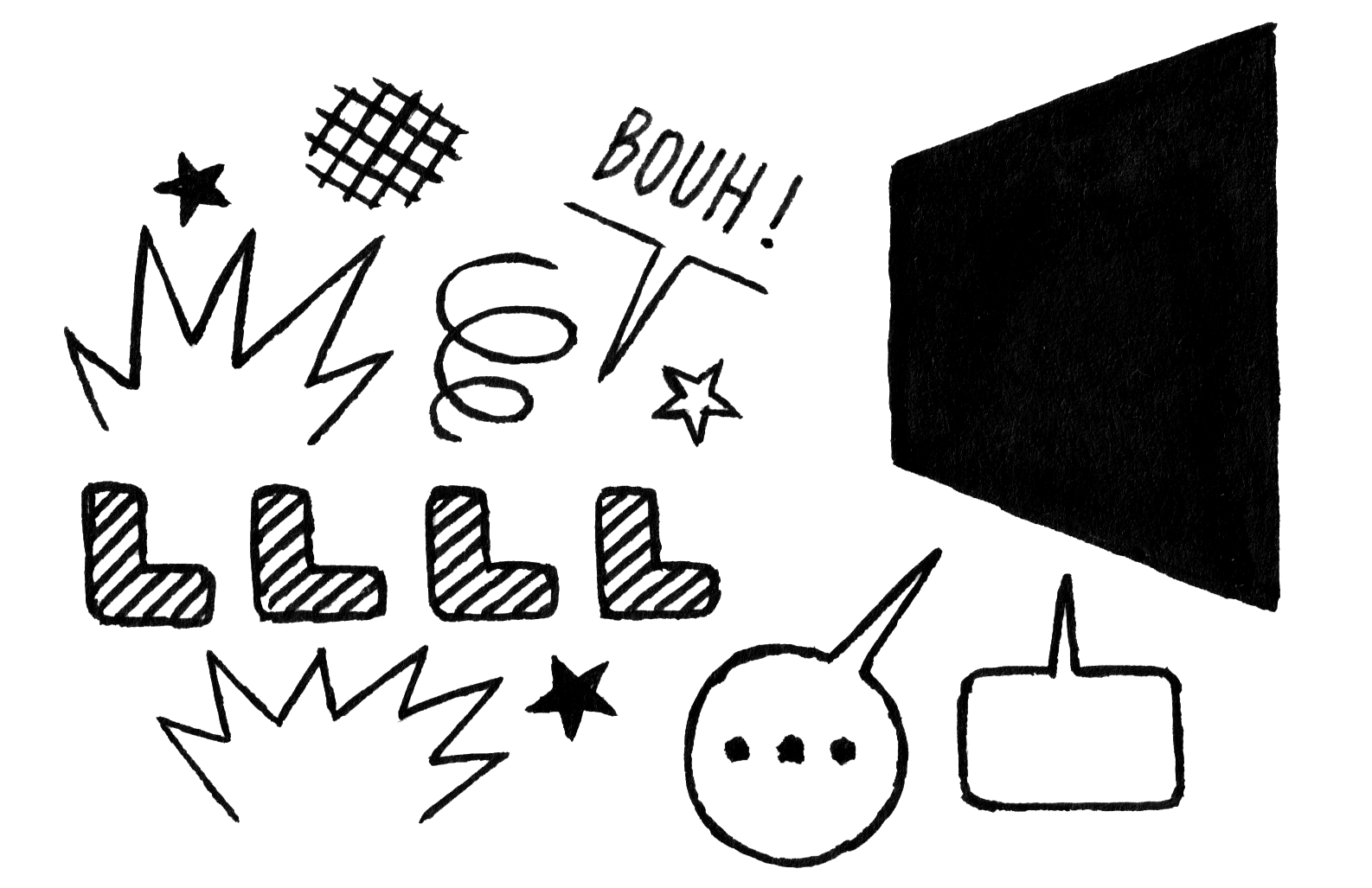 À son tour, Guy Debord se met au cinéma. Le premier de ses six films, Hurlements en faveur de Sade, est projeté le 30 juin 1952 au ciné-club Avant-Garde 52. Cette fois-ci, il n’y a plus d’images. Sur l’écran blanc, des voix assènent des formules ciselées – « Nous étions prêts à faire sauter tous les ponts, mais les ponts nous ont fait défaut » – et d’autres plus banales – « Dis, tu as couché avec Françoise ? » Guy Debord prononce la dernière phrase : « Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes », avant vingt-quatre minutes de silence et d’écran noir.
À son tour, Guy Debord se met au cinéma. Le premier de ses six films, Hurlements en faveur de Sade, est projeté le 30 juin 1952 au ciné-club Avant-Garde 52. Cette fois-ci, il n’y a plus d’images. Sur l’écran blanc, des voix assènent des formules ciselées – « Nous étions prêts à faire sauter tous les ponts, mais les ponts nous ont fait défaut » – et d’autres plus banales – « Dis, tu as couché avec Françoise ? » Guy Debord prononce la dernière phrase : « Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes », avant vingt-quatre minutes de silence et d’écran noir.
« Perdu », le mot revient souvent pour désigner ces années-là. « Dans le café de la jeunesse perdue », comme une politesse au temps qui passe… Et l’on songe de nouveau à la description par Francis Ponge des vertus du savon : « Pudique, se dérobant, fuyant, secret, héroïque, se dispensant à une allure inquiétante… ce qu’on appelle mener une existence dissolue… mauvais garçon par pudeur et dignité. »
Les lettristes brandissent le goût du jeu, en quête d’une méthode pour créer des « situations bouleversantes de tous les instants »
Guy Debord a toujours été fasciné par le crime et les bas-fonds. Au Moineau, un bar minable 22 rue du Four, puis au Tonneau d’or, 32 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, il s’encanaille et son cercle s’élargira avec les ivresses et les discussions partagées : Gil Wolman, Ivan Chtcheglov, Mohamed Dahou, Michèle Bernstein et beaucoup d’autres ; toujours, Guy Debord fera l’assaut de nouveaux amis, devenus ses interlocuteurs privilégiés, avant d’être soudain écartés. L’Internationale lettriste puis l’Internationale situationniste seront marquées par les exclusions abruptes et définitives. Le fondateur du lettrisme, Isidore Isou, en a fait les frais dès le 5 novembre 1952. Décidément trop histrion du pouvoir, il avait désavoué un épandage de tracts contre Charlie Chaplin.
Les revues Internationale lettriste puis Potlatch documentent les activités du groupe. On y trouve quelques textes politiques contre le dictateur espagnol Franco ou l’intervention américaine au Guatemala en 1954. Mais l’action se porte d’abord sur la transformation de la vie quotidienne. Contre les sinistres dimanches de la nouvelle société des loisirs, les lettristes brandissent le goût du jeu, en quête d’une méthode pour créer des « situations bouleversantes de tous les instants ». Ils fondent la « psycho-géographie » : une science de la dérive urbaine et du dépaysement. Ils théorisent le détournement des mots et des images pour réveiller les esprits.
En octobre 1955, ils écrivent sur les murs de Paris de nouveaux slogans : « Bénéficiez du doute », « La révolution, la nuit », « Des femmes pour les Kabyles »… Leurs actions restent confidentielles, même si l’Internationale a enfin franchi les frontières de la France. Le mouvement est désormais lié aux artistes post-surréalistes du mouvement Cobra, et notamment au Danois Asger Jorn.
Depuis 1954, Guy Debord est marié à Michèle Bernstein, sans que leur union empiète sur leur liberté sexuelle et sentimentale. Comme les surréalistes, il prise l’amour, plus intense parce que passager, et multiplie les tocades. Son épouse décrira plus tard cette atmosphère faite de rencontres et de liaisons dangereuses dans deux romans subtils. Ce sont presque des pastiches, écrits pour gagner des sous : il faut bien financer Guy Debord, fidèle à son vœu de ne jamais travailler.
L’Internationale situationniste naît le 28 juillet 1957, créée par huit personnes, dont trois sont exclues au printemps suivant. La lutte se déroule toujours sur le terrain idéologique. Les surréalistes avaient affirmé la souveraineté du désir et de la surprise, mais ils auraient surestimé la richesse de l’inconscient. Les situationnistes réfléchissent plutôt aux situations de la vie et aux décors qui les conditionnent. Ils sont en quête d’une Méthode – c’est le nom du nouveau bar que Michèle Bernstein et Guy Debord ouvrent rue Descartes, une aventure qui ne durera que quelques semaines.
Peu à peu, une radicalité nouvelle se fait jour qui exclut les pratiques artistiques et concentre les discours sur la politique. En 1960, Raoul Vaneigem intègre l’Internationale situationniste, de laquelle Asger Jorn démissionne l’année suivante. Guy Debord fréquente alors les marxistes du groupe Socialisme ou barbarie, qui sont les premiers à dénoncer dans le système de l’URSS un « capitalisme d’État bureaucratisé » – une critique qui touche le libertaire qu’il restera toujours. Il côtoie l’intellectuel Henri Lefebvre, comme lui préoccupé des conditions de la vie quotidienne plutôt que des superstructures – une rencontre marquante.
En revenant aux Manuscrits de 1844 de Karl Marx, que négligent les staliniens, et au chapitre du Capital consacré au caractère fétiche de la marchandise, émerge le concept de spectacle pour décrire les conditions nouvelles de l’aliénation, marquées par le règne de l’apparence et la passivité de consommateurs épris de leur servitude volontaire.
L’audience du mouvement s’accroît. En 1963, le huitième numéro de l’Internationale situationniste est tiré à 4 000 exemplaires. Les contacts à l’international se multiplient : Japon, Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Algérie… Le mouvement risque-t-il d’être banalisé ? Les situationnistes surenchérissent. Haro sur les mystiques beatniks ! Haro sur Jean-Luc Godard ! Haro sur Jean-Paul Sartre ! Grâce notamment au sinologue René Viénet, qui a rejoint le mouvement en 1963, Guy Debord n’est pas dupe de l’engouement des intellectuels pour le maoïsme.
Guy Debord comparera souvent la révolte de Mai 68 à une charge de cavalerie
En 1966, les situationnistes noyautent l’Union nationale des étudiants de France à Strasbourg. Une structure syndicale qui leur permet de diffuser plus massivement la brochure De la misère en milieu étudiant de Mustapha Khayati, situationniste depuis 1964. De quoi déjà créer le scandale !
Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, de Raoul Vaneigem, paraît en décembre 1967 chez Gallimard ; La Société du spectacle de Guy Debord, en novembre chez Buchet-Chastel. L’auteur dira plus tard y avoir montré « ce que le spectacle moderne était déjà essentiellement : le règne autocratique de l’économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable, et l’ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne ».
Aux situationnistes, on relie souvent la révolte de Mai 1968, que Guy Debord comparera à une charge de cavalerie. « J’admets, certes, être celui qui a choisi le moment et la direction de l’attaque, et donc je prends assurément sur moi la responsabilité de tout ce qui est arrivé », dira-t-il lyriquement. Les situationnistes sont alors proches d’un groupe d’étudiants de Nanterre, menés par René Riesel, qui se font appeler les Enragés.
Le 14 mai 1968, ils envahissent à la Sorbonne la salle Cavaillès devenue salle « Jules Bonnot », puis « Ravachol ». Les graffitis vont fleurir sur les murs, le plus souvent imaginés par Christian Sébastiani et René Viénet : « Je prends mes désirs pour la réalité car je crois en la réalité de mes désirs »… Mais le Comité d’occupation de la Sorbonne est mis sous tutelle dès le 15 mai, et les situationnistes, qui défendent la création par les travailleurs de « conseils ouvriers », sont très vite marginalisés par les groupes trotskistes ou maoïstes, plus autoritaires dans leur pratique du pouvoir.
Guy Debord va alors se soustraire à la sphère médiatique, refusant entretiens et interviews
Pourtant, ce seront bien les « situs » les grands vainqueurs de la bataille idéologique. Dès la disparition des barricades, les livres sortis les années précédentes s’arrachent. On parle de 200 000 copies de la brochure De la misère en milieu étudiant… Les slogans, les détournements de bandes dessinées et de photos érotiques font désormais partie de la panoplie du petit activiste. Ne reste plus à Guy Debord que l’option de pousser à la dissolution de l’Internationale situationniste pour éviter davantage de récupérations, ce qui sera fait en 1972, après moult exclusions et démissions.
Guy Debord va alors se soustraire à la sphère médiatique, refusant entretiens et interviews. Il n’animera plus de groupe ni de revue, mais continuera à réaliser films et livres. « Paris a été saccagé, et détruit intégralement le genre de vie qu’on y avait mené », constate-t-il. Il vivra désormais à Florence, à Arles, à Séville, en Auvergne avec sa nouvelle épouse, Alice Becker-Ho.
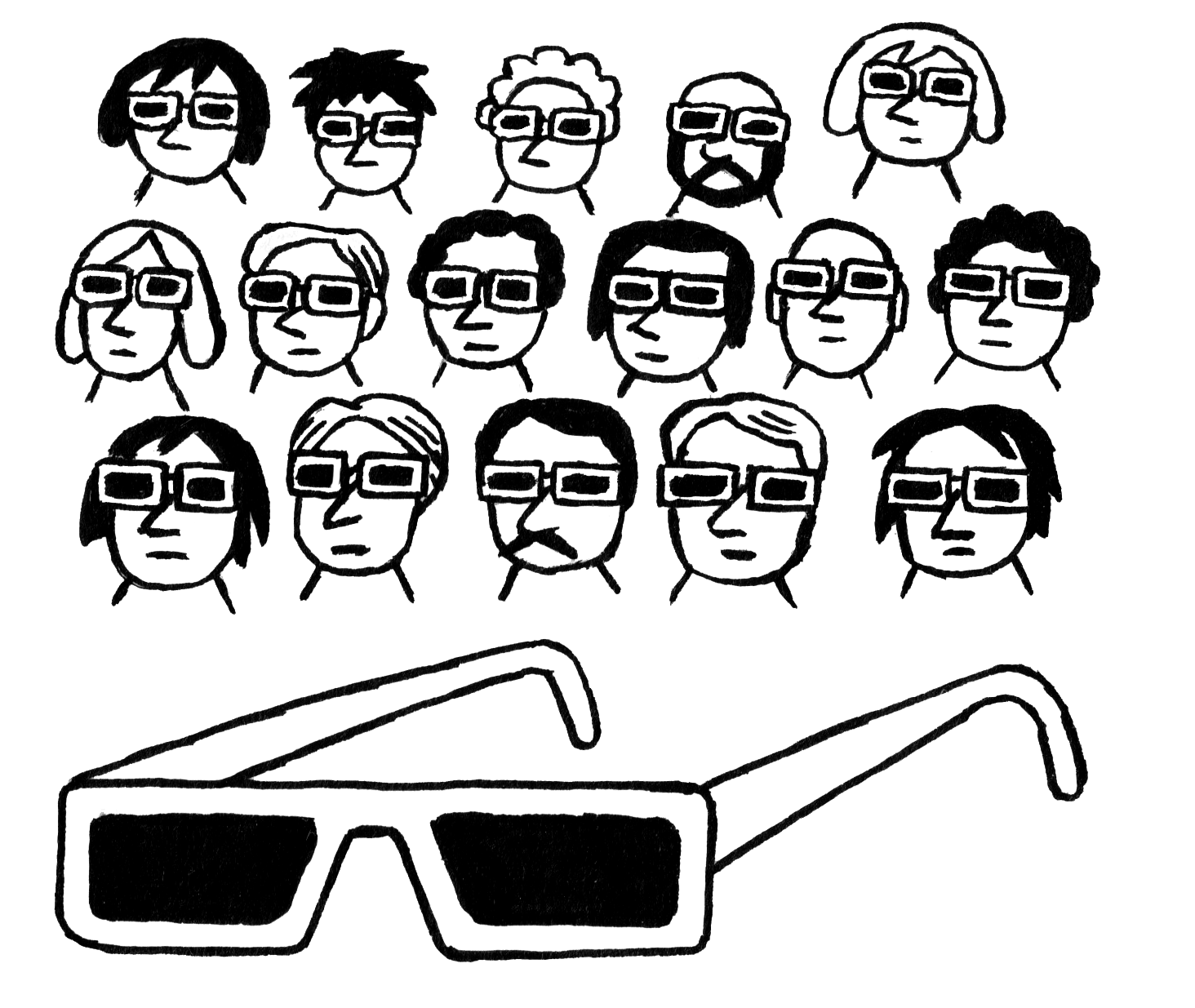 Le long métrage La Société du spectacle sort en 1973. In girum imus nocte et consomimur igni est réalisé en 1978. Le titre est un palindrome : « Nous tournoyons dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. » Guy Debord revient sur les années de lutte, dans une bataille de la mémoire placée sous le patronage des grands stratèges militaires Sun Tzu et Clausewitz.
Le long métrage La Société du spectacle sort en 1973. In girum imus nocte et consomimur igni est réalisé en 1978. Le titre est un palindrome : « Nous tournoyons dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. » Guy Debord revient sur les années de lutte, dans une bataille de la mémoire placée sous le patronage des grands stratèges militaires Sun Tzu et Clausewitz.
Les films sont produits par Gérard Lebovici, devenu l’ami et le mécène de Guy Debord. Imprésario de Brigitte Bardot, de Simone Signoret et d’Alain Delon, il a fondé les éditions Champ libre, où reparaissent La Société du spectacle et les douze numéros de L’Internationale situationniste. C’est un magnat du cinéma, le propriétaire d’Artmedia et de la société de distribution AAA. Dans les années 1980, il investit massivement le nouveau marché de la vidéo que convoitent aussi les milieux mafieux. Son assassinat, le 5 mars 1984, expose Guy Debord aux insinuations les plus farfelues. La presse voit en lui un prince maléfique qui aurait envoûté Gérard Lebovici : un coupable idéal !
Guy Debord riposte dans les Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici, rendant coup pour coup, article par article. En 1988, dans Commentaires sur la société du spectacle, il ajoute à ses analyses passées et dénonce le « spectaculaire intégré » qui a irradié toute la réalité. Par un tour de passe-passe, la science est devenue l’alliée d’une économie toute-puissante dans une guerre ouverte aux humains et à leur environnement. Pour la toilette intellectuelle, vous reprendrez bien un petit morceau de savon ?
Le premier volume de Panégyrique, paru en 1989, est un autoportrait écrit d’une plume virtuose, limpide, et multipliant pourtant les sens et les pièges. « Je ne prétends ressembler à personne d’autre », écrit Guy Debord, comme en écho à Jean-Jacques Rousseau (« Je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus »). Mais nulle confession ou plainte, ici, seulement l’histoire de ce qu’un homme libre a aimé : « Et tout le reste, à cette lumière, se montrera et se fera bien suffisamment comprendre. »
Souffrant de la goutte et des conséquences de l’alcoolisme sur la santé, Guy Debord se tire une balle de carabine dans le cœur le 30 novembre 1994, à 62 ans.
« Guy Debord saisit l’émergence de la société de consommation »
Vincent Kaufmann
Le sociologue Vincent Kaufman nous donne les clés pour entrer dans la pensée de Debord et comprendre ses concepts clés. Il revient également sur les grandes étapes de son parcours et sur sa postérité.
L’itinéraire d’un insoumis
Louis Chevaillier
« De sa biographie, il a fait une arme contre le règne de la marchandise et la société du spectacle. » Poète, éditeur et membre du comité de rédaction du 1 hebdo, Louis Chevaillier retrace la vie de cet intellectuel subversif et montre comment il s’est très tôt employé à sculpter sa lége…








