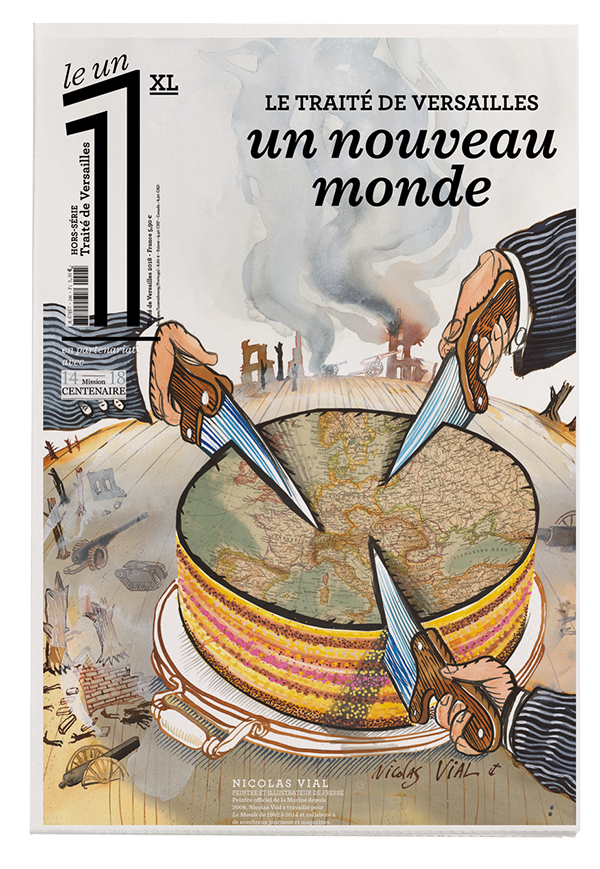« La paix ne se décrète pas, c’est un processus lent »
Temps de lecture : 9 minutes
Après les dix millions de morts militaires de la Grande Guerre et la signature de l’armistice avec l’Allemagne le 11 novembre 1918, la paix semble se dérober. Pourquoi ?
Durant les années 1918-1923, les populations vivent même une apothéose de la guerre. Les empires austro-hongrois et ottoman se disloquent et des conflits éclatent en Europe de l’Est, dans les Balkans, en Russie et au Proche-Orient. Ces violences trouvent même un écho en Irlande où se déclare une guerre pour l’indépendance. Dans le même temps, les Britanniques et les Français se partagent le Proche-Orient.
Mais il y a un tournant à partir de 1923. Ces innombrables conflits s’apaisent. Les nouveaux États-nations en Europe centrale et en Europe de l’Est trouvent leur équilibre. C’est une période de réconciliation, de reprise économique – notamment en Allemagne. C’est aussi la grande période de la Société des nations (SDN) ; on commence à rêver d’une paix durable. L’Allemand Gustav Stresemann et le Français Aristide Briand, tous deux ministres des Affaires étrangères, reçoivent le prix Nobel de la paix en 1926 pour leur action en faveur de la réconciliation franco-allemande. Jusqu’à la crise économique de 1929, tout est possible, rien n’est écrit. C’est très important. On ne peut pas imputer de manière mécanique au traité de Versailles la responsabilité des années 1939-1945.
Pour quelles raisons le traité de Versailles n’est-il pas parvenu à imposer immédiatement la paix ?
Il y a une raison principale. En 1870, les Allemands avaient défilé sur les Champs-Élysées pour célébrer leur victoire. En 1918, les Alliés n’ont pas défilé sur l’avenue Unter den Linden à Berlin. Les Alliés n’ont pas voulu pousser leur avantage pour épargner la vie de jeunes soldats. Cela fait une grande différence ! Après une guerre très dure, l’Allemagne reste donc potentiellement la puissance la plus forte en Europe, même au moment où elle est déclarée vaincue. Les troupes françaises sont stupéfaites en arrivant sur le Rhin de voir l’Allemagne intacte, debout. Les Allemands pensaient pouvoir siéger à la table des négociations, comme la France, représentée par Talleyrand, l’avait fait au congrès de Vienne en 1814-1815. Mais les dirigeants américain, britannique, italien et français réunis à Paris, confrontés à une situation internationale insaisissable et dangereuse, renoncent à convier l’Allemagne aux négociations. Je dirais que, sur le fond, la question allemande n’a pas été résolue en 1919. Or, c’était central.
Les différents traités signés entre 1919 et 1923 comportaient-ils d’autres défauts ?
Le redécoupage de plusieurs pays a été très durement ressenti. Prenez l’exemple de la Hongrie. Ce pays perd de vastes territoires, notamment la Transylvanie, qui passe à la Roumanie, et une bonne partie de la Slovaquie. Du coup, la Hongrie se considère spoliée, humiliée. C’est une blessure terrible qui saigne aujourd’hui encore.
Quels sont les deux ou trois dirigeants qui ont joué un rôle majeur dans ces années-là ?
Clemenceau d’abord. Il pensait qu’il existait des intérêts nationaux plus puissants que l’idéalisme porté par Wilson. Mais il a su trouver le point d’équilibre entre la vision américaine et sa volonté d’instaurer un nouveau rapport avec l’Allemagne. C’est pour cela qu’il refuse ce que lui demande Foch : séparer la Rhénanie de l’Allemagne.
Wilson ensuite. On oublie que, pour la première fois, les États-Unis occupent le devant de la scène internationale pour ne plus jamais le quitter. C’est un moment historique : le président américain impose l’idée de l’autodétermination des peuples, une instance supranationale – la SDN –, une nouvelle forme de diplomatie qui échapperait au secret. Ce sont des idées fortes, encore aujourd’hui. Wilson est une figure tragique parce qu’il arrive à Paris très malade et, de retour à Washington, ne parvient pas à convaincre le Sénat de ratifier le traité de Versailles.
Enfin, j’ajouterais Lénine, encore un grand absent de la conférence de la paix, pour la lueur révolutionnaire que jette sur le monde la prise de pouvoir bolchevique.
Comment expliquer l’enchaînement des violences dans ce monde nouveau ?
La paix ne se décrète pas. C’est un processus lent. L’armistice de 1918 marque la fin de l’épisode central de la Grande Guerre, c’est-à-dire de la lutte entre les grandes puissances en Europe. Mais ce n’est pas du tout la fin du conflit. Au contraire, la Conférence de la paix, en 1919, constitue le summum de la guerre dans le reste du monde. Autrement dit, la paix déclenche la guerre. Il y a d’abord la Révolution russe qui dégénère en guerre civile et guerres interétatiques. Lénine et Trotski, sont farouchement anti-impérialistes, mais nullement pacifistes. À leurs yeux, le déclenchement d’une guerre révolutionnaire internationale est nécessaire pour qu’on leur vienne en aide : leur idée est de s’appuyer sur les foyers industriels, les prolétariats avancés des pays capitalistes, l’avant-garde. Les bolcheviques étaient donc prêts idéologiquement et théoriquement à une nouvelle guerre, à laquelle répond la contre-révolution interne. Avant la fin de l’année 1918, la guerre civile commence entre les rouges et les blancs avec, par surcroît, l’intervention des pays alliés contre les bolcheviques. Si l’on regarde les bilans humains, on constate que durant la Première Guerre mondiale, 1,8 million de soldats russes meurent au front ; durant la guerre civile, ce sont au minimum deux millions de soldats et de civils qui périssent, sans compter un million de réfugiés blancs qui fuient vers l’Europe.
Le deuxième élément déclencheur de guerres est l’écroulement des empires multiethniques austro-hongrois et ottoman avec la défaite en 1918. Sur leurs cendres, il y aura une flambée de nationalismes qui chercheront à créer ou confirmer les États-nations, qui deviendront la forme politique prédominante dans l’Europe de l’Est et en Turquie. Tout cela déclenche des violences multiformes. Prenons l’Ukraine. Les nationalistes aspirent à fonder une république indépendante. Le pays se bat tour à tour contre la Pologne et la Russie et se trouve finalement partagé entre les deux au bout de deux ans. Dès 1921, une terrible famine en Ukraine soviétique entraînera la mort de près d’un million d’habitants et la fuite de centaines de milliers d’autres. Cette histoire tragique trouvera un sinistre écho en 1940-1945 avec l’engagement de beaucoup d’Ukrainiens aux côtés des nazis contre les Soviétiques et l’annexion définitive de l’Ukraine de l’Ouest à la fin de la guerre. On peut encore distinguer des traces de ces événements dans la guerre aujourd’hui entre l’ouest et l’est du pays.
Certains États titubent, d’autres choisissent la dictature.
C’est exact. Beaucoup d’États se délitent, ne parviennent pas à assurer des fonctions vitales. Cela génère des violences qui vont marquer durablement ces zones géographiques. Pour d’autres, comme la Russie, on observe que la Grande Guerre ouvre la voie à une forme de radicalité extrême. On peut citer le recours à la déportation de populations – ainsi celle des Cosaques (200 000 à 300 000 personnes) ; ou encore l’invention de la terreur policière et politique avec la création de la Tcheka ; et l’instauration d’un collectivisme économique sauvage afin de gagner la guerre civile. Trois éléments qui seront centraux dans le stalinisme des années 1930. Cela façonne l’expérience bolchevique.
Ce même enchaînement de violences se produit-il dans l’Empire ottoman ?
Oui. C’est une nouvelle guerre des peuples. L’Empire ottoman comprenait non seulement de nombreuses minorités ethniques, mais aussi de nombreuses terres arabes, jusqu’au Yémen. C’est un immense empire qui commence à se défaire avant la guerre et continue pendant. On oublie aujourd’hui que si les Alliés n’occupent ni Berlin ni Vienne, ils viendront occuper Istanbul pendant cinq ans. Ils déclarent la région des Détroits (Bosphore et Dardanelles) zone démilitarisée, établissent à l’est une République arménienne et autorisent les Grecs à débarquer dans le nord-ouest de l’Anatolie où se trouvent des populations grecques depuis l’Antiquité. La Grèce, qui a déjà mis la main sur la Macédoine, rêve de recréer l’empire de Byzance. Et c’est une catastrophe : beaucoup de crimes sont commis par son armée.
Le sultan, retenu à Istanbul, est impuissant. C’est l’occasion pour le jeune leader nationaliste turc Mustafa Kemal de s’installer à Ankara et de lancer une guerre de libération nationale. L’armée grecque commet l’erreur de vouloir marcher sur Ankara. Durant cette guerre, beaucoup d’atrocités ont lieu dans les deux camps. Cela se termine par le repli des Grecs, le sac et l’incendie de Smyrne, aujourd’hui Izmir, du 9 au 24 septembre 1922, et l’exode de la population grecque.
Quelles sont les leçons de cette séquence ?
Deux faits inédits sont actés. D’abord, les Turcs refusent le traité de Sèvres qui leur imposait de nombreuses pertes territoriales. Il est remplacé en 1923 par le traité de Lausanne qui établit la République de Turquie dans ses frontières actuelles. Cette séquence est donc couronnée par le premier acte de révision d’un traité dûment signé à Paris en 1919-1920. Ensuite, ce nouveau traité consacre un échange sans précédent de populations, une grande première dans le droit international. Entre 1 million et 1,2 million de personnes sont transférées selon des critères religieux. Grecs chrétiens d’Anatolie et Turcs musulmans de Thrace et de Macédoine sont expulsés, échangés. C’est un nettoyage ethnique avant la lettre. Tout cela est observé très attentivement par les nationalistes allemands, qui constatent ainsi que l’on peut réviser un traité de paix. Ensuite, c’est l’application d’une solution radicale à un problème de minorités et de frontières. Ces suites de la Première Guerre mondiale auront plus tard des échos terribles.
Quel est le bilan humain de l’après-guerre dans cette région du monde ?
Il est très lourd, mais, sauf erreur, personne n’a établi le bilan précis des pertes. Il s’agit de plusieurs centaines de milliers de morts en tout cas. On peut ajouter les transferts de population et l’impact du blocus économique des Alliés contre l’Empire ottoman, qui a provoqué des famines dès 1917. L’invention de la figure moderne du réfugié, on la doit en grande partie à l’intervention philanthropique massive d’agences telles que celle de Herbert Hoover (American Relief Administration) ou encore celle de la Société des nations naissante. Constantinople, entre autres, devient un canal pour les rescapés de la guerre civile russe.
La chute des empires était-elle inéluctable ?
Oui. La grande guerre a servi d’accélérateur, c’est certain. Le conflit de 14-18 a révélé et accentué l’importance du sentiment national, des identités nationales. La mobilisation a pu être inclusive comme en France, avec l’Union sacrée. Dans le cas de l’Empire austro-hongrois, le poids du nationalisme, du sentiment national qui explique qu’on puisse sacrifier sa vie dans une guerre, est devenu trop fort pour que résiste le cadre de l’empire. Quand l’Empire ottoman a battu le rappel sur la base du nationalisme turc, ce sont les Arméniens qui ont été désignés comme l’ennemi intérieur. Dès 1915, il y a un génocide au centre de la Grande Guerre. Là encore, l’histoire se répétera… ![]()
Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER
« La paix ne se décrète pas, c’est un processus lent »
John Horne
Après les dix millions de morts militaires de la Grande Guerre et la signature de l’armistice avec l’Allemagne le 11 novembre 1918, la paix semble se dérober. Pourquoi ?
Durant les années 1918-1923, les populations vivent même une apoth…
Les 14 Points du président Thomas Woodrow Wilson
Dans un message au Congrès américain du 8 janvier 1918, alors que la Première Guerre mondiale semble devoir encore durer un an ou deux, le président des États-Unis rend publique sa vision du monde de l’après-guerre. Ce texte, dont nous publions ici un large extrait, est rest…