« Les ennemis d’Erdogan sont imaginaires »
Temps de lecture : 6 minutes
La Turquie contemporaine souffre-t-elle d’une nostalgie de l’Empire ottoman ?
Absolument, on peut même parler d’une nostalgie violente. Elle est ressentie à la fois par le pouvoir, mais aussi par une partie de la société turque. Ce sentiment naît dès le xixe siècle, lorsque l’empire prend conscience que son modèle ne fonctionne plus et qu’il faut repenser la société. Dans les réformes lancées entre 1839 et 1876, il y a cette idée que l’empire a échoué et que la seule manière de se garantir un avenir est d’intégrer l’histoire occidentale. Le choc est énorme. L’empire est alors comme Janus, le dieu romain à deux visages. Il doit devenir l’autre pour rester lui-même. Il faut ajouter à cette schizophrénie, extrêmement forte et encore perceptible en Turquie aujourd’hui, un désamour de la part du cœur même de l’Empire ottoman, situé dans les Balkans et bien mieux intégré à l’Europe que l’empire lui-même. La Turquie porte encore le poids de ce désamour.
Peut-on parler d’une vraie nation turque ?
Il y a toujours eu plusieurs Turquies, mais un noyau dur turco-musulman et occidentaliste a lui aussi toujours existé. À l’époque ottomane, la « classe dominante », appelée « classe militaire » (askeri), était composée du Palais et de ses serviteurs, des militaires et des religieux musulmans. À la suite du processus de désintégration de l’empire, le sociologue Ziya Gökalp (1876-1924), disciple autoproclamé de Durkheim et grand inspirateur de la politique du fondateur de la République turque Atatürk, fixe trois objectifs à la nouvelle nation.
« Ce mythe alimente la nostalgie d’un pouvoir maintenant réduit »
Le premier est sa turcification, car la turcité représente l’essence immuable de la nation qui résiste au changement et au temps. Le deuxième est son islamisation, car la nation a besoin d’un système de valeurs et de croyances que seul l’islam est en mesure d’assurer. Le troisième est son occidentalisation. Selon Gökalp, les Turcs n’ont pas de civilisation propre et doivent s’adapter à la civilisation supérieure.
Ce noyau dur, qui forme le creuset de la nation turque, continue d’exister dans une version du parti aujourd’hui au pouvoir, l’AKP, moins occidentaliste mais toujours consolidé autour du pouvoir.
Qu’est-ce que l’essence turque, la « turcité » ?
Elle s’inspire du romantisme et du darwinisme social du xixe siècle, selon lesquels les nations sont des produits de la nature et possèdent des traits distinctifs. Il est dit qu’au commencement, les Turcs se trouvaient sur la terre d’Ergenekon, en Asie centrale. Des conditions climatiques drastiques les auraient poussés à partir avec la mission de conquérir le monde.
« Erdogan veut propulser les Turcs à la tête de l’islam »
Après deux siècles d’échecs successifs, ce mythe alimente la nostalgie d’un pouvoir maintenant réduit, contenu sur un tout petit territoire et contesté dans son islamité sunnite par une minorité religieuse comme les alévis et dans sa turcité exclusive par la minorité ethnique kurde.
Comment l’Empire ottoman gérait-il ses minorités ?
L’empire a hérité d’un droit musulman qui protège les communautés chrétiennes et juives, à condition que celles-ci se soumettent et renoncent à toute égalité. En contrepartie de cette protection, elles payaient un impôt spécifique et acceptaient un statut de subordonné qui leur interdisait notamment d’accéder aux armes et d’assumer officiellement des fonctions administratives. Une autonomie interne leur était alors accordée dans certains domaines comme la religion et l’éducation. L’empire n’exigeait pas de les intégrer, il ne cherchait pas à fabriquer de citoyens.
Comment définiriez-vous le projet du président Recep Tayyip Erdogan ?
Sa vision de l’empire n’est pas seulement impériale, elle est aussi islamique. Erdogan veut propulser les Turcs à la tête de l’islam. Selon son actuel Premier ministre Ahmet Davutoglu, qui a élaboré une grande partie de la politique étrangère du pays, la Turquie ne peut pas reconstruire l’empire. En revanche, il pense que le pays est une sorte de primus inter pares dans son ancien espace impérial, qu’il est « le plus privilégié parmi les égaux ». Pour parvenir à ce statut d’acteur hégémonique et être maître et arbitre des conflits internes, la Turquie doit être forte économiquement, militairement et du point de vue de son soft power.
Quels sont les points forts de la Turquie aujourd’hui ?
Il n’en reste pas beaucoup. Il y a cinq ans, le pays était encore considéré comme le modèle d’une combinaison réussie de l’islam et de la démocratie. Mais tout a changé depuis 2009-2010 et le virage autoritaire d’Erdogan. Le projet démocratique qui marquait la première partie du règne de son parti, l’AKP, est devenu parfaitement caduc. On est passé à un projet de construction d’une hégémonie interne à travers les structures du parti au pouvoir.
« Les opinions publiques arabes ne comprennent pas le virage autoritaire de la Turquie »
À l’extérieur, ses rapports avec l’Amérique et l’Europe sont extrêmement mauvais et, dans le monde arabe, son ambition de s’imposer comme le maître ultime a échoué. En Égypte, un coup d’État sanglant a renversé les Frères musulmans ; en Tunisie, le parti Ennahdha a perdu les élections ; en Libye, les Frères musulmans ont été marginalisés et le pays se trouve divisé ; et en Syrie, qu’Erdogan considérait comme sa chasse gardée, Bachar al-Assad est toujours là. À l’intérieur comme à l’extérieur, le pays est très fragilisé.
Quelle est la place de la Turquie dans le Moyen-Orient actuel ?
Une place médiocre. L’image d’Erdogan a été considérablement rehaussée à deux occasions. La première, en 2009-2010, lorsque la Turquie, jusque-là très proche d’Israël, est devenue très critique à son égard. La seconde, en 2011, quand le pays montrait qu’il parvenait à coexister avec les « laïcs » tout en étant islamiste. Ce fut bref. Depuis 2012, ce temps est révolu. Les opinions publiques arabes ne comprennent pas le virage autoritaire de la Turquie.
Erdogan peut-il compter sur des alliés ?
Mis à part l’Azerbaïdjan, Erdogan n’a pas d’alliés. Il est totalement isolé. L’Europe et l’Amérique le soutiennent uniquement à cause du conflit syrien. Il s’agit plus d’un pragmatisme contraint que de réelles alliances.
Qui sont ses ennemis ?
Le paradoxe est qu’il n’a pas d’ennemi non plus. Erdogan parle d’une bataille entre l’Est et l’Ouest. Or, l’Ouest n’est pas du tout engagé dans cette bataille. Au contraire, il ressent une très grande fatigue de l’islam et du Moyen-Orient. La seule chose qu’il souhaite est de se désengager totalement.
« C’est le parti au pouvoir lui-même qui est devenu la principale source de violence du pays »
Quant au monde arabe, même s’il ne comprend pas la Turquie, il n’est pas son ennemi. S’il fallait désigner un ennemi, ce serait l’Iran. La Turquie, l’Iran et l’Arabie saoudite portent une responsabilité historique très lourde dans la fabrique de la carte du Moyen-Orient d’aujourd’hui. Mais il s’agit plus d’une guerre froide que d’un réel conflit. Les ennemis d’Erdogan sont imaginaires, ils n’existent que dans son esprit. C’est comme s’il ne pouvait imaginer le monde sans un principe d’inimitié.
Le niveau de violence actuel en Turquie est-il inédit ?
La violence n’a pas toujours fait partie de l’histoire turque, mais elle s’est montrée très intense à plusieurs reprises : une quasi-guerre civile entre 1975 et 1980, une répression atroce après le coup d’État militaire de 1980 ; la guérilla du PKK lancée en 1984. Structurellement, le système de la Turquie provoque cette violence en incluant et en excluant. La turcification que prônait Gökalp a très nettement exclu les Kurdes. Elle a aussi, avec l’islamisation, été à la base du génocide arménien et du rejet des alévis. L’occidentalisation a exclu les islamistes et désormais le système Erdogan, qui impose le sunnisme, exclut les occidentalistes. Depuis quatre ou cinq ans, c’est le parti au pouvoir lui-même qui est devenu la principale source de violence du pays.
Propos recueillis par MANON PAULIC


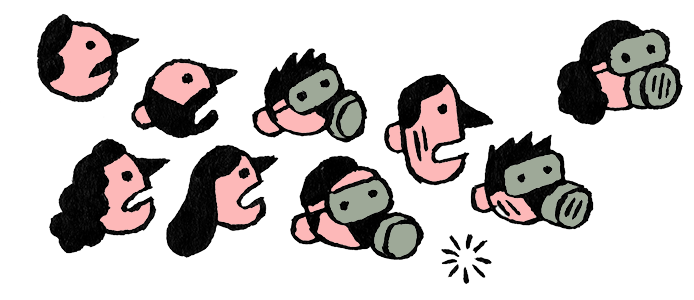
« Les ennemis d’Erdogan sont imaginaires »
Hamit Bozarslan
La Turquie contemporaine souffre-t-elle d’une nostalgie de l’Empire ottoman ?
Absolument, on peut même parler d’une nostalgie violente. Elle est ressentie à la fois par le pouvoir, mais aussi par une partie de la société turque. Ce sentiment naît dès le xixe s…
[Sultan]
Robert Solé
Sire,
On s’est permis de reprocher à Votre Majesté le palais qu’elle a daigné se faire construire à Ankara. Laissez-moi lui dire toute la honte que m’inspirent de telles remarques. Elles ne sauraient venir que de faibles d’esprit ou de r…
Réflexions sur « l’État profond »
Dorothée Schmid
L’attentat qui a coûté la vie à plus de cent manifestants pro-paix, le 10 octobre à Ankara, témoigne d’une dégradation dramatique du climat politique turc. Faute de revendication, les autorités ont avancé une liste de suspect…







