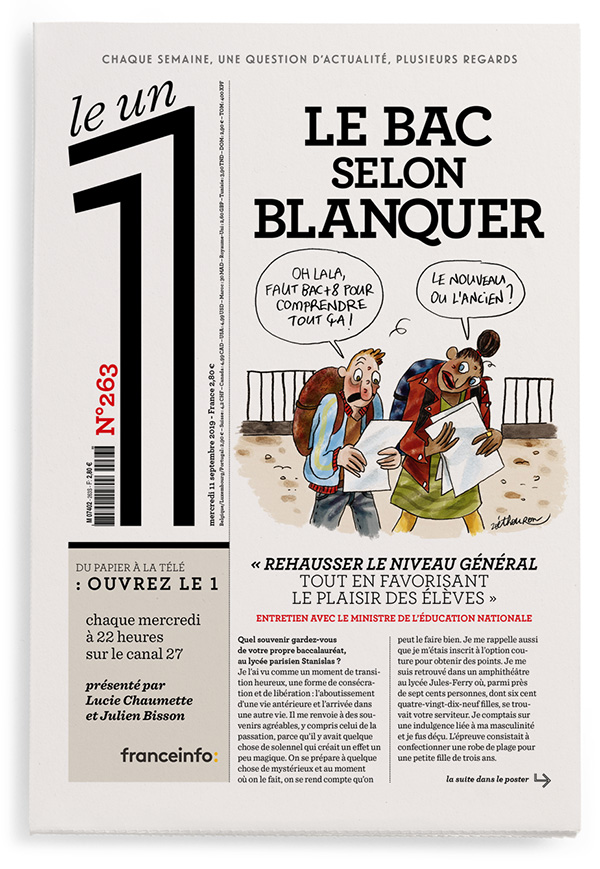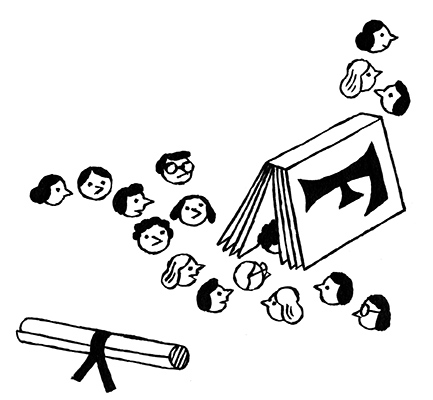« Le baccalauréat envoie un message à tout le système scolaire »
Temps de lecture : 31 minutes
Quel souvenir gardez-vous de votre propre baccalauréat, au lycée parisien Stanislas ?
Je l’ai vu comme un moment de transition heureux, une forme de consécration et de libération : l’aboutissement d’une vie antérieure et l’arrivée dans une autre vie. Il me renvoie à des souvenirs agréables, y compris celui de la passation, parce qu’il y avait quelque chose de solennel qui créait un effet un peu magique. On se prépare à quelque chose de mystérieux et au moment où on le fait, on se rend compte qu’on peut le faire bien. Je me rappelle aussi que je m’étais inscrit à l’option couture pour obtenir des points. Je me suis retrouvé dans un amphithéâtre au lycée Jules-Ferry où, parmi près de sept cents personnes, dont six cent quatre-vingt-dix-neuf filles, se trouvait votre serviteur. Je comptais sur une indulgence liée à ma masculinité et je fus déçu. L’épreuve consistait à confectionner une robe de plage pour une petite fille de trois ans.
Je revois chacune de ces jeunes filles remettant un travail très bien fait, et moi une espèce de chiffon froissé et très raté. Je n’ai évidemment eu aucun point !
Avez-vous trouvé facilement votre orientation au moment de choisir votre filière ?
J’avais commencé en seconde C [section où primaient les mathématiques et les sciences physiques], en m’inscrivant dans cette logique que nous combattons à présent avec la réforme : considérer qu’être en C, c’était le signe qu’on faisait partie des meilleurs élèves. Beaucoup de matières ne m’intéressaient pas en réalité, j’étais profondément littéraire et intéressé par les sciences humaines et sociales. Je suis allé dans la filière D [sciences de la nature et mathématiques appliquées], qui ne me plaisait pas davantage. C’est arrivé en terminale B [sciences économiques et sociales] que je me suis épanoui. J’aurais mieux fait de faire ce choix dès le début du lycée. C’est aussi pour cela que je porte ce message clé : faites ce que vous aimez et vous pourrez ainsi approfondir.
Vous évoquez votre bac comme une transition entre deux mondes. Pensez-vous que cet examen ait toujours cette fonction pour les élèves qui ont 18 ans aujourd’hui ?
Il demeure l’institution nationale par excellence et, depuis la fin du service militaire, la seule à concerner la très grande majorité d’une génération, a fortiori avec l’existence d’une grande diversité de baccalauréats (général, technologique et professionnel). Or on a besoin de rituels, dans une société comme dans une vie, et le baccalauréat en est un bon. On a aussi besoin d’une certification, de pouvoir attester de ce qu’on a acquis à un moment donné. De nombreux pays qui n’ont pas d’équivalent du baccalauréat se sont d’ailleurs intéressés ces dernières années au bac à la française et à la réforme actuelle, pour aller dans le même sens que nous. Je pense que psychologiquement, du point de vue de l’élève, la dimension d’un cran franchi demeure, et il ne faut ni la sous-estimer ni la dénigrer.
Le bac est-il une représentation de ce qu’est la République à vos yeux ?
Il existe un lien fort entre le baccalauréat et l’histoire napoléono-républicaine des deux derniers siècles. Il contribue à la dimension d’unité du pays ; à celle de méritocratie, très présente dès les origines – bien que la démocratisation de l’institution ait atténué cette dernière dimension, elle l’a conservée, notamment par le maintien des mentions. Le baccalauréat est donc bien une institution républicaine.
Lors de la grève des copies, en juillet dernier, vous avez parlé de « sacrilège ». Le baccalauréat a-t-il un caractère sacré à vos yeux ?
Oui, tout à fait. C’est évidemment à dessein que j’ai utilisé cette expression. Le viol de certains principes et valeurs républicains représente, lorsqu’il est commis, un sacrilège. C’est le cas lorsqu’on s’attaque au baccalauréat et à sa passation. Si vous interrompez un mariage à la mairie, vous faites quelque chose de sacrilège. Le sujet n’est pas divin, mais le mot sacrilège peut s’adapter à la situation car la République est ce qui nous relie et, à ce titre, peut être considérée comme sacrée.
Est-ce en raison de ce caractère sacré que les réformes envisagées au cours des dernières décennies se sont cassé les dents, de François Fillon à Xavier Darcos ? À force d’être un totem, le bac serait-il devenu un tabou ?
Il y a beaucoup de raisons à ces échecs. La première est qu’en tant qu’institution nationale universelle, le baccalauréat concerne énormément de gens. Un effet de taille entre en jeu, qui fait qu’on ne peut pas avoir l’accord de tous sur chacun des aspects. La deuxième raison est que le baccalauréat ne vaut pas seulement pour lui-même : il envoie un message à tout le système scolaire et il est d’autant plus intéressant à ce titre. Par exemple, en créant dans la réforme un oral solennel de fin de baccalauréat, on adresse un message jusqu’à la petite section de maternelle, qui dit : les compétences pour s’exprimer, argumenter, écouter, structurer sont des savoirs essentiels. L’enjeu en est fondamental, et j’ai tendance à penser que certains de ces objectifs sont partagés par la population française et le monde éducatif dans leur ensemble. Il s’agit de donner aux élèves confiance en eux. Et, pour réaliser cela, nous donnons un sens plus fort au baccalauréat. Au-delà des questions bien naturelles qui existent dès que vous changez quelque chose, il y a aussi ceux qui cherchent à ajouter de la conflictualité pour des raisons politiques ou autres. L’entreprise n’est évidemment pas facile, mais nous sommes bien engagés.
Emmanuel Macron annonçait déjà dans son programme présidentiel qu’il fallait changer le baccalauréat. Pourquoi a-t-il voulu en faire un des marqueurs de sa campagne ?
C’est un point dont nous avions parlé pendant la campagne présidentielle et sur lequel il avait des convictions ancrées, que nous partagions totalement. Les deux points sur lesquels il a pris un engagement présidentiel étaient de ramasser les épreuves à passer en quatre matières et d’instaurer le contrôle continu. Pourquoi ? Les motivations sont multiples, à commencer par la volonté d’en finir avec le bachotage. Il est intéressant de noter que ce néologisme même vient du baccalauréat ! Cela signifie quelque chose de ce qu’il a pu engendrer depuis longtemps : un exercice artificiel consistant à réviser à la dernière minute et de manière intensive, qui perd toute réelle utilité au-delà de l’examen. En finir avec le bachotage, c’est approfondir et c’est aussi offrir la possibilité du contrôle continu – soit la possibilité d’un travail continu – qui est la meilleure assurance contre l’accident d’examen. Ce sont nos motivations.
On y retrouve, au-delà, la volonté qui nous habite de rehausser le niveau général, tout en favorisant le plaisir des élèves. Un des principes de cette réforme est que, là où il y a un choix, il peut y avoir un approfondissement. En préparant le baccalauréat, l’élève prépare ce qui va le faire réussir après le baccalauréat. Dès la campagne présidentielle, ce qu’a proposé Emmanuel Macron était motivé par le souhait d’en finir avec le vrai scandale, qui est l’échec dans l’enseignement supérieur. On s’y est habitué alors que, à mes yeux, il s’est développé depuis une trentaine d’années du fait de la déresponsabilisation de tous. Il existe dès le début de la scolarité des problèmes qu’on a fait semblant de ne pas voir. L’interdiction du redoublement en était une conséquence. Cela revient finalement à dire : « Passez, passez, un jour vous finirez par savoir lire… » On atteint la fin de la troisième sans savoir lire, on passe entre les gouttes du baccalauréat pour arriver dans un amphi de première année et là, c’est l’heure de vérité, mais ce n’est plus la faute de personne si l’étudiant est en échec, et ce n’est pas la faute de l’université, qui est bien en droit d’avoir des exigences. Ce système qui, de proche en proche, a conduit à l’échec des élèves tout en dédouanant tout le monde est assez scandaleux.
Nous sommes donc en train de retricoter toute la pelote, d’une part, en donnant la priorité des priorités à l’école primaire pour ancrer les savoirs fondamentaux et, d’autre part, en permettant une personnalisation et un approfondissement des parcours pour que tous les élèves arrivent à niveau là où ils se dirigent, dans l’enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle. Réussir s’avère ainsi un objectif de profonde justice sociale, puisque les premières victimes de ce système sont évidemment les plus défavorisés.
La responsabilisation de tous, est-ce également celle des élèves ? Car on leur propose des parcours plus adaptés à leurs goûts, mais aussi une orientation plus précoce. Ont-ils dès lors une obligation de réussite ?
Je ne le dirais pas en ces termes, mais il est vrai que la responsabilisation amène à se poser dès la seconde des questions qu’on se posait différemment ou plus tardivement – parfois trop – dans le système précédent. On me dit souvent : « Attention, il n’est pas normal qu’on demande à un élève de seconde de choisir, alors qu’il ne peut savoir quel métier il veut faire. » Mais la réforme n’amène absolument pas à cela ! À 16 ans, il est bien normal qu’on ne le sache pas, et c’est le cas de la majorité des élèves. En revanche, se poser la question de ce qu’on aime ou non, mener des premières réflexions sur ce qu’on a envie de faire par la suite, est à la portée d’un élève de seconde. Et il est bon d’institutionnaliser le fait de se poser ces questions. Est-ce que j’aime ou non telle discipline ? Dans n’importe quelle conversation courante, un adolescent est capable de vous le dire. Il s’agit de prendre au sérieux ses aspirations et de le faire réfléchir. C’est le processus dans lequel s’engage le site horizon2021.fr : se projeter dans le futur à partir de ce qu’on aime ou non, non pas pour obtenir des réponses immédiates, décider à 16 ans si on veut être architecte ou jardinier, mais tout simplement pour que l’élève se dise qu’il y a un spectre d’enseignements qui lui plaisent. Avec cette réforme, les lycéens vont pouvoir les approfondir, se tester, changer ensuite, rectifier leur parcours, définir progressivement le genre d’études qui leur plaît et, un jour, trouver un métier.
L’une des grandes critiques faites au bac concernait le coût de son organisation. La question financière fait-elle partie des motivations de cette réforme ?
Le coût et la lourdeur font tous deux partie des enjeux de la réforme, sans en être les principaux. Il n’y a pas de honte à cela. L’ensemble du système éducatif était alourdi par l’organisation des mois de juin et de juillet, voire avant, du fait du baccalauréat. C’était non seulement coûteux sur un plan financier mais aussi très chronophage, et ce au détriment, notamment, de la scolarité des élèves de seconde et de première. Cela recouvre donc un enjeu de société : le mois de juin va changer en France. Ce ne sera plus seulement le mois où on regarde le festival de Cannes et Roland-Garros. Il y aura du temps scolaire regagné, en particulier pour les élèves de seconde et de première. Ce n’est pas tant le coût de l’organisation du baccalauréat qui importe – même s’il y aura quelques économies, je l’espère, qui seront réaffectées à d’autres choses –, que le temps que les professeurs et les élèves vont gagner.
Cette nouvelle organisation du lycée entraînera-t-elle des économies de personnel ? A-t-on besoin de moins d’enseignants dans ce nouveau lycée ?
Non, mais cette organisation permettra en revanche une meilleure utilisation des moyens. La visée n’est pas de réduire les coûts mais d’offrir plus de possibilités en s’organisant différemment. L’exemple type, c’est la naissance de nouvelles disciplines et de nouveaux enseignements – en particulier de la spécialité « numérique et sciences informatiques », pour laquelle on a formé deux mille professeurs pour cette rentrée et qu’on a réussi à implanter dans plus de la moitié des lycées de France. C’est véritablement un grand changement pour notre pays et pour les élèves concernés, notamment en termes d’égalité garçons-filles dans le domaine informatique. Toute une série de progrès s’accompliront ipso facto.
L’offre est aussi enrichie. Auparavant, peu de gens, voire personne, ne s’intéressaient au nombre de lycées où on avait implanté les filières S, ES et L. En réalité, 84 % des lycées proposaient les trois à la fois ; les 16 % restants n’en avaient que deux, le plus souvent des petits lycées ruraux. Désormais, 90 % des lycées ont au moins sept spécialités en comptant, au minimum, dix à quinze élèves par cours.
Pourquoi était-il essentiel de décloisonner ces filières – S, ES, L – qui existaient depuis 1995 ?
Elles avaient engendré de l’artificialité, une sorte de conformisme qui lui-même a abouti à une hiérarchie en fait assez explicite entre S, puis ES, puis L. Cette hiérarchie était absurde, peu républicaine et néfaste pour les élèves. On aurait pu lui trouver au moins le mérite de porter au pinacle la culture scientifique – on en avait après tout effectivement besoin –, mais ça n’avait pas même cette vertu-là. En réalité, après le bac S se produisaient une fuite importante d’élèves vers d’autres domaines que les sciences. Je préfère des élèves qui restent fidèles à leur vocation affirmée, plutôt que cette démarche qu’on a observée jusqu’à présent.
Les matières scientifiques restent pour l’instant les matières reines dans les choix des élèves…
Les mathématiques sont évidemment la matière la plus choisie, de l’ordre de 70 %. À présent, à chaque discipline de tirer son épingle du jeu. L’intérêt de la réforme réside aussi dans la refonte des programmes qui s’est accomplie à l’issue d’un travail gigantesque. On compte 80 nouveaux programmes qui ont tous en commun de remuscler les exigences, dans l’intérêt des élèves.
Avez-vous été surpris par les premiers choix de spécialités des élèves ?
Ils correspondent à ce à quoi je m’attendais. Beaucoup prédisaient que les élèves reconstruiraient les filières telles quelles, j’étais donc évidemment satisfait d’avoir confirmation de ce que je pensais : seuls 25 % des élèves ont reconstitué la filière S, alors qu’ils étaient 55 % jusque-là dans cette voie. On observe aussi des parcours très originaux. Avec le Premier ministre, nous nous sommes rendus dans un lycée du Var. Sur les trois cent cinquante élèves de première de cet établissement, vingt avaient opté pour un parcours totalement unique. Un élève qui voulait être ingénieur du son a, par exemple, couplé informatique, art et musique, et mathématiques.
Selon les syndicats d’enseignants, les bons élèves feraient preuve de davantage de conformisme que les autres. Ils auraient ainsi davantage tendance à reconstituer les anciennes filières, notamment la filière scientifique. Qu’est-ce que cela dit de leurs angoisses, ou de celles de leurs parents ?
C’est un sujet passionnant et à double tranchant. Je ne le vois pas dans mes chiffres mais il est possible de penser que cette tendance existe. Maintenant, est-ce un bon calcul ? C’est comme lorsque vous faites la Route du Rhum : la route du nord n’est pas forcément meilleure que la route du sud ! On trouvera peut-être plus d’originalité dans les territoires défavorisés parce que les codes sont moins intégrés par les parents, mais ces codes sont désormais ceux d’autrefois et ils pourraient se retourner contre ceux qui y croient encore. Autrement dit, si vous avez deux bons élèves et que tous les deux veulent faire un institut d’études politiques (IEP), si l’un choisit par conformisme de recomposer la combinaison de l’ancienne série S – maths, physique, SVT – et si l’autre fait histoire-géographie, langues et civilisations et humanités (philosophie ou sciences économiques et sociales), le deuxième sera avantagé par rapport au premier, qui aura fait un faux calcul de sécurité.
Pour ma part, je ne vois pas de déterminant social dans les choix actuels. Quand bien même il y en aurait un, il serait au détriment de ceux qui joueraient le code conservateur. On retrouvera la même chose dans les établissements d’enseignement supérieur. Leurs attentes à l’égard des élèves sont en train d’évoluer, et cette évolution est à compter, à mes yeux, parmi les progrès qui s’accomplissent au travers de Parcoursup et de la réforme du baccalauréat. Les élèves de seconde, je le disais tout à l’heure, se posent de bonnes questions. Les établissements explicitent davantage ce qu’ils attendent d’eux. Plutôt que le système que nous avions précédemment, dans lequel un élève de terminale arrivait au bout d’un couloir et se rendait compte, parfois trop tard, qu’il avait suivi une démarche aléatoire, désormais nous avons mis en place un système où, dès la seconde, les élèves peuvent se renseigner.
Les attentes des établissements d’enseignement supérieur ont changé, parce que la réforme du baccalauréat les amène à dire qu’ils aiment avoir des profils différents et pas seulement standardisés. Un bon exemple en sont les IEP, mais aussi les écoles de management et même les écoles d’ingénieurs. Bien sûr, dans le cas des études scientifiques, le spectre des compétences indispensables est plus défini, mais les établissements peuvent introduire des variantes et ils le font. Typiquement les écoles d’ingénieurs insisteront sur l’informatique, les universités de médecine sur la SVT, mais, ensuite, préciseront qu’il est possible de panacher. Il ne s’agit pas d’édulcoration, au contraire : la diversité des profils est favorisée et, en même temps, on a tenu compte des remontées des écoles d’ingénieurs ou des facultés de sciences, selon lesquelles le niveau de mathématiques avait baissé depuis un certain nombre d’années. On a donc remusclé le programme de cette matière : ceux qui font des mathématiques en font plus et mieux.
Ce bac réformé peut-il contribuer à lutter contre les inégalités territoriales ?
C’est notre but. Le « laissez faire, laissez passer » et l’immobilisme étaient les plus sûrs facteurs de renforcement des inégalités, si nous n’avions rien fait. Le tableau actuel est assez inégalitaire et il résulte du système ancien. C’est bien qu’il fallait faire quelque chose. Nous avons décidé de nous appuyer sur plusieurs facteurs pour réduire les inégalités. D’abord, plus d’explicitation et moins de codes, quitte à ce que les parents qui maîtrisaient ces codes soient déstabilisés. Il n’existe plus de combinaison meilleure en soi, plus de martingale. Certaines combinaisons sont souhaitables mais explicitées, ce qui clarifie, permet plus de transparence et pousse davantage à aller s’informer. Certains disent que cela crée de la complexité. En réalité, la complexité existait avant, mais sous le boisseau. Jusqu’à présent 99 % des terminales ne savaient pas, par exemple, ce que signifiait atterrir dans une faculté de droit. Par cette réforme, nous luttons directement et indirectement contre les inégalités en nous inscrivant pleinement dans la stratégie générale contre les inégalités. Notre travail pour la modernisation de l’orientation, en lien avec les régions, améliorera aussi l’égalité entre les élèves.
L’offre de formation elle-même est aussi un moyen de lutte contre les inégalités. Par volontarisme, on implante des enseignements de spécialité dans les territoires les plus défavorisés. La différence se fait non pas entre un établissement des beaux quartiers et un des quartiers défavorisés, mais entre un petit et un grand établissement. Un établissement de grosse taille comportera plus d’offres. À Bourg-en-Bresse, par exemple, trois lycées ont été amenés à coopérer davantage grâce à cette réforme, et toutes les spécialités sont désormais présentes dans un rayon très proche. Tous les élèves disposent de toute l’offre possible, ce qui est pleinement au service de l’égalité sociale. Comme les lycées de banlieue sont souvent de grande taille, ils ont une offre de formation assez riche. Si vous prenez les lycées ruraux, au contraire, il peut y avoir un sujet, quand ils sont petits. Ce problème existait déjà avant et notre rôle est de le compenser autant que possible. J’ai demandé aux recteurs de mettre le plus possible dans les lycées ruraux une offre de formation riche, parfois avec une politique volontariste.
Et enfin, nous étions contraints jusqu’à présent par un système rigide de blocs où il était impossible de changer les enseignements. Dans le cadre nouveau, il sera possible de faire du réglage fin. Il sera possible de se dire : mais, au fond, pourquoi ne rajoute-t-on pas un enseignement spécialisé dans tel domaine, puisque la société a évolué de telle façon ? Vous créez ainsi un cockpit de pilotage pédagogique et social beaucoup plus fort. Et c’est bénéfique pour le pays, évidemment.
Justement, qu’est-ce qui a présidé au choix des sept spécialités principales que propose la réforme ?
D’abord les tendances existantes, les attentes des lycéens – nous en avons consulté quarante mille – et les attendus de l’enseignement supérieur. Il est tout à fait normal de s’intéresser au « facteur aval », si je puis dire. Nous pensons avoir élaboré un spectre de compétences qui permette d’épouser toutes les combinaisons pertinentes pour l’accès à l’enseignement supérieur. Mais – je le redis –, ce faisant, on a aussi créé un système souple qui permettra dans le futur de créer des choses nouvelles si nécessaire.
Le rapport remis par Pierre Mathiot sur « le lycée des possibles » pointait la revalorisation nécessaire du bac. Comment cette réforme peut-elle y parvenir ?
Le but est de renforcer le baccalauréat et de lui redonner du sens. À partir du constat de l’éventuelle perte de crédibilité du baccalauréat, il y avait deux routes possibles. L’une consistait à dire que l’on mettait fin au baccalauréat…
A-t-elle été envisagée ?
Pas par moi, ni par le président de la République. Mais dans le débat public précédant l’élection, oui, bien sûr. Des gens tout à fait respectables jugent qu’un certificat de fin d’études du secondaire sur la base du bulletin de notes simplifierait tout. C’est un argument qu’on peut entendre. Ce n’est pas ma façon de penser, ni celle du président et du Premier ministre. Nous pensons au contraire que le baccalauréat est une belle institution qui a du sens et qui a besoin d’en avoir plus encore. Nous estimons que cette réforme le renforce en lui donnant encore plus d’authenticité à travers l’idée de contenu plus approfondi et d’authenticité des choix. Nous visons vraiment la désartificialisation. La perte de crédibilité tient plutôt au côté artificiel du bachotage et des choix standardisés.
Une des critiques principales de cette réforme tient au fait que le bac ne serait plus national, que les bacs ne se vaudraient pas selon l’établissement fréquenté par l’élève. Quelle réponse apportez-vous à cette inquiétude ?
Il y a plusieurs éléments de réponse. D’abord, nous sommes allés vers l’objectivation maximale du contrôle continu. On devait concilier le principe de simplicité avec celui d’objectivité et trouver un point d’équilibre. Du côté du principe de simplicité, le bulletin scolaire, et du côté du principe d’objectivité, le contrôle continu tel qu’on l’a conçu, qui vient épouser les pratiques déjà existantes en matière de bac blanc, mais avec des éléments d’objectivité forts comme l’anonymisation des copies, une banque de sujets nationale, et un correcteur autre que le professeur de l’élève. C’est le système antérieur qui, en réalité, se caractérisait déjà par beaucoup d’inégalités ! Dans le système précédent, une bonne partie des élèves étaient déjà pré-destinés aux filières sélectives de l’enseignement supérieur avant même d’avoir passé le baccalauréat. Un certain nombre de déterminismes sociaux jouaient à plein. Dans le nouveau système, le baccalauréat va compter davantage pour l’enseignement supérieur. Enfin, vous avez parfois des élèves de lycée des quartiers favorisés qui ont peur d’être lésés parce qu’ils sont notés plus sévèrement qu’ailleurs. Je crois que ce sont deux craintes qui s’annulent.
Le système français, avec cette réforme du bac, peut-il apparaître comme plus moderne que d’autres modèles éducatifs au niveau international ?
J’y crois profondément, et c’est un de nos buts. À mes yeux, on garde les qualités reconnues à la France depuis toujours et le prestige historique du baccalauréat, tout en ayant des éléments de modernité et d’adaptation. C’est cette combinaison qui peut faire du nouveau baccalauréat français un point de repère dans le monde. Et je suis convaincu que ça va être le cas. On a déjà les premiers indices de cela par le surcroît d’attractivité des lycées français à l’étranger dans le contexte de la réforme du baccalauréat. Dans ces lycées, les élèves se sont emparés pleinement du potentiel des nouveaux cadres et ça leur va très bien.
Cette réforme s’inspire-t-elle de certains exemples étrangers ?
Bien sûr. Comme pour toutes nos réformes, on fait une analyse comparative au niveau international. Il ne faut pas fonctionner en vase clos, même si nous devons conserver nos forces et nos particularités – en particulier, l’épreuve de philosophie, qui est quelque chose de très français et qu’on a mise au centre des épreuves finales. C’est l’épreuve commune par excellence du nouveau baccalauréat. Mais on a aussi regardé à l’étranger, en Italie par exemple, où les élèves passent le colloquio, une épreuve orale solennelle, en fin de parcours.
On parle beaucoup du bac général, moins des bacs technologiques et professionnels. Vont-ils également évoluer profondément dans les années à venir ?
Nous avons souhaité conforter le bac technologique, le consolider en maintenant les séries pour les années qui viennent, puisqu’elles avaient été modifiées il n’y a pas très longtemps. Mais le bac technologique va aussi connaître des modernisations par les effets de bord du bac général. Par exemple, la matière « sciences de l’ingénieur » peut être suivie de façon modulaire par des élèves de bac général ou de bac technologique. S’agissant du bac professionnel, il fait l’objet d’une réforme en soi, très profonde et que je considère comme au moins aussi importante, voire plus importante, que celle du baccalauréat général. C’est une réforme qui entre en vigueur à cette rentrée avec la notion de co-intervention, qui articule des éléments professionnels avec du général, pour faire mieux comprendre le sens de sujets relevant de l’histoire ou du français via des savoir-faire professionnels. Et la notion de chef-d’œuvre, qui renvoie à une pédagogie de projet dans l’enseignement professionnel, et aussi à une part de prestige. Nous souhaitons mettre en place le « Harvard du pro ». Et, dans ce cadre, nous sommes en train de travailler avec les régions de France pour avoir des lieux extrêmement attractifs, et notamment des campus professionnels, dont on rendra publique la cartographie dans peu de temps avec la ministre du Travail et la ministre de l’Enseignement supérieur.
Cette réforme va-t-elle toucher les établissements dans leur organisation, leur géographie, et modifier les salles de classe ? Suppose-t-elle aussi une autre manière de vivre le lycée au jour le jour ?
Bien sûr. Si je parle de « Harvard du pro », c’est en ayant en tête la dimension physique des choses, c’est-à-dire un campus qui fait envie : des espaces verts, des équipements sportifs, des internats, etc. C’est ce qu’on peut souhaiter en France, avec une modernisation du bâti scolaire qui est réelle depuis un certain nombre d’années et qui, je l’espère, va encore s’accentuer. Ce sera aussi le cas du lien avec le supérieur : on peut imaginer des campus associant grands lycées et universités. Vous aurez plus d’espaces verts – j’insiste beaucoup sur ce point –, a fortiori dans le cadre de la nouvelle impulsion environnementale que nous sommes en train de donner. Et parmi les évolutions très importantes qu’on peut souhaiter, aussi bien pour le lycée que pour le collège et même l’école primaire, c’est la prise en considération qu’il y a de manière éternelle pour les institutions de savoir, en leur cœur, la bibliothèque. Dans la civilisation technologique dans laquelle nous sommes en train d’entrer, cela signifie deux poumons. La bibliothèque correspond à deux pôles : l’un, classique, qui ne doit surtout pas disparaître – qui est une bibliothèque avec des livres physiques et des revues très bonnes, où l’on s’assoit et se concentre de façon individuelle –, et un pôle numérique, plus collectif, plus bruyant, plus interactif. On ne doit évidemment pas opposer l’un à l’autre, mais au contraire sentir qu’on tient sur ces deux pieds-là. Il faut que les élèves, quand ils ont du temps libre, aillent faire du sport et fréquenter ces lieux qui sont à la fois des lieux de concentration et de convivialité.
La dimension modulaire tient aussi à un changement de conception du groupe-classe. On a dit que les emplois du temps vont être plus difficiles à faire. C’est en partie vrai. Vous êtes ensemble pendant 60 % des heures de cours et le reste du temps vous croisez d’autres élèves. C’est bien d’avoir le groupe-classe et c’est bien aussi d’avoir des modalités de regroupement différentes.
Cela implique-t-il une mixité nouvelle ?
Comme souvent d’ailleurs, il est important en matière éducative qu’il y ait de la mixité. Ce n’est pas une réforme technique où l’on change le nombre d’heures d’enseignement. C’est vraiment une réforme d’état d’esprit. Et cet état d’esprit, une des manières de le résumer, c’est de dire qu’il y a deux périodes dans la vie d’un jeune : une première période qui commence avec l’école maternelle et qui s’achève avec la fin du collège, dans laquelle vous allez donner à tous le bagage fondamental indispensable pour la vie ; et puis une nouvelle période de la vie qui commence avec la classe de seconde et qui ne s’arrête pas avec la classe de terminale, qui tient à l’affirmation de votre personnalité, à la personnalisation de votre parcours, à la sortie du tuyau que pouvait être l’école jusque-là.
Comment jugerez-vous de la réussite de cette réforme ? Quels sont les indicateurs que vous regarderez ?
Il y a bien sûr le critère de la réussite au baccalauréat. Et, plus fortement encore, le critère de la réussite dans l’enseignement supérieur. Ce qui est vraiment très important pour nous, et j’associe Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, à ce raisonnement, c’est de mieux préparer ce qui se passe après le baccalauréat. J’entends trop souvent encore les professeurs de l’enseignement supérieur être extrêmement navrés du niveau de maîtrise des savoirs fondamentaux de leurs nouveaux étudiants – en matière d’écriture, tout bonnement, ou même de mathématiques. Je prends très au sérieux ces analyses parce que ce n’est pas juste de la déploration éternelle sur le niveau qui baisse. Il y a réellement eu un affaissement, qui concerne des choses fondamentales, ce qui nous renvoie encore une fois à la politique de l’école primaire, mais aussi à cette bonne préparation des élèves. Il nous faut en finir avec le grand écart qui existe entre les meilleurs – qui, pour certains, sont peut-être encore meilleurs que ceux d’autrefois, mieux préparés et profitant de toute une série d’avantages – et puis tous ceux qui sont restés au bord du chemin. Ce projet est profondément social à ce titre. Et il est aussi au service de l’élévation du niveau de notre pays.
Propos recueillis par JULIEN BISSON& ÉRIC FOTTORINO
[Réussites]
Robert Solé
Si conduire sans permis est un délit grave, rien n’interdit de réussir sa vie professionnelle sans bac. Quelques exemples éloquents inciteraient même les cancres à pousser l’école buissonnière jusqu’au bout. Des non-bache…
Il faut changer l'école
Michel Fize
Les réformes passent, l’école française trépasse. C’est, depuis un nombre infini de décennies, une mort continue.
La réforme Blanquer, tant vilipendée aujour…