« L’Algérie dispose de 5 à 10 ans pour réussir sa mutation »
EntretienTemps de lecture : 8 minutes
En Algérie, la « diversification » de l’économie semble toujours promise mais jamais enclenchée. Comment sortir de la « dépendance » pétro-gazière ?
Le temps presse : c’est devenu un impératif. Aujourd’hui, l’Algérie importe presque tout ce qu’elle consomme. Ce système est supportable aux Émirats arabes unis, pas en Algérie où la croissance démographique doit pouvoir s’appuyer sur une production intérieure. Sans cela, ce pays n’y arrivera pas. L’Algérie est riche non seulement de son sous-sol, mais de son sol et de sa force de travail. Un exemple : son potentiel céréalier est formidable. Il est absurde d’importer la quasi-totalité des céréales consommées. L’économie de la rente pétrolière qui pousse à tout acheter à l’extérieur stérilise le changement. Quand il devient plus rentable d’importer que de produire, on entre dans une spirale infernale. Elle doit être brisée. D’autant qu’avec les profits qu’elle induit pour ceux qui en bénéficient, cette spirale encourage la mauvaise gouvernance.
Vous faites référence à la corruption ?
Je parle d’un phénomène beaucoup plus profond. En Tunisie, on disait que Ben Ali avait accumulé 5 milliards de dollars. On parle de 20 milliards, en Égypte, pour Moubarak. Vrais ou faux, ces chiffres resteraient mineurs comparés aux montants que la faiblesse de l’État de droit a fait perdre à ces pays. En Algérie, le système de la rente pétrolière alimente celui des importations qui bénéficie seulement à quelques-uns, lesquels ne se situent d’ailleurs pas forcément au niveau du gouvernement. Sortir de cette économie de la rente nécessitera de rendre les institutions dignes d’un État de droit, d’investir massivement dans le système éducatif pour donner une perspective à la jeunesse, et de rendre la production locale plus incitative.
Pour aboutir, ces réformes devront être débattues de façon transparente. Car si on touche au système de la rente en Algérie, on aura forcément dans un premier temps une hausse des prix, en particulier à la pompe, et une perte de pouvoir d’achat de la population. Même temporaire, il faudra l’expliquer et prendre des mesures pour compenser ses effets. Si l’Algérie dispose de moyens financiers, comme c’est le cas aujourd’hui, pour promouvoir une politique sociale, une assurance chômage, pour investir dans la formation et l’éducation, la protection-santé et le logement social, la réforme de l’économie sera mieux acceptée dans la phase de transition, avant que la réindustrialisation du pays recrée du pouvoir d’achat et une croissance économique différente. Mais si elle attend et épuise ses importantes réserves de change, ce sera très compliqué. L’Algérie dispose de 5 à 10 ans pour réussir sa mutation.
Centrales électriques, routes, métro… Le pays ressemble à un immense chantier. Beaucoup de projets sont confiés à des entreprises chinoises. Comment expliquer ce phénomène ?
La Chine, qui a des besoins titanesques en matières premières, tend à s’implanter chez ceux qui en ont. C’est le cas de l’Algérie. Le montant des investissements dans les infrastructures est tel qu’il dépasse les 200 milliards de dollars selon le plan d’investissements publics 2015-2019. Les Chinois semblent à même de mener de nombreux chantiers à moindre coût. Leurs ouvriers apparaissent qualifiés, plus nombreux, moins chers et mieux contrôlables que les Algériens…
Le cours du baril de brut a chuté de moitié depuis juin 2014. Comment l’économie algérienne est-elle impactée ?
L’impact est faible à ce jour. Les dirigeants insistent sur le fait que la baisse des recettes pétrolières – moins 20 % sur un an – n’affectera pas la dépense publique. En revanche, l’Algérie est entrée dans une phase de remaniements ministériels et d’évolution du discours public qui est significative. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a récemment évoqué la possibilité d’une « crise économique » si aucune réforme n’est entreprise. De tels propos, jusqu’ici inaudibles, sont importants car l’économie algérienne est marquée par un fort protectionnisme et une importante méfiance envers le capitalisme libéral. Ces deux phénomènes s’expliquent par l’histoire d’un pays où les potions amères du FMI restent présentes dans les mémoires. La méfiance envers le secteur privé est très ancrée. L’évolution « réformiste » actuelle représente donc un bon signe.
Mais le débat sur la libéralisation de l’économie existe en Algérie depuis des années...
C’est vrai. Mais que les politiques s’en emparent, ça c’est neuf. La baisse des prix du pétrole a mis sur la place publique un débat jusqu’ici limité aux experts. La nomination de nouveaux ministres à des postes clés (finances, pétrole…) laisse entrevoir la possibilité de réformes financières et fiscales qui encourageront l’entreprise privée et les investissements étrangers, très faibles jusqu’à présent. On peut ainsi espérer que soit modifiée la célèbre règle 49/51, qui oblige tout investisseur étranger à trouver un « partenaire » algérien forcément majoritaire et rend difficile le rapatriement des bénéfices en devises. Annuler cette loi, dont les effets négatifs pèsent surtout sur l’investissement industriel en Algérie, ouvrirait les vannes à des investissements étrangers de grande ampleur. C’est un enjeu capital pour l’avenir du pays.
Cela explique que les entreprises françaises, au moment d’investir, regardent plus favorablement le Maroc que l’Algérie…
Mais oui, les entrepreneurs français investissent plus facilement au Maroc. On en revient à l’arsenal législatif algérien très autoprotecteur, qui décourage l’investissement étranger, alors que depuis dix ans le Maroc s’est beaucoup libéralisé.
Personne ne sait exactement quelle est la réalité du pouvoir exercé par le président Abdelaziz Bouteflika aujourd’hui, ni qui dirige réellement le pays. Quel est l’impact de ce gel politique sur son évolution et son économie ?
L’Algérie est un grand pays avec un grand État. L’absence d’un homme ne fait pas tomber tout l’édifice. En comparant la situation du pays en 2010 avec celle d’aujourd’hui, on n’a pas le sentiment d’une dégradation de la gestion politique du pays. Je le répète, malgré le blocage politique, on commence à voir une évolution favorable de l’environnement juridique de l’économie. La seule question est de savoir si le prochain président s’engagera dans la voie des réformes ou pas.
Le gaz de schiste peut-il constituer une nouvelle source de revenus ?
Oui, si l’on en croit les chiffres sur la prospection potentielle. En même temps, il ne faudrait pas que l’exploitation du gaz de schiste pose des problèmes environnementaux graves, ni qu’elle renforce la dépendance économique aux recettes pétro-gazières.
Le gaz et le pétrole constituent le tiers du PIB, près des deux tiers des recettes budgétaires de l’État et 96 % des recettes d’exportation. Ils ont permis à l’Algérie de constituer un matelas de réserves de change très confortable. Pourtant, certains économistes prévoient que l’Algérie pourrait bientôt devoir recommencer à emprunter.
Évidemment. Car dans dix ans, le pays comptera un million et demi de travailleurs supplémentaires. Que fera-t-il si ses réserves de change s’épuisent ? Certes, rien n’exclut que le prix du baril remonte, et on ne connaît pas les recettes potentielles du gaz de schiste. Mais on doit surtout espérer la mise en place de réformes pour sortir le pays de l’« économie de la rente » pétro-gazière.
Sans réformes, ce système ne sera plus compatible avec la croissance démographique de l’Algérie. Le potentiel d’explosion de la jeunesse algérienne est énorme. L’État ne pourra pas éternellement réaffecter les revenus du pétrole pour distribuer un peu de pouvoir d’achat. Si les réformes politiques et juridiques ne sont pas menées aujourd’hui, elles seront bien plus douloureuses à mettre en œuvre une fois les réserves monétaires épuisées. On pourrait alors redouter de très gros risques dans 5 à 10 ans.
Propos recueillis par SYLVAIN CYPEL


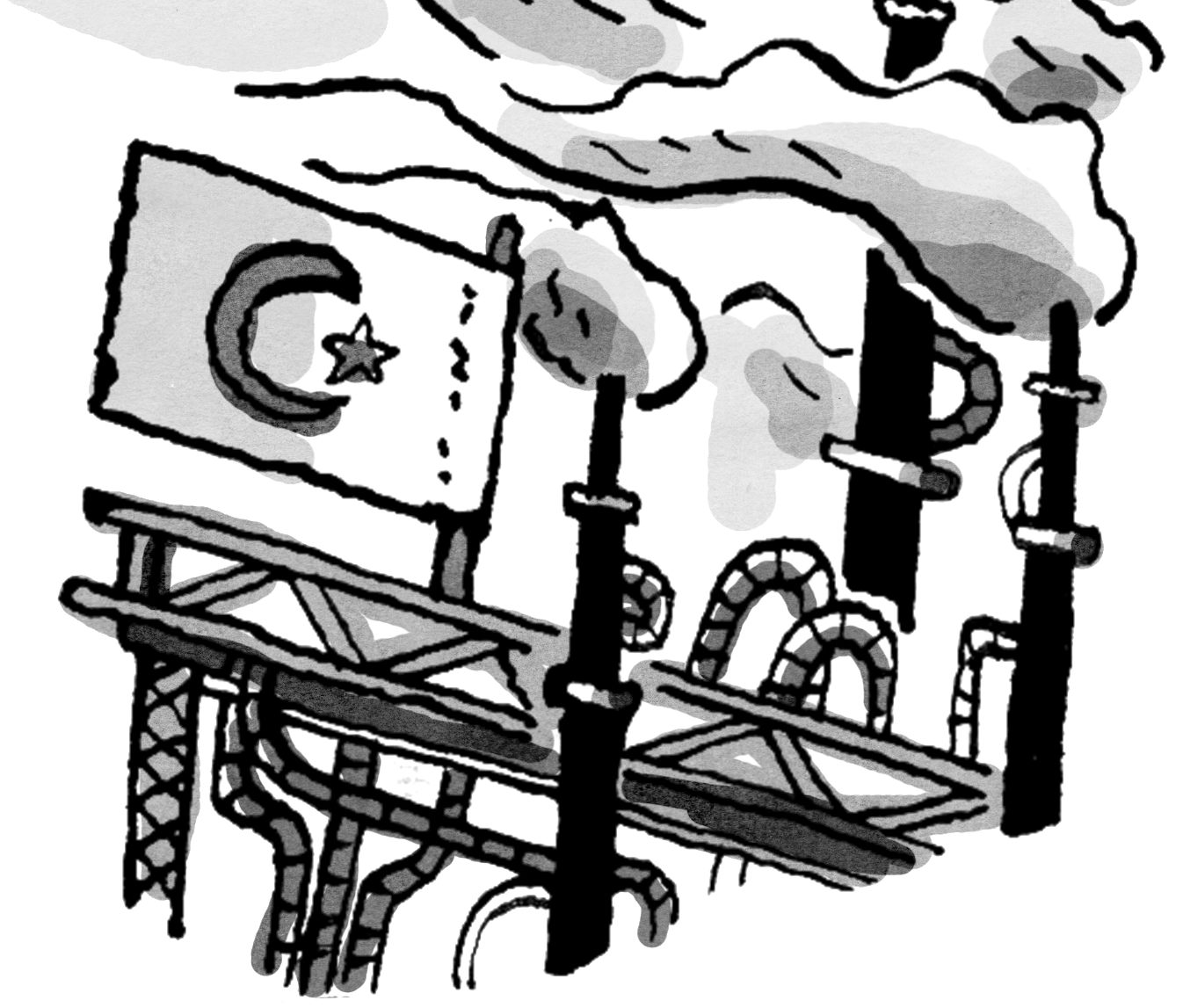
« L’Algérie dispose de 5 à 10 ans pour réussir sa mutation »
Riadh El-Hafdhi
En Algérie, la « diversification » de l’économie semble toujours promise mais jamais enclenchée. Comment sortir de la « dépendance » pétro-gazière ?
Le temps presse : c&r…
L'Algérie invisible de Kamel Daoud
Kamel Daoud
Algérie, « terra incognita » organisée depuis 1962. « Incognita » car on peut aller vers ce pays sans jamais y arriver, y loger sans y habiter, y arriver en le ratant ou le connaître par une série de …
Alacrité
Robert Solé
Rire pour ne pas pleurer… Comme d’autres peuples privés de démocratie, les Algériens, désabusés, se consolent en plaisantant. Ils ont une cible de choix en la personne de leur président, Abdelaziz Bouteflika, qui a entamé un quatri&egr…
Un grand gâchis
Tahar Ben Jelloun
Quand vous avez un voisin dont le plaisir est de vous créer des ennuis et de vous empêcher de vivre en paix, vous déménagez. Mais il existe des situations où cette sagesse n’est pas possible. Le Maroc n’est-il pas sans cesse harcelé depuis l&rs…







