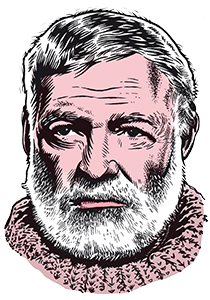Au café des Amateurs
Temps de lecture : 5 minutes
Il fallait alors fermer les fenêtres, la nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. C’était un café triste et mal tenu, où les ivrognes du quartier s’agglutinaient, et j’en étais toujours écarté par l’odeur de corps mal lavés et la senteur aigre de saoulerie qui y régnaient. Les hommes et les femmes qui fréquentaient Les Amateurs étaient tout le temps ivres ou tout au moins aussi longtemps qu’ils en avaient les moyens, surtout à force de vin qu’ils achetaient par demi-litre ou par litre. Nombre de réclames vantaient des apéritifs aux noms étranges, mais fort peu de clients pouvaient s’offrir le luxe d’en consommer, sauf pour étayer une cuite. Les ivrognesses étaient connues sous le nom de poivrottes qui désigne les alcooliques du sexe féminin.
Le café des Amateurs était le tout-à-l’égout de la rue Mouffetard, une merveilleuse rue commerçante, étroite et très passante, qui mène à la place de la Contrescarpe.
***
C’était une belle soirée, et j’avais travaillé dur toute la journée et quitté l’appartement au-dessus de la scierie et traversé la cour encombrée de piles de bois, fermé la porte, traversé la rue et j’étais entré, par la porte de derrière, dans la boulangerie qui donne sur le boulevard Montparnasse et j’avais traversé la bonne odeur des fours à pain puis la boutique et j’étais sorti par l’autre issue. Les lumières étaient allumées dans la boulangerie et, dehors, c’était la fin du jour et je marchai dans le soir tombant, vers le carrefour, et m’arrêtai à la terrasse d’un restaurant appelé Le Nègre de Toulouse où nos serviettes de table, à carreaux rouges et blancs, étaient glissées dans des ronds de serviettes en bois et suspendues à un râtelier spécial en attendant que nous venions dîner. Je lus le menu polycopié à l’encre violette et vis que le plat du jour était du cassoulet. Le mot me fit venir l’eau à la bouche.
M. Lavigne, le patron, me demanda des nouvelles de mon travail et je lui dis que tout allait très bien. Il me dit qu’il m’avait vu travailler à la terrasse de La Closerie des Lilas, tôt dans la matinée, mais qu’il n’avait pas voulu me parler tant je semblais occupé.
« Vous aviez l’air d’un homme tout seul dans la jungle, dit-il.
– Je suis comme un cochon aveugle quand je travaille.
– Mais vous n’étiez pas dans la jungle, monsieur ?
– Dans le bush », dis-je.
Je poursuivis mon chemin, léchant les vitrines et heureux, dans cette soirée printanière, parmi les passants. Dans les trois principaux cafés, je remarquai des gens que je connaissais de vue et d’autres à qui j’avais déjà parlé. Mais il y avait toujours des gens qui me semblaient encore plus attrayants et que je ne connaissais pas et qui, sous les lampadaires soudain allumés, se pressaient vers le lieu où ils boiraient ensemble, dîneraient ensemble et feraient l’amour. Les habitués des trois principaux cafés pouvaient bien en faire autant ou rester assis à boire, à bavarder et à se faire voir par les autres. Les gens que j’aimais et ne connaissais pas allaient dans les grands cafés pour s’y perdre et pour que personne ne les remarque et pour y être seuls et pour y être ensemble. Les grands cafés étaient bon marché, eux aussi, et tous servaient de la bonne bière et des apéritifs à des prix raisonnables, d’ailleurs indiqués sans ambiguïté sur la soucoupe de rigueur.
Ce soir-là, j’avais en tête ces idées très générales et fort peu originales, et je me sentais extraordinairement vertueux parce que j’avais travaillé dur et de façon satisfaisante, alors que j’avais eu, dans la journée, une terrible envie d’aller aux courses. Renoncer à aller aux courses à l’époque où nous étions vraiment pauvres était une nécessité, et cette pauvreté, elle m’était encore trop familière pour que je coure le risque de perdre de l’argent.
De quelque façon qu’on le prît, nous étions toujours pauvres et je faisais encore de petites économies en prétendant, par exemple, que j’étais invité à déjeuner, pour me promener pendant deux heures au Luxembourg et décrire, au retour, mon merveilleux déjeuner à ma femme. Quand vous avez vingt-cinq ans et que vous appartenez naturellement à la catégorie des poids lourds, vous avez très faim lorsque vous sautez un repas. Mais cela aiguise aussi toutes vos perceptions et je découvris que la plupart de mes personnages étaient de gros mangeurs et qu’ils étaient gourmands et gourmets et que la plupart d’entre eux étaient toujours disposés à boire un coup.
Au Nègre de Toulouse, nous buvions du bon vin de Cahors, en quarts, en demi-carafes ou en carafes, généralement coupé d’eau dans la proportion d’un tiers. À la maison, au-dessus de la scierie, nous avions un vin de Corse connu mais peu coûteux. Il était si corsé qu’on pouvait y ajouter son volume d’eau sans le rendre totalement insipide. À Paris, à cette époque-là, vous pouviez vivre très bien avec presque rien et si vous sautiez un repas de temps à autre et ne renouveliez pas votre garde-robe, vous pouviez même faire des économies et vous permettre certains luxe.
Paris est une fête, traduit de l’anglais par Marc Saporta et Claude Demanuelli
© Éditions Gallimard, 2011
[Fluctuations]
Robert Solé
Inscrite sur son blason, qui comporte un navire à voiles, la devise de la ville de Paris a inspiré plusieurs artistes après les attentats du 13 novembre. Fluctuat nec mergitur signifie textuellement : « Il est ballotté et ne somb…
Nec mergitur !
Laurent Greilsamer
Paris sera toujours Paris, chantait Maurice Chevalier en 1939. C’était la drôle de guerre, période de couvre-feu. Celle qu’on appelait encore la Ville Lumière badigeonnait ses réverbères pour se fondre dans la nuit. Paris sera…