«J’ai rencontré Paul Ricœur qui m’a rééduqué sur le plan philosophique»
EntretienTemps de lecture : 19 minutes
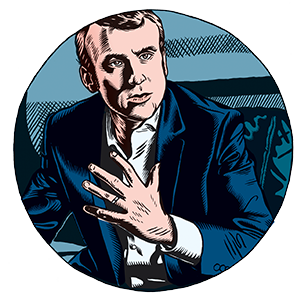
On connaît votre intérêt pour la philosophie. Comment est venue cette appétence, depuis quand ? Ce sont des rencontres, des lectures ?
Elle n’a pas de genèse identifiée. Je crois que j’ai aimé la chose publique avant d’aimer la philosophie. Ma première approche de la philosophie, ce sont des lectures. J’ai d’abord emprunté des chemins buissonniers – Marcel Conche (philosophe né en 1922) a fait partie de mes premières lectures ; j’ai reçu ensuite, en classes préparatoires, un enseignement très classique.
Je suis vraiment entré dans la philosophie par Kant, le premier philosophe qui m’ait marqué avec Aristote. Ce n’est pas très original ! Je lui dois beaucoup de mes moments d’émotion philosophique, ainsi qu’à son traducteur Philonenko, qui avait fait un magnifique commentaire de son œuvre. Je ne sais pas si cela se lit toujours… J’ai passé beaucoup de temps à lire Kant, Aristote, Descartes. Ce refuge intellectuel, cette possibilité de se représenter le monde, de lui donner un sens à travers un prisme différent, ont été importants. J’ai ensuite découvert Hegel, sur lequel j’ai fait mon DEA.
Avez-vous été marqué par un professeur ?
Celui qui m’a beaucoup inspiré, c’est Étienne Balibar. J’ai suivi ses cours, qui étaient des exercices philosophiques assez uniques. Véritable puits de science, il dépliait un concept pendant deux heures. Au cours suivant, pour reprendre le fil, il se lançait généralement dans une introduction qui durait une heure et demie et qui consistait à revisiter le cours d’avant. J’ai suivi son enseignement pendant trois ou quatre ans et rédigé sous sa direction un travail sur Machiavel. C’est à ce moment que j’ai abandonné la métaphysique pour la philosophie politique.
Vous vous destiniez à une carrière…
Pas du tout ! C’était par goût de comprendre les choses, cela me permettait de mettre en relation l’espace théorique philosophique et le réel. La philosophie politique permet en effet de mettre en tension le réel avec des concepts, de l’éclairer grâce à leur lumière.
Le réel ?
Quand on lit Aristote, on comprend que la philosophie repose d’abord sur un rapport au réel. Vous y trouvez une taxinomie, de la botanique… Chez Descartes, c’est pareil. Il y a toujours un rapport au réel qui est très fort, y compris chez les métaphysiciens. C’est Hegel qui disait que l’exercice philosophique indispensable, chaque matin, c’était la lecture du journal.
La prière de l’homme moderne…
Exactement ! J’ai ensuite rencontré Paul Ricœur (1913-2005), qui m’a rééduqué sur le plan philosophique.
Rééduqué ?
Oui ! Parce que je suis reparti de zéro… La première fois que je l’ai vu, je ne l’avais encore jamais lu. J’avais la liberté des ignorants et donc je n’étais pas intimidé. Je lui ai parlé comme à un contemporain, alors qu’il souffrait justement du sentiment d’être traité comme une icône. Notre première rencontre a duré plusieurs heures et il m’a tendu à la fin un manuscrit de cinquante pages : la première conférence qu’il avait faite pour La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli. Je lui ai rendu le texte avec des annotations. J’étais complètement incompétent, mais il a fait comme si de rien n’était : il m’a répondu. C’est comme cela que les choses se sont engagées. Avec lui, j’ai lu ou relu de la philosophie antique. Il avait sur ce sujet un recul exceptionnel, dû au fait de l’avoir étudiée et enseignée pendant un demi-siècle. J’allais tous les matins chez lui, aux Murs Blancs, et nous lisions ensemble. Il lisait tous les matins, où qu’il se trouve, même en voyage. L’après-midi était consacré à l’écriture.
Avec le recul, comment définiriez-vous son apport ?
Chez Ricœur, il y a trois apports conceptuels qui sont très forts. D’abord, une pensée de la représentation en politique, qu’il a analysée sous toutes ses formes. Ensuite, c’est l’un de ceux qui a pensé de la manière la plus forte le sujet de la violence et du mal en politique. Il a marqué le courant de l’antitotalitarisme. On l’a trop oublié… Enfin, c’est l’un des philosophes d’Europe continentale qui a le plus pensé la philosophie délibérative. Il a réfléchi sur la possibilité de construire une action qui ne soit pas verticale (c’est-à-dire qui ne soit pas prise dans une relation de pouvoir), mais une action qui échappe dans le même temps aux allers-retours permanents de la délibération.
Cette réflexion d’ensemble est très ancrée dans sa culture protestante, car il était arrivé à la philosophie par l’herméneutique, par la lecture des textes religieux et philosophiques. C’est ce qui lui a donné son immense liberté. Il a montré qu’il n’est pas besoin d’être un expert pour réfléchir sur tel ou tel sujet : il suffit de savoir lire un texte. C’est sa méthode. C’est comme cela qu’il a écrit de manière lumineuse sur la psychanalyse, par exemple. C’est une des choses qu’il m’a le plus apportée. C’est aussi une culture politique.
Comment cela, une culture politique ?
Cela veut dire : tout élément versé dans le débat public est critiquable si on l’attaque au fond. Paul Ricœur a dressé une voie parallèle à celle que notre vie politique et philosophique a portée depuis trente ans. C’est l’autre voie de 1968. Derrière Mai 68, il y avait un mouvement de déconstruction par rapport à l’autorité. Lui a constamment revisité les choses en marge des structuralistes et des soixante-huitards, en se situant uniquement par rapport aux textes et dans une forme de recherche de la vérité en politique. En acceptant qu’il puisse y avoir une polyphonie ou une pluralité des interprétations.
Faut-il pour autant faire le deuil de la vérité en politique ?
Non, car la vérité est toujours une quête, un travail de recherche, et c’est fondamental. C’est ce qui permet à la politique délibérative d’échapper au nihilisme et à toute forme de cynisme. Cela revient à dire que la vérité unique, avec la violence qu’elle implique, n’est pas une voie de sortie. Mais il y a des recherches de vérité et, justement, une forme de délibération permanente que vient contrarier la prise de décision.
Toute la difficulté du politique aujourd’hui réside dans ce paradoxe entre la demande permanente de délibération, qui s’inscrit dans un temps long, et l’urgence de la décision. La seule façon de s’en sortir consiste à articuler une très grande transparence horizontale, nécessaire à la délibération, et à recourir à des rapports plus verticaux, nécessaires à la décision. Sinon, c’est soit l’autoritarisme, soit l’inaction politique.
S’il n’y a pas une vérité unique en politique pour Ricoeur, il y a pourtant un mal, un mal spécifiquement politique et constitutif de l’exercice du pouvoir.
Ce mal est l’action humaine avec ce qu’elle a d’irréductible. Ricœur pense la dimension tragique de l’action politique, étant très marqué par le deuxième conflit mondial. Le mal, pour lui, est un objet politique, mais aussi moral et métaphysique. Il faut d’abord reconnaître ce mal, et c’est ce qu’il propose de faire avec le concept d’impardonnable. Toute la difficulté consiste ensuite à déterminer si celui-ci est unique, comme la Shoah, ou s’il peut prendre plusieurs visages.
Personnellement, je pense qu’il y a plusieurs impardonnables. Le défi, c’est d’arriver à reconstruire après l’émergence du mal. C’est tout le travail qui a été fait en Afrique du Sud, après la période de l’apartheid, avec la commission Vérité et Réconciliation (CVR) présidée par l’archevêque anglican Desmond Tutu. Ce fut un vrai travail politique : on nomme le mal et on pardonne. C’est le principe même de l’amnistie : à un moment, on décide d’oublier.
Vous évoquiez tout à l’heure l’importance de laisser un espace à la vérité ou aux vérités et d’éviter le cynisme. Est-ce une boussole pour votre action ?
Oui. Je crois à l’idéologie politique. L’idéologie, c’est une construction intellectuelle qui éclaire le réel en lui donnant un sens, et qui donne ainsi une direction à votre action. C’est un travail de formalisation du réel. L’animal politique a besoin de donner du sens à son action. Cette idéologie doit être prise dans une technique délibérative, se confronter sans cesse au réel, s’adapter, revisiter en permanence ses principes. Je pense que l’action politique ne peut pas se construire dans une vérité unique ni dans une espèce de relativisme absolu, qui est une tendance de l’époque. Or ce n’est pas vrai. Il y a des vérités, des contrevérités, il y a des choses que l’on peut remettre en cause. Toutes les idées ne se valent pas !
Peut-il y avoir un conflit entre l’idéologie qu’on s’est forgée et celle de son parti, à laquelle il faut souscrire ?
Il y aurait conflit, si les partis avaient une idéologie.
Ils n’en ont pas ?
Non. Les partis ne vivent plus sur une base idéologique. Ils vivent sur une base d’appartenance et sur la rémanence rétinienne de quelques idées. Qu’est-ce que signifie être… « Républicains » aujourd’hui – cela fait bizarre à dire, non ? Avoir une carte et payer sa cotisation, adhérer à des hommes aussi. Être en accord avec un corpus idéologique composé d’énormément de malentendus, dans un moment où les idées ont été largement abandonnées par les partis politiques. Ce qui explique qu’ils mobilisent moins.
Était-ce déjà le cas lorsque vous aviez adhéré à l’âge de 24 ans au Parti socialiste ?
C’était déjà le cas. C’est le cas depuis plusieurs décennies. Ce qui est étrange aujourd’hui, c’est que l’espace de débat critique est mis de côté. Les intellectuels se sont repliés dans le champ universitaire et se sont spécialisés dans leur discipline. Les politiques, eux, se sont reconcentrés sur les valeurs, c’est-à-dire sur un rapport beaucoup plus émotionnel aux choses et plus suiviste de l’opinion.
Le politique n’est plus pensé aujourd’hui ?
On a énormément de mal à rehausser le politique au niveau de la pensée. Il est saisissant de voir que, dans le moment que nous vivons, on pense si peu l’État. Nous restons dans une approche très régalienne. Le réduire à cette dimension régalienne n’est pas suffisant. Il faut élargir la réflexion sur le rôle que doit avoir l’État dans le temps, dans ses territoires, dans la régulation sociale. Comment reconstruire notre imaginaire politique et notre régulation sociale à la lumière de ce qu’est notre économie et notre société ? Le travail reste à faire.
Voyez-vous une incompatibilité entre la lecture, la réflexion et l’activité politique qui suppose une certaine urgence de l’action ? Faut-il inviter les philosophes au pouvoir ?
Pour ma part, je n’ai jamais cru à l’application pratique de la théorie du philosophe-roi. Mais je pense qu’il doit exister plus d’échanges, de passages, de traduction entre la philosophie et la politique. L’idéologie, c’est exactement cela : un travail de traduction, né de la nécessité de transmettre et de faire circuler d’un espace à l’autre. Il faut donc des concepts de passage. Ce n’est jamais parfait. C’est comme la lecture de la traduction française d’un texte anglais : ce n’est pas exactement l’original, mais un travail intellectuel a été accompli, qui permet de comprendre et fait toucher du doigt cet autre espace imaginaire et esthétique. C’est la même chose en politique : si on laisse les philosophes dans leur espace et les politiques dans le leur, on manque cette interface de traduction qu’est l’idéologie. C’est le rôle des revues, des intellectuels que d’occuper cet interstice. Leur travail doit se propager. Mais la question est d’abord de savoir sur quel concept idéologique refonder l’action politique. Il faut franchir ces étapes, tracer des chemins de traverse. Des gens comme Jürgen Habermas (philosophe allemand né en 1929) ou Étienne Balibar jouent ce rôle !
Précisément, quel temps réservez-vous à la lecture ?
Je mentirai si je prétendais arriver à lire tous les jours. Mais ce qui me rassure, c’est qu’il ne se passe pas un jour sans que cela me manque. Le temps que je peux consacrer à la lecture varie selon l’actualité, mais, comme l’écriture ou les échanges, il est indispensable. Sans ces espaces de respiration, l’épuisement vient très vite. L’action politique est en effet d’une nature autosuffisante, de l’ordre du divertissement pascalien : une fois que c’est fait, c’est fait. Mais c’est une fuite. Quant à la parole médiatique, c’est la nourriture donnée à un monstre qui n’arrête jamais. Il considère au début que cette parole est intéressante. Puis il en demande davantage. Il prend ce que vous lui donnez, jusqu’au moment où il vous rejette, considérant qu’il a tout entendu et que vous n’avez plus rien à livrer. C’est pourquoi l’action politique se construit aussi par des périodes de parenthèse, de retrait vis-à-vis de l’action. Elles sont importantes. C’est pourquoi je ne crois ni à la transparence complète ni à l’agitation absolue, qui constituent deux grandes faiblesses du moment politique actuel.
La politique et la pensée politique se construisent dans les plis, pour reprendre une formule de Gilles Deleuze (1925-1995). Les plis de la vie sont les moments où il y a une forme d’opacité assumée. C’est une bonne chose parce qu’on se construit dans l’obscurité. On peut lire, réfléchir, penser à autre chose, être plus en recul, c’est une nécessité. De la même façon, dans la construction d’un intellectuel, il doit y avoir des moments de frottements avec le réel qui peuvent se faire par le compagnonnage politique. C’est ce qu’a fait Paul Ricœur en accompagnant Michel Rocard un moment. Il faut articuler la pensée et l’action.
Comment y parvenir concrètement ?
D’abord en lisant. J’essaie de me tenir au courant de ce qui est publié en philosophie politique. En essayant d’écrire aussi. Et puis en discutant, et c’est pourquoi je sollicite régulièrement des intellectuels qui pensent la chose publique, comme Olivier Mongin (directeur de la rédaction d’Esprit de 1988 à 2012). Ils mettent des mots sur les décalages entre la légitimité démocratique et la capacité réelle, ressentie, à construire une action. Aujourd’hui le processus démocratique est remis en cause.
Comment le réinventer ?
En proposant. Les gens protestent car il y a un vide. La démocratie s’incarne toujours de manière imparfaite, à des moments historiques, dans des formes plus ou moins violentes et antagonistes. La République française est une forme d’incarnation démocratique avec un contenu, une représentation symbolique et imaginaire qui crée une adhésion collective. Or, on peut adhérer à la République. Mais personne n’adhère à la démocratie. Sauf ceux qui ne l’ont pas. La vraie difficulté aujourd’hui, c’est que le concept est vide et laisse place à des prurits identitaires toujours plus forts : les Bonnets Rouges en Bretagne, les zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. Ce sont des mouvements d’identification.
La démocratie est-elle forcément déceptive ?
La démocratie comporte toujours une forme d’incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du Roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif : le Roi n’est plus là ! On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d’y placer d’autres figures : ce sont les moments napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l’espace. On le voit bien avec l’interrogation permanente sur la figure présidentielle, qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu’on attend du président de la République, c’est qu’il occupe cette fonction. Tout s’est construit sur ce malentendu.
Qu’est-ce qui manque à la démocratie de nos jours ?
Nous vivons un moment de tâtonnement démocratique. La forme démocratique est tellement pure et procédurale sur le plan théorique qu’elle a besoin d’incarnation momentanée : elle doit accepter des impuretés si elle veut trouver une forme concrète d’existence. C’est la grande difficulté. Nous avons une préférence pour les principes et pour la procédure démocratiques plutôt que pour le leadership. Et une préférence pour la procédure délibérative postmoderne plutôt que pour la confrontation des idées au réel. Or, si l’on veut stabiliser la vie politique et la sortir de la situation névrotique actuelle, il faut, tout en gardant l’équilibre délibératif, accepter un peu plus de verticalité. Pour cela, il faut proposer des idées. Si l’on est en capacité, grâce à des propositions, d’expliquer vers quelle société on veut aller, c’est-à-dire vers une République plus contractuelle et plus européenne, inscrite dans la mondialisation avec des formes de régulation qui correspondent à la fois à notre histoire et à nos souhaits collectifs, alors on peut mobiliser.
À l’inverse, si l’on ne propose rien et qu’on se contente de réagir au fil de l’eau, on se retrouve en situation de faiblesse. Si l’on installe l’idée que toutes les paroles se valent, et si l’action politique se construit uniquement dans les équilibres à trouver entre ces paroles, on tue alors la possibilité d’emmener nos concitoyens vers une destination identifiée. C’est l’immobilisme.
La philosophie est-elle nécessaire à l’action ?
Elle aide à construire. Elle donne du sens à ce qui n’est sinon qu’un magma d’actes et de prises de parole. C’est une discipline qui ne vaut rien sans la confrontation au réel. Et le réel ne vaut rien sans la capacité qu’elle offre de remonter au concept. Il faut donc accepter de vivre dans une zone intermédiaire faite d’impuretés, où vous n’êtes jamais un assez bon penseur pour le philosophe, et toujours perçu comme trop abstrait pour affronter le réel. Il faut être dans cet entre-deux. Je crois que c’est là l’espace du politique.
Quelles leçons gardez-vous de Paul Ricœur dans l’exercice de votre charge ?
D’abord, toujours conserver de la liberté par rapport à ce qui est dit, écrit ou affirmé. Ricoeur, c’est la discipline. Celle de reprendre tous les matins son crayon, sa page, et de se demander comment on peut réinventer ce qu’on a écrit, le revisiter, le redire autrement. Cette herméneutique permanente m’apporte beaucoup. J’ai également appris de Ricœur en creux, à propos des événements de Mai 68, qu’il avait vécus comme professeur à la faculté de Nanterre. Il était très malheureux de tout ce qu’il n’avait pas dit et des décisions qu’il n’avait pas prises durant cette période. La leçon que j’en ai tirée est qu’il y a un besoin de dire, d’affirmer les choses, et qu’il faut céder à ce besoin. L’erreur de beaucoup a été de se laisser intimider par la brutalité du moment, d’accepter de ne pas dire et de ne pas agir. C’est Ricœur qui m’a poussé à faire de la politique, parce que lui-même n’en avait pas fait.
Il m’a fait comprendre que l’exigence du quotidien, qui va avec la politique, est d’accepter le geste imparfait. Qu’il faut dire pour avancer. C’est une forme d’affranchissement par rapport à la philosophie : on bascule dans le temps politique en acceptant l’imperfection du moment.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO, LAURENT GREILSAMER et ADÈLE VAN REETH


«J’ai rencontré Paul Ricœur qui m’a rééduqué sur le plan philosophique»
Emmanuel Macron

Comment la réflexion philosophique peut-elle nourrir, étayer l’action politique ? Le ciel des idées peut-il s’acco…
Alchimie
Robert Solé
– Pouvez-vous m’aider à écrire une chronique pour le 1 ? Cette semaine, la rédaction a choisi un thème impossible, qui ne m’inspire vraiment pas.
– Je veux bien, mais…
– C’est tr&egrav…
Homme politique cherche vision du monde
Luc Ferry
« Pour agir, disait Nietzsche, il faut se bander les yeux d’un voile d’illusion. » Une fois n’est pas coutume, le grand déconstructeur était proche de son principal adversaire, Hegel, qui lui aussi opposait radicalement le philosophe et l&rsqu…







