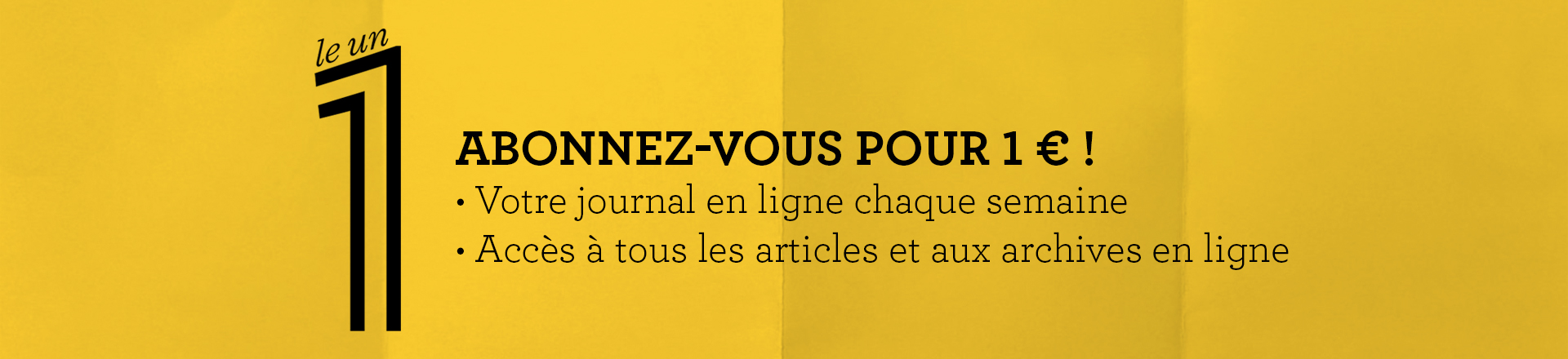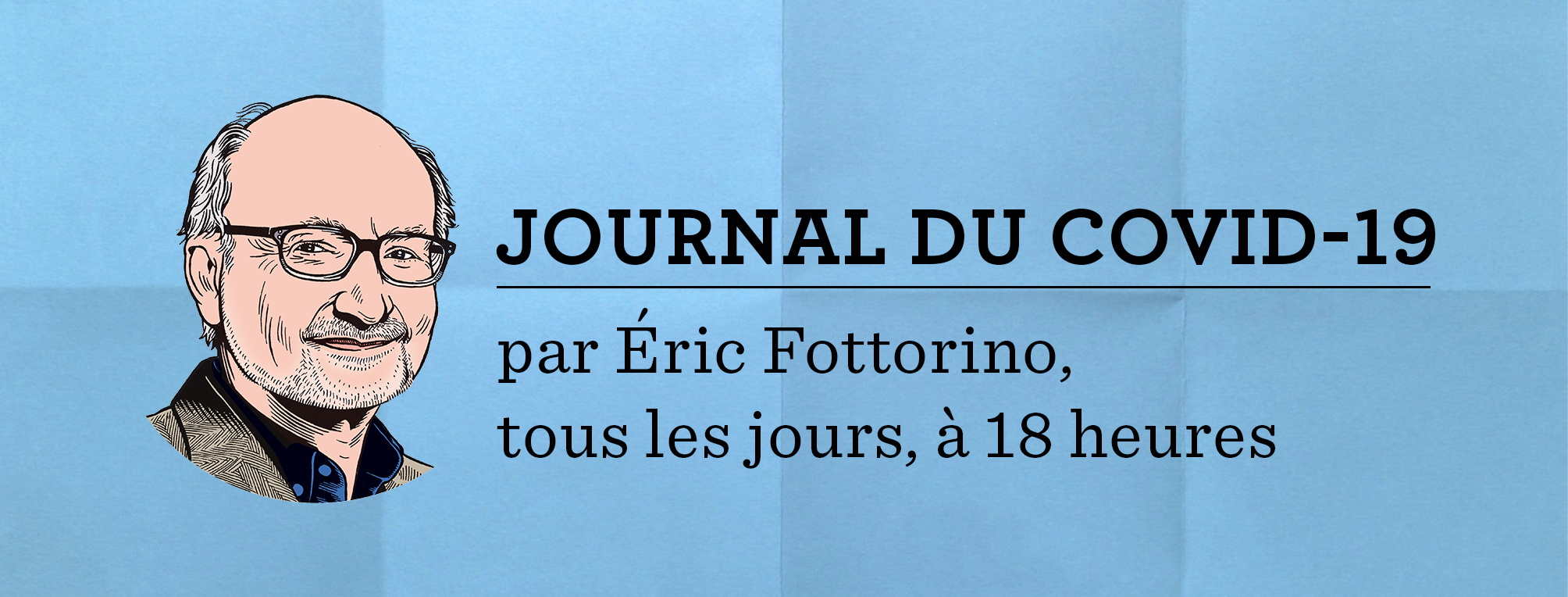Avec ce 70ème et dernier épisode s’achève le « Journal du Covid-19 », tenu par Éric Fottorino et illustré par Nicolas Vial depuis le 16 mars.
Retrouvez ici l’intégralité des chroniques et illustrations.
Je me souviens…
Par Éric Fottorino
24/05/2020
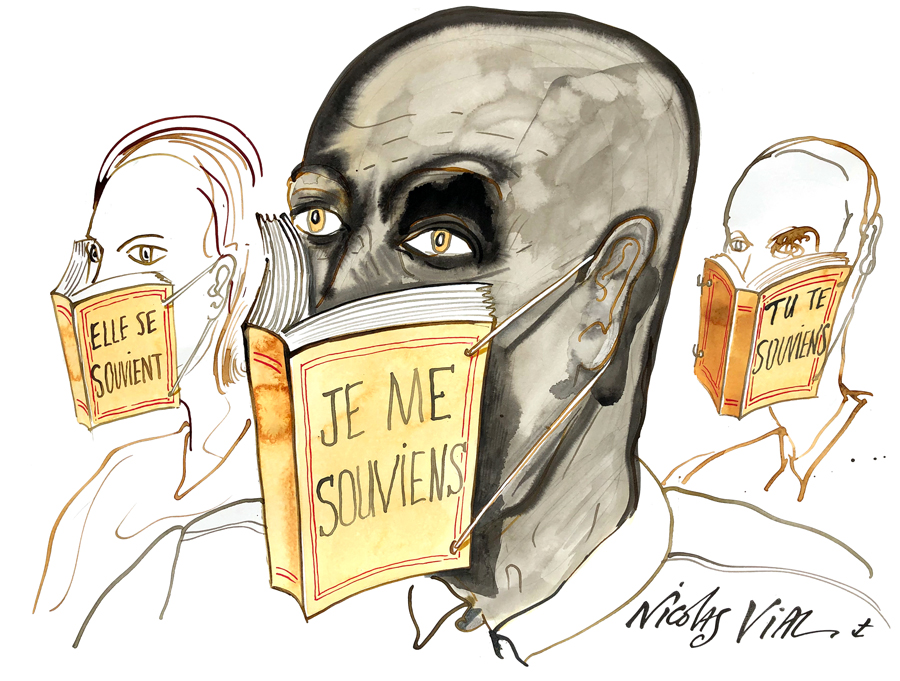
JE ME SOUVIENS qu’au début j’avais du mal à dire le mot coronavirus.
Je me souviens du « nous sommes en guerre » prononcé six fois par le Président Macron dans son allocution du 16 mars.
Je me souviens des premières annonces effrayantes sur « le pic de l’épidémie » et ses chiffres catastrophe.
Je me souviens que le confinement débuta le 17 mars à midi, annoncé par le ministre de l’Intérieur Castaner.
Je me souviens du vertige de l’enfermement.
Je me souviens de mon trouble en me signant une attestation de sortie.
Je me souviens des cercueils de Bergame.
Je me souviens du silence soudain, dans les rues, dans le ciel, partout.
Je me souviens que les masques étaient inutiles.
Je me souviens des applaudissements des soignants à 20 heures sur les balcons.
Je me souviens de l’hécatombe de personnes âgées dans les EPHAD.
Je me souviens du mot « cluster » employé à propos d’un rassemblement d’évangélistes à Mulhouse en février.
Je me souviens des gestes-barrière, des coudes pliés pour tousser, des gouttelettes et des postillons.
Je me souviens de la mort de Christophe, de Manu Dibango, de Luis Sepúlveda, de Pape Diouf, de Patrick Devedjian.
Je me souviens que finalement les masques étaient nécessaires, mais qu’on en manquait cruellement.
Je me souviens de la première cagette de légumes livrée chez moi par un restaurateur voisin donnant un coup de main à son maraîcher.
Je me souviens de la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe.
Je me souviens de la distanciation sociale, du mètre réglementaire, du réflexe de s’écarter des autres dans la rue.
Je me souviens de chanteurs et de musiciens envahissant joyeusement mon écran d’ordinateur.
Je me souviens de l’annulation des Jeux Olympiques, de l’Euro de Foot, du Festival de Cannes, du Festival d’Avignon, des Francofolies de La Rochelle…
Je me souviens d’une messe en drive-in en Champagne. Et d’un confessionnal semblable à Limoges.
Je me souviens de la place Saint-Pierre déserte le jour de Pâques.
Je me souviens du visage livide de Boris Johnson assurant qu’il allait bien.
Je me souviens des traits tirés de Cyril et d’Houria venant nous livrer fruits et légumes à domicile après leurs petits matins à Rungis.
Et je me souviens qu’une halle de Rungis fut transformée en chambre froide mortuaire.
Je me souviens que « Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux », (Allocution présidentielle du 13 avril, référence inattendue au programme du Conseil National de la Résistance).
Je me souviens que le même soir, le chef de l’Etat annonça la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.
Je me souviens de la queue devant la boulangerie, tous espacés, tous masqués.
Je me souviens d’avoir lu et relu L’art du roman de Milan Kundera et Malevil de Robert Merle. Et aussi Un homme qui dort de Georges Perec.
Je me souviens d’avoir découvert les films époustouflants de Jane Campion Bright Star – la vie météorique du poète John Keats –, et In The Cut, avec une incroyable Meg Ryan. Et aussi les films si dérangeants sur le rapport aux autres du suédois Ruben Östlund, The Square et Snow therapy.
Je me souviens du jour du déconfinement, de mon incrédulité.
Je me souviens du vertige de la liberté retrouvée.
Je me souviens qu’il faudra se souvenir du Covid devenu la Covid après avis de l’Académie française.
Je me souviens.
Attendre et espérer
Par Éric Fottorino
23/05/2020

FALLAIT-IL que cette chronique se termine ici comme elle avait commencé le 16 mars ? Au lendemain de la première intervention présidentielle déclarant le confinement général et la guerre au virus, j’écrivais ainsi (excusez cette autocitation pour illustrer mon propos !) : « Jeudi soir, le président a parlé fort. Tout en maintenant le premier tour des municipales, ce qui m’a troublé quant à la logique en vigueur au sommet de l’État. L’urgence sanitaire était à son comble, sauf pour se rendre aux urnes. Gérard Larcher en avait, du pouvoir, pour enfoncer un coin dans les gestes barrières ! » Deux mois et une pandémie plus tard, le temps semble tourner en rond. Nous revoici face à la même problématique. Alors que les terrains de foot sont en jachère, les églises et autres lieux de culte priés d’y aller mollo sur les grands raouts (rien à voir avec un professeur de Marseille) religieux, cette grand messe républicaine que sont les élections municipales, à la différence de la Guerre de Troie vue par Giraudoux, aura bien lieu. Le Premier ministre, lui-même candidat balloté dans sa ville du Havre, en a décidé ainsi. Une décision prise par l’exécutif et non par le Comité scientifique, ce dernier, par la voix de son président Jean-François Delfraissy, se limitant à rappeler les précautions qu’impliquent le contexte sanitaire : « Il ne pourra pas y avoir de campagne électorale comme d’habitude, insiste le professeur de médecine et immunologue. Il faudra le moins de contacts possible ».
Cette décision convient manifestement à la grande majorité des maires. À l’issue du premier tour, 4 922 communes attendaient un second tour pour désigner les équipes qui auraient la tâche délicate de prendre les décisions s’imposant au lendemain de cette période si singulière. Le rendez-vous a été fixé au 28 juin pour terminer ce qui avait été commencé à la mi-mars. On achève bien les scrutins ! Pour quelles perspectives ? Le flou demeure, sachant que l’absence de grandes réunions sous les préaux ou dans les salles polyvalentes seront bannies. Les candidats devront être imaginatifs pour parler à leurs électeurs. Et sans doute revoir leurs programmes pour trouver un écho qui rassure et fasse rêver à la fois, au sortir d’un confinement qui aura soulevé bien des questions, suscité bien des envies – et des besoins – de vivre autrement. Sans retomber dans les pires travers de la vie d’avant et pour faire mentir Michel Houellebecq pour qui la vie d’après sera la même, « en un peu pire ». Chiche ? Alors relisons le Comte de Monte-Cristo, avec cette invitation tentante du grand Dumas : « Mon ami, le comte ne vient-il pas de nous dire que l’humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots : Attendre et espérer ! »
Masques et mascarade
Par Éric Fottorino
22/05/2020
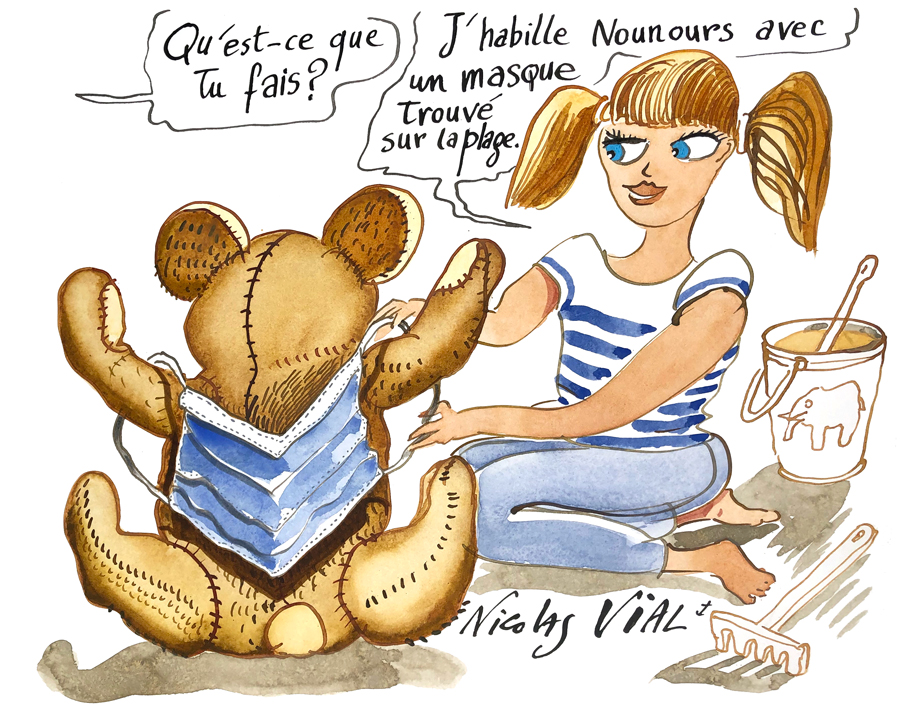
BAS LES MASQUES ! Ceux qui espéraient que le monde d’après serait paré de toutes les vertus dont avait manqué le monde d’avant en sont hélas pour leurs frais. Non que nous attendions un monde idéal et idyllique où l’on raserait gratis (les coiffeurs et barbiers ont besoin de gagner leur vie !), mais un monde où chacun, averti de la fragilité de l’autre, prendrait au moins soin de son prochain qui est d’abord son semblable. Il suffit de mettre le nez dehors pour sentir que la pollution aux oxydes de carbone remonte en flèche dans nos narines, même recouvertes d’une toile protectrice. Que les nuisances sonores ont repris de plus belle, truffées d’invectives qu’on n’entendait plus guère faute de combattants au volant. Bref, le – ou la Covid, dit l’Académie – ne nous a pas rendus meilleurs, et c’est dommage. On attendait par exemple un regain de propreté dans les lieux publics qui sont notre bien commun, transports et trottoirs. Les premiers ont certes connu une désinfection et surtout une certaine désaffection. Mais les trottoirs, tout au moins dans la capitale, sont trop souvent d’une saleté répugnante. Et inquiétante.
Sans être gagnés par une obsession hygiéniste, sans rêver de nettoyages forcenés des rues grandeur nature, avec jet de produits sanitaires contre les semelles de nos chaussures, on peut s’inquiéter des négligences peu citoyennes qui sont légion. Parmi ces incivilités particulièrement malvenues alors que les foyers de contagion restent nombreux – on en recense une trentaine, des abattoirs bretons aux chantiers de désamiantage d’Île-de-France –, il en est une qui nous laisse sans voix : l’abandon en rase campagne, au hasard des rues et des chemins, des cours d’eau, des squares et des plages, de masques usagés. Il fallait le faire ! Eh bien, c’est fait. Les témoignages se multiplient de ces voiles protecteurs cruellement manquants au début de l’épidémie, que tout un chacun ou presque arbore désormais pour conjurer, et d’abord repousser, le virus, et qui finissent sous nos pas. En pleine nature ou en pleine ville. Ces marques d’incivisme en disent long sur les négligences coupables de l’espèce humaine – parfois désespérante ! –, prompte à oublier ce qui la menaçait hier. Ces masques salvateurs, en particulier les masques chirurgicaux à usage unique, risquent, si on n’y prend garde, de se changer en vrais dangers publics. Quand ils ne finissent pas à la poubelle, ils deviennent potentiellement des déchets toxiques pour les personnels de nettoyage, pour les enfants, pour tous ceux qui négligemment pourraient les piétiner ou les rencontrer dans leurs baignades… Après l’épidémie, la mascarade continue. Et elle compte beaucoup trop d’acteurs.
Épidémie de surveillance
Par Éric Fottorino
21/05/2020

C’EST UNE HISTOIRE VIEILLE COMME LE MONDE. Disons comme la liberté, si on admet avec Rousseau que l’homme est né libre et qu’il est partout dans les fers. Ses fers d’aujourd’hui – métaphoriques mais loin de nous rendre euphoriques – sont bourrés d’algorithmes, d’intelligence artificielle, de puces savantes, de mouchards et de judas électroniques qui, bien sûr, nous veulent du bien. Longtemps, ce fut au nom de la sécurité qu’on acceptait bon gré mal gré de voir rogner des pans entiers de nos libertés. Et les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York comme celles de 2015 à Paris avaient élargi le champ toléré de notre « servitude volontaire », selon l’expression de La Boétie dans son célèbre discours de 1576. Le nouveau contrat social ajoutait ainsi un codicille non négligeable à la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » inscrite aux frontons de nos édifices publics depuis le 14 juillet 1880. Et cette exigence de sécurité, tout en bousculant nos libertés, correspondait à une volonté implicite des citoyens de vivre délivrés d’une peur sourde ou aiguë, pour eux, pour leurs proches, leurs enfants, leurs semblables.
L’épidémie de Covid aura déclenché un effet de cliquet – disons un point de non-retour –en termes de libertés, sachant qu’on ne retrouvera pas facilement ce à quoi nous avons renoncé. Le moteur cette fois n’est pas la sécurité, mais la santé. La santé publique et universelle, l’intégrité physique de tous et de chacun(e), menacée par un ennemi à qui on a officiellement déclaré la guerre. Et si la guerre sanitaire déploie ses armées de médecins et de soignants en « première ligne » – l’expression a été rabâchée ad nauseam –, elle comprend aussi son armée des ombres, ses services secrets, ses espions aussi invisibles que le virus. S’impose à nous la surveillance tous azimuts, avec les brigades sanitaires (version humaine du contrôle), les caméras thermiques, les applications de traçage façon StopCovid signalant si vous avez croisé, vous ou votre voisin, une personne infectée. Ce monde d’après, tant commenté avant qu’il ne survienne et désormais devant nous, nous place à la croisée des chemins. Jusqu’où ira la surveillance ? Et quand deviendra-t-elle intolérable, voire aussi dangereuse qu’une épidémie ?
La maison, c’est le bureau ?
Par Éric Fottorino
20/05/2020

TÉLÉTRAVAILLEURS, TÉLÉTRAVAILLEUSES DE TOUT LE(S) PAYS, ne vous réunissez plus ! Œuvrez chacune et chacun chez vous, et le patron y retrouvera les siens ! Présentée volontairement sur le mode de l’humour, cette percée du télétravail n’en est pas moins une des grandes évolutions sociales qu’aura apportées la pandémie. Feu de paille ou lame de fond ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais quelques idées reçues ont été bousculées sur cette pratique jusqu’ici minoritaire (3 % des salariés avant mars), parcellaire (1 à 2 jours maximum par semaine) et essentiellement réservée aux cadres. Ce qui semblait impossible à certaines professions, comme les métiers de la banque pour des raisons de sécurité des données, ou l’exercice de la médecine ou même l’activité de député, est devenu courant. Au point qu’au sortir du confinement, environ 7 millions de personnes, près du tiers de la population active, sont en télétravail. Et les intéressés en redemandent !
Une enquête officielle du ministère du Travail montre d’abord la progression tous azimuts de cette nouvelle pratique à domicile. Les pantoufles l’emportent sur les chaussures cirées, le rester chez soi sur les trajets en voiture et les longs tunnels des transports en commun. Entre les chiffres de 2017 et ceux du printemps, c’est le jour et la nuit : Il y a trois ans, le travail à domicile concernait 11,1 % des cadres, 1,4 % des employés et quasiment pas les ouvriers (0,2 %). Aujourd’hui, ces taux sont montés respectivement à 70 %, 23 % et 8 % ! Quant aux indices de satisfaction, ils atteignent des sommets : 56 % sont assez satisfaits, 25 % très. Voilà qui donne à réfléchir au moment où les interrogations demeurent sur les risques de voir s’abattre sur nous d’autres vagues du Covid, saisonnières ou erratiques. Faut-il d’ores et déjà faire du télétravail une norme nouvelle au nom de la santé de tous ? Ou le télétravail n’est-il pas en lui porteur d’autres trouble inquiétants : le sentiment d’isolement, d’inutilité, de perte de sens d’une activité dont les liens avec une stratégie collective – et des collègues ! – seraient distendus ? Si rester travailler à la maison peut rendre plus supportable la subordination à la hiérarchie dans des secteurs où le contrôle et la compétition sont de mises, on voit bien aussi que transporter symboliquement son bureau chez soi, et les tracas qui vont avec, n’est pas la panacée… Alors, ne laissons pas le Covid décider pour nous de nos modes de travail, ni le travail coloniser notre home sweet home…
Vous avez dit « cluster » ?
Par Éric Fottorino
19/05/2020
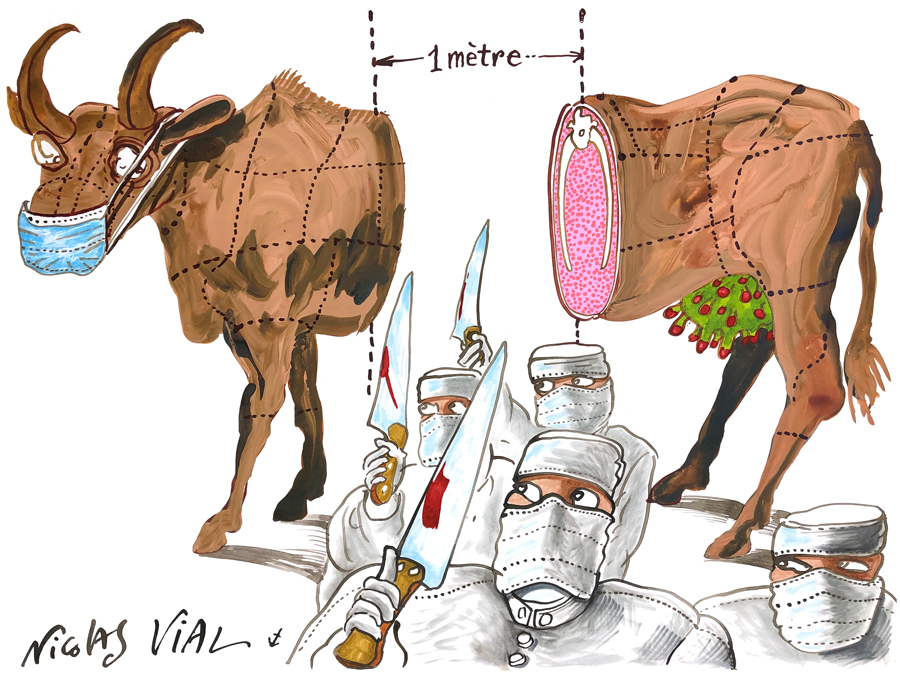
JE NE SAIS PAS VOUS, mais ce mot de « cluster » utilisé à tour de bras depuis le début de l’épidémie m’irrite, comme si on ne pouvait pas trouver un mot français pour dire, par exemple, « foyer » ou « foyer de contagion ». D’autant que, sans rire, ce fichu virus nous a renvoyé dans nos foyers sans ménagement afin que chacun d’entre nous ne devienne pas un cluster pour les autres (je devine vos pensées sartriennes : « Le cluster, c’est les autres » !). Jusqu’ici, je n’avais entendu ce mot qu’associé à l’informatique. Et plus précisément à la Silicon Valley, que les spécialistes décrivaient comme un no man’s land culturel mais rempli de clusters, dont la définition était à plusieurs entrées : soit une grappe de serveurs sur un réseau, soit un bloc urbain abritant des activités homogènes (le quartier de la Défense à Paris), soit encore le regroupement dans un bassin d’emploi, d’entreprises du même secteur. On parlait alors de grappe industrielle. Les linguistes vous diront qu’un « cluster » est une succession de deux syllabes dans un mot (« tigre » est un cluster, eh oui… mais le tigre chasse-t-il le Covid ? pas sûr). Les fous de musique ajouteront que Cluster fut le nom d’un groupe allemand des seventies – genre New Age, et que Pink Floyd enregistra dans les années 1990 un morceau instrumental baptisé Cluster One. Et pour faire bonne mesure, je vous avouerai que je ne peux entendre prononcer « cluster » sans penser au général Custer (George Armstrong, de ses prénoms) qui s’illustra pendant la guerre de Sécession puis dans les guerres indiennes, avant de succomber à Little Bighorn face au non moins légendaire chef sioux Sitting Bull – « Bison qui s’assied ».
Ayant ainsi fait le tour des clusters (on se déconfine comme on peut, en ces temps de disette touristique), j’en viens à la nouvelle principale du jour : méfiez-vous encore du virus, ce n’est pas le moment de baisser la garde ! Au moment où 150 000 collégiens ont repris leur cartable, et où le Conseil d’État demande la réouverture des lieux de culte avec des mesures « proportionnées au risque sanitaire », la vigilance s’impose. Le ministre de la Santé Olivier Véran a identifié rien moins que vingt-cinq clusters sur le territoire, et en particulier dans des abattoirs du Loiret – près d’Orléans – et des Côtes-d’Armor – non loin de Saint-Brieuc –, où une centaine de personnes ont été testées positives au Covid ce dimanche. Les abattoirs semblent particulièrement touchés, puisque des foyers de contagion ont encore été signalés aux États-Unis et en Allemagne, dans le Schleswig-Holstein. N’oublions pas l’avertissement de Pascal : « Qui veut faire l’ange fait la bête. » Alors ne soyons pas bêtes au point d’oublier que le virus n’a pas dit son dernier mot, un mot comme « cluster »…
Machine à tuer
Par Éric Fottorino
18/05/2020
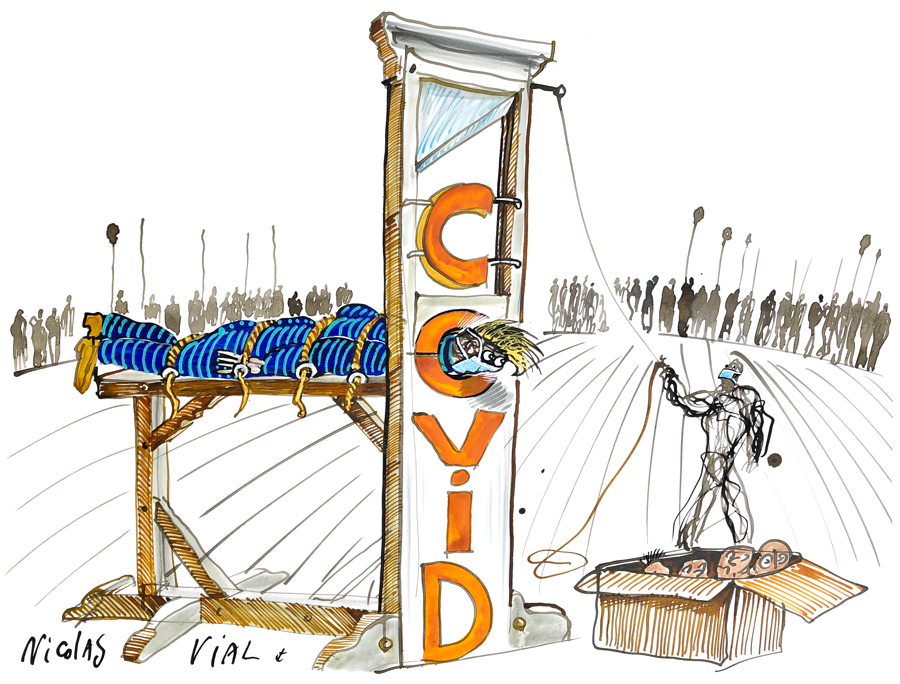
IL EST DES IMAGES QUI FONT FROID DANS LE DOS. Comme cette guillotine symbolique assortie d’un hashtag qui cogne et siffle telle une hache dans sa représentation numérique : #guillotine2020. Ce n’est pas rien, la guillotine, dans un pays qui en a usé de manière folle pendant sa Révolution, dans sa version Terreur, et qui a aboli la peine de mort le 9 octobre 1981, après que la « veuve » sanglante eut servi la justice de la République jusqu’en 1977 – à trois reprises sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing. « La justice française ne sera plus une justice qui tue », déclara alors l’ancien avocat abolitionniste devenu garde des Sceaux, Robert Badinter. Ce simple rappel pour souligner que l’usage même virtuel de cet engin de mort n’est pas anodin. S’il provient dans sa dernière version d’un mouvement né aux États-Unis pour stigmatiser les stars hollywoodiennes affichant leur richesse avec ostentation, son arrivée en France n’en revêt pas moins des particularités inquiétantes. Les propagandistes de cette guillotine ont identifié leurs cibles : des comédiens célèbres – Thierry Lhermitte en fit les frais récemment – mais d’abord et surtout les élites de tout poil, choisies dans l’univers médiatique, intellectuel, politique. Toutes ces têtes qui dépassent doivent trépasser ! Au nom du peuple, d’une justice populaire aussi radicale qu’expéditive pour faire rendre gorge aux nantis, aux trop-payés, à tous ces hors-sol qui loin de voir les souffrances de la plèbe ne cessent de les aggraver, voire d’en profiter.
Dans la France qui se déconfine cahin-caha, on ne saurait prendre ces manifestations à la légère. La réalité d’un État providence avec ses nombreux filets de sécurité – que bien des pays nous envient – ne suffit pas à éteindre la colère sourde des plus démunis, en butte aux inégalités que la pandémie aura aggravées. Derrière la guillotine numérique et son couperet, on trouve aussi, et sans surprise, la main des Gilets jaunes qui avaient déjà usé de ce symbole. Jusqu’à installer une machine à tuer factice en décembre 2018, sur un rond-point de Redon, avec fausse tête coupée – certains y auraient bien vu celle du président Macron – et sang artificiel. Le décor était planté. Gare à ce que l’après-Covid ne nous réserve pas des lendemains qui déchantent, et dégénèrent.
Haine déconfinée
Par Éric Fottorino
17/05/2020

ATTENTION DANGER ! Le Covid-19 ? Oui, bien sûr, nous sommes au courant. Il faudrait être aveugles et sourds, depuis deux mois qu’on nous prévient. Masques, gel, gestes barrières, on connaît la chanson triste alourdie par ces plus de trois cent mille morts du virus à travers le monde. Attention danger ? Ce cri n’est pas tant destiné à nous protéger du virus que des haines qu’il libère. De la folie des hommes, des théories complotistes, du grand n’importe quoi qui se déchaîne à mesure que les actions antivirus sont perçues ici et là comme les prémices de dictatures qui avancent masquées… Samedi, ils étaient des milliers dans une vingtaine de villes d’Allemagne à souffler un air inquiétant dans des manifestations étrangement baptisées anti-Covid. Comprenez : hostiles aux mesures prises par les autorités du pays pour endiguer – avec une grande efficacité, il faut le rappeler – l’épidémie de coronavirus.
À Berlin, Stuttgart, Francfort, Dortmund et ailleurs, ces manifestants aux appartenances hétéroclites n’ont pas hésité à crier leur peur et leur haine déconfinées face à un pouvoir qui, selon eux, vise un autre dessein que de protéger le peuple. Certains mettaient en doute l’efficacité et donc l’utilité des masques, mais aussi des vaccins. D’autres s’inquiétaient de voir des lois d’exception liberticides pervertir la Constitution. Manifestants conspirationnistes, énervés d’ultragauche mais aussi d’extrême droite soutenus par le parti du même bord AFD (Alternative pour l’Allemagne) ; ramassis d’antisémites (accusant Rockefeller et Rothschild d’avoir « inventé le coronavirus », rapporte Thomas Wieder dans Le Monde), tous ont vivement dénoncé un pouvoir autoritaire et liberticide qu’incarnerait la chancelière Angela Merkel. Au point, dès vendredi, d’avoir déposé une imitation de pierre tombale devant sa permanence de Stralsund, dans le nord du pays. Avec un masque de protection et un slogan comparant leur mobilisation avec les protestations populaires qui avaient précédé l’effondrement de la dictature communiste est-allemande, en 1989…
« Ces manifestations constituent un réservoir dans lequel antisémites, conspirationnistes et négationnistes peuvent se retrouver » a prévenu Felix Klein, le commissaire du gouvernement pour la lutte contre l’antisémitisme. Elles rappellent de façon inquiétante les actions du mouvement nationaliste Pegida qui avaient éclaté à Dresde à partir de 2014. Ce groupe islamophobe avait donné corps à la poussée de l’extrême droite anti-migrants, devenue la première force d’opposition au Bundestag avec 92 députés.
Une partie de plaisir
Par Éric Fottorino
16/05/2020
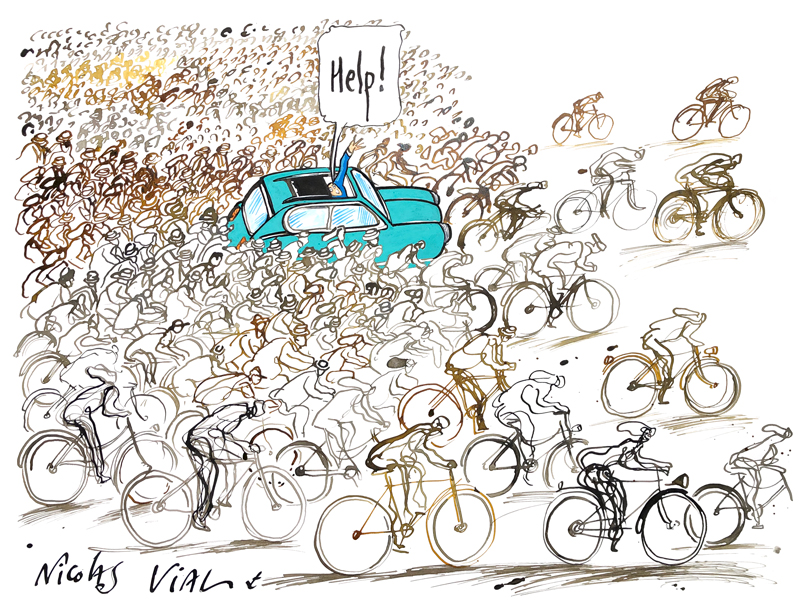
DEPUIS LE DÉCONFINEMENT DU 11 MAI, les marchands de vélo n’ont jamais vu ça. C’est la ruée vers les deux-roues, une vague d’achats si spectaculaire que les rayons cycles des grandes enseignes de sport et les réparateurs n’ont plus assez de mains et d’oreilles pour répondre à la demande. Est-ce le « coup de pouce vélo » gouvernemental qui accorde à chacun 50 euros s’il fait remettre en état une vieille bécane par un artisan agréé ? Est-ce d’avoir des fourmis dans les jambes à force de trop longues séances canapés ? Les Français se sentent pousser des ailes et, faute de s’envoler dans les airs, c’est à vélo qu’ils veulent réaliser leurs rêves d’oiseaux !
Il faut dire que l’échappée belle est tentante, même pour les pédaleuses et pédaleurs occasionnels, jusqu’ici rebutés par le deux-roues tributaire de la seule force musculaire. Avant l’épidémie – et pendant les grèves de décembre – on assistait déjà à un véritable boom sur le vélo à assistance électrique (VAE) qui permet d’adoucir les côtes sans les effacer, et d’aller loin en ménageant sa monture, sans essoufflement ni sudation excessifs. Mais tout change encore. Vent dans le dos et vent en poupe, les cyclistes pourraient bien devenir les rois d’une petite reine enfin consacrée. La crainte d’attraper le « corona » dans les transports n’y est pas pour rien. L’hygiène a certes été fortement améliorée dans le métro et les bus, avec nettoyages massifs, marquages au sol, distributions de masques et mise à disposition de gel hydroalcoolique. Mais la méfiance demeure. Si des clusters à virus subsistent, à Paris et dans les grandes villes, c’est bien dans les transports publics.
La peur de pédaler au milieu de la circulation, en revanche, recule. Et pour cause. Au fil des semaines, les pistes cyclables deviennent plus larges, plus longues, mieux sécurisées par des bornes et balises empêchant les véhicules de venir empiéter sur ces zones en voie de sanctuarisation. À vélo aussi, le casque est de rigueur, pas forcément le masque : on se ventile correctement même à 15 km/h, et la distance avec les autres usagers va de soi. Rien n’est sans danger, mais la bécane bien réglée, avec bons freins, bons pneus et loupiotes, est d’un confort rare, surtout par les belles journées de printemps qui réclament nos coups de pédale…
Enfin, il n’a échappé à personne (sauf aux nuisibles climatosceptiques) que le fond de l’air est meilleur quand les voitures restent au garage. L’association Airparif l’affirme : entre mars 2019 et mars 2020, les émissions de dioxyde d’azote – polluant direct du trafic routier – ont baissé de 20 % à 35 %, et jusqu’à 50 % le long des axes routiers. Quant aux rejets de CO2, ils ont diminué de 30 %. Des résultats jamais vus en 40 ans de lutte contre la pollution automobile.
Quoi d’autre ? Un dernier mot avant d’enfourcher vos bécanes : ça fait du bien au cœur et au moral. Alors en route, une partie de plaisir vous attend !
Messe et confesse drive…
Par Éric Fottorino
15/05/2020
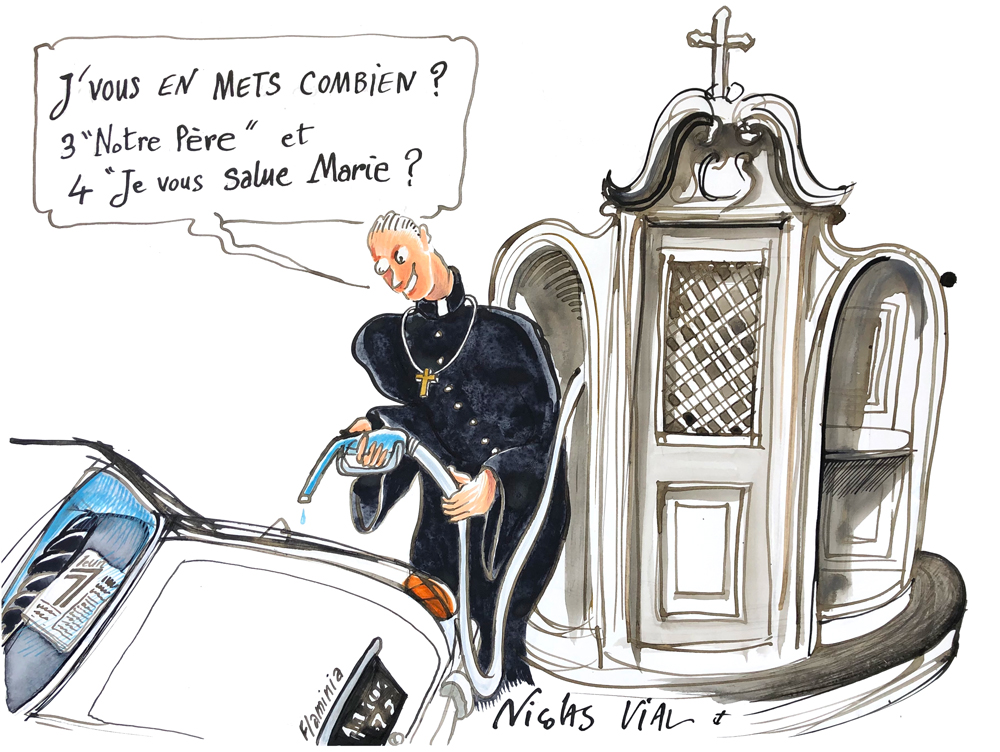
IL FALLAIT Y PENSER. L’évêque de Châlons-en-Champagne, Mgr Touvet, l’a fait. Ou va le faire dès ce week-end. Un miracle ? Pas loin ! Soucieux de ne pas abandonner ses fidèles alors que les célébrations religieuses restent interdites jusqu’au 2 juin, l’homme d’Église a décidé de sortir de la Maison de Dieu pour célébrer sa messe dominicale sur les trois hectares du parking du Capitole, le parc des Expositions de la ville. Et ceux qui l’aiment et le suivent prendront… leur voiture. C’est en effet à un drive-in religieux que l’évêque a convié ses ouailles, un rendez-vous aussi insolite que moderne, prévu ce dimanche 17 mai. Lui sera juché, en guise de chaire, au faite d’un camion transformé en scène. Les participants, eux, resteront dans leurs autos – à raison de quatre membres d’une même famille au maximum –, derrière leurs vitres. Ils pourront même communier lorsque les prêtres et leurs auxiliaires passeront le long des voitures avec leurs ciboires remplis d’hosties, à condition au préalable de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Pour que nul ne perde une miette du sermon, des prières et des chants, cette messe au volant sera retransmise en direct par la radio RCF Cœur de Champagne. Les voies – ou les voix – du Seigneur seraient-elles devenues moins impénétrables ? « Il ne s’agit pas de faire un show, a expliqué l’évêque.Notre but, c’est de répondre à un besoin social et spirituel. »
Nul doute qu’au-delà du décorum dégradé qui peut rebuter les puristes du cérémonial, bien des fidèles seront heureux de renouer ce lien, même à distance des autres participants. L’invitation concoctée par Mgr Touvet – une carte de jeu des mille bornes estampillée de ces mots : « Messe en voiture » – fait sourire. L’évêque n’en a cure : « L’Église, insiste-t-il, doit être inventive pour transmettre son message d’espérance et de renaissance. Surtout en cette période difficile. » Rien n’a été précisé sur l’organisation de la quête ni sur la contribution de chacun selon sa cylindrée…
Dans le même esprit, à Limoges, l’abbé David de Lestapis a mis en place fin avril un drive… confession. Les conducteurs chargés de lourds péchés se garent sur le parking de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. Un prêtre dûment masqué approche de la portière à la vitre baissée et s’assoit sur une chaise. Le sacrement commence… « Venez comme vous êtes », dit une grande banderole pour attirer les candidats à confesse. Dieu serait-il tombé sur la tête ?
Cinema Paradiso
Par Éric Fottorino
14/05/2020
.jpg)
FAUTE DE FESTIVAL DE CANNES, on peut bien continuer à rêver de cinéma. Cette année, Cannes ne sera pas dans Cannes mais essaiera d’exister partout où le septième art sera à l’honneur. De même que le patron du Tour de France Christian Prudhomme avait écarté l’idée d’une Grande Boucle à huis clos, c’est-à-dire sans public au bord des routes, le délégué général du Festival Thierry Frémaux, pédaleur forcené, s’est refusé à dématérialiser cet événement majeur du cinéma mondial : « Je ne sais pas ce que c’est, un festival virtuel ! s’agaçait-il ces jours-ci. Les films en libre-service pour les accrédités ? Qui l’acceptera ? Étymologiquement, un festival, c’est une fête. C’est physique. C’est une projection publique. Après quoi, tout commence. »
Ce qui pourrait commencer, c’est l’amorce d’une coopération internationale : un peu de Cannes à la prochaine Mostra de Venise – le président du festival Pierre Lescure explore cette possibilité –, un essaimage de l’esprit et de la sélection officielle de Cannes dans les grands festivals de l’automne, de Toronto à Deauville, de Busan en Corée au Festival Lumière à Lyon, animé au sens plein, corps et âme, par Thierry Frémaux. Par ailleurs, Cannes sera partie prenante au We Are One : A Global Film Festival (« Nous sommes un : un festival mondial du film ») organisé sur YouTube du 27 mai au 7 juin. Avec la volonté de montrer les œuvres sélectionnées, parmi lesquelles Tre Pianide Nanni Moretti, The French Dispatch de Wes Anderson et Benedetta de Paul Verhœven.
En attendant, notre réflexe pavlovien de frénésie cinématographique du mois de mai a pris une tournure singulière d’après-confinement. Comme si le monde d’avant, faute de survivre pleinement dans la réalité, n’existait plus que dans la fiction du septième art. Et nous voilà revisionnant les vieux films de Claude Sautet, de César et Rosalie à Garçon ! en passant par Vincent, François, Paul… et les autres. Des cafés bondés (et enfumés) où les bandes de potes s’étreignent et se parlent à dix centimètres, des salles de boxe pleines à craquer, des brasseries ouvertes le soir jusqu’à pas d’heure. C’était le bon temps, c’était hier, et c’est tout le temps au Cinema Paradiso.
Double peine
Par Éric Fottorino
13/05/2020

OUVRIR UNE ÉCOLE C’EST FERMER UNE PRISON, écrivait jadis Victor Hugo. Mais, dans un monde qui ne tourne plus très rond, le sens commun est sens dessus dessous. Ces quelque deux mois de confinement ont vu au contraire les écoles se fermer et les prisons s’ouvrir, tout au moins s’entrouvrir, pour environ 10 000 détenus à qui il restait moins de deux mois à purger. Ceux-là, à condition qu’ils aient pu justifier d’un logement et qu’ils n’aient pas été condamnés pour terrorisme, crimes graves ou violences intrafamiliales, ont pu échapper aux rigueurs du confinement carcéral. Car pour les plus de 60 000 prisonniers répartis dans les 188 établissements pénitentiaires du pays, c’est un sentiment de double peine qui a surgi avec la suppression des parloirs et la suspension des activités habituelles, promenades et accès aux salles de sport. Une situation dénoncée d’une même voix par de nombreux avocats et syndicats de gardiens. Et par les détenus eux-mêmes, dont les coups de sang spectaculaires ont émaillé la période, de la prison de la Santé à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en passant par les centres de détention de Metz et Perpignan. Ou encore à Uzerche, en Corrèze, où une mutinerie a même conduit au transfert de 300 prisonniers vers d’autres établissements.
L’épidémie de Covid-19 aura ainsi douloureusement renforcé la privation de liberté d’une population déjà entassée de façon indigne d’une grande démocratie à cheval sur les droits de l’homme. Avant le confinement, on comptait 72 575 détenus en France pour environ 61 000 places, soit un taux d’occupation de 119 % qui pouvait, en certains endroits, monter à 140 %. Concrètement, on pouvait compter jusqu’à trois personnes dans des cellules de 9 mètres carrés, soit 1 à 2 mètres carrés d’espace vital par détenu quand, à titre de comparaison, le ministère de l’Agriculture estime à 5 mètres carrés l’espace minimal requis pour l’hébergement d’un chien. Soit dit en passant, les libérations intervenues pour diminuer les risques de propagation du virus en prison ont ramené le taux d’occupation à 103 %. Preuve qu’il est possible de réduire la surpopulation carcérale par des libérations anticipées et une politique d’encellulement moins systématique pour des délinquants n’ayant rien à faire en prison. Mais qui s’en souviendra, dans le monde d’après ?
Évitez les embrassades !
Par Éric Fottorino
12/05/2020

SURVIVRA-T-ELLE AU COVID-19 ou faut-il la ranger au rayon des accessoires du monde d’avant ? De qui, de quoi parlons-nous ? De la bise, bien sûr. Cette bise qu’on se claquait à tout bout de champ, en famille, au bureau, lors de manifestations publiques et festives – elles aussi désormais restreintes. La bise obligée, souvent pesante pour les femmes censées embrasser les collègues masculins et tous les mâles d’une assemblée (demandez aux femmes politiques). La bise qui s’était répandue chez les hommes entre eux, dans un rituel générationnel apparu on ne sait pourquoi ces dernières années.
La bise, comme chacun sait depuis ses tendres années et la fable apprise par cœur de La Cigale et la Fourmi (« La Cigale, ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue »), la bise donc, désigne aussi un vent frisquet et violent venu du nord, qui souffle en hiver et même au printemps. Voilà donc que la bise – ventée – malmène la bise réflexe. « Évitez les embrassades », nous enjoint sur les ondes le message solennel Information corovanirus. Pas de doute : un véritable coup de froid s’est abattu sur la bise – et sur la poignée de main – depuis les premiers jours de mars.
C’est dans la revue Usbek & Rica du 23 mars dernier que l’on trouve les meilleurs éclairages sur cette pratique très ancienne. Sous le titre explicite : « Covid-19 : la bise peut-elle disparaître ? » la journaliste Annabelle Laurent raconte : « Chez les Romains, l’ancêtre de la bise est l’osculum (littéralement “petite bouche”), un baiser qui se pratique les lèvres fermées, que l’on échange entre membres d’une même corporation ou d’un même ordre social (baiser social). Ils le distinguent du saevium, pour le baiser passionné, impudique, en insérant la langue, ce qui inspirera le fameux French Kiss […]. Le troisième est le basium, qui formera la racine du mot moderne, le baiser sur la bouche de la tendresse amoureuse qu’on se donne entre époux ou entre membres d’une même famille (baiser familial). » Tout un programme !
Mais le virus est passé par là. Pour continuer de réviser notre latin, le Covid nous donne des scrupules, de scrupulum, petit caillou pointu dans les sandales, qui plaçait les soldats de César devant ce dur dilemme : continuer de marcher en souffrant, ou s’arrêter pour chasser le caillou, au risque de mettre la troupe en retard… La norme nouvelle est claire : pas d’embrassades, donc, et sans scrupules. La santé d’autrui passe avant la politesse, et le sans contact est une nouvelle forme d’affection !
Marions-les !
Par Éric Fottorino
11/05/2020

COMMENT SE DIRE « OUI » QUAND LE RÈGLEMENT DIT « NON » ?! Voici le casse-tête non résolu de bien des futurs couples qui ont vu s’évanouir ces dernières semaines la perspective, peut-être surfaite mais toujours tenace dans l’imaginaire populaire, du plus beau jour de leur vie. Car s’il n’a pas été possible de dire au revoir décemment à ses proches défunts au pire de l’épidémie du Covid, se marier n’est pas non plus une mince affaire. Et malgré les autorisations d’aller et venir, malgré la possibilité désormais officielle de se rendre dans les commerces et d’aller travailler sous certaines conditions, se rendre chez Monsieur le Maire en grand tralala et en belle et nombreuse compagnie reste interdit. Sauf à ne pas compter plus de dix personnes pour la cérémonie, ce qui donne d’emblée à la fête une dimension triste et étriquée. Si on se penche sur les exceptions, elles donnent plus encore le bourdon : elles concernent les militaires sur le point partir en opération ou les personnes atteintes de maladie grave. Bref, le mariage in extremis, comme étape préliminaire au cimetière… Quant aux célébrations religieuses, elles ne reprendront pas avant le 2 juin, et en très petit comité seulement.
Ces restrictions expliquent pourquoi 97 % des mariages prévus entre mars et août ont été reportés soit à l’automne, soit carrément courant 2021. On imagine les déceptions, larmes et grincements de dents pour celles et ceux qui avaient tout prévu sauf cet invité surprise (très mauvaise surprise) venu déjouer les préparatifs les plus minutieux, avec robe et costume de mariés, traiteur, fleuriste, DJ, photographe, salle en location. Sans oublier les alliances à graver aux prénoms des promis, avec une date intangible devant marquer avec les ans la solidité du lien… Si on laisse les (beaux) chiffons pour parler chiffres, la corbeille des mariés « pèse » chaque année quelque 3,5 milliards d’euros.
On peut déjà trouver sur la toile de nouveaux faire-part adaptés, sur lesquels le traditionnel « Save the date » a été remplacé par « Change the date » afin de prévenir les invités sans les perdre en route. L’histoire ne dit pas si les pas de danse seront délimités au sol, ou si les soirées se transformeront d’office en bals masqués – avec masques stylisés et personnalisés… Et puisque tout finira forcément en chanson, les heureux invités pourront alors reprendre soulagés les paroles de Juliette Gréco :
Marions-les, marions-les
Je crois qu’ils se ressemblent
Marions-les, marions-les
Ils seront très heureux ensemble !
À toute berzingue
Par Éric Fottorino
10/05/2020

À LA VEILLE DU D-DAY (déconfinement Day si vous préférez), quelques inquiétudes toutes personnelles m’assaillent. Pas tant le risque de manquer de masques ou de tests, si on en croit Christophe Castaner sur les ondes ce dimanche. 1,3 milliard de masques, assure le ministre de l’Intérieur, ont été importés ces dernières semaines. Assez en principe pour permettre à tous les Français en situation fragile ou en mobilité – transports en commun surtout – de se protéger des risques de gouttelettes et postillons indésirables. Quant aux tests, le pays serait en mesure d’en effectuer 700 000 par semaine, de quoi faire baisser pressions et angoisses.
Non, mes inquiétudes sont ailleurs, au vu de petites scènes de vie tristement banales auxquelles j’ai assisté dans les deux ou trois jours précédant le D Day si attendu. Par exemple, cet automobiliste énervé de ne pas pouvoir me doubler comme je pédalais tranquillement sur mon vélo, et jouant du klaxon comme un sale gosse avec un interrupteur. Son geste d’humeur ne m’a pas seulement cassé les oreilles. J’ai eu la sensation que soudain la trêve du confinement, avec son lot bienvenu (il fallait bien aussi qu’il ait du bon) de silence et d’une certaine lenteur, était rompue. Vendredi dans l’après-midi, les enfants qui avaient pris l’habitude de jouer au ballon dans la rue se sont fait rabrouer par leur père, dont je n’avais plus entendu élever la voix depuis près de deux mois : « Rentrez à la maison ! Vous voyez bien que les voitures roulent à toute berzingue ! »
Cherchant l’origine et le sens précis de ce mot, j’ai découvert au hasard Balthazar qu’il s’agissait d’une expression picarde signifiant « ivre » ou « un peu fou ». Vérité des locutions anciennes. Là était bien ma crainte : qu’après ces longues semaines d’enfermement ou de servitude plus ou moins volontaire, nos concitoyens se mettent à rappuyer sur le champignon, à rouler trop vite et à laisser leur moteur tourner inutilement. Comme le fit devant moi un automobiliste venu ainsi manifester bruyamment sa présence et envoyer du même coup dans mes poumons un panache toxique que le Covid, ces temps-ci, m’avait épargné.
La Sécurité routière ne s’y est pas trompée. Si le nombre de morts sur la route, pandémie oblige, a mécaniquement baissé de quelque 40 % en mars, il ne faudrait pas que ça reparte comme en quarante, disons comme avant la quarantaine. En retrouvant leur liberté perdue, combien de conducteurs iront dans le décor et causeront des accidents ? D’où les conseils à suivre en voiture comme désormais partout ailleurs : ne prenez pas tous le volant ! Gardez vos distances, et faites attention à autrui, qui est un autre vous-même.
Boire un petit coup…
Par Éric Fottorino
09/05/2020

LES PLUS ANCIENS ONT FORCÉMENT EN TÊTE CE REFRAIN aussi léger qu’un beaujolais nouveau interprété jadis par Michel Simon et Gaby Morlay dans le film Les Amants du pont Saint-Jean (Henri Decoin, 1947) – oui, je sais, ça ne nous rajeunit pas –, une chanson à boire qui disait :
Boire un petit coup, c’est agréable
Boire un petit coup, c’est doux
Mais il ne faut pas rouler dessous la table
Serge Lama s’en empara aussi pendant que les Charlots, dangereux propagandistes du goulot, popularisaient cet « apérobic » qui fit en son temps un tabac :
Et un, je retire le bouchon,
Et deux, je mets un p’tit glaçon ;
Et trois, je verse la boisson,
Et quatre, je me rince le siphon,
C’est l’apérobic,
À elle la gym, à moi l’tonic
Alors, de l’apéro, parlons-en. Si question alcool les Français ont forcé la dose pendant ce confinement, il faut être indulgent : faute de convivialité faite de chaleur humaine, de verres entrechoqués aux terrasses des cafés qui s’annonçaient si accueillantes dans ce printemps ensoleillé, il a fallu se rabattre sur les moyens du bord. Et, pour briser la glace face à un écran, quoi de mieux qu’un petit verre par-derrière la cravate – même si la cravate est au rencard pour cause de télétravail ? Les apéros Skype – un mot qui sonne un peu comme escape (« s’évader ») – ont fourni une belle occasion de boire en toute bonne conscience, boire pour oublier un peu le virus, boire pour s’oublier aussi soi-même, à force de passer des jours entiers en sa propre compagnie et de ne pas toujours se trouver facile à vivre… C’est bien connu, comme au sport, l’échauffement fait passer les petites douleurs. Quelques degrés dans le gosier, et voilà un salon, un balcon qui prennent soudain une nouvelle dimension, avec les amis aux bobines plus ou moins déformées, effet conjugué des pixels et de la dive bouteille. Ou des voisins qu’on n’avait jamais connus si affectueux. On retiendra ainsi que pour ce premier grand confinement de notre époque moderne, les Français auront pas mal picolé – on attend des statistiques fiables ! –, alternant Covidapéro et coronanniversaires. Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ? Verre à moitié vide, à moitié plein : la plate-forme « Addictions drogues alcool info service » a vu les appels augmenter en avril, émanant de personnes dépendantes angoissées à l’idée de « replonger » plus fort encore pendant cette période d’enfermement. Tout le monde n’a pas le vin gai.
Le virus de la défiance
Par Éric Fottorino
08/05/2020

SI L'ÉPIDÉMIE DE COVID FINIT PAR ÊTRE TERRASSÉE, un autre virus tenace n’est pas près de rendre gorge : celui de la défiance. Qui rime avec peuple de France. À un point si étonnant que nous pourrions entrer dans le livre des records. Est-ce dans nos veines, dans nos gènes, cet appétit immémorial d’en découdre, de n’être jamais d’accord avec l’autorité, de lui chercher des poux dans la tête, surtout si elle tend des bâtons pour se faire battre ? Pendant l’été 2018, notre président avait reçu des volées de bois vert en comparant les Danois prompts à se réformer aux « Gaulois réfractaires au changement ». Notre sang chaud n’avait fait qu’un tour et pas seulement en Armorique peuplée d’irréductibles… Emmanuel Macron avait fini par reconnaître son erreur, mais trop tard pour éviter les critiques venues surtout de la droite et de l’extrême droite, seules défenderesses, selon leurs leaders, du véritable génie français. La polémique s’était éteinte, mais le mal demeure, comme le montre une fois encore le baromètre de la confiance des Français envers leurs gouvernants tenu par le Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po) dans sa vague de fin avril.
À vrai dire, trois ans après l’élection présidentielle, les dirigeants du pays, chef de l’État en premier de cordée – ou de curée, allez savoir –, n’étaient guère flambants avant. La crise des Gilets jaunes et les manifestations anti-réforme des retraites étaient passées par là, faisant sérieusement tanguer l’exécutif. Mais la gestion de l’épidémie, les ordres et contrordres sur l’usage des masques, les atermoiements cachant une incapacité à équiper en temps voulu les soignants, tout a concouru à ternir l’image de Macron et de son gouvernement. De mars à avril, le taux d’insatisfaits a bondi de 46 % à 58 %. Et le sentiment de colère, lui, a atteint jusqu’à la moitié des Français interrogés. À la question : « Le gouvernement a-t-il mieux géré le coronavirus que la plupart des autres pays ? », à peine 13 % des sondés répondent oui… Aussi étonnant que cela puisse paraître, Boris Johnson – champion d’Europe de la négligence – est plus soutenu par les Britanniques qu’Emmanuel Macron par nos concitoyens. Signe que les comparaisons peuvent être non seulement cruelles, mais aussi irrationnelles ! Et que l’autorité relève d’une mystérieuse alchimie dont l’exécutif n’a pas plus la recette que du vaccin anti-Covid.
Le mot de l’année…
Par Éric Fottorino
07/05/2020
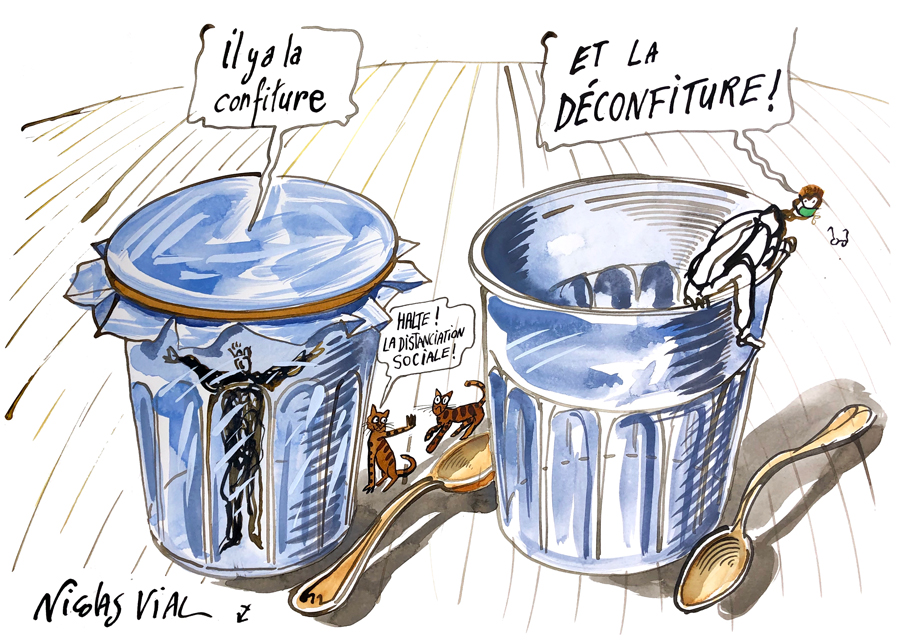
À L’APPROCHE DU DÉCONFINEMENT – plus ou moins général selon que vous serez rouge ou vert, ou vert d’être rouge– , nul doute que le mot « confinement » sera le mot de l’année. Espérons qu’il ne sera pas celui de la décennie, et encore moins celui du siècle. Vous imaginez, les manuels d’histoire, plus tard : le xxie siècle fut celui des confinés ! Mais revenons à nos moutons, qui n’ont pas vu passer beaucoup d’humains ces temps-ci, soit dit en passant. Avant l’épidémie de Covid-19, le mot « confinement », et son adjectif « confiné », probablement les vocables les plus prononcés en France et dans le monde depuis le début du printemps, étaient employés à dose très homéopathique. Je suis même certain que nombre d’entre vous aviez omis jusqu’à son existence. Car si je me gratte la tête pour me souvenir dans quelles circonstances j’ai pu naguère dire « confiné », je sèche. Pas dans le métro aux heures de pointe (l’expression qui me vient est : « serrés comme des sardines »). Et je me réjouis de penser que le métro bondé, ce n’est sans doute pas demain la veille, grâce à cette nouvelle expression remplie d’humanité, la « distanciation sociale ». Mais « confiné », « confinement », non, je ne vois pas cet article dans les rayons de la vie d’avant. Il est aussi rare, si je faisais du mauvais esprit, que les masques au début de l’épidémie…
Dans pareil cas, le secours vient du dictionnaire. Confinement, m’informe le Larousse, vient du latin confinis (« qui a la même limite »), assemblage de cum et de finis, « fin, frontière ». Les exemples cités sont éclairants : « Tout condamné aux travaux forcés à perpétuité subira un confinement solitaire d’un mois à son entrée dans la maison de force », dit un ancien texte de loi belge, nous confirmant que se confiner est tout de même, avec ou sans barreaux, s’emprisonner. Autre sens intéressant au temps du Covid : « Dans certaines conditions de confinement, le principe cholérique peut conserver, durant plusieurs mois peut-être, à l’état latent, une sorte de vitalité. » Tiré d’un manuel savant sur le choléra de 1868, cet extrait montre que se confiner n’est pas toujours la meilleure solution pour chasser bacille ou virus.
Enfin, dans notre monde contemporain, le mot confinement était jusqu’ici réservé au vocabulaire lié à la sécurité nucléaire. Enceintes de confinement pour les réacteurs de centrales ou pour la matière fissile, et sinistres abris antiatomiques. Espérons juste que le monde d’après ne sera pas celui des docteurs Folamour qui, de la Maison-Blanche, de la Corée du Nord ou d’ailleurs, nous forceraient à ce confinement terrifiant raconté jadis par Robert Merle dans Malevil ou, plus près de nous, par Cormac McCarthy dans La Route. De l’inconvénient d’être né pour finir confiné.
Quand l’Afrique résiste
Par Éric Fottorino
06/05/2020

COMMENT ÇA VA, L’AFRIQUE ? Comment ça va avec la douleur ? L’épidémie de coronavirus s’annonçait sévère entre Capricorne et Cancer. Les spécialistes annonçaient mi-avril que le continent de toutes les plaies de la terre allait subir, une fois de plus, un choc terrible. On parlait de 300 000 morts. On pointait du doigt la « Chinafrique », avec les vols en pleine expansion reliant les villes infectées de Chine et de grandes capitales africaines, en Égypte, en Afrique du Sud et en Algérie. Mais, si les foyers du Covid ont certes été plus importants dans ces pays, le virus ne s’est en revanche pas propagé avec l’ampleur redoutée, tant s’en faut. Et l’Éthiopie, particulièrement imbriquée avec Pékin en raison de leurs échanges, semble même épargnée, avec moins de 150 cas observés.
Ce constat est d’autant plus surprenant, et au final réjouissant, que les poncifs afropessimistes sont généralement légion qui scellent une bonne fois le sort du continent noir. Ces dernières décennies ne l’ont pas épargné, du sida à Ebola, des sécheresses en série aux famines terrifiantes, souvent amplifiées, si ce n’est déclenchées, par des dictateurs ivres de pouvoir et prêts à exterminer des parties entières de leurs peuples. Sans oublier – comment le pourrait-on ? – le génocide rwandais, les guerres du Congo et des Grands Lacs, et les exactions d’Al-Qaïda au Sahel, au Mali et au Niger, jusqu’aux zones semi-arides du Sénégal et de la Mauritanie.
En résistant mieux que le reste du monde au virus tueur, l’Afrique fait preuve d’une résilience qui étonne. Les explications, sous réserve que l’épidémie ne soit pas sous-évaluée, sont à rechercher dans ce qui, pour certains, apparaissait comme un retard économique du continent : une plus faible insertion dans la mondialisation, dans les flux de biens et de personnes qu’elle implique. « La moindre exposition de l’Afrique aux mobilités internationales a retardé l’arrivée de l’épidémie », estime Angèle Mendy, une sociologue suisse citée par Le Monde. Autre atout : ce sont précisément les agressions répétées d’épidémies et de fièvres hémorragiques qui ont pu mieux préparer les systèmes immunitaires des populations. Une façon d’anticiper le mal par le mal. Enfin, la richesse de l’Afrique, c’est son immense jeunesse. Moins en butte au virus qu’à une pauvreté endémique qui, trop souvent, la force à mourir en bonne santé, au fond de la Méditerranée.
Merci pour la musique…
Par Éric Fottorino
05/05/2020

ILS NE MANQUENT PAS, les traits d’esprit et de génie pour dire les bienfaits de la musique. À commencer par cette observation du bon sens populaire inspirée, dit-on, de Platon : « La musique adoucit les mœurs. » Pour certains, elle « creuse le ciel » (Baudelaire) ; pour d’autres, elle est du « bruit qui pense » (Victor Hugo). Nos grands-mères auraient dit qu’une journée sans musique est comme un baiser sans moustache. La musique, notait Kant, est la « langue des émotions », pendant que Shakespeare la tenait pour « l’aliment de l’amour ». Voilà qui suffirait à justifier l’élan de Verlaine qui, dans L’Art poétique, exigeait « de la musique avant toute chose », y voyant, comme Paul Valéry, une pure poésie, « hésitation entre le son et le sens ».
C’est bien ce ressenti qui nous traverse plus encore depuis le début de la pandémie, avec la générosité de tous ces artistes qui, seuls ou en nombre – leurs visages et leurs instruments se démultipliant comme à l’infini sur nos écrans –, nous offrent depuis leur salon des moments de grâce, de légèreté, de joie simple et immédiate. Mais le mot le plus en phase avec l’époque revient peut-être au grand compositeur et chef d’orchestre américain Leonard Bernstein, quand il affirmait : « La musique ne se vend pas, on la partage. »
Mais si la musique nous nourrit cœurs et âmes, elle ne nourrit pas son homme ou sa femme, et c’est bien là le danger qui menace ces faiseurs de bonheur – comme il est des faiseurs de pluie – que sont les musiciens. Quand ne tombent du ciel que des bravos mais pas d’espèces sonnantes ni trébuchantes, le risque est immense qu’ils finissent par lâcher leurs instruments, faute de ressources pour vivre. Publiée mardi sur les sites du Monde, du Figaro et de France Musique, la tribune de 311 musiciens classiques indépendants – rassemblant les plus grands noms de la scène musicale – retentit comme un cri d’alarme. « Nous n’avons pas l’habitude de nous exprimer par des mots. Notre langage est celui des notes, phrasés, articulations, coups d’archets… Il nous faut pourtant décrire et nommer une situation qui nous laisse sans voix », disent en chœur les signataires, dénonçant leur précarité abyssale, l’absence de statut d’intermittent pour nombre d’entre eux, les cachets de concert au rabais, les heures de répétition non payées pour les chambristes et les solistes. Ce texte prend aux tripes comme une musique déchirante. Il nous dit que ces porteurs de spectacle vivant pourraient mourir, faute de considération. Alors puisque le président Macron doit s’exprimer ce mercredi sur la culture, on tendra une oreille attentive en espérant l’entendre dire, même sur un air d’Abba (belle intro au piano) : « Thank you for the music »…
Silence, on butine !
Par Éric Fottorino
04/05/2020
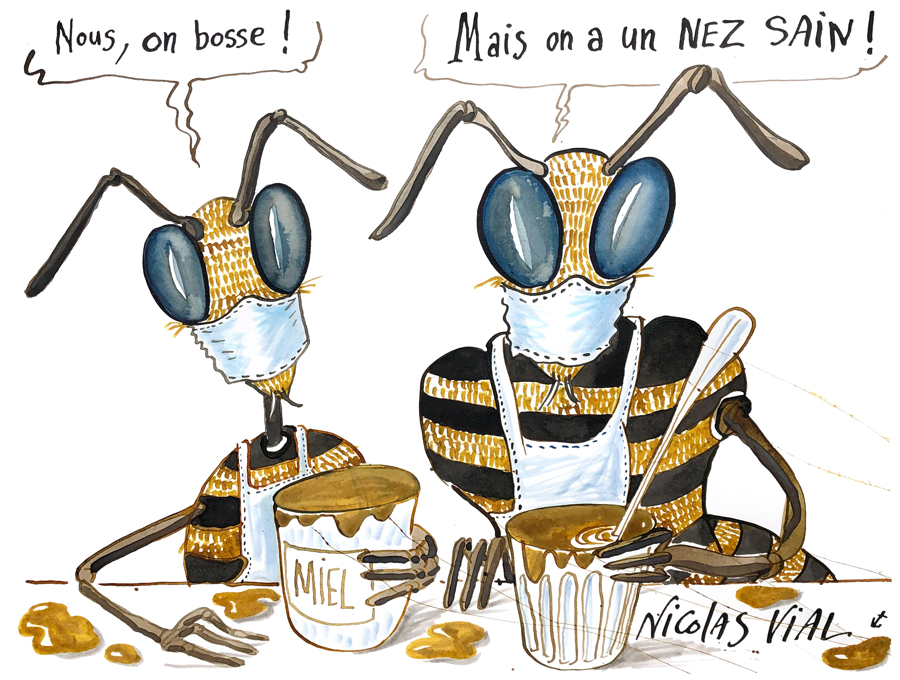
SI L’ÉPIDÉMIE C’EST LA GUERRE, alors elle a ses héros et ses profiteurs, ses généreux et ses Thénardier, si on a bien lu les Misérables du père Hugo. La délation a, hélas, si bien retrouvé ses vieux réflexes dans les tréfonds de nos inconscients que cette chronique ne viendra pas ajouter à la vindicte. En revanche, nous pouvons ici, la conscience tranquille, dire le nom de nombreux êtres vivants qui auront fait leurs choux gras de l’épidémie. Il s’agit, qui plus est, de prolétaires de tous les pays, unies – oui, au féminin – pour une grande cause : la fabrication de miel par une infinité d’ouvrières (non syndiquées à notre connaissance), besogneuses et travailleuses, aussi méritantes dans leur genre que nos personnels soignants.
Qu’on se le dise : les abeilles pètent le feu. Elles dont on craignait la disparition à cause des épandages de Gaucho et autre glyphosate sont dans une forme olympique. Mais quelles mouches les piquent pour que leurs bzzz fassent le buzz ! « En vingt ans, mes abeilles n’ont jamais produit autant de miel », s’emballe Pierre Stephan, un apiculteur bio d’Alsace. « En l’espace de trois jours, j’ai eu des rentrées de nectar exceptionnelles. Autour de quatre kilos par jour ! » Des miellées intenses qu’il attribue au calme régnant dans les forêts. Silence, on butine ! Pas de promeneurs pour déranger les vaillantes ouvrières, pas de bruits de scies assourdissantes ni d’engins à moteur pétaradants. Une sorte de commencement du monde propice à une grande razzia de pollens.
Et vous sourirez d’apprendre que la firme anglaise Rolls-Royce, dont la fabrication de belles autos est stoppée, a vu la production de ses six ruches exploser ces dernières semaines. Ses 250 000 abeilles n’ont pas chômé, pour la plus grande joie des consommateurs qui se ruent sur cet or brun ou doré. À preuve, la demande de miel est elle aussi en plein boom depuis le confinement. Le Béarnais Vincent Michaud, patron du leader mondial du conditionnement Michaud Miel, n’est pas surpris : « Cela fait quatre mille ans que les gens se tournent vers l’apithérapie pour être en bonne santé et se soigner. » Alors un cri s’impose, avec applaudissements à bonne distance de leurs ailes – et de leurs dards : merci les abeilles !
Duluc détective
Par Éric Fottorino
03/05/2020

MAIS QU'ALLAIT-IL FAIRE DANS CETTE GALÈRE ? Ce n’est pas parce que les matchs de foot étaient annulés sine die qu’il devait jouer les limiers en traquant au péril de sa vie ce virus de malheur aux formes de ballon rond, clouté comme des crampons qui se cramponnent à vos bronches jusqu’à, trop souvent, vous tuer. Il n’en est pas mort, le grand reporter Vincent Duluc, mais il n’était pas loin de jouer les arrêts de jeu. 28 jours de réa, une fièvre de cheval et un remède du même genre, comme passer trois jours et trois nuits allongé sur le ventre pour retrouver un semblant de souffle et la bonne voie respiratoire qui ramène à la vie. À lire son témoignage superbe et poignant paru ce week-end dans L’Équipe, on constate avec soulagement que le Covid n’a pas emporté la plume du journaliste-écrivain à qui l’on doit parmi les plus beaux reportages sur les fous du ballon rond et quelques ouvrages inoubliables, comme Le Cinquième Beatles (histoire captivante de l’attaquant de génie George Best).
Le virus ne l’a pas tué tout court, mais l’auteur d’un prémonitoire Éloge des coiffeurs (2018), nous a transmis a posteriori les pires angoisses, genre celles du gardien de but au moment du penalty. « Je suis sorti de l’hôpital avec 20 kilos de moins, les jambes de Tigana et en ayant besoin d’une chaise au milieu pour aller de ma chambre à la salle de bains », témoigne le rescapé. « Ce qui me reste, poursuit-il, c’est le dévouement du personnel de l’hôpital. » Et une sérieuse envie d’insulter, maintenant qu’il retrouve du coffre, ceux qu’il voit faire n’importe quoi dans la rue, qui dansent à quarante sur le trottoir au risque d’achever les soignants.
Vous vous souvenez de Baisers volés de Truffaut (dont douze des films, cadeau du confinement, ont été mis en ligne sur Netflix). Le héros Antoine Doinel se faisait engager comme (piètre) enquêteur chez « Duluc détectives, détectives privés, surveillances et filatures ». Qui n’a pas rêvé un jour devant l’enseigne noire aux néons vert absinthe accrochée au 18 de la rue du Louvre, à Paris ? Maintenant on pensera au détective Duluc, Vincent de son prénom, qui s’approcha du Covid comme on saute dans le vide. Et revint dans un récit à couper le souffle nous raconter son retour chez les vivants.
Et pendant ce temps…
Par Éric Fottorino
02/05/2020

BIENTÔT DEUX MOIS QU'ON NE PARLE QUE DE LUI. Pas une phrase, pas une page, pas une plage (interdite), pas une chronique, bref pas un jour ni un lieu ni un interstice de vie dont il soit absent, ce Covid-19 devenu numéro 1 dans nos esprits et notre vie quotidienne. C’est à peine si les grands classiques du cinéma, que redonne la télévision (de La Grande Vadrouille à Scarface), ou de la littérature, empoussiérés dans les rayons de nos bibliothèques, n’ont pas été réactualisés pour l’occasion, afin de se mettre au goût, ou au dégoût du jour. Mais même quand on n’en parle pas, on y pense. Chaque scène de foule, de restaurant animé ou de café enfumé dans un film nous fait nous dire : « Tiens, ça c’était avant » (sous-entendu : « avant le virus »). Et au détour d’un passage romanesque, quelques mots sur un personnage isolé – Un homme qui dort de Perec – nous ramènent invariablement à notre condition de confiné pour cause de… Bon, on ne va pas encore écrire le mot. Même cette chronique qui s’était juré de ne pas le prononcer y succombe. Caramba, encore raté !
Et pourtant. Il suffirait d’ouvrir les yeux, de prêter une oreille attentive, de passer certaines pages des journaux – vous devinez lesquelles – pour s’en apercevoir : pendant ce temps, le temps continue d’agir. Et il se passe d’autres choses sur notre planète (ne nous soucions pas trop des autres, pour l’instant) que ce maudit virus. Vous ne me croyez pas ? Il vous faut des exemples ? Tenez, vous vous souvenez du boucher de Damas, alias son ophtalmo de président – oui, un ancien soignant – Bachar el Assad ? Figurez-vous que même pendant l’épidémie, il reste fidèle à sa mauvaise réputation. Son peuple qui manque de tout gronde comme jamais depuis qu’un média russe proche de Poutine a divulgué la nouvelle : alors que le pays est saigné par dix ans de guerre, Bachar a offert en cadeau d’anniversaire à son épouse Asma une toile de David Hockney pour la modeste somme de 27 millions de dollars…
Et pendant ce temps, au Liban, le 30 avril, qualifié de jour historique par son Premier ministre Hassan Diab, le pays, au bord de la faillite bien avant l’épidémie, a présenté un plan de sauvetage économique en appelant le FMI à l’aide.
Et pendant ce temps, au Mali, depuis le 25 mars, date de l’enlèvement de Soumaïla Cissé près de Tombouctou, on est sans nouvelles du chef de l’opposition, ancien ministre et plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle… L’enlèvement d’une personnalité nationale de cette envergure est unique et sans précédent, entend-on à Bamako.
Et pour finir, la Pologne s’apprête à vivre l’événement le plus surréaliste depuis la chute du communisme : le parti au pouvoir veut à tout prix faire réélire le président Andrzej Duda en organisant le 10 mai prochain un vote… par correspondance, au terme d’une non-campagne, de peur qu’il soit défait plus tard, quand la population sera en butte aux lourdes conséquences économiques de l’épidémie. Varsovie réinventant la démocratie en catimini. Ça valait bien quelques lignes, non ?
Ça roule !
Par Éric Fottorino
01/05/2020
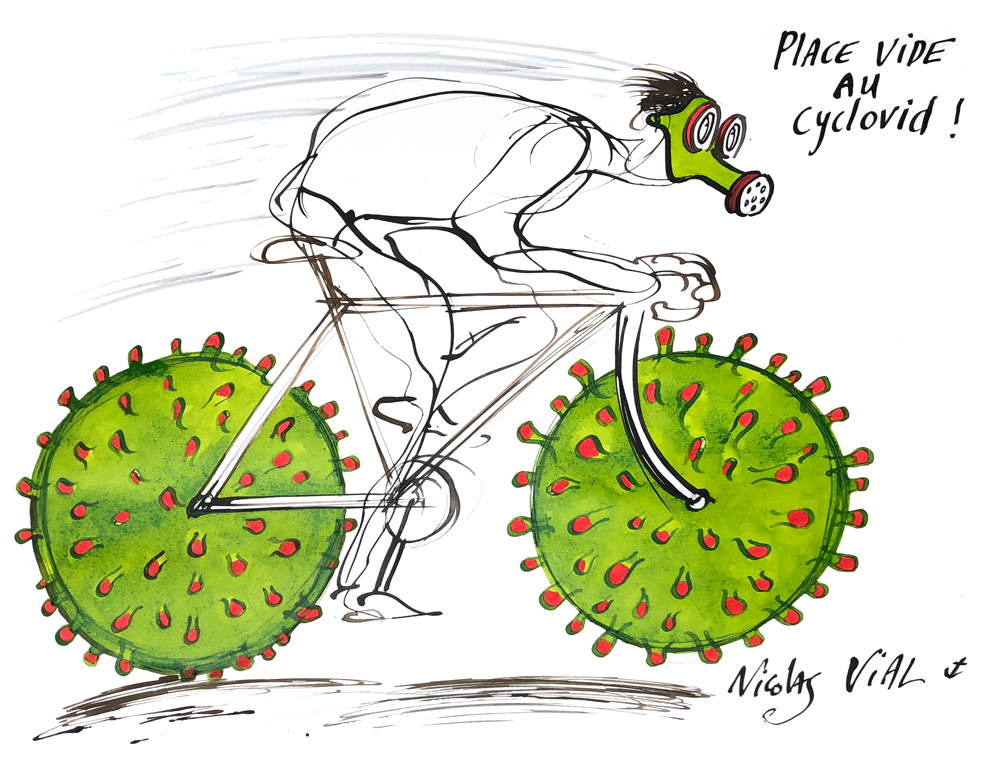
AU CHAPITRE DES BIENFAITS POSSIBLES DU COVID-19 – en regard d’une longue liste de méfaits, à commencer par celle de ses victimes –, il faudra peut-être mentionner ce grand pas pour l’homme que constitueraient ses déplacements non polluants sur deux-roues. Le cycliste invétéré, mais pas invertébré, que je suis a réagi avec joie en apprenant qu’un jour prochain, la rue de Rivoli, axe roi de la capitale, serait entièrement dédiée à la petite reine. En y regardant de plus près, il a fallu en rabattre un peu, l’espace promis devant être partagé avec les taxis et les bus. Soit. Mais quelle avancée ! Elle paraissait inconcevable il y a tout juste deux mois, avant que le virus nous force à force ruses pour l’esquiver. Et quoi de mieux que le vélo, qui nous nettoie les bronches, déploie notre arbre respiratoire et nous arme contre le Covid ?
Alors je me prends à rêver tout éveillé de ces trois kilomètres de balade depuis Saint-Paul, longeant successivement l’Hôtel de Ville et le Louvre en toute sécurité. De l’air, du bon air, et pas seulement dans les pneus. Une solution urbaine qui remettrait la bicyclette au centre du jeu, comme jadis l’église était au milieu du village… « Rue de Rivoli, je souhaite qu’il y ait un axe uniquement dédié au vélo, a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo, et un autre réservé uniquement aux bus, taxis, véhicules d’urgence et véhicules d’artisan, mais sans les voitures. » Joe Dassin l’avait chanté dès 1972, sur des paroles de Claude Lemelle et Richelle Dassin : « Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. » Et s’il n’y a plus d’autos, alors ce sera un jeu d’enfant, une grande évasion, la ville en « live », un Paris (ou un pari) bucolique…
Nul doute que cette décision, d’abord expérimentale, mais qui pourrait survivre à l’épidémie, ne fera pas que des heureux. Elle répond en tout cas à la crainte fondée que le déconfinement se traduise le 11 mai par un embouteillage monstre, les Parisiens, même masqués, répugnant à s’engouffrer dans les rames du métro. Comment concilier heures de pointe et distanciation sociale ? L’équation est un casse-tête insoluble. Sauf si, avec les beaux jours, l’idée de Mme Hidalgo prend consistance, de doubler les principales lignes de métro d’une voie cyclable en surface. Pédaler d’un trait de Vincennes à La Défense ? Ce qu’on appelle la « tactique urbaine » est en marche. Je dirais même plus : ça roule !
En mai, ne fais pas…
Par Éric Fottorino
30/04/2020

VOICI MAI QUI POINTE SON NEZ, le joli mois de mai et ses clochettes de muguet qui apportent le bonheur depuis quelques croyances et traditions du Moyen-âge… Après : « En avril, ne te découvre pas d’un fil » – surtout celui qui sert à confectionner les masques –, passons à : « En mai, fais ce qu’il te plaît ». Enfin, ça, c’était avant. Et le fameux 1er mai censé célébrer la fête du Travail promet d’être une journée particulière. D’abord parce que fêter le travail au temps du télétravail et du chômage (partiel) de masse relève du paradoxe, un de plus dans cette période si étrange. Ensuite parce que ce 1er mai sans travailleurs (hormis les premiers de tranchée souvent salués, soignants en tête) sera aussi sans défilés. Confinement oblige jusqu’au 11 mai (et avant l’heure, c’est pas l’heure), la question ne se pose plus de savoir si les manifestations seront unitaires ou si chaque centrale syndicale aura son propre itinéraire. Le 1er mai sera aussi chômé pour les manifestants. Au moins sur l’espace réel. Mobilisation il y aura, mais sur les réseaux sociaux. Chaque organisation y va de son hashtag et de son mot d’ordre. Cela donne : #1maiCGT, avec le slogan « Transformons le monde demain », ou, pour la FSU, #OnNeVaPasSeDéfiler. On s’attend aussi à des concerts de casseroles et à des chansons de lutte depuis les balcons devenus scènes publiques.
Seuls les Le Pen père et fille, sans doute immunisés par les grâces de Jeanne, et dotés d’une autorisation de sortie au motif d’intérêt partisan, braveront les interdits pour honorer la Pucelle d’Orléans. À chacun sa statue : la fille a jeté son dévolu sur la Jeanne à cheval, épée brandie, de la place Saint-Augustin à Paris, le tout en Facebook live. Son père, lui, déposera une gerbe de fleurs cueillies dans son jardin aux pieds la Jeanne équestre en bronze doré de la place des Pyramides, une amie de trente ans…
Quant au muguet, il ne va pas porter bonheur cette année à ceux qui le cultivent. Seul un tiers de la production a été récolté. Il n’y aura pas de vendeurs à la sauvette. Pas de clochettes pour les confinés sous cloche que nous sommes. Heureusement, le Parti communiste a trouvé la parade : « Nous proposons aux gens d’aller acheter un brin de muguet électronique et de l’offrir à une personne de leur choix sur le site du PC », dit son Secrétaire national Fabien Roussel. Un brin qui ne coûtera pas un bras.
Aux lames citoyens !
Par Éric Fottorino
29/04/2020

VOUS AVEZ TOUS EN TÊTE CE COUPLET du Barbier de Belleville interprété par un Serge Reggiani alternant voix de stentor et voix de fausset :
« Je suis le roi du ciseau
De la barbiche en biseau
Je suis le Barbier de Belleville
Des petits poils jusqu’aux cheveux
Je fais vraiment ce que je veux »
Ah, il nous aura manqué, Figaro-ci, Figaro-Là, je ne parle pas du journal toujours fidèle au poste – la presse a bien été classée produit de première nécessité pendant le confinement – mais du barbier raseur Figaro, sorti jadis de l’esprit farceur de Beaumarchais. Mon royaume, disons ma maison, pour un coiffeur ! Voilà le cri qu’auraient pu pousser plus d’une et plus d’un d’entre nous en voyant leurs cheveux perdre leurs belles couleurs, leurs racines blanchir, leur tignasse épaissir, leurs franges ou leurs mèches s’allonger au-delà du raisonnable. Comme en temps de guerre, il a fallu recourir au système D pour jouer de la lame parfois à l’emporte-pièce. C’est la consommation de tondeuses (non, pas à gazon) qui a bondi en flèche, avec leurs prix devenus fous !
Mais une fois l’instrument en main, les apprentis coiffeurs, leurs compagnes ou compagnons de confinements n’y sont pas toujours allés avec le dos de la cuiller pour couper les cheveux en quatre. Combien d’ados se sont vengés sur la toison de leur père réduite à une boule à zéro accidentée de trous et de crans voyants. Ah, tout le monde n’a pas regardé les tutos des ténors de la haute coiffure qui, vidéos à l’appui, ont montré comment régler le sabot d’une tondeuse et ne la passer que sur les cheveux dépassant du peigne plaqué tantôt sur les tempes, tantôt sur les circonvolutions du crâne… Quant à ces dames, beaucoup se sont mises à rejoindre la tendance assumée de la regrettée Agnès Varda, racines claires au milieu et le reste à la dernière couleur passée avant le confinement. Mais les femmes ont leurs petites ruses pour tromper le regard, avec du mascara étalé sur les zones grises les plus voyantes, avec chapeaux ou foulards pour cacher le désastre. À Montpellier, un coiffeur clandestin a ouvert son salon aux plus désespérés par leurs coupes loupées. Mal lui en a pris, la police l’a surpris l’arme du crime dans une main, une touffe de tifs dans l’autre. Y a pas : vivement le 11 mai, c’est la seule chute (de cheveux) qui vaille !
Le virus Presstalis
Par Éric Fottorino
28/04/2020

C’EST UNE HISTOIRE VIEILLE COMME LA PRESSE. Au moins celle qui renaquit de ses cendres après la Libération, expurgée des titres ayant trempé dans la Collaboration. Les Gaullistes prirent les rédactions. Les communistes, les imprimeries et la distribution. Une sorte de Yalta des canards. Les quotidiens furent d’emblée sous-capitalisés, avec interdiction pour leurs propriétaires de détenir plus de deux titres. Le CNR (Conseil national de la Résistance) jugeait à raison que l’information n’était pas un bien comme les autres, et qu’il fallait la tenir éloignée des magnats du grand capital. Moyennant quoi soixante-quinze ans plus tard, pas un groupe de presse, du Monde au Figaro, de Libération à L’Express ou L’Obs, n’a échappé aux appétits de puissants industriels.
La semaine passée, l’entreprise Presstalis, qui assure le plus clair de la diffusion des journaux sur le territoire, s’est mise en cessation de paiements, affichant des pertes abyssales. Résultat : 20 % des magazines risquent de disparaître, en particulier les éditeurs indépendants – dont le 1 – subissant une double ou triple peine : le risque de voir leurs recettes en kiosques gelées par cette situation de quasi-faillite. Les pratiques ambiguës des pouvoirs publics qui, pour assurer un plan de sauvetage, proposent une issue en forme de chantage. Le genre de proposition que font les riches aux pauvres : on vous propose un peu d’argent mais à l’arrivée, on vous piège.
Démonstration ? Le plan de la dernière chance consisterait à payer aux journaux membres de Presstalis 83 % de leurs créances… une somme dont ils devront reverser 70 % dans une nouvelle structure de remplacement ! Si on ajoute que sur ces 83 %, la moitié est un prêt remboursable, une créance de 100 deviendra une dette, un passif de - 16,5. Qui dit mieux comme tour de passe-passe ? Enfin, les éditeurs signataires devraient rester six ans dans le Presstalis ainsi « revampé », sans donc pouvoir sauver leurs titres et leurs avoirs dans la seule messagerie concurrente, les MLP (Messageries lyonnaises de presse). Pendant le Covid, le virus Presstalis agit, qui met en danger de mort de nombreux journaux. Et la pandémie ne fait que donner le coup de grâce à un secteur qui, pour sauver ses dernières plumes, croit trouver refuge et salut dans l’illusion numérique.
Avatar que jamais
Par Éric Fottorino
27/04/2020

LE COVID A CRÉÉ UN GRAND VIDE. Dans les rues (même si beaucoup, trouvant que les plus courtes sont les meilleures, se déconfinent avant l’heure), dans les restaurants et les cafés – tristes terrasses aux chaises tête-bêche comme pouce en bas –, dans les stades, dans les salles de théâtre, de cinéma, de concert, de classe. Dans le ciel. Vide total. Sidéral et sidérant. Oui, on a beau se pincer, se dire chaque matin que ce n’est pas vrai, qu’à la fin il faudra que ça finisse, le déconfinement donne naissance à de nouvelles peurs. Peur de reprendre le travail au bureau avec les collègues, de déposer les petits à la crèche, d’envoyer les enfants au collège ou au lycée, de renouer avec les habitudes d’avant.
Et bien sûr, si l’espace public a désempli, ce n’est pas que la colère sociale soit retombée. Aux Gilets jaunes et aux révoltés par le projet de réforme des retraites se sont ajoutés tous ceux qui ne manqueront pas de manifester contre les impérities du gouvernement. Certains espèrent même traduire les responsables, forcément coupables de tous ces morts, de la pénurie de masques et de tests, devant des juridictions idoines. Fantasmes d’un remake sanglant des procès du sang contaminé…
Mais en attendant, pas question de manifester à l’ancienne avec banderoles, slogans, haut-parleurs, ballons gonflés à l’hélium, saucisses grillées et hot dogs à la fin des rassemblements. Alors des petits malins ont trouvé la parade. Le combat continue, à condition de se télétransporter sur des jeux vidéo. En particulier sur la petite merveille dernier cri de Nintendo baptisée Animal Crossing New Horizons, lancée le 20 mars. Ce petit jeu inoffensif qui consiste à décorer sa maison tranquillou sur son îlot, et à nouer des liens avec une bonne distanciation sociale avec l’avatar de l’îlot voisin, a été détourné pour abriter de vraies manifs. En 2016 déjà, la migration virtuelle avait été expérimentée sur une version antérieure par les travailleuses et travailleurs du sexe interdits de voie publique. Fin mars, les Gilets jaunes ont lancé sur ce support leur première cybermanifestation anti-Macron en confectionnant leurs propres pancartes 2.0. D’autres, moins belliqueux, organisent sur Animal Crossing des fêtes de mariage ou des anniversaires qui n’ont pu avoir lieu « en vrai ». Avatar que jamais ! Bienvenue dans les mondes parallèles qui, à l’infini, rejoindront peut-être le monde réel…
Lire libère !
Par Éric Fottorino
26/04/2020

SI, AU BOUT D'UNE QUARANTAINE DÉJÀ DÉPASSÉE, nous ne sommes ni nés ni confinés de la dernière pluie, certains, dont je suis, ont trouvé la parade pour se sentir pousser de grandes ailes et voler loin. Cela s’appelle la lecture. Lire libère. Ça sonne bien ! Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que le mot liber – venu en toutes lettres du latin – désigne à la fois une des trois enveloppes qui constituent l’écorce de l’arbre et l’assemblage de feuilles manuscrites ou imprimées. De liber à la liberté en passant par les pages d’un livre, voici le plus court chemin de l’évasion quand le temps s’étire en longueur pour cause d’épidémie. Je ne parle pas de lire à toute allure sur un écran au rythme fou des algorithmes qui nous gavent d’infos en continu sur les maux du monde. Je pense aux livres de fiction qui, dans l’instant où le « il était une fois » est commencé, font tomber les murs autour de nous.
À tout seigneur tout honneur, c’était comme une visite de politesse d’aller s’enquérir du bon docteur Rieux qu’on avait laissé avec un rat crevé dans son escalier d’Oran, au début de La Peste de Camus. On y trouve cette belle phrase à méditer : « Ce que nous apprend le fléau, c’est qu’il y a en l’homme plus de choses à admirer qu’à mépriser. » Je n’ai pas quitté le grand Albert sans prendre un bain de chaleur dans Tipasa l’algérienne qui au printemps est habitée par les dieux. Et ces dieux « parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres ». Si Camus imaginait un « Sisyphe heureux », je vous garantis aussi une bouffée de bonheur en lisant ces pages, même si nous devons remonter encore le boulet des jours qui coulent trop lentement.
Déjà cette chronique s’achève, moi qui voulais vous parler du déstabilisant Malevil de Robert Merle (une poignée de survivants dans un château moyenâgeux après une guerre nucléaire qui a ravagé la France), du Jardin des Finzi-Contini de Giorgio Bassani (une autre forme de confinement : une famille aristocrate juive de Ferrare enfermée chez elle au moment des lois raciales de 1938 en Italie). Ou du comédien Stéphane Freiss qui chaque soir lit admirablement de grands auteurs, de Gary à Anaïs Nin, ici.
Ah, et avant de conclure, dire aussi un mot d’Un homme qui dort, de Georges Perec, où un étudiant se renferme sur lui-même, dans sa chambre, en écoutant le bruit d’un robinet qui goutte. Que n’a-t-il ouvert un roman !
Le covid, ça décape
Par Éric Fottorino
25/04/2020
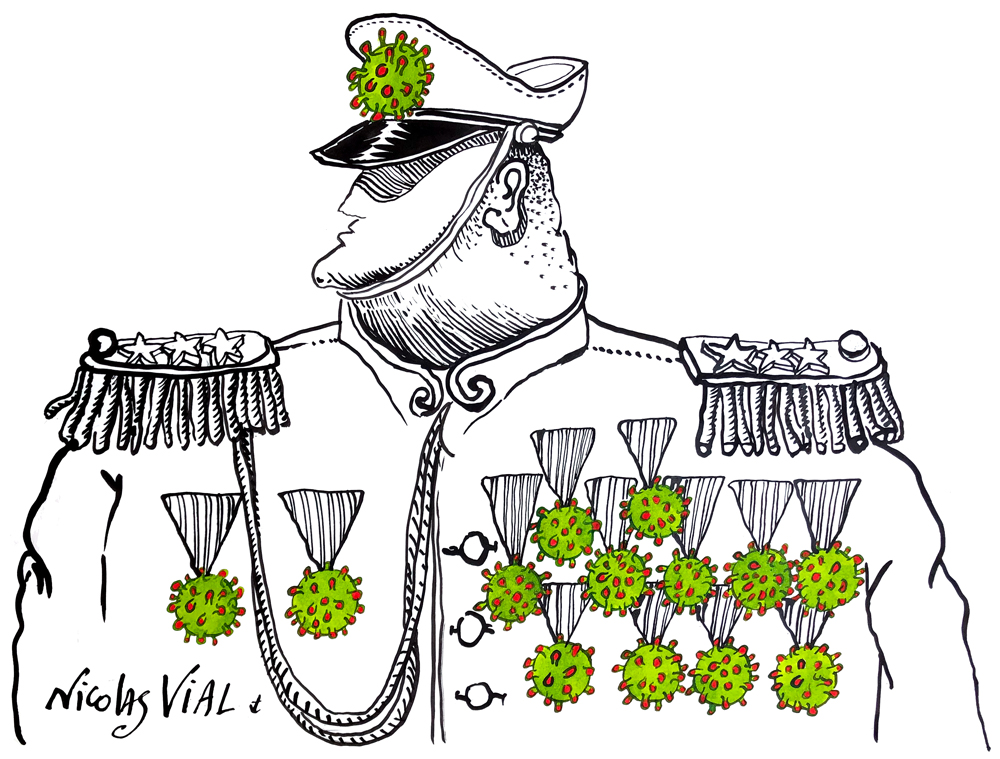
C’ÉTAIT COURU ON LE SAVAIT, mais les faits et chiffres ont cette fois corroboré nos craintes. Tous ceux qui jouaient les fiers-à-bras en disant : « Le virus, connais pas » ont mis leurs peuples en danger plus que de raison. Dans le club des autruches têtes de mule, si l’espèce est répertoriée aussi bien que le pangolin et la chauve-souris, Donald Trump se pose-là, qui tenait encore il y a peu le virus pour un canular démocrate. À présent que l’Amérique compte plus de 50 000 morts, que les Indiens navajos sont parmi les plus touchés après les habitants de New York (dont 21 % ont été contaminés) et ceux du New Jersey, les comptes sont douloureux. « En un mois, nous apprennent les décodeurs du Monde Mathilde Damgé et Gary Dag, la crise économique liée au Covid-19 a détruit plus d’emplois aux États-Unis que la croissance n’avait réussi à en créer durant les dix dernières années. » Et de préciser : « Les inscriptions au chômage dépassent 26,4 millions, un chiffre inédit dans l’histoire américaine. Ce cumul “efface” les 22,8 millions d’emplois créés en dix ans. »
Pendant ce temps, Trump continue de jouer les apprentis sorciers. N’a-t-il pas suggéré de recourir à la luminothérapie et à l’injection de désinfectant pour se défaire du virus ?! Les protestations et les mises en garde n’ont pas tardé pour contester les propos présidentiels aussi dangereux que le Covid-19 lui-même : « Cette idée d’injecter dans le corps ou d’ingérer n’importe quel type de produit nettoyant est irresponsable et dangereuse », a déclaré le docteur Vin Gupta, un spécialiste du poumon, précisant qu’il s’agissait d’une méthode « couramment utilisée par les gens qui veulent se tuer ».
De son côté, Poutine, qui se vantait d’avoir bouté le virus hors de Russie, doit déchanter : le pic de l’épidémie est prévu chez lui pour la mi-mai et l’impéritie du Kremlin menace la Chine d’une deuxième vague d’épidémie. Quant au coronasceptique brésilien Bolsonaro, qui tient le Covid pour une « simple grippette » et prône le déconfinement, peut-il entendre que l’épidémie déjà galopante atteindra son sommet dans un mois ? Veut-il voir les images de ces morts enterrés à même la terre dans des milliers de fosses creusées en hâte à la pioche ou au tractopelle ? Non, à l’évidence. « Nous sommes à la limite de la barbarie », se lamente le maire de Manaus. On parle de « populicide ». Ce virus est un sacré décapant : il montre le vrai visage des salauds.
Quarantaine
Par Éric Fottorino
24/04/2020

LES CHIFFRES, PARAÎT-IL, NOUS AVAIENT PRÉVENUS. C’était même imparable. L’année 2020 n’était pas l’assurance d’avoir 20 sur 20 dans nos entreprises, mais plutôt la promesse d’une addition salée : 20 + 20 n’égale point la tête à Toto mais plutôt la quarantaine. Pas de faridondaine ni de calembredaine, mais une bonne vieille quarantaine sortie de derrière les fagots de l’histoire brûlant des mille feux de l’enfer, peste noire, choléras et pandémies à l’ancienne, de quoi vous mettre le trouillomètre à zéro. La quarantaine, donc, était écrite, inscrite dans l’année calendaire aussi sûrement que 2 et 2 font 4, on n’allait pas y échapper. Preuve que dans ce monde mondialisé capitaliste et tout le tintouin, c’est encore les chiffres qui ont le dernier mot.
Dans notre imaginaire de contemporains n’ayant jamais connu la moindre contagion de ce type, pas plus la peste bubonique que la grippe espagnole, la quarantaine n’était reliée à rien de précis, sinon quelques récits parvenus de villes anciennes infestées de virus par des navires aux équipages suspects, à Dubrovnik ou Venise, quelque part entre le XIVe et le XVe siècle. La gare Saint-Lazare, proche des bureaux du 1, aurait dû nous mettre sur la voie des lazarets de la lagune vénitienne ou du lépreux de la Bible nommé Lazare, mais avouez que c’était un peu tiré par les cheveux, plus fort que le Da Vinci Code, cette histoire de quarantaine rattachée pour les plus pieux au jeûne imposé au Christ par le Saint-Esprit – quarante jours dans le désert sans manger ni boire...
Tout compte fait, le mot m’évoquait un roman de Le Clézio, tout simplement titré La Quarantaine, une ode superbe à la vie sauvage inspirée du séjour forcé de son grand père maternel sur une langue de terre au large de l’île Maurice. Plus encore, la quarantaine n’allait pas sans être accolée à un terme générique qui vaut pour ce que nous vivons à présent : une crise. Et la crise de la quarantaine, comme chacun sait, parfois associée au démon de midi, surgit au mitan présumé de la vie, quand les rives de la jeunesse sont aussi éloignées que celles, se rapprochant dangereusement mais encore distantes, de la vieillesse, antichambre de la mort.
Ces lignes écrites, la quarantaine s’impose à moi d’un bon sang mais c’est bien sûr ! Je viens d’écrire la quarantième chronique de ce journal.
Fumer nuit grave… au Covid-19
Par Éric Fottorino
23/04/2020
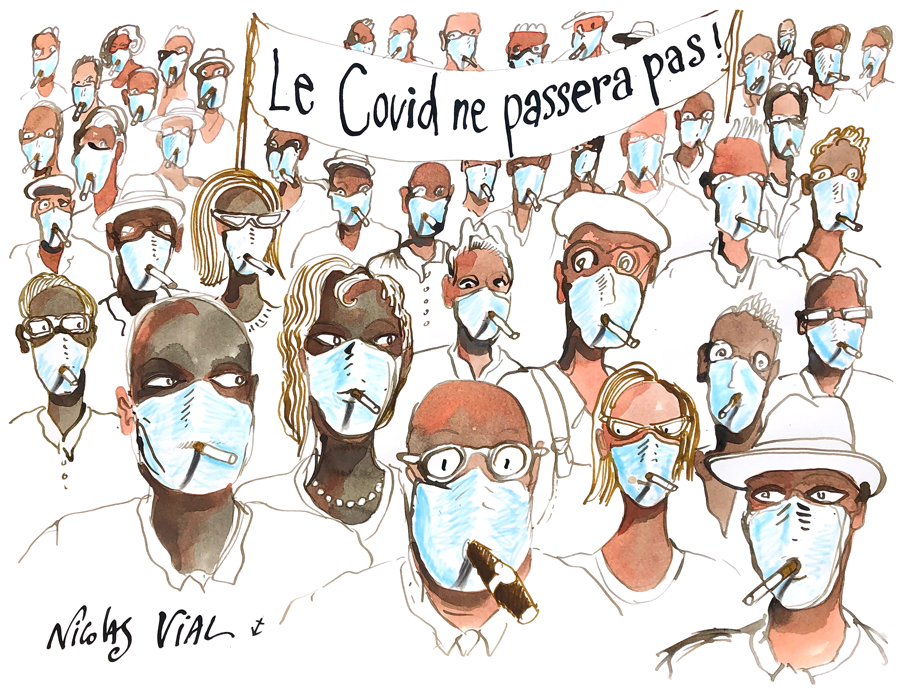
VOILÀ UNE ÉTUDE QUI VA FAIRE UN TABAC ! En tout cas chez les fumeurs. D’après une équipe de chercheurs de la Pitié-Salpêtrière, tout ce qu’il y a de sérieux, pas du genre à fumer la moquette ou à se bourrer d’hydroxychloroquine, les faits sont là : le taux de fumeurs parmi les patients infectés par le Covid-19 est de 5 % à peine. Oui, vous avez bien lu. Et les auteurs, qui vont commencer sans tarder des essais cliniques, d’enfoncer leur clou : « Notre étude transversale suggère fortement que les fumeurs quotidiens ont une probabilité beaucoup plus faible de développer une infection symptomatique ou grave par le SARS-CoV-2 par rapport à la population générale », observent le docteur Makoto Miyara et le professeur Zahir Amoura, du service de médecine interne à la Pitié. « L’effet est important, ajoute leur collègue de la Sorbonne et coauteure de cette recherche, l’épidémiologiste Florence Tubach. Cela divise le risque par cinq pour les patients ambulatoires et par quatre pour les patients hospitalisés. On observe rarement ça en médecine ».
Le président du Comité scientifique, Jean-François Delfraissy, a confirmé sur les ondes en observant que « l’immense majorité des formes graves (d’infection) n’était pas des fumeurs ». D’après lui, le tabac protégerait contre le virus, via la nicotine. Une impression qui reste à valider, et que cet épidémiologiste de renom assortit d’un avertissement : « Ne vous mettez pas au tabac »… Ce dernier demeure en effet la première cause de mortalité, tuant pas moins de 75 000 personnes par an. D’où la prudence de Florence Tubach : « Sur la base de ces résultats, si robustes soient-ils, il ne faut pas conclure à un effet protecteur de la fumée du tabac, qui contient de nombreux agents toxiques. Seule la nicotine ou d’autres modulateurs du récepteur nicotinique pourraient avoir un effet protecteur et je maintiens le conditionnel car nos travaux restent observationnels. »
L’heure est ainsi aux examens approfondis et aux tests. Des essais thérapeutiques vont ainsi être proposés pour évaluer l’effet des patchs de nicotine. Avec une vigilance accrue sur les effets secondaires de cette substance, pour les non-fumeurs en particulier. Si fumer nuit grave… au coronavirus, on pourra méditer cet étrange paradoxe qui consisterait à se sauver de l’asphyxie en s’intoxiquant à la cigarette…
Labourage, pâturage… et maraîchage
Par Éric Fottorino
22/04/2020

D’ABORD UN PEU D’HISTOIRE. Écoutons la voix de Sully, surintendant des finances du « bon roi » Henri IV, auteur de ces mots, tirés de son maître ouvrage Les Œconomies royales (1594) et qui firent longtemps la fierté du monde paysan : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vrais mines et trésors du Pérou. » Puis écoutons en écho un autre cri du cœur non moins célèbre, attribué à Henri de Navarre, son souverain : « Je veux qu’il n’y ait si pauvre paysan en mon royaume qu’il n’ait tous les dimanches sa poule au pot. » Belles paroles. Mais ne pas oublier que les cultivateurs et les éleveurs d’antan étaient écrasés d’impôts. Qu’ils ne mangeaient pas toujours à leur faim, abandonnés à une misère crasse quand ils n’étaient pas enrôlés et sacrifiés dans les sanglantes batailles du royaume. Une situation qui se perpétua jusqu’aux deux guerres mondiales, la paysannerie ayant fourni une chair à canon abondante et bon marché.
Avec la modernisation des années 1950, grâce à la motorisation permise par le plan Marshall et aux avancées de la chimie, l’agriculture est devenue hyperproductive. Elle s’est mise à produire plus avec moins de bras. Exode rural, abondance alimentaire, chute des prix agricoles. Pendant les Trente Glorieuses (1946-1975), les Français sont devenus des consommateurs heureux, accédant à l’électroménager, à la télé, aux voyages. Et pour cause : la part de la nourriture fondait à vue d’œil dans leurs budgets, même si le contenu des assiettes était moins goûteux, plus industriel, uniformisé…
La pandémie de Covid remet les choses à leur place. Prix négatif du pétrole, prix des denrées de qualité qui grimpe. On a pris conscience que les agriculteurs étaient des premiers de cordée (nos autres soignants, à condition de cultiver sain). Que le maraîchage s’ajoute aux labourages et aux pâturages pour apporter aux citadins des fruits et des légumes dont ils avaient oublié les conditions de production – pénibles et exigeantes en main-d’œuvre. Voici que se multiplient les initiatives de « drive » sur des parkings, de livraisons de cagettes, de points de retrait de paniers qui permettent aux producteurs de faire « d’une pierre deux coups » : satisfaire les consommateurs et combler en partie la chute de leur activité due à la fermeture des restaurants et des marchés alimentaires de plein air. Sans oublier les volontaires qui ont pris le chemin des champs et des serres car le printemps n’attend pas quand il faut cueillir et récolter. Se pencher vers la terre, une autre façon de se tenir debout. Et de réaliser que bien se nourrir a un coût.
Sans contact
Par Éric Fottorino
21/04/2020

VOUS SOUVENEZ-VOUS de ce film américain déjà ancien (sorti en 1995) dont le titre était Denise au téléphone ? La période d’évitement que nous vivons, pour notre bien il faut croire, me rappelle des scènes frappantes de ce qui n’était encore qu’une fiction. On ne parlait pas de gestes barrières ni de distanciation sociale, mais repenser à cette comédie au temps du coronavirus me la rend terriblement réaliste. Presque prémonitoire. Le ressort narratif était simple et glaçant. Toutes les relations de l’héroïne, Denise donc, amicales et intimes pour l’essentiel, mais aussi professionnelles, se passaient par téléphone. L’argument du film était sans ambiguïté : « Sept New-Yorkais célibataires travaillent de chez eux sur un ordinateur et ne vivent que par et pour le téléphone. Ils se rencontrent, se confient, se dévoilent, se séduisent toujours par téléphone. »
C’est donc au bout du fil, si on peut dire, d’un appareil sans fil – un des premiers modèles de la fin du xxe siècle – que s’organisait toute la vie de la jeune femme. Les protagonistes se promettaient à tout bout de champ de se voir, mais on comprenait après quelques minutes qu’il n’en serait rien. Par cette technologie nomade qui annonçait notre xxie siècle, personne ne rencontrait plus personne, c’était chacun pour soi, chacun avec soi, un entre-soi au carré, confiné avant l’heure. Denise assistait ainsi à distance à un accouchement comme à un accident mortel, mais ne voyait jamais rien de ses yeux, comme si son oreille devenait son organe vital, son unique lien au monde.
Je me souviens d’être ressorti du cinéma amusé par le jeu des acteurs mais terrifié à la perspective d’un monde où la technologie détruirait les relations humaines. Aussi ai-je tiqué dimanche quand le Premier ministre a souhaité que le télétravail « se poursuive dans toute la mesure du possible ». Ce qui était jusqu’ici une pratique assez marginale réservée aux cadres pourrait faire tache d’huile et concerner jusqu’à 8 millions d’actifs. La promesse d’un monde froid et sans contact. Pas forcément sans danger. Je me suis dit que même si nous venions à bout de l’épidémie, nous ne serions pas quittes avec cet ennemi. Un virus invisible qui nous empêche de nous serrer la main, de nous embrasser, de nous réunir au bureau ou entre amis, n’est-ce pas le portrait-robot d’un dictateur du futur venu saccager notre présent ?
Vivre en poésie
Par Éric Fottorino
20/04/2020

APRÈS LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001, pour échapper à l’angoisse ambiante faite de milliers de morts et de nuages de poussière, de pages entières de nécrologies dans le New York Times et de cérémonies funèbres, beaucoup d’habitants de la Grosse Pomme endeuillée s’étaient réfugiés dans la poésie. Je me suis souvenu hier de ce détail qui n’en est pas un. La poésie face à la peur, face à l’angoisse, au mal-être que provoque l’incertitude d’un monde qui vacille sur ses bases dans une violence mortifère. C’est l’auteur américain Don DeLillo qui, en bon sismographe de son temps, avait relevé ce phénomène dans son roman L’Homme qui tombe (2007). Un homme et une femme se confiaient sur leurs émotions. « Les gens lisent de la poésie, racontait la femme. Des gens que je connais, ils lisent de la poésie pour adoucir le choc et la souffrance, cela leur procure une sorte d’espace, quelque chose de beau dans le langage, qui leur apporte du réconfort ou de la sérénité. » Et elle ajoutait : « Je ne lis pas de poésie. Je lis les journaux. J’enfonce ma tête entre les pages et je deviens folle et enragée. »
En ces temps de Covid que chacune, chacun d’entre nous peut traverser avec des hauts et des bas, des trop-pleins ou de grands vides, la poésie est un pays qui aide à vivre. Elle est un recours et un secours précieux qui, à l’instar de la musique, de la chanson ou des romans, mais à sa manière faite de sens et de sons, de rythmes et de rimes, remplit nos âmes.
Soit en mélancolie – bonjour Apollinaire :
Passons passons puisque tous passe
Je me retournerai souvent
Les souvenirs sont cors de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent
Soit en légèreté – voici Boris Vian :
Pourquoi que je vis
Pour la jambe jaune
D’une femme blonde
Appuyée au mur
Sous le plein soleil
Pour la voile ronde
D’un pointu du port
Pour l’ombre des stores
Le café glacé
(…)
Pourquoi que je vis
Parce que c’est joli.
On peut aussi écouter la voix de Borges :
Si je pouvais vivre une nouvelle fois ma vie
J’essaierais d’y commettre plus d’erreurs
Je m’exposerais à plus de risques
Je ferais plus de voyages…
Ou suivre le conseil de Paul Claudel, extrait de Cent phrases pour éventail, et donné dans sa lettre quotidienne par France Culture (« Culture maison ») :
Chut !
si nous
faisons du bruit
le temps
va recommencer
Deux mains pour être humain
Par Éric Fottorino
19/04/2020
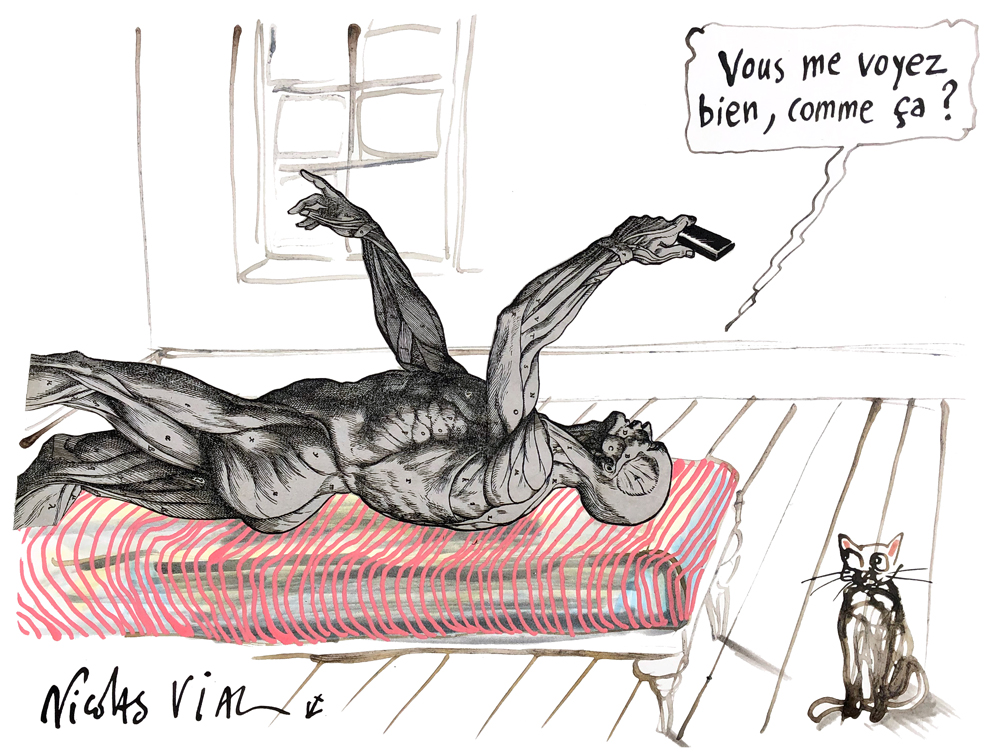
L’ARRÊTÉ EST SANS DOUTE PASSÉ INAPERÇU POUR LE COMMUN DES MORTELS, encore que le confinement prolongé puisse réveiller de vieilles douleurs qui mériteraient qu’un œil expert, faute d’une main autorisée, s’y penchât. Depuis ce samedi, les kinésithérapeutes sont désormais autorisés à pratiquer leur art à distance. Non que le télésoin soit l’équivalent d’une téléportation qui, d’un clic magique, amènerait votre kiné au milieu de votre salon tout ganté, masqué et hydroalcoolisé. Si ce métier reste avant tout manuel – le kiné touche, appuie, étire, masse, soulage –, la dureté des temps l’oblige à adapter ses pratiques. Pour soulager une lombalgie, un lumbago, un rhumatisme ou un ligament récalcitrant, ou encore des douleurs abdominales postopératoires, le télésoin à petites doses peut au moins vous épargner de vilaines ankyloses.
Pour les patients déjà rompus aux exercices, qui avaient rencontré leur soignant dans la vie d’avant, quand on pouvait encore prendre un rendez-vous dans un cabinet et voir un kiné en chair et en os (il faut parfois rappeler ce qu’était le monde d’hier), pour ceux-là donc, la séance par écran est assez simple : il s’agit de réviser des gestes et des pratiques connues, et de les pousser un peu plus pour progresser. Comme aux premiers temps du Super 8, chacun compose ses bouts de film amateur et les poste sur whatsApp. Le praticien montre la voie, le patient s’exécute à son tour, ce qui permet au professionnel de le corriger. Un échange qui suppose tout de même d’être agile… avec ces outils. Quand il s’agit d’un premier contact (un kiné de nos amis a reçu un appel à l’aide… du Japon !), la séance se résume à quelques conseils dispensés au mieux : porter une ceinture lombaire ou un collier cervical (délivré par ordonnance scannée) pour mettre au repos les zones douloureuses, adopter des postures ergonomiques et des positions de sommeil adaptées, ne pas porter de charges…
Mais rassurons-nous, Ce n’est pas demain la veille que la rééducation s’exercera à la voix et en images. Dans cette époque où le sans contact est érigé en impératif vital, il faudra toujours deux mains pour être un kiné à visage humain.
Venise à livre ouvert
Par Éric Fottorino
18/04/2020

« VENISE, VIDI, VICI ! » pourrait s’exclamer triomphant le terrible Covid devant une cité des Doges si vide que les pigeons de la Place Saint-Marc en perdent leur latin. Cinquante jours sans touristes, des canaux déserts, le Danieli et le Canaletto sans clients, des gondoles sans amoureux en goguette, le pont des Soupirs abandonné à ses souvenirs, et au milieu coule une eau transparente comme jamais où frayent des poissons visibles à l’œil nu. Pour un peu, on entendrait Aznavour chanter :
Que c’est triste Venise
Lorsque les barcarolles
Ne viennent souligner
Que des silences creux
Mais est-ce si triste, Venise, quand la ville devient moins fréquentée encore que le petit bois de Trousse-Chemise ? Ses édiles sont partagés entre la crainte du marasme économique qui pointe et la volupté de ce calme absolu, qui redonne à chaque perspective, à chaque pierre, sa vraie dimension. Comme un morceau d’éternité rendu par une humanité qui, soudain, lâche prise et se tient à distance. De quoi demain sera-t-il fait si déconfinement rime avec recherche d’un raffinement peu compatible avec le tourisme de piétinement ? Déjà des voix s’élèvent à Venise pour dire que plus jamais n’approcheront ces vaisseaux monstrueux, véritables immeubles flottants débarquant par milliers des hordes de visiteurs qui prennent d’assaut les rues étroites et les boutiques de babioles made in China.
Ils étaient trente millions en 2018, l’année record. « On est passé d’un extrême à l’autre », expliquait en fin de semaine sur France 2 Matteo Secchi, de l’association Venessia. « Ici, il y a quelques mois, on ne pouvait même pas se croiser. Maintenant, c’est désert. » L’idée fait son chemin, que désormais on fixerait un quota journalier maximum de voyageurs pour saisir l’opportunité écologique que représente l’épidémie. En attendant, ce n’est pas pour rien que les autorités ont accepté de rouvrir les librairies vénitiennes, prudemment d’abord, à raison de deux jours par semaine, avec des horaires spéciaux pour les personnes âgées. La ville est une réserve d’histoire et de belles histoires. Pour ceux qui n’auront pas la patience de faire la queue, il leur suffira de lever le nez, d’ouvrir les yeux sur le ciel pur. Venise s’offrira à eux à livre ouvert.
Un chanteur ne meurt jamais
Par Éric Fottorino
17/04/2020

ON SENTAIT BIEN que ça ne sentait pas très bon depuis quelques semaines pour le dernier des Bevilacqua. Celui qui avait survécu à la vague yéyé, au disco, à l’électro et aux modes qui se démodent a vu le virus lui couper la chique. Après Manu Dibango et quelques formidables papys du jazz, c’est l’éternel amoureux d’Aline, le chevalier servant de sa Señorita qu’on espérait increvable qui a succombé au Covid. Le 26 mars, quand on avait appris son hospitalisation dans un établissement parisien, les balcons remplis à 20 heures pour applaudir les soignants étaient restés animés pour reprendre ses Mots bleus, les mots qu’on dit avec les yeux, ceux qui rendent les gens heureux. Et ses paroles montant dans un ciel de la même couleur nous avaient rassérénés. Christophe n’allait pas faire faux bond à un public si fervent ! Ses amis de scène y allaient de leurs encouragements, de Michel Polnareff à Jeanne Mas qui, pour l’occasion, lui avait envoyé du France Gall / Berger : « Résiste, suis ton cœur qui insiste, […] bats-toi, signe et persiste. » Etson copain le comédien Jean-Paul Rouve, dans un clin d’œil à son rythme de vie décalé, lui avait donné rendez-vous un soir prochain : « Et on ira dîner à 23 heures, quand tu te réveilles. »
Quelques jours plus tard, on s’était encore pris à espérer, quand l’oiseau de nuit avait migré vers une unité de soin brestoise. Donc il volait encore ! Allez savoir pourquoi, mais rapprocher le chanteur aux moustaches gauloises du grand air d’Armorique nous avait paru de bon augure. Comme si là-bas il allait respirer large, regonfler ses poumons et fredonner : « Avec les filles, j’ai un succès fou… le charme, ça fait vraiment tout… » Manifestement non, le virus n’a guère été sensible à celui d’un vieux crooner romantique aux allures de barde un peu dandy, vraiment maudit. Et lorsque son épouse Véronique a fait savoir que l’artiste était intubé et sous sédation profonde, on s’est mis à redouter chaque matin en se levant l’annonce qu’il ne se réveillerait plus. La mauvaise nouvelle a fini par tomber ce matin, et comme un pied de nez à la froide réalité, c’est sa voix qui a aussitôt murmuré à nos oreilles, douce et voilée, sortie d’une corne de brume, d’un tonnerre de Brest, cette voix inoubliable, pour nous dire qu’un chanteur ne meurt jamais.
Des chiffres et des êtres
Par Éric Fottorino
16/04/2020
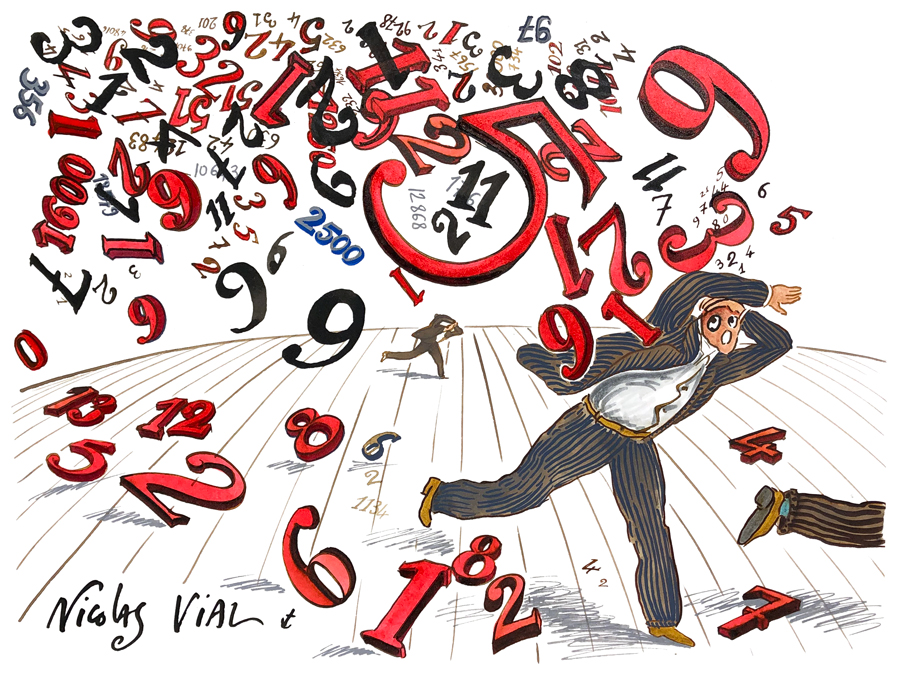
AVANT DE COMMENCER L’ÉGRENAGE FATAL, cette potion à base de Mark Twain en guise d’antidote : « Il y a trois mensonges, affirmait l’écrivain et humoriste américain qui nous fit rêver enfants avec Les Aventures de Tom Sawyer : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. » Forts de cet avertissement et d’une pincée d’optimisme tout de même – depuis plusieurs jours, le solde entre entrées et sorties d’hôpital de patients atteints du Covid en France est négatif –, plongeons dans le maquis des énumérations. Voici le bilan forcément provisoire de la tragédie. Sans oublier l’essentiel : derrière les chiffres, il a des êtres.
On comptait hier 131 000 morts du coronavirus dans le monde. 17 167 chez nous depuis début mars, dont 10 643 à l’hôpital. Soit près de 7 000 décès dans les EPHAD. Une hécatombe. 12 868 victimes étaient recensées au Royaume-Uni, avec une polémique à la clé : les autorités ne comptent pas les morts à domicile. Si c’était le cas, le bilan outre-Manche avoisinerait celui de la France, puisque le syndicat des Maisons de retraite du Yorkshire estime à plus de 4 000 le nombre de résidents décédés. De son côté, apprenant le record peu enviable de 2 500 morts du Covid-19 dans la seule journée de mardi (pour un bilan total de 28 326 morts), tremblant – qui sait ? – pour sa réélection qui lui paraissait acquise avant l’épidémie qu’il qualifiait de « canular démocrate », Donald Trump a vu rouge : avec son sens coutumier de la nuance, il a suspendu la contribution des États-Unis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qu’il suspecte de compromission avec les Chinois – preuve que les chiffres servent à tout, y compris, et peut-être d’abord, à faire de la basse politique.
Là où règne la transparence, il y a des plus et des moins. Plus pour l’Italie (21 645 morts) et l’Espagne (18 579). Beaucoup moins en Allemagne (3 569 morts). Enfin, cherchez l’erreur : berceau de l’épidémie, et peuplée de 1,4 milliard d’habitants, la Chine annonce « seulement » 3 346 morts officiels. Même si les files impressionnantes observées à Wuhan pour venir retirer les cendres des victimes incinérées laissent penser que le bilan est bien plus lourd. En début de semaine, les 97 nouveaux cas enregistrés seraient le fait « de personnes arrivant de l’étranger », dixit Pékin. Quant à la Russie, elle comptait à la mi-avril 18 300 cas, mais à peine 300 décès. Vous reprendrez bien un peu de Mark Twain ?
Le puzzle, ça vous pulse !
Par Éric Fottorino
15/04/2020
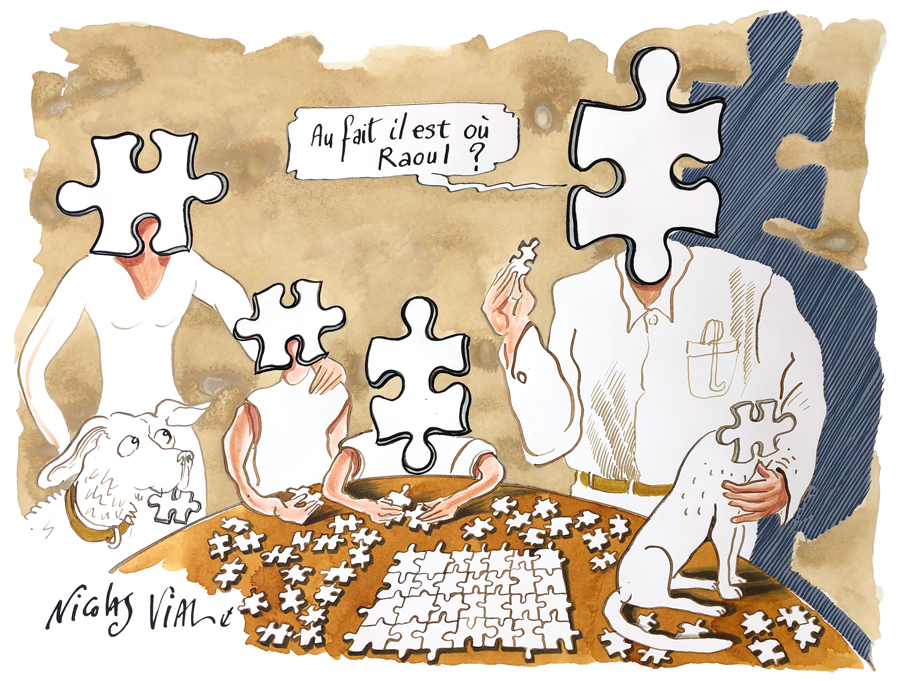
QUI N'A PAS ENTENDU au moins une fois dans sa vie le Tonton flingueur Raoul Volfoni, alias Bernard Blier, débiter sa célèbre tirade : « Je vais lui montrer qui c’est, Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu’on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle » ? Et bien voilà que le puzzle reprend du service aux quatre coins du monde, la faute au confinement de près de 4 milliards de personnes qui, pour ne pas broyer du noir, s’évertuent à remettre dans le bon ordre de petits morceaux de carton colorés. Chez Ravensburger, leader mondial de ces jeux de patience, on n’avait jamais vu ça. Dès la première semaine de cantonnement à domicile, les ventes ont augmenté de 200 % comparées à la même période de 2019. Et même de 350 % pour les modèles adultes, preuve qu’il n’y a pas d’âge pour se casser la tête en s’amusant. Devant cet engouement inattendu – il s’en écoule plus encore qu’à Noël –, le Premier ministre d’Australie Scott Morrison a carrément déclaré le puzzle « activité essentielle », au point d’autoriser les citoyens accros à sortir de chez eux pour s’en procurer. Mais dans quel monde vit-on ?!
Avouons que ce jeu inventé au xviiie siècle par un cartographe anglais qui voulait faciliter l’apprentissage de la géographie ne manque pas d’attraits. Au point de nous faire oublier que le mot puzzle signifie « laisser perplexe ». Des supplices pareils, on en redemande : par sa réalité en miroir brisé, atomisée comme nous dans une solitude partagée, le puzzle nous livre la promesse d’un monde entier qu’il nous appartient de reconstituer. Un paysage, un tableau, une scène d’anthologie, un visage, une nature morte qui sous nos doigts peu à peu reprend vie. En ces temps où nos existences se fissurent, retrouver l’image d’un tout est rassurant. Le puzzle, ça vous pulse ! Et les neurologues vous le diront : la résolution de ces énigmes cartonnées, en 300 ou 1 500 pièces – à vous de choisir – est une formidable gymnastique pour le cerveau. La mémoire, la perception visuelle et spatiale, la rotation mentale qui permet de bien positionner une pièce de puzzle – aucune n’a la même forme –, voilà une stimulation précieuse autant qu’une ouverture bienvenue de nos univers clos. Reste une énigme dont je n’ai toujours pas trouvé la solution : pourquoi certains prononcent-ils « peulze », et non « pezeul », le mot « puzzle » ? Loin de moi l’idée qu’il leur manque une case…
Bonheur danois
Par Éric Fottorino
14/04/2020
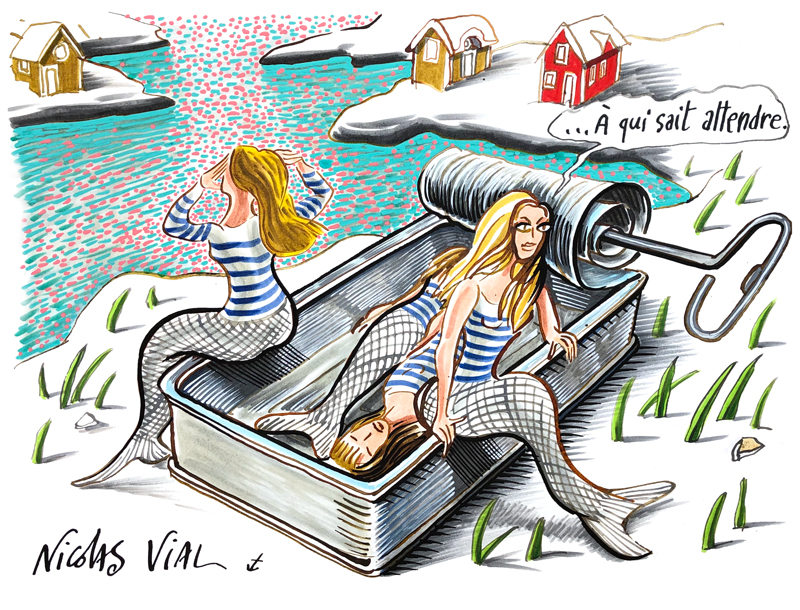
ALORS QUE LE PRÉSIDENT MACRON, comme on s’y attendait, a repoussé au 11 mai notre remise en liberté conditionnelle, il est un petit pays d’Europe qui dès demain mercredi va redonner la permission de sortie à son peuple. Les crèches et les écoles primaires rouvriront pour permettre aux parents de travailler. Si les bars et les restaurants resteront clos, et aussi les lycées (jusqu’au 10 mai), une vie presque normale va reprendre. Excepté dans les stades et les salles de concert – ou même les salons de coiffure ! –, partout où promiscuité rime avec danger.
Le Danemark, puisqu’il s’agit de lui, aurait-il sa martingale pour bouter hors du royaume le coronavirus ? Les chiffres laissent songeur, et un peu rêveur. D’après l’université John Hopkins, on comptait en début de semaine moins de 300 victimes du Covid-19 (295, précisément) sur 6 318 cas, pour une population totale de 5,8 millions d’habitants. Le pays des contes d’Andersen, de la Petite Sirène et de la série Borgen, le pays qui inventa le Lego et le container – signe de son génie de l’adaptation –, bref, le Danemark nous cache-t-il quelque chose ? Mentirait-il, comme on soupçonne que mentent les autorités chinoises ? Ou aurait-il un secret emmitouflé dans ses longs mois d’hiver – même si on nous assure que c’est la chaleur qui assomme le virus ?
Ne cherchez pas davantage. La raison relève du bon sens : le Danemark est composé de Danois. Or, à la différence des Français réputés indociles (pas tant que ça), des Italiens fantaisistes et des Espagnols brouillons (oui, d’accord, on enfile les clichés), les Danois sont disciplinés. La preuve, ils n’ont pas attendu que leur Première ministre, Mette Frederiksen, décide de fermer les frontières (dès le 13 mars) pour s’autoconfiner. Vous avez bien lu. C’est de leur propre initiative qu’ils se sont protégés pour mieux protéger les autres. Et vous avez là éclairci un pan du célèbre bonheur scandinave raconté par Malene Rydahl dans son savoureux petit livre Heureux comme un danois (2014, J’ai lu). Parmi les dix clés de cette félicité, la première se résume à ces mots : « Je ne crains pas mon prochain. » Le Danemark est le pays du monde où les gens se font le plus confiance. Et ont le plus confiance en leurs institutions.
Une humanité sans visages ?
Par Éric Fottorino
13/04/2020

JUSQU’ICI JE NE CONNAISSAIS que deux types de personnes avec des masques. Je ne parle pas des masques de carnaval qu’on portait enfant pour Mardi gras, avec la tête de Donald (le vrai, pas le triste sire de la Maison-Blanche) ou de Mickey, de Laurel et Hardy, ou le loup noir de Zorro, en plastique qui coupait les joues, ou en douce feutrine et côte de velours. Je me souviens qu’au bout d’un moment on transpirait là-dessous, notre souffle confiné embuait nos visages et le masque finissait relevé sur le front pour mieux respirer. Avancer masqué longtemps supposait de ne pas manquer d’air, ou un don pour l’hypocrisie que cultivent beaucoup d’anciens enfants devenus adultes, mais c’est une autre histoire.
Je parlais de deux types de personnes ainsi affublées dans la vie courante avant le Covid-19. Les premières étaient les Japonais en voyage, fidèles à leur tradition de se couvrir le visage qui remonte, dit-on, à la grippe espagnole de 1919. Il est admis chez les Nippons que c’est faire montre de politesse de dissimuler sa figure, et c’est aussi une promesse d’anonymat dans une société sans cesse scrutée par l’œil des caméras. Les seconds porteurs de masques entrés dans nos mœurs, c’était bien sûr les chirurgiens et autres soignants des blocs opératoires, des zones sensibles où les gestes barrières ne datent pas d’hier. Si on cherche bien, on a vu apparaître ces dernières années des cyclistes masqués pour se protéger de la pollution, et des graffeurs de street art cachant leur visage pour ne pas inhaler de substances toxiques et se soustraire à la police… Sans parler de quelques rappeurs et vengeurs masqués, ou violents Black Blocs.
Si l’hygiène obligatoire devait imposer demain le port du masque, comme sur deux-roues celui du casque, nul doute que la mode s’emparera de ces nouveaux objets tendance. Des sites commerciaux exhibent déjà les premiers appendices très stylés. Certains futuristes, avec écran plexiglas articulé à une large casquette à visière. D’autres en chapeaux corolles du dernier chic, genre Audrey Hepburn dans Vacances romaines, avec une sorte de bavoir devant la bouche (beaucoup moins chic).
Mais voilà qui m’arrache soudain une vision d’horreur. Et si demain on ne voyait plus nos visages. Si demain on ne pouvait plus sourire qu’avec les yeux. Si demain, pour sauver l’humanité, nous n’étions plus humains.
Venez à moi, petits agneaux…
Par Éric Fottorino
12/04/2020
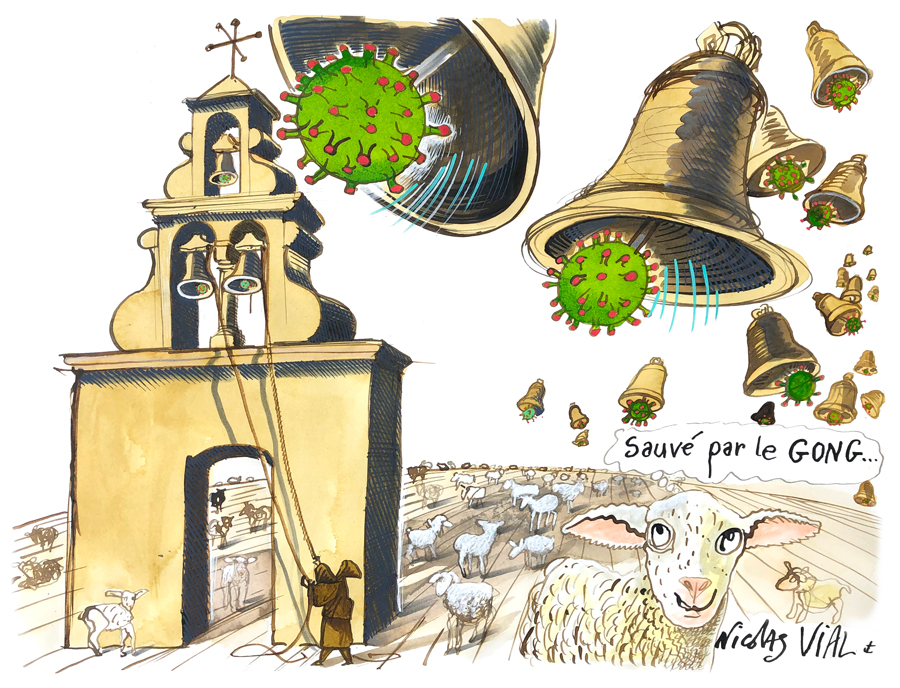
AH MES AGNEAUX ! En ce week-end pascal confiné, nos petites bêtes sacrificielles s’apprêtaient à goûter un répit divin, fondé sur une sorte de décret du ciel pas très catholique, mais providentiel tout de même : pour cause de réclusion chacun chez soi, le Covid-19 promettait d’être le meilleur allié des gentils ovins. L’épidémie envoyait trop d’humains à la mort pour risquer des banquets à haut risque autour d’un agneau gras. Même la Fondation Brigitte Bardot applaudissait des deux mains : « Entre l’interdiction des regroupements familiaux et des cérémonies religieuses en groupe, la fermeture des restaurants et le renforcement des consignes sanitaires dans les points de vente, 500 000 agneaux vont échapper à un abattage synonyme de souffrances inacceptables », lisait-on sur le site officiel de l’ancienne star. Et de préciser en ces termes l’ampleur de la menace que l’épidémie promettait d’écarter : « Le mois d’avril devait signifier une hécatombe pour les agneaux d’élevage français, égorgés sans étourdissementdans les abattoirs du pays pour 80 % d’entre eux. En effet, la Pâque juive (8 avril), la Pâques catholique (12 avril), la Pâques orthodoxe (19 avril) et le Ramadan musulman (du 23 avril au 23 mai) sont concentrés cette année sur une même période. Avec, pour toutes ces confessions, une tradition religieuse d’un autre temps consistant à sacrifier un jeune animal. »
Tradition d’un autre temps ? Agneaux épargnés ? Pas si sûr ! Certes, les journaux se sont fait l’écho du calvaire non pas des cheptels, mais des éleveurs. Titre du Parisien : « La filière de l’agneau souffre dans les Deux-Sèvres » (un département qu’enfant, vivant près de Niort, j’appelais Deux-Chèvres). Des ventes en chute libre de 75 %. Plus assez de bras aux abattoirs pour découper les bêtes. Et la concurrence saignante des agneaux importés de Nouvelle-Zélande avant que tout s’arrête… « Les éleveurs d’ovins en prés-salés vivent un cauchemar », renchérit Ouest-France. Mais à y regarder de plus près, la filière s’est adaptée aux besoins des familles. Puisque les grandes tablées sont remises aux calendes grecques, les professionnels ont proposé des portions plus petites, tranches de gigot, gigot raccourci, ou rôti dans la selle. Pas si sûr que Bardot y ait retrouvé les siens. Dieu si.
Le mystère du Charles de Gaulle
Par Éric Fottorino
11/04/2020
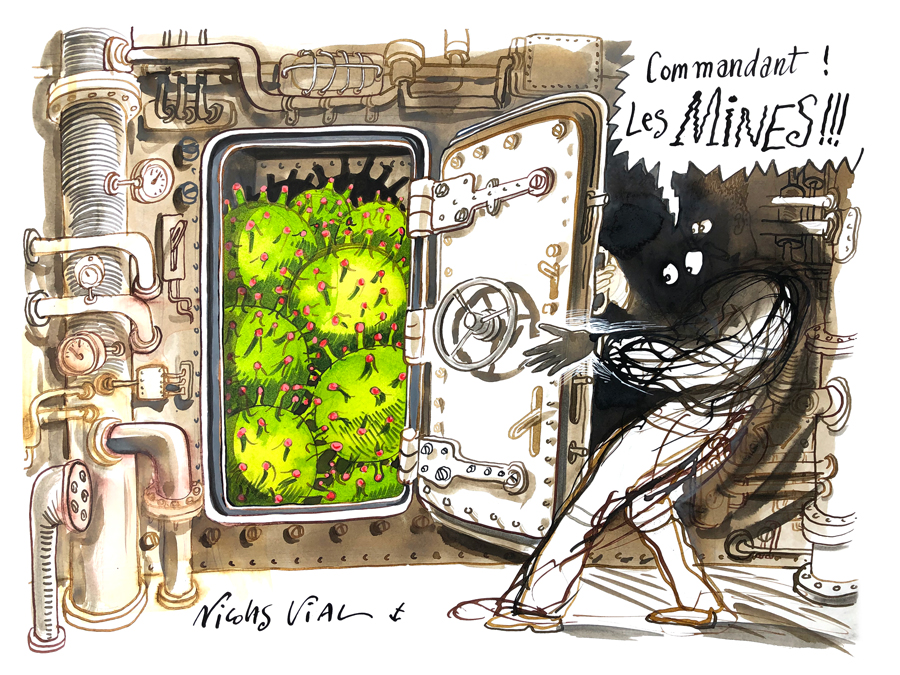
ÇA, C’EST LE POMPON ! Mille milliards de mille sabords, serait-ce un sabotage ? Comment expliquer qu’une cinquantaine de marins du porte-avions nucléaire le Charles de Gaulle se fasse porter pâle pour cause de Covid-19 monté à bord ? Surtout quand le bâtiment n’a plus touché terre, et pareil pour son équipage, depuis le 15 mars. La date du 1er tour des élections municipales, soit dit en passant. Tiens, tiens, se demandent les limiers, y aurait-il un lien de cause à effet ? Mais, que l’on sache, les marins ne se sont pas rendus aux urnes. Alors quoi ? Auraient-ils organisé une fête en catimini avec des autochtones malades sans le savoir, mélangeant allègrement bérets et chapeaux ronds, chansons et postillons, vive les Bretons ?!
Tonnerre de Brest (oui, signalons que ce jour-là, rentrant d’une mission de l’Otan en Atlantique Nord, le Charlymouillait en rade de Brest), voilà un drôle de mystère. C’est d’ailleurs ainsi que la presse qualifie l’affaire. Les gros titres ne parlent plus que de la contamination mystérieuse, ou de l’énigme des cinquante cas positifs suspects. Par quel circuit le virus a-t-il pu s’introduire, alors qu’aucun contact avec l’extérieur n’a eu lieu depuis près d’un mois. Cela signifie-t-il que le Covid peut se déclarer au-delà d’une quatorzaine ?
Parmi les hommes infectés, trois ont dû quitter le navire pour être hospitalisés à titre préventif. « On n’a pas d’explication », constate le capitaine de vaisseau Éric Lavault, alors que des mesures drastiques ont été prises à bord, bâbord et tribord : astiquage en règle des rampes et des poignées de porte, limitation des réunions, et surtout confinement d’une tranche avant du bâtiment pour accueillir les hommes touchés, même s’ils ne présentent aucun symptôme grave de la maladie. Le Charles de Gaulle fait maintenant route vers sa base de Toulon, et si le temps est dégagé, les raisons du mal demeurent plus qu’obscures. Gageons au moins que cette histoire ne finira pas comme celle du porte-avions USS Theodore Roosevelt, qui a accosté début avril en urgence sur l’île de Guam, dans le Pacifique, pour évacuer une partie de son équipage. Son commandant, Brett Crozier, criait haut et fort qu’il n’y avait aucune raison de laisser le virus décimer ses marins. La Maison-Blanche, opposée à pareil débarquement en temps de paix, a limogé l’homme qui voulait sauver son équipage. Ça se passe comme ça, chez Donald.
Raoult au bénéfice du doute
Par Éric Fottorino
10/04/2020
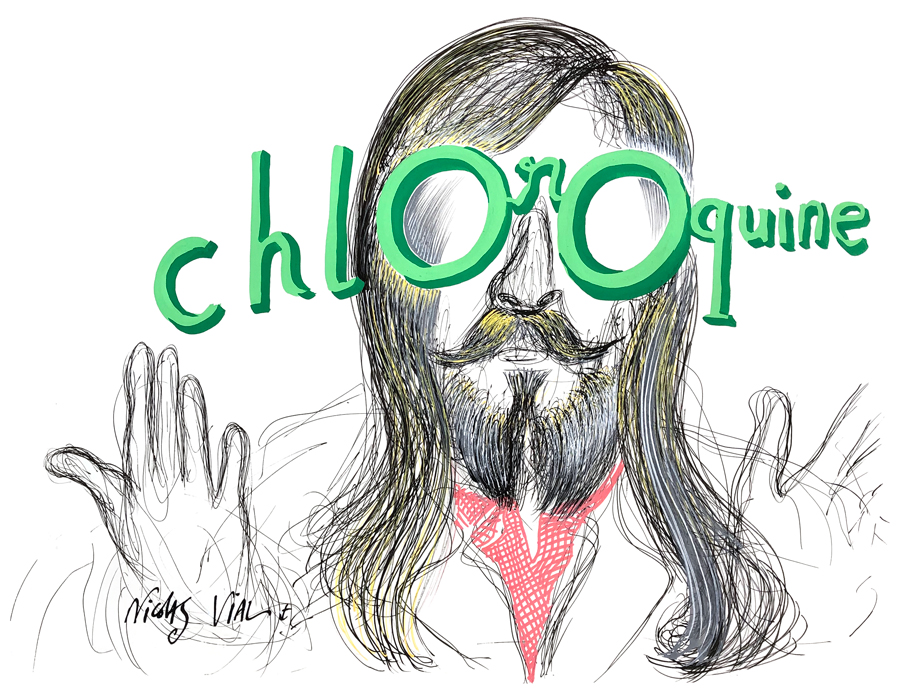
QU’UN SAVANT DE MARSEILLE ait le don de se faire mousser, on ne saurait trop l’en blâmer. Malgré l’ombre tutélaire de la Bonne Mère qui ne baisse pas la garde du haut de sa colline, on ne sait trop à quel saint se vouer face au virus. Alors pourquoi pas tendre l’oreille à cet infectiologue de bonne réputation, n’étaient son allure de druide et ses vanteries dignes d’un Escartefigue faisant passer son « fériboâte » – disons, cette hydroxychloroquine qui enquiquine l’establishment médical – pour un vaisseau des mers ?
À regarder la vidéo où il dit sans ciller : « Je vous assure, je suis un grand scientifique », on est tout de même saisi par les arguments de bon sens de ce professeur qui sort à l’évidence de l’ordinaire. Cherchant les raisons – mais sommes-nous dans le rationnel ? – de toutes les passions qu’il a déclenchées en voulant soigner les malades du Covid-19 avec un antipaludéen, il avance une explication toute simple : lui est un praticien qui continue, depuis quarante-deux ans qu’il exerce ce métier, de consulter les malades. Et les malades, poursuit-il, ne sont pas des objets de recherche. Ils n’espèrent qu’une chose : être soignés.
Face à lui, Didier Raoult voit se dresser la cohorte de ceux « qui ne sont plus médecins », ceux qu’il appelle des « médecins de bureau », et ceux qui, à cheval sur la méthode et le respect des protocoles, se refusent, même en temps de guerre, à combattre un ennemi viral inconnu au bataillon avec un médicament qui pourrait causer des lésions cardiaques aux patients. Si la voie Raoult, comme il le prétend, donne des résultats et désengorge les lits des réas, pourquoi aller chercher des poux à Panoramix ?
Ce n’est pas votre serviteur qui saura trancher dans ce débat scientifique vital, où la suffisance des censeurs masque mal leur ignorance. Que le chef de l’État ait rendu discrètement visite à ce personnage controversé a permis de désamorcer les accusations complotistes du moment. Notamment celle selon laquelle Raoult serait blacklisté pour nuisance aux intérêts pharmaceutiques. Être soutenu par de nombreux médecins généralistes comme par une frange droitière, voire plus, de la classe politique ne lui donne pas raison pour autant. Le professeur marseillais ne mérite ni indignité ni excès d’honneur. Pas de grand raout, mais le bénéfice du doute, pour les patients qui espèrent.
Voyage en chambre
Par Éric Fottorino
09/04/2020

CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT, mines déconfites car reconfinement durci et prolongé, ordre et contrordre… Non content de tuer par milliers, le Covid-19 joue avec nos nerfs. Surtout quand on apprend que nous resterons encore un bail en stand-by. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, on connaît le dicton. Un mois et demi coincés chez nous, voilà que les minutes et les heures se déforment comme prisonnières des montres molles de Dalí, s’étirant à l’infini dans un interminable vertige. Alors, pour ne par perdre espoir, rien de tel que ce texte réjouissant écrit en 1794 par un jeune officier, Xavier de Maistre, mis aux arrêts dans la citadelle de Turin pour avoir combattu en duel.
De ce confinement forcé, le fougueux soldat a tiré des observations malicieuses. « J’ai entrepris et exécuté un voyage de quarante-deux jours autour de ma chambre, nous dit-il. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j’offre une ressource assurée contre l’ennui, et un adoucissement aux maux qu’ils endurent. Le plaisir qu’on trouve à voyager dans sa chambre est à l’abri de la jalousie inquiète des hommes ; il est indépendant de la fortune. » Quant aux malades, assure ce reclus d’autrefois, ils ne pourront qu’apprécier cette aventure confinée : « Ils n’auront point à craindre l’intempérie de l’air et des saisons. » Les poltrons, eux, « seront à l’abri des voleurs ; ils ne rencontreront ni précipices ni fondrières ».
Un voyage dans sa chambre, ni coûteux ni dangereux, on aurait tort de s’en priver, non ? Surtout si, comme ce drôle de pistolet, on marche selon sa fantaisie pour tomber sur quelque objet accueillant : « Lorsque je voyage dans ma chambre, confesse de Maistre, je parcours rarement une ligne droite : je vais de ma table vers un tableau placé dans un coin ; de là je pars obliquement pour aller à la porte ; mais, quoique en partant mon intention soit bien de m’y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façons, et je m’y arrange tout de suite. » Il fallait à cette histoire un bon fauteuil qui nous fasse une bonne chute, confortable à souhait…
À lire, Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, 1795
Un mauvais tour au Tour
Par Éric Fottorino
08/04/2020
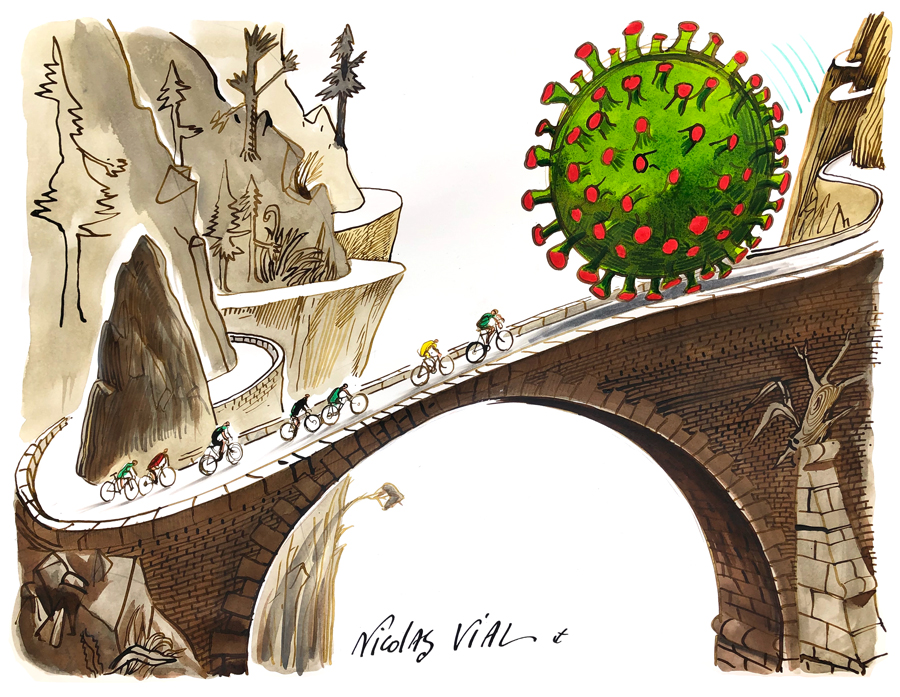
LE TOUR DEVRA-T-IL LUI AUSSI PASSER SON TOUR ? Pour tous les amoureux de cyclisme – et des somptueux paysages de notre pays retransmis en majesté les après-midi de juillet –, pareil coup de tonnerre ne serait rien moins qu’une sévère punition ! Surtout si le confinement s’éternise, et que la télé reste vide à cause du Covid, sans une belle échappée à se mettre sous la dent. Pour trouver une image à la hauteur de cette catastrophe nationale, ce serait l’équivalent du ciel tombant sur la tête de milliers de Gaulois. Un mauvais tour joué au Tour. Et à tous ses fans.
Mais du calme, nous n’en sommes pas là. Aux dernières nouvelles, la Grande Boucle pourrait seulement être reportée à des jours meilleurs. Certains – sans garantie aucune – risquent des dates : du 27 juillet au 16 août. Avec spectateurs au bord des routes ? Le patron du Tour, Christian Prudhomme, l’a dit clairement : l’épreuve ne peut se courir à huis clos. Le monde tournerait en effet à l’envers si une compétition de plein air se disputait confinée, même si par les temps qui courent – façon de parler puisque le temps se traîne plus que jamais – la normalité est devenue aussi rare que les cyclistes sur les routes.
C’est le manager de l’équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot, double vainqueur de Paris-Roubaix à l’époque bénie où un peloton pouvait encore se lancer sur les pavés, qui a eu les mots les plus sages : le Tour oui, à condition que les coureurs puissent s’entraîner au moins dix semaines avant. Avec le report du Critérium du Dauphiné, l’épreuve traditionnelle de préparation des organismes aux bagarres de juillet, la tâche se complique. Il n’y aura ni passe-droit ni tour de passe-passe.
Si la plus grande course cycliste du monde n’a pas lieu en 2020, il faudra admettre que, virus oblige, la France ne sera plus tout à fait la France. Dans l’histoire de l’épreuve, c’est seulement pendant les guerres que la Grande Boucle (« La fête et les jambes », disait Antoine Blondin) s’est arrêtée. À ce jour, il manque onze millésimes sur les tablettes : de 1915 à 1918, puis de 1940 à 1946. C’est en avance sur les autres années – pour cause de Jeux olympiques désormais reportés – que la 107e édition du Tour devait s’élancer de Nice, le 27 juin prochain. Espérons qu’il ne faudra pas attendre cent sept ans pour revoir la vie en jaune.
God Save the Kid
Par Éric Fottorino
07/04/2020

ON POURRAIT SOURIRE UN PEU. Se féliciter par exemple qu’avec le Brexit, les contaminés britanniques du Covid-19 ne viennent pas alourdir le bilan statistique des malades en Europe. Plaisanter sur le fait que l’Angleterre est une île et qu’elle doit le rester, à bonne distance de nos côtes, surtout depuis que son Premier ministre est devenu à lui tout seul un cluster à virus. Il faut reconnaître que ses façons trumpesques, début mars, de prendre le corona pour de la petite bière, serrant des mains à tour de bras, si vous me passez l’expression, tout cela était un brin puéril et irresponsable. Croire, quand on dirige une grande nation, que ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse, est une erreur d’appréciation qui, par ces temps confinés, peut se révéler fatale. Et on reste songeur en pensant que les leaders mondiaux les plus désinvoltes devant l’épidémie, du Brésilien Bolsonaro à BoJo – pour Boris Johnson – à Londres, en passant par l’ineffable Donald de Washington, sont ces meneurs populistes qui croient toujours avoir raison contre et avant tout le monde. Forcés de se raviser d’urgence une fois que leur aveuglement leur a sauté aux yeux…
S’agissant du Premier ministre britannique, à qui on souhaite sérieusement de sortir des soins intensifs et de guérir, on pense à ce mot du poète-philosophe Novalis : « Non seulement l’Angleterre, mais tout anglais est une île. » Si nous sommes prêts à chanter un God Save the Kid (reconnaissez que Johnson fait figure de sale gosse comparé à « Queen Elizabeth »), on est saisi par la dignité à toute épreuve de la souveraine. En s’adressant à son peuple pour la cinquième fois de son long règne, vêtue d’une robe vert espoir, elle a su trouver les mots pour donner force et courage aux siens, évoquant la résilience de son pays lors du Blitz de 1940-1941, quand l’Angleterre ployait mais ne cédait pas sous les bombes nazies.
Et dans une légère poussée de fièvre, sans doute psychosomatique en ces temps de Covid-19, on s’est pris à rêver à front renversé : pour réussir cette unité européenne qui une fois encore nous fait tant défaut, n’est-ce pas une reine d’Angleterre qu’il nous faut ?
L’Arrache-cœur
Par Éric Fottorino
06/04/2020

LORSQUE LE MOMENT SERA VENU – ce n’est pas demain la veille – de dresser la liste des bouleversements qu’aura provoqués dans nos vies l’épidémie de Covid-19, sans doute faudra-t-il revoir nos hiérarchies et toutes les échelles de valeurs de notre société technicienne et dématérialisée. Le président Macron s’était distingué par son expression malheureuse des « premiers de cordée », désignant ceux qui ont réussi, censés tirer – comme un fardeau ? – les autres, les moins performants, les moins utiles à la croissance nationale, les moins contributeurs au produit intérieur brut, juge de paix souvent critiqué de la richesse d’un pays.
Le coronavirus aura remis les pendules à l’heure et chaque chose à sa place. Comprenez que les soignants, les enseignants, tous ceux qui nous nourrissent, des paysans aux maraîchers en passant par les commerces de proximité, tous ces métiers injustement négligés, et souvent mal considérés, et plus mal rétribués encore, auront remonté dans l’estime du corps social. Et que dire des caissières – qui payent leur tribut à la maladie en s’exposant chaque jour – ou des livreurs à domicile, si souvent rémunérés au lance-pierre, quelques euros la course, une misère en guise de salaire de la peur ? Si nous n’oublions rien après, il sera temps de réévaluer la grille des priorités, et des revenus, afin de reconnaître à leur vraie valeur les véritables premiers de cordée. L’épidémie comme révélateur, comme moment de vérité. Comme retour à l’essentiel.
Mais voir le virus en justicier de la condition humaine serait aller vite en besogne. Car, c’est un fait, ses victimes sont massivement des personnes âgées déjà affaiblies qui succombent à ses assauts. Les témoignages affluent de ces détresses respiratoires insoutenables, où les victimes prises à la gorge succombent avec une terrible sensation de noyade. Et puis il y a ce discours sans cesse répété, qui angoisse les plus de 70 ans : « Vous ne serez pas prioritaires. » Nos anciens, ceux qui ont leurs sièges réservés dans les transports en commun, ceux à qui on cédait volontiers sa place dans la vie de tous les jours (pour peu qu’on soit un minimum attentionné), voilà que le Covid-19 les a relégués dans cette sinistre « foire aux vieux » qu’avait imaginée Boris Vian. Le roman s’appelait L’Arrache-cœur.
Insécurité alimentaire
Par Éric Fottorino
05/04/2020

UN VIEUX DICTON DE LA SAGESSE POPULAIRE – mais le peuple fut-il jamais sage ? – dit que notre aliment doit être notre médicament. Que manger sainement nous protégerait du mal, autant que les prières pour les croyants. Après que la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a tenu ces propos rassurants : « Les Français peuvent dormir tranquilles. Il n’y a pas de pénurie alimentaire ?», le doute m’a gagné. Non pas que nous ayons à craindre de manquer dans l’immédiat et au-delà. Mais le cri d’alarme lancé par un collectif de personnalités sur l’insécurité alimentaire qui nous menace (à lire ici en exclusivité) a semé le doute dans mon assiette.
Que nous disent-ils, le sociologue Edgar Morin, l’ancienne ministre Corinne Lepage, le philosophe Dominique Bourg, les cinéastes Coline Serreau et Cyril Dion, les élus Delphine Batho et Yannick Jadot, pour ne citer qu’eux, réunis autour de l’agriculteur Philippe Desbrosses, connu pour son action environnementale de longue haleine ? Leur message est simple : grande nation agricole, la France ne suffit plus à la France. Peut-elle nourrir sa population ? « Non », répondent les auteurs : « notre système alimentaire dépend d’importations de soja américain et brésilien (faute de protéines végétales cultivées), de matières premières (dont les énergies fossiles et les phosphates), et de fruits et légumes (des milliers de camions par jour nous apportent les denrées agricoles des pays du Sud). Aujourd'hui, moins de 2 % de notre surface agricole utile produit des fruits et légumes, alors qu’il en faudrait 10 % ! »
Si on ajoute qu’une ferme disparaît en France toutes les 26 minutes, que près de 11 millions d’agriculteurs ont été chassés de la terre depuis les années 1960 au nom de la modernité, que les sols arables se rétrécissent comme peau de chagrin sous les assauts de l’urbanisation, on voit poindre le danger. Derrière la crise sanitaire sourd une crise alimentaire. Le triomphe fatal du lointain et de l’intensif chimique, là où il faudrait du proche et de l’humain. Si nous voulons empêcher cette agriculture sans paysans qui artificialise les terres et fragilise l’homme, alors il est temps de se retrousser les manches et d’agir. Pour que se nourrir ne soit pas une autre façon de mourir.
Vive les vacances !
Par Éric Fottorino
04/04/2020

C’EST UNE PETITE COMPTINE de l’enfance qui me revient ce matin comme le soleil brille de nouveau :
Vive les vacances
À bas les pénitences
Les cahiers au feu
Et les maîtres au milieu !
Comme nous l’avons repris en chœur, ce refrain mutin qui annonçait les grands départs, la liberté sine die, farniente et insouciance, mais oui, mais oui l’école est finie… bye bye, sacré Charlemagne qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école… Entendant à la radio que les congés scolaires de Pâques commençaient ce samedi pour la zone C – comprenez les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse –, le surréalisme de la situation m’a sauté aux yeux. D’autant que notre ado de 16 ans confinée à la maison ne cachait pas sa déception : que sont des vacances sans départs en vacances ? Que sont des congés quand on ne peut même pas aller marcher ? Ça nous fait les pieds, de ne même pas pouvoir s’en servir ne serait-ce que pour aller retrouver des copines ou un amoureux transi… Fichue semaine des quatre jeudis, où c’est tous les jours dimanche.
Réflexion faite, sans doute eut-il mieux valu reporter cette trêve crève-cœur à des jours meilleurs. Et garder nos enfants concentrés devant leurs écrans où ils enchaînent leçons de français (Le Mariage de Figaro, pour notre fille qui est en première) et de SVT, cours d’anglais et de dessin, d’histoire et même de chant. Car, s’il faut applaudir sans réserve tous les soignants de ce pays, les enseignants méritent à l’évidence un grand coup de chapeau. À ce sujet, on est d’ailleurs un brin surpris d’entendre tant de parents sur les réseaux sociaux saluer le mérite des professeurs, comme s’ils découvraient les exigences, grandeurs et servitudes de ce métier ! Force est de reconnaître que leur capacité à s’adapter pour fournir aux élèves un enseignement de qualité, assidu et varié, est admirable. Pour ceux qui en doutaient, transmettre et partager un savoir est une vocation largement répandue dans l’Éducation nationale, et des maîtres et maîtresses pour les plus jeunes aux profs de lycées préparant les grands, c’est une solide chaîne de solidarité qui s’est mise en place. N’étaient les difficultés rencontrées par les enfants les plus démunis pour disposer d’un ordinateur – les inégalités n’ont pas disparu d’un coup de baguette magique –, on pourrait croire qu’il n’y a pas une ombre au tableau noir…
Rungis de profundis
Par Éric Fottorino
03/04/2020

IL NE FAUT PAS CROIRE que les jours de confinement se suivent et se ressemblent. Confinés supportant de l’être le lundi, confinés déconfits le mardi. Et ce qui vaut pour nous vaut pour certains lieux gais le matin et pas si gais le soir, comme dans la tirade du pinson de Prévert, souvenez-vous :
Le pinson n’est pas gai
Il est seulement gai quand il est gai
Et triste quand il est triste ou ni gai ni triste.
Le grand marché de Rungis, avant le virus, était plutôt gai pour qui aime à humer tôt matin les nourritures terrestres, fruits et légumes de nos campagnes, vins de nos terroirs, viandes d’appellation contrôlée, bars de haute mer et crustacés (ou mangues par avion, mais pour combien de temps encore !), dans la chaleur humaine des travailleurs de l’aube. La perspective de voir se fermer le ventre de Paris comme la plupart de nos marchés de plein air ne réjouissait personne. Mais le 1er avril – juré, ce n’était pas un poisson farceur –, on apprenait avec délice qu’une plateforme numérique baptisée fort à propos « Rungis livré chez vous » allait permettre aux accros d’Île-de-France de faire leur marché en ligne, avec port à votre porte d’un panier de produits frais. « Nous sommes les taxis de la Marne de la guerre contre le coronavirus ! » se réjouissait un rien lyrique Stéphane Layani, heureux président du MIN (marché d’intérêt national), une fois l’accord conclu avec la région. Nous rappelant au passage, ignares que nous sommes en géo, que Rungis se trouve bien en Val-de-Marne.
« La joie venait toujours après la peine », promettait Apollinaire sous le pont Mirabeau. Mais, à Rungis, c’est la peine qui a pris le pas dès le lendemain quand le préfet de police a réquisitionné un bâtiment réfrigéré pour le transformer en morgue. La nouvelle a jeté un froid et, d’un coup, le MIN a eu bien mauvaise mine. Rungis de profundis. Tristesse des familles endeuillées face à cette vision d’une mort en vrac, Dieu, espérons, y reconnaîtra les siens. Tristesse, ou fatalisme, de voir confondus les frais appâts de la vie et les ultimes appareillages du trépas.
Un mal pour un bien
Par Éric Fottorino
02/04/2020

« L’ÉTAT, C’EST MOI », aurait dit le roi Soleil. « L’État, c’est moins », ont répété sur tous les tons les néo-libéraux, depuis Ronald Reagan et Margaret Thatcher… Me revient cette caricature ancienne opposant le Grand Timonier chinois à De Gaulle. « Mao », disait l’un, « Moâ » répondait l’autre. Ramener l’État à un seul homme est un danger dont bien des peuples souffrent encore…
Mais si on se réfère au passé, la période de pandémie que nous traversons pourrait aussi se révéler un mal pour un bien – au plan institutionnel, cela s’entend. Il suffit de lire ce que nous dit ce penseur de premier ordre qu’est Pierre Rosanvallon dans le 1 de cette semaine. Pour l’auteur de La Crise de l’État-providence (1981), c’est moins l’État-nounou qui doit reprendre du service que l’État hygiéniste, apparu après les deux grandes épidémies de choléra survenues, on l’a oublié, en 1832 puis en 1849.
Dans un souci de protéger l’ensemble de la population, la Seconde République de Louis-Napoléon Bonaparte créa des comités non pas de salut public mais de salubrité publique. Assainir les logements les plus vétustes était une urgence vitale. Ce qui fit dire à Martin Nadaud, modeste maçon de la Creuse devenu député républicain socialiste : « Je crois que l’apparition du choléra dans notre vieille Europe, au lieu d’avoir été un malheur, a été un grand bienfait. Sans le choléra, en France comme à Londres, je doute que les pouvoirs publics eussent jamais songé à porter la pioche dans les quartiers pauvres. »
Que fera l’État hygiéniste de 2020 ? Où portera-t-il la pioche, pour quelle cause supérieure mettra-t-il la main à la poche ? Rosanvallon répond sans détour : « Les sorties d’épreuves collectives, rappelle-t-il, se sont toujours opérées à travers des formes nouvelles de solidarité. Pour ma part, je n’imagine pas qu’à la sortie de cette épreuve, il n’y ait pas un grand impôt de solidarité nationale. » Et d’enfoncer le clou : « Cela ne pourra se faire sans contribution majeure et massive de ceux qui ont les patrimoines les plus importants. » On conseille au chef de l’État une posologie sous forme de chanson pour faire passer la pilule. Du courage, par exemple, le titre impérieux de la Grande Sophie !
Un soupçon de bonheur
Par Éric Fottorino
01/04/2020
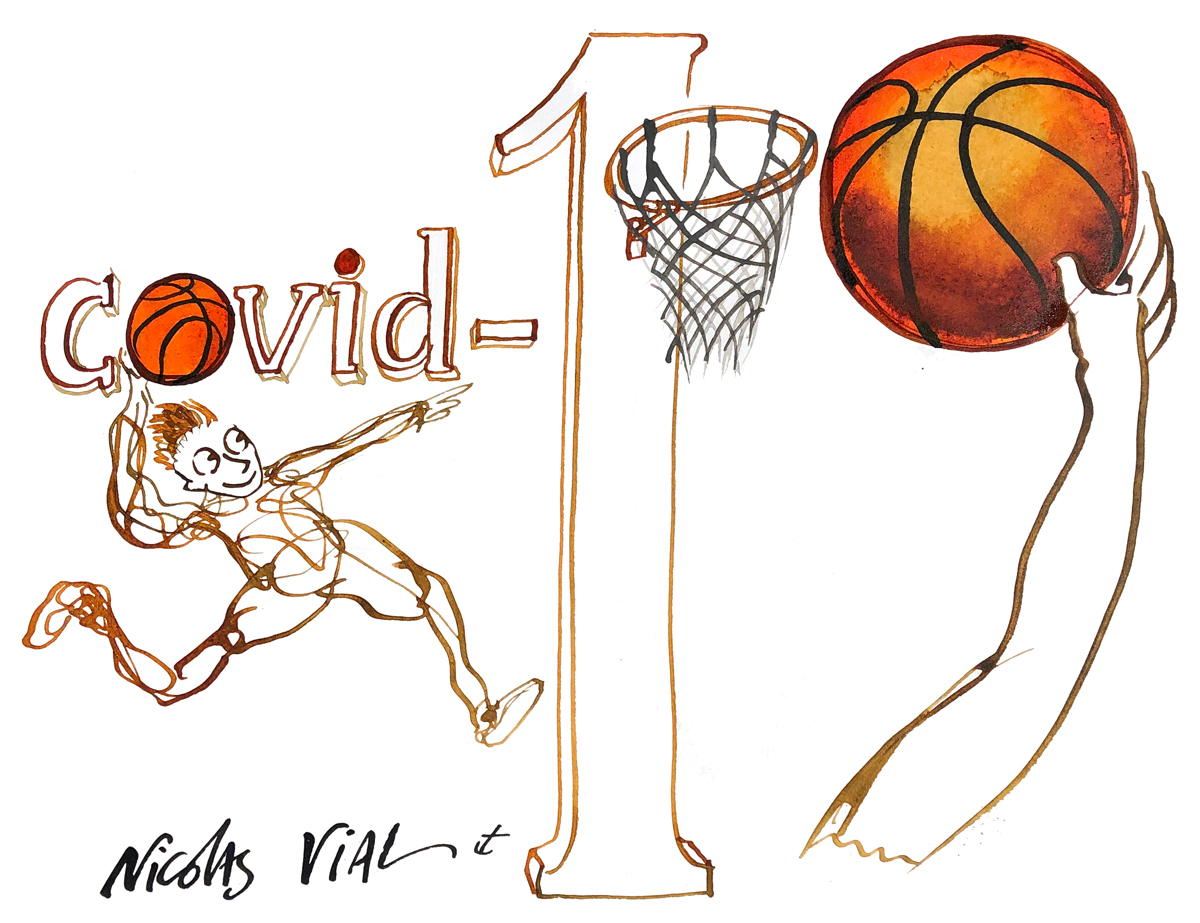
HIER, MARCHANT PRÈS DE CHEZ MOI dans le respect des consignes, un bruit inhabituel m’est parvenu d’une cour voisine. En m’approchant, j’ai reconnu les rebonds sonores d’un ballon de basket contre le sol bitumé, et c’était comme un cœur qui battait la chamade au milieu du quartier silencieux. Un signe de vie. Le nez collé à la grille j’ai vu deux hommes, ou plutôt un adulte et un ado, un père de dos et le gamin face à lui, qui tentait de le dribbler. Le père se tenait très droit, les bras écartés pour couper à son fils le chemin du panier. Ils étaient très près l’un de l’autre, moins d’un mètre c’est sûr, mais les confinés d’un même lieu et d’une même famille ont ce privilège de la proximité.
J’ai passé mon chemin pensif en me demandant si ces deux-là avaient l’habitude de jouer ensemble, ou si ce duel pacifique, gros ballon orange au bout des doigts, était un avantage collatéral de l’étrange période que nous vivons. Sur le visage du garçon – je n’avais vu que la nuque du père –, se lisait autant le plaisir du jeu que le désir de feinte. Il était visiblement heureux de cet instant où, à l’évidence, il ne pensait ni au virus, ni au danger flottant dans l’air, ni à la mort qui fait ses courses tout près de nous, invisible et sournoise. Il n’avait d’autre obsession souriante que d’échapper aux bras paternels pour marquer deux points. Il serait bien temps, dans la soirée, d’apprendre que le Covid-19 avait fait carton plein et battu son macabre record, 499 victimes en vingt-quatre heures, sans compter, au Sénégal, un amoureux d’un autre ballon rond, l’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf.
De retour chez moi, j’ai ouvert un document envoyé par Benoît, mon médecin généraliste, lui-même touché par le virus. J’ai découvert le titre, Petit guide pratique du confiné, rédigé ces jours-ci sous la direction de la psychologue Mélanie Lafond. Après l’inventaire de tous les désordres anxieux que provoque normalement notre situation de confinés (irritabilité, insomnie, difficulté de concentration, indécision, résignation…), je suis tombé sur ce passage qui aurait ravi mes deux basketteurs. « Que l’on soit directement confronté au virus ou pas, il est normal de ressentir de la joie, un soupçon de bonheur au cours de nos journées. »
Épidémie de surveillance
Par Éric Fottorino
31/03/2020

TOUS LES COUPS seraient-ils permis ? Les coups d’essai, les coups bas, les coups d’État en douce, l’air de rien, comme inévitables concessions à la misère des temps. Ah ! il a bon dos le Covid-19 ! Sous couvert de l’éradiquer, certains dirigeants peu regardants sur les libertés individuelles se sentent pousser des ailes d’aigles royaux pressés d’enserrer leur peuple. Violant les droits les plus élémentaires pour cause supérieure d’urgence sanitaire. Il faut dire qu’ils sont à bonne école quand ils tournent leurs regards vers Pékin. L’épidémie de coronavirus a déclenché une épidémie de surveillance à grande échelle. Et si le président Xi Jinping peut se targuer d’avoir vaincu le danger (un triomphalisme suspect, vu le nombre réel de victimes maintenu secret), c’est en menant sa population à la baguette. Machiavel n’est pas mort. La fin justifie toujours les moyens.
Le philosophe italien Giorgio Agamben a fait mouche avec ces phrases parues ces jours-ci dans Le Monde : « Je ne suis pas le seul à penser, dit-il, que pour un gouvernement totalitaire comme celui de la Chine, l’épidémie a été le moyen idéal pour tester la possibilité d’isoler et de contrôler une région entière. Et qu’en Europe l’on puisse se référer à la Chine comme à un modèle à suivre, cela montre le degré d’irresponsabilité politique dans lequel la peur nous a jetés. » Premier à se glisser dans la brèche, ce forban d’Orban s’est arrogé lundi les pleins pouvoirs pour une période illimitée. Un régime d’exception qui suspend toutes les élections et permet au chef populiste hongrois de gouverner par décret. « Monsieur le Premier ministre, lui a demandé un député socialiste, c’est le virus ou c’est nous, l’opposition, que vous voulez éliminer ? » Viktor imperator a suavement répondu qu’il était prêt à rendre le pouvoir au parlement (qu’il contrôle aux deux tiers) dès que celui-ci le demanderait. « Je m’inquiète pour les Roms, pour la communauté juive, pour la presse et pour toute une génération de jeunes », a aussitôt tweeté Jacob Labendz, le directeur du Center for Judaic and Holocaust Studies de Youngstown State University (Ohio). La voix de Jacques Delors, devenue si rare, s’est aussitôt fait entendre comme sonne le glas. Le manque de solidarité, a averti l’ancien président de la Commission de Bruxelles, « fait courir un danger mortel à l’Union européenne ».
Le soleil des mourants
Par Éric Fottorino
30/03/2020
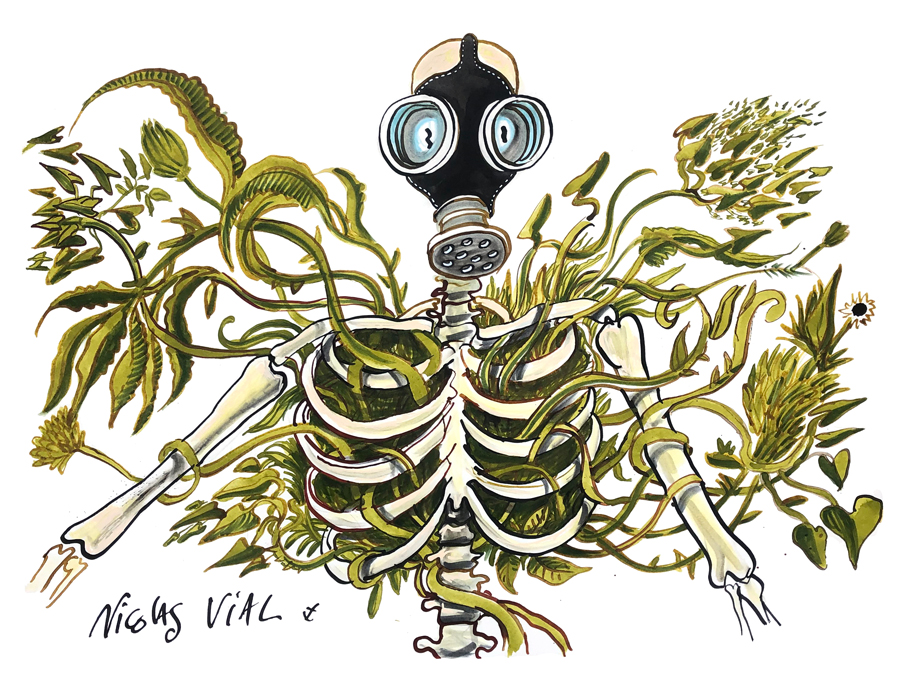
DE CETTE PREMIÈRE QUINZAINE DE CONFINEMENT, on se souviendra qu’il faisait beau. Presque trop beau même. Un soleil insolent planté de bon matin dans un ciel bleu immaculé. Et quand des nuages auront tenté d’assombrir le tableau, le vent par bourrasques se sera chargé de les éloigner. À ceux qui vivent dans un environnement verdoyant, en banlieue ou à la campagne, et même à proximité des cimetières, ce temps printanier aura offert le spectacle des fleurs nouvelles tout juste écloses, féerie blanche des arbres fruitiers, magnolias aux calices roses, branches jaune vif des forsythias. Sur les chemins, les promeneurs auront rencontré non loin de chez eux les premières jonquilles, le mauve des lilas, le fanal rouge des coquelicots émergeant parmi les touffes d’herbe d’un vert tendre digne des Renoir les plus bucoliques. Pâquerettes et pissenlits, parfum dans l’air des orangers du Mexique et des buis, taches colorées des tulipes et des iris. Un jardin d’Éden à la taille d’un pays ou presque. Excepté pour les reclus nombreux des cités, des prisons, les loin de la lumière.
Oui, on se souviendra qu’il faisait beau, et que les oiseaux chantaient à tue-tête, ivres de joie et de liberté. On n’entendait qu’eux dans le ciel puisque les avions s’étaient tus, et les autos, et les motos, sans parler des humains confinés à qui le virus avait cloué le bec. À Acy, dans les Hauts-de-France, on a signalé les vols en looping d’hirondelles rustiques revenues d’Afrique. Sous d’autres cieux, on a vu des bêtes sauvages parcourir tranquillement les villes confinées, un sanglier visitant les rues de Barcelone, un puma dans un quartier de Santiago du Chili, un loup solitaire sur les pistes de ski de Courchevel. Le carnaval des animaux.
Comme elles nous semblent irréelles, ces images idylliques d’une nature qui reprend ses droits. Quand à la nuit tombée nous laissons entrer la réalité télévisée, ce ne sont plus qu’urgences et réanimations, bilans des morts de la journée et inquiétudes pour la suite, en redoutant le pic de l’épidémie. Ce soleil dominateur n’est qu’un leurre. C’est « le soleil des mourants » de Jean-Claude Izzo, ce grand auteur de polars disparu trop tôt. Il fait beau et froid. Et le soleil est noir.
Coronavirusse
Par Éric Fottorino
29/03/2020
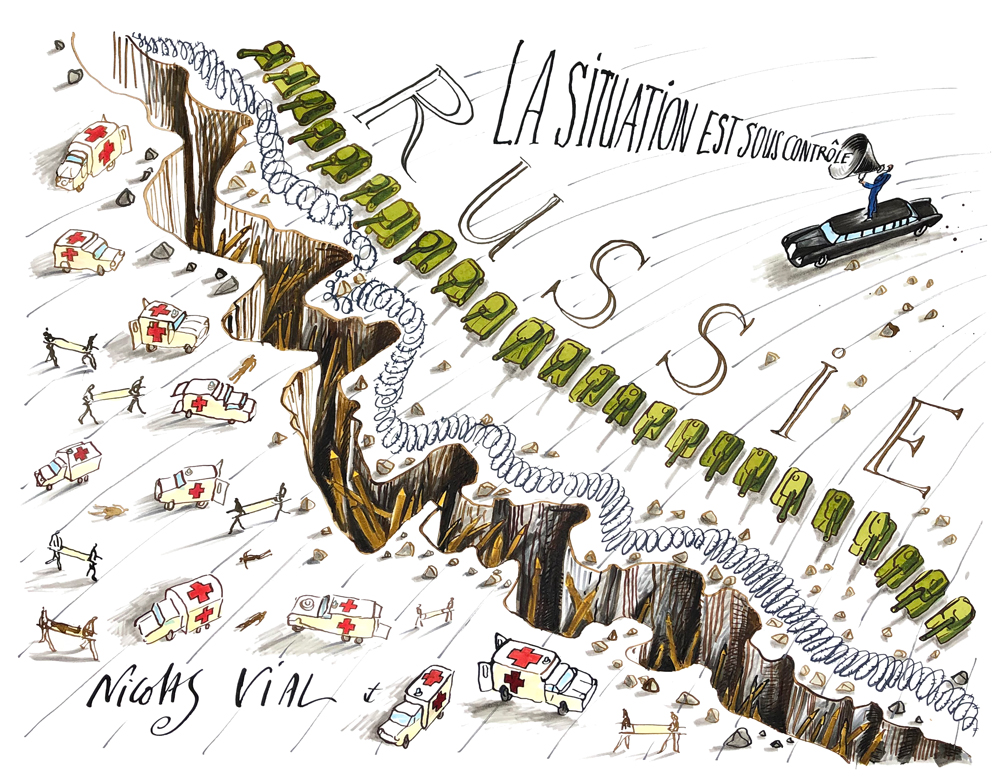
LÀ-BAS, TOUT VA BIEN. Enfin, c’est ce que disent les satisfecit de la place Rouge. De quelle ruse use donc le pouvoir russe pour estourbir le virus ? De la propagande, bien sûr ! La bonne vieille propagande – la même dont jadis nous abusâmes quand un fameux nuage mortel échappé de Tchernobyl s’était sagement confiné derrière nos frontières pour nous épargner. Sur le front russe du Covid-19 et autres SRAS, R.A.S. ! C’était du moins la vérité assenée jusqu’à ces jours derniers, lorsqu’un Poutine droit dans ses bottes prétendait que chez lui tout était sous contrôle, avec à peine 500 cas avérés et seulement trois morts. Les Russkovs plus forts que les Ritals. Par quel miracle la grande Russie surclassait-elle, au hasard, le petit Luxembourg ? Le peuple avait-il baisé en masse la croix de l’ordre de Saint-Vladimir ? Dans un pays qui longtemps préféra le sinistre Lyssenko au bon docteur Jivago, on pouvait s’interroger sur la fiabilité des diagnostics médicaux signalant une flambée de pneumonies, mais cherchant en vain les victimes du coronavirus.
La semaine dernière, la musique a toutefois varié d’un ton avec le millième cas officiel de Covid-19. En père soucieux de son peuple, Poutine a décrété une semaine de congés payés pour les travailleurs, et prôné enfin le confinement. Il a même reporté au 22 avril le vote sur la réforme constitutionnelle qui doit faire de lui un Russe couronné à vie, bien mieux qu’un coronavirus. « Un collègue pense que nous nous débarrasserons du Covid en deux ou trois mois, a-t-il crânement affirmé. Ce sont de bonnes prévisions. Mais pour ce qui est de la date à laquelle nous sortirons vraiment de cette situation – et nous en sortirons à coup sûr – j'espère que cela se produira encore plus tôt. » On vous le dit, l’âme russe, c’est autre chose que le Trump Circus. Le tsar Poutine veut renvoyer l’image d’un pays sain (ou saint ?) qui aide son prochain, d’où ces cartons d’équipements sanitaires envoyés en Italie avec cette étiquette très 007 : « From Russia with love. » Quant à la transparence, popularisée autrefois par Mikhaïl Gorbatchev sous le nom de glasnost, elle attendra des jours meilleurs.
Le poumon, le poumon…
Par Éric Fottorino
28/03/2020

ON NE SAURAIT DIRE SI LE CORONAVIRUS – qui doit son nom à sa méchante couronne de particules – a une gueule d’atmosphère. On sait en revanche qu’il ne manque pas d’air pour étendre son emprise sur la planète, semant la panique partout où il passe en prenant ses victimes à la gorge. Ce n’est pas un hasard si la lutte ultime contre ses assauts meurtriers se livre avec des respirateurs devenus indispensables dans les services de réanimation. L’image de poumons attaqués par le Covid-19 fait peur à voir, et on comprend que sans machine à oxygène, les malades en phase critique succombent à une détresse respiratoire aiguë. Les tissus alvéolaires deviennent opaques, l’échangeur air-sang se grippe, les organes vitaux cessent d’être alimentés. C’est l’asphyxie générale. Sinistre scénario qui donnerait raison à Molière et à la servante Toinette, quand, déguisée en docteur, elle assénait au Malade imaginaire : « C’est du poumon que vous êtes malade » !
Le poumon, le poumon… Celui de la planète semble aller beaucoup mieux et ce n’est pas le moindre paradoxe de cette épidémie. Le Covid-19 étouffe les humains en même temps qu’il permet à notre vieille terre de mieux respirer. Comme s’il préférait le monde aux hommes. Mais n’allons pas prêter une intention à ce virus, comme le font certains illuminés du complotisme ou les prophètes de la vengeance divine façon Philippulus dans L’Étoile mystérieuse, annonçant la fin du monde aux cris de « C’est le châtiment ! » Force est pourtant d’admettre que, ces temps-ci, les cartes satellites sont plus rassurantes que les radios pulmonaires des malades. La grande panne d’activité aurait déjà provoqué en Chine un recul de 25 % des émissions de CO2, soit l’équivalent des deux tiers de ce que rejette la France en une année ! Et ce n’est pas fini. Partout ou presque s’arrêtent les avions de ligne, les autos, les usines. Un chercheur de Stanford, Marshall Burke, affirme même que le nombre de vies sauvées par la chute de la pollution dépassera le nombre de victimes du virus. Là, on a besoin de respirer un grand coup. Avec une petite blague bien à-propos venue d’une Irlande tout juste confinée. Un peu d’Eire, dit-on là-bas, ça fait Dublin !
Clé des champs
Par Éric Fottorino
27/03/2020
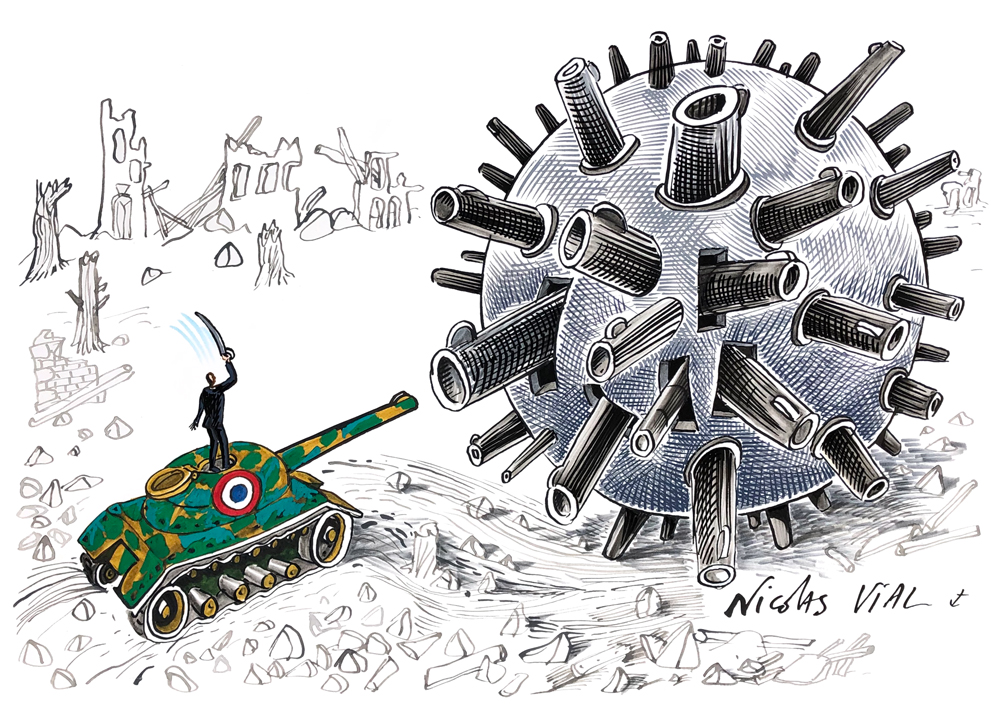
LA MÉTAPHORE GUERRIÈRE A SES LIMITES. Passe encore que le président, lors de son discours du 16 mars annonçant le confinement général, martèle de façon martiale que nous sommes en guerre. Il est dans son rôle de chef de l’État et de chef des armées face à une attaque sans précédent, aussi déroutante et dangereuse que l’ennemi est invisible. Si certains peuvent légitimement se sentir en guerre, ce sont d’abord les bataillons d’hospitaliers et de soignants qui, jour et nuit, sans répit ni repos, sauvent des vies. Mais lorsque le ministre des paysans Didier Guillaume lance un appel solennel à « l’armée de l’ombre des hommes et des femmes » privés d’activité pour cause de Covid-19, les invitant « à rejoindre la grande armée de l’agriculture française », le trait guerrier est inutile. Tout ne peut être chargé d’analogies militaires, avec le subliminal de la Résistance et de l’armée des ombres. Sauf à désigner demain, qui sait, des collabos face au virus, comme le laissent déjà craindre les plaintes de collectifs déposées contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn, afin qu’ils soient traduits devant la Cour de justice de la République pour « mensonges d’État ». Rien que ça.
On peut aussi regretter les paroles malheureuses de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, quand elle déclare comme une fleur : « Nous n’entendons pas demander à un enseignant qui aujourd’hui ne travaille pas compte tenu de la fermeture des écoles de traverser toute la France pour aller récolter des fraises. » Si elle n’est pas si bête, Sibeth, est-ce alors par simple maladresse qu’elle déclenche l’ire des profs s’échinant à ne pas lâcher leurs élèves dans la nature ?
Passons pour ne pas passer à côté de l’essentiel. Car c’est ingénieux de proposer aux rats des villes désœuvrés de prendre la clé des champs. Une révolution culturelle à la chinoise, sans propagande ni massacres, pourquoi pas ? D’autant que les saisonniers étrangers, bloqués aux frontières, ne viendront pas dans nos campagnes. « Nous avons besoin de 200 000 personnes dans les trois mois qui viennent », alerte la présidente de la FNSEA Christiane Lambert. Se confiner au vert et toucher de plus près aux dures réalités du monde paysan, l’idée vaut son pesant d’asperges. Pas besoin de l’imposer manu militari !
Perte de sens
Par Éric Fottorino
26/03/2020

AGUEUSIE, a privatif pour désigner la perte, gueusis, du grec ancien, pour désigner le goût. Bon sang, mais c’est bien sûr ! Je savais que ce mot ne m’était pas inconnu avant qu’il ne surgisse brutalement dans l’actualité comme symptôme possible du Covid-19, flanqué de son compère anosmie, ou perte de l’odorat. L’agueusie, c’est le mal qui frappe Charles Duchemin, alias Louis de Funès, à la fin du film de Claude Zidi L’Aile ou la cuisse – j’espère que vous me suivez. Confronté, lors d’un duel télévisé, à l’ignoble Tricatel qui sert à sa clientèle des plats infâmes, le père des guides Duchemin est frappé d’une sévère agueusie qui menace de le ridiculiser. Tout ce qu’il mâche est du carton. Il ne fait plus la différence entre sucré et salé, amer et acide. La cata ! Voilà pourquoi l’agueusie avait laissé dans mon cerveau une légère trace mnésique réveillée par l’épidémie. À la perte de goût qui peut accompagner l’infection au coronavirus, s’ajouterait encore la panne d’odorat dont témoignent certains malades qui ne sentent ni l’odeur du café matinal, ni le parfum de leur shampoing, ni encore le fumet caractéristique d’une couche de bébé remplie…
Sur nos cinq sens, deux sont déjà perturbés par le virus aux allures d’enzyme glouton. Mais, non content de s’attaquer à notre perception des saveurs et des senteurs, cet insatiable nous interdit de toucher quoi que ce soit, même notre propre visage. Surtout quand on sort de son confinement pour une courte balade. Touche pas ci, touche pas ça, la civilisation du sans contact fait des bonds de géants. Le résultat est là : nos sens sont sens dessus dessous. Car pour la vue ce n’est pas mieux. Le Covid n’est pas une « défense d’y voir », mais il limite à ce point nos horizons que nos yeux jouent aux quatre coins entre quatre murs, avec pour seules échappatoires ces ersatz du réel appelés écrans. Notre champ de vision se rétrécit, comme s’appauvrit notre ouïe qui, entre deux chanteurs de balcon, entend surtout le silence. Mais de cette perte de sens surgira peut-être intact, tout neuf, quand l’épidémie sera finie, un sixième sens. Le sens d’une vie pleine de sens. Qu’il appartiendra à chacun de retrouver. Ou d’inventer.
Trump-la-mort
Par Éric Fottorino
25/03/2020

TOUJOURS LE MOT (LA MORT ?) POUR RIRE, l’ineffable Donald. Alors que la propagation du virus gagne le monde, Numéro 45 – il est le 45e président des États-Unis –, ou POTUS (President of The United States), comme l’appellent ceux qui refusent de prononcer son nom, bref, le locataire de la Maison-Blanche n’en manque pas une. Il a d’abord tourné cette histoire d’épidémie en dérision. Tout ça n’était que ragots politiciens des démocrates enrageant de n’avoir pu le destituer. Devant ses succès économiques insolents, ils lui cherchaient encore des noises. Le complot russe hier, le coronavirus aujourd’hui, tout ça parce qu’ils ne supportaient pas l’idée de sa réélection. Pour « Trump-la-mort », le Covid-19 n’était rien d’autre qu’un canular.
Quelques jours plus tard, il faisait une embardée dont il est familier pour justifier l’état d’urgence soudain décrété. Bien sûr, il savait qu’une pandémie menaçait. Mieux : il l’avait su avant tout le monde. Et si on le titillait sur son retard à l’allumage, il répétait son mantra favori : « On a fait un super boulot. » Trop fort Le Donald, on vous dit. Sans doute devrait-il se remettre en mémoire ce que tout bon économiste sait : « On ne tombe pas amoureux d’un taux de croissance. » Car pour lui, c’est economy first. Les affaires doivent primer l’humain. Un confinement national durable ? Vous n’y pensez pas ! « Nous ne pouvons laisser le remède être pire que le mal lui-même », a-t-il tweeté en lettres capitales. Et tant pis s’il y a de la casse – on veut dire : des morts. Un de ses sbires, le vice-gouverneur du Texas Dan Patrick, n’a-t-il pas déclaré dans un élan sacrificiel : « Les grands-parents devraient être prêts à mourir afin de sauver l’économie pour leurs petits-enfants » ?
Il faut se rendre à l’évidence, Trump, le pourfendeur des fausses nouvelles, est devenu à lui tout seul un cluster à fake news. Le voilà qui promet un vaccin disponible « dans les trois ou quatre mois ». Le médecin Anthony Fauci a dû le démentir en parlant, lui, d’un an à un an et demi pour espérer un traitement efficace contre ce que Le Donald s’obstine à nommer le « virus chinois ». Un peu de racisme est toujours bon à distiller. Le Covid-19 fait peur. Le président de la plus grande puissance mondiale aussi. Quand il était l’animateur vedette du jeu télévisé The Apprentice, Trump prenait un malin plaisir à crier au perdant : « You’re fired ! » On imagine le cri triomphal du peuple des confinés à un con fini, un cri comme : « You are coronavired ! »
Les hackers ont-ils du cœur ?
Par Éric Fottorino
24/03/2020

Y AURA-T-IL UNE TRÊVE DES HACKERS comme une trêve des confiseurs ? Ce sont de drôles de communiqués qui ont fleuri sur la Toile ces derniers jours. Les méchants loups du Net se seraient transformés en agneaux en jurant leurs grands dieux – un exploit pour ces bandits sans foi ni loi – qu’ils ne procéderaient à aucune cyberattaque contre les sites des hôpitaux aussi longtemps que frapperait le coronavirus. Ces groupes de hackers, connus sous les noms de Maze, DoppelPaymer, ou encore Ako, (vous avez le droit, comme moi, de dire kézaco, inconnus au bataillon !) ont, semble-t-il, renoncé à leur méthode habituelle d’extorsion, le ransomware – rançonnement numérique en bon français. Un procédé illégal par lequel ils bloquent tout le réseau d’ordinateurs d’un établissement avant d’exiger de lui une forte rançon pour qu’il récupère l’accès. Dans cette période de télétravail intense où les entreprises sont contraintes d’ouvrir à tout-va leurs systèmes informatiques, cet engagement des hackers vaut son pesant de cryptomonnaie…
Les hackers auraient-ils du cœur ? On pourrait le penser devant l’initiative de ces pirates du Web italiens ulcérés qu’un fabricant de valves pour appareils respiratoires vende sa camelote 11 000 dollars pièce sur le marché. Face à cette immoralité honteuse, leurs neurones hyperconnectés n’ont fait qu’un tour. Et nos Robin des bois transalpins ont réussi à s’emparer des plans nécessaires à l’élaboration des valves que le rentier du Covid-19 refusait de partager. Son précieux savoir pillé, ce fut pour eux un jeu d’enfant de mettre en production les soupapes salvatrices sur des imprimantes 3D, vendues pour la modique somme d’un dollar pièce.
Va-t-on allumer des cierges en l’honneur de ces gentils hackers ? Pas si vite ! Dimanche dernier, l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) a subi une violente attaque informatique sur son réseau. L’offensive a duré une heure, découpée en sales quarts d’heure. Pour protéger les infrastructures du système, il a fallu d’urgence bloquer les accès Internet hors d’Europe, fermer l’entrée externe à la messagerie et aux applications des hôpitaux, ainsi qu’à Skype. En pleine urgence sanitaire… Hackeurant, non ?
Bas les masques !
Par Éric Fottorino
23/03/2020
EST-CE LA ÉNIÈME REDIFFUSION DES TONTONS FLINGUEURS, l’autre après-midi à la télé ? On dirait que cette affaire des masques enfle à vue d’œil, comme jadis celle des ferrets de la reine. Des bourre-pifs en pleine guerre du coronavirus, est-ce bien raisonnable ? Cette fois, sous couvert de transparence et comme pour s’en laver les mains (c’est tendance), chaque ministre de la Santé, actuel ou ancien, d’Olivier Véran à Roselyne Bachelot – tant critiquée d’avoir explosé les dépenses de précaution au temps du H1N1 – en passant par Xavier Bertrand, chacun donc y va de ses chiffres pour confondre les responsables du désastre. Comment se fait-il que le stock d’État de masques ait fondu en une décennie de plus d’un milliard d’unités à 117 millions lorsque le Covid-19 est apparu chez nous ?
On ne tentera pas ici de démêler le vrai du faux, car sous couvert de bonne foi outragée sur l’air du « c’est pas moi c’est l’autre », on mesure l’indécence qu’il y a à polémiquer pendant que les soignants sur le front des urgences s’efforcent d’inverser la courbe terrifiante du virus tueur. Sans doute faudra-t-il faire le compte et le décompte de ces masques qui auront cruellement manqué aux personnels médicaux. Sans doute découvrira-t-on de mauvaises décisions publiques prises pour de mauvaises raisons budgétaires, dans ces années où les gestionnaires chargés de rationaliser les dépenses ont pris le pas sur les médecins chargés de sauver des vies. Mais de là à crier au loup (de Zorro) et « bas les masques » pour faire rouler des têtes, comme on le lit çà et là, voilà qui semble au moins prématuré…
En attendant que les gros bonnets du luxe apportent leurs contributions en masques (LVMH en a promis 10 millions d’unités), des infirmières d’Agen ont eu l’idée d’en confectionner avec des soutiens-gorge. On n’est pas sûr de leur efficacité mais voilà qui met de la couleur dans cette grisaille morbide. Me vient parfois l’image de nos rues quand ce virus aura disparu. Nos visages seront-ils dissimulés comme dans les sociétés asiatiques ? À tout prendre, je préférerais les masques du théâtre nô ou, mieux, ces appendices cyranesques en bec d’oiseau dont s’affublaient jadis les médecins de peste, et qui refleurissent chaque année au carnaval de Venise. Ou encore, comble du chic, je voudrais un masque de chez Dior, en écho au « J’suis snob » de Boris Vian, qui rêvait de disparaître dans un suaire de la même maison, aujourd’hui propriété de Bernard Arnault.
Silhouettes tremblées
Par Éric Fottorino
22/03/2020

J’AI TOUJOURS AIMÉ LES MARCHÉS, les marchés ouverts où se mélangent joyeusement cocos de Paimpol et gariguettes (ça c’est aux fruits et légumes), boudins blancs et farce aux herbes, vieux chandeliers venus d’on ne sait quel grenier, pots de miel ambré, poulets nourris au grain bardés de médailles de concours, olives cassées de Tunisie et fleurs de saison, renoncules aux tons pastel en attendant mes chéries les pivoines. Il me semble que la vie palpite plus fort sous ces halles à claire-voie qui abritent ce qu’on appelle avec à-propos les marchés forains. Car c’est bien une petite foire humaine qui se déroule à jour fixe, où les marchands rivalisent de gueule et de gouaille (j’en connais un à la voix de stentor qu’on entend cinquante mètres à la ronde crier : « Mara des bois, elle est belle elle est là ma mara des bois !). À chacun son style, rigolard ou familier – « Et avec ça ? »
J’y pensais ce matin en rejoignant un peu inquiet mon marché dominical. Y aurait-il la queue ? Garderait-on ses distances comme mon beau-frère de Bruxelles me l’a montré en photo dans une grande surface près de chez lui, où les caddies font office de cordon sanitaire ? J’ai bien fait d’arriver sur le coup de midi. Le gros des clients était déjà reparti. Le maire avait précisé : pas plus de cent personnes sous la halle. Pour la première fois, j’ai dû emprunter un sas de fortune avec le placier qui, sourire aux lèvres, m’a prié d’entrer comme on vous introduit dans un cabinet de curiosités.
Tout m’a paru comme avant, je me suis senti soulagé. Mais en tendant l’oreille, je n’ai pas perçu le brouhaha habituel. Certaines rangées étaient clairsemées, des commerçants avaient déclaré forfait. Manquait cette légèreté qui donne son charme au marché. Le vrai choc, je l’ai eu en m’avançant vers l’étal des primeurs où je suis toujours servi par mon amie Houria. Un épais film de plastique transparent me séparait d’elle. Comme une herse tombée entre nous. Défense d’approcher. Soudain, pour d’évidentes raisons de sécurité, je devrais dire de vie ou de mort, le virus invisible nous tenait éloignés. Houria faisait ses gestes habituels : « Combien de clémentines ? Essaie les oignons jaunes de Roscoff », mais ce n’était plus elle. Houria n’était plus vraiment réelle. C’était une silhouette tremblée dans une bulle coupée du monde. Une apparition pareille à une disparition.
Les âmes errantes de Bergame
Par Éric Fottorino
21/03/2020

UN JOURNAL PEUT-IL SE CHANGER EN CIMETIÈRE ? Drôle de question qui renvoie aux pires journées de l’après 11 septembre 2001, quand l’Amérique comptait ses morts et que le New York Times publiait des placards sur les victimes du World Trade Center, comme pour faire mentir George Sand qui écrivait que « l’oubli est le vrai linceul des morts ». Cette fois, c’est ici, enfin tout près, une vérité au-delà des Alpes qui est déjà notre destinée anticipée. Cette épidémie aura ses villes martyres, Wuhan en Chine, Bergame en Italie, Mulhouse en France, qui sait ?
Elles laissent sans voix, ces pages de L’Eco di Bergamo, le plus grand quotidien bergamasque – et pourquoi le mot masque vient-il se loger dans ce nom comme un funeste présage ? Des pages et des pages de nécrologie jusqu’à la nausée. D’habitude, il suffit d’un recto verso pour les morts de la veille, et à chaque jour suffit sa peine. Mais depuis que Covid-19 bombarde la côte lombarde, il y a trop-plein de cercueils. Des vivants qui tombent à la pelle comme feuilles mortes au printemps, il n’y a plus de saison. Pas le temps de les enterrer. Pas la place dans les cimetières. Dans le journal, en revanche, on trouve toujours où les caser. Surtout quand les critiques théâtrales se sont tues, et les rubriques cinéma, et tout ce qui donne à l’homme un supplément d’âme.
Parlons-en, tiens, de ces âmes laissées errantes, faute d’avoir été choyées jusqu’au bout par ceux qui les aimaient. Enterrer les siens est un rituel apparu au Proche-Orient il y a cent mille ans. C’est en préparant les défunts à l’au-delà que l’homme est sorti de l’animalité pour devenir vraiment humain. Et c’est de cette humanité dont le virus nous prive quand il prend tant de proies à la gorge.
« Aujourd’hui, à Bergame, dit une représentante de L’Eco di Bergamo citée par Libération, les nécrologies sont l’unique rituel qui reste pour saluer les défunts. À présent, si une personne est transportée à l’hôpital, les membres de sa famille ne peuvent rien savoir, jusqu’à l’appel qui leur annonce la mort de leur proche. Il n’y a plus de chambre mortuaire. On ne peut pas porter le corps du défunt à la maison. On ne peut pas célébrer de messe de funérailles ». Et de finir sur ces mots glaçants : « Le four crématoire fonctionne 24 heures sur 24. »
Un dictateur révolutionnaire
Par Éric Fottorino
20/03/2020
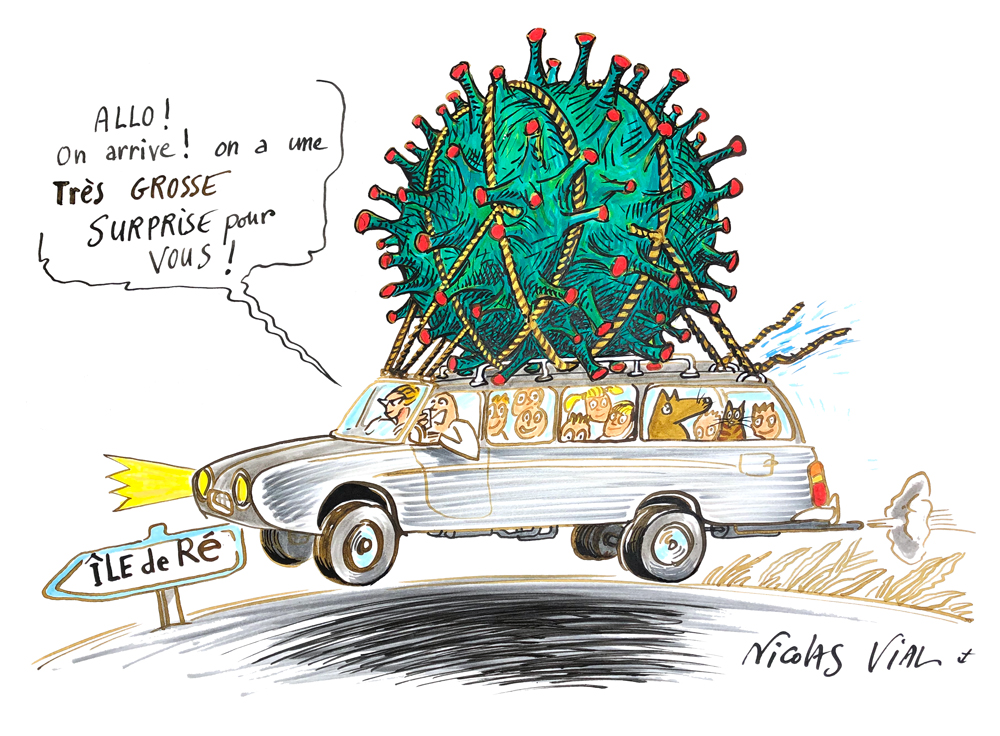
DANS CE MONDE SANS CONTACT QU'EXIGE LE COVID-19 (et pour les fans de Marathon Man, l’expression « sans contact » rappelle le « c’est sans danger » que répète à Dustin Hoffmann l’ancien dentiste nazi campé par Laurence Olivier), dans ce monde qui nous incite à prendre des gants, il en est pourtant qui se sentent d’humeur castagneuse. Rien à voir avec notre ministre de l’Intérieur, qu’on devrait d’ailleurs rebaptiser ministre de l’Extérieur avec ses cent mille pandores en vadrouille pour nous faire rentrer chez nous fissa. L’ire de la vox populi tombe surtout à mots raccourcis sur ceux qui ont l’humeur vagabonde. Suivez mon regard : vers ces parigots têtes de veau qui ont eu l’impudence de venir semer leurs virus à la campagne comme des chiens secouent leurs puces. À moins qu’ils se soient entassés dans nos belles îles quasi désertes et vierges de tout Covid, Ré, Oléron, Belle-Île ou Noirmoutier, au risque de gripper grave les autochtones et de vider leurs supérettes.
C’est vrai que ce grand rush vers les lieux de villégiature a quelque chose d’incongru, de très humain pourtant. Qui reprocherait à ceux qui le peuvent de préférer un confinement au vert et au large aux quatre murs d’un appartement en ville ? Mais ils en ont un peu trop fait, ces exilés viraux, en s’étalant sur le sable, en pique-niquant, en surfant, bref, en se la jouant vacanciers en congés payés par l’État providence façon Front populaire renversé, les riches et les bobos se la coulant douce quand les soignants et les vrais confinés ont la vie dure. Il a fallu fermer des plages et faire circuler ces braves gens comme le gendarme de Saint-Tropez – j’assume mes références – faisait se rhabiller manu militari d’inconscients nudistes.
Le confinement est le confinement, et à la guerre comme à la guerre. Ce corona-machin venu de Chine a quelque chose d’un mutant. Avec ses airs de petit dictateur, il se prend aussi pour un révolutionnaire. Le virus tueur est un Janus biface qui n’a pas fini de bousculer notre jeu de quilles. Non content de rendre notre printemps silencieux (seuls les oiseaux chantent, tous les instruments de la puissance humaine, autos, avions, usines, sont réduits au silence), non content de mettre l’humanité aux arrêts et la planète au repos, voilà qu’il éclaire à bas bruit une criante épidémie : nos inégalités.
Denrée vitale
Par Éric Fottorino
19/03/2020

LE PRÉSIDENT L'A DIT SOLENNELLEMENT MARDI SOIR : « Tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont clos leur porte. » Je pensais à cette phrase quand mon épouse Natalie, d’habitude si calme, est rentrée bien énervée des courses en début d’après-midi. Elle s’était imprimé une dérogation de sortie, comme l’obligation nous en est faite. Le matin, j’avais glissé dans mes poches le même laissez-passer pour aller chercher une baguette, respectant la distance réglementaire avec les autres clients qui ne tenaient pas plus que ça à me voir approcher d’eux.
C’est d’ailleurs assez cocasse, si on veut garder l’esprit taquin – le Covid-19, que je sache, ne s’attaque pas à l’humour –, d’observer la réaction des gens quand ils aperçoivent soudain au détour d’une rue, ô surprise, un autre humain. Les plus méfiants (je ne parle pas des inconscients qui fraterniseraient à bras ouverts) s’écartent ostensiblement. Ils décrivent un arc de cercle pour être sûrs d’être hors de portée de vos gouttelettes et postillons, agrémentant leur pas de côté d’un sourire contrit, pour vous signifier que ce n’est pas personnel mais juste vital. Il suffit de voir les images floutées des malades dans les hôpitaux de Mulhouse pour comprendre que ça ne rigole pas.
J’en reviens à mon épouse irritée. Elle a pris des laitages et des pâtes à l’épicerie (non, pas six kilos d’un coup comme un bonhomme craignant de manquer dans un petit village de l’Allier, et qui a prétendu que c’était pour son chien). Elle a aussi été raisonnable sur les tranches de jambon, mais je ne vais pas vous raconter ici nos repas de confinés. Puis, s’avisant que la Maison de la presse de notre petite ville de banlieue était ouverte, elle est allée acheter un journal. Une manière de soutenir le marchand. De se relier au monde, aussi. C’est en sortant, son canard sous le bras, qu’une policière l’a interpellée. « Que faites-vous ici ? Vous mettez en danger les autres ! » Un de ses collègues a abrégé la dispute. Si la Maison de la presse à côté de l’épicerie était ouverte, c’est bien qu’on pouvait y entrer, non ? se défendait Natalie. Le président a bien dit que seuls restaient ouverts les commerces essentiels. « Un journal, a assené la représentante de l’ordre, ce n’est pas une denrée vitale ! »
Un grand blanc
Par Éric Fottorino
18/03/2020

C'EST PARTI COMME EN QUARANTAINE. Même si c’est une quinzaine pour commencer. Quinzaine du blanc. Je veux dire d’une forme de silence après la sidération. Un grand blanc. Celui qui vient quand justement les mots ne viennent pas. En tendant l’oreille, j’ai compris que les hôpitaux appliquaient les « plans blancs ». Des dispositifs d’urgence déjà mis en vigueur lors des attaques terroristes de 2015. Les établissements de l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) sont mis en alerte face aux situations exceptionnelles. La pandémie en est une. On déprogramme les opérations qui peuvent attendre. On rappelle des personnels médicaux. On réquisitionne des lits. On priorise les malades – quel mot sinistre, prioriser, quand il s’agit de choisir entre des souffrants. On dresse des tentes dehors pour effectuer des tests sur les patients les plus atteints. En attendant un hôpital militaire de campagne en Alsace, comme une ironie de l’histoire, pour bien signifier que la guerre fait rage.
À nous simples citoyens, on recommande la défense passive. Des soignants au contraire, on exige un engagement de chaque instant. C’est le paradoxe de ce combat. Le fardeau repose sur très peu d’épaules. Pour nous autres, l’écrasante majorité, résister c’est rester assis. Ne bouger qu’en cas de nécessité.
Hier matin avant l’heure du confinement, les quais de Seine étaient bondés. Beaucoup de familles avec enfants, comme pour un ultime bol d’air en provision, en prévision de la longue apnée. Puis les douze coups de midi ont fait s’égayer la foule – pas si gaie, en réalité –, telle un troupeau résigné. L’après-midi les rues étaient désertes. Un seul magasin ouvert dans la longue et si commerçante rue Lafayette. Une boutique de réparation d’ordinateurs.
Un grand blanc s’est abattu sur la capitale. Un silence si lourd que mon amie Sophie M., penchée à son balcon de Belleville, a pu entendre au loin une mère parler à son enfant. Elle percevait distinctement ses paroles, comme si elle avait marché auprès d’elle dans la rue. En temps normal le trafic recouvre tout. Mais plus rien n’est normal. Maintenant on se guide à la voix, d’où l’importance de se parler. En fin de journée, allez savoir pourquoi, l’envie d’un verre m’a pris en voyant des images de la Seine près d’Alma-Marceau. J’ai reconnu l’enseigne d’un café familier. Le Grand Corona.
Cueillir des fleurs
Par Éric Fottorino
17/03/2020

LA GUERRE, DONC. Tout s’arrête, sauf les angoisses. Et les départs au vert de ces Parisiens qui rejouent l’exode en rase campagne. Comme si le Covid-19 traçait une ligne invisible sur le pays, une ligne de démarcation aux airs de ligne Maginot. Aucune défense qui vaille. Soudain tout a changé. Après les cafés et les restaurants, on a fermé parcs et jardins. Il faut perdre l’habitude de l’habitude. Pas seulement la bise et les poignées de main. Se voir entre amis, en famille, se réunir, se toucher. Terminé. Quant aux pauvres diables qui font la manche, on les évite plus que jamais.
Si des queues se forment, c’est devant les pharmacies et les commerces de bouche. Une ambiance de pénurie. Ce qui manque cruellement, ce n’est pas la nourriture. C’est l’insouciance d’avant (relative tout de même). Prévert nous l’avait chuchoté : « On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. » En respectant un intervalle avec son voisin – on dit : une distanciation sociale – chacun peut mesurer, outre le mètre réglementaire, ce que signifie d’être seul et ensemble à la fois.
Dans la rue, des passants marchent visage masqué, automates perdus dans leurs pensées, mais les automates pensent-ils ? Nous, on ne pense plus qu’à ça. Impossible de se concentrer sur rien d’autre car ce virus invisible est partout. Avant de menacer nos bronches, il nous prend la tête. On tourne en rond, c’est ça le confinement. On reste collés aux infos, aux rumeurs. Il paraît qu’à Milan ils désinfectent l’asphalte au chlore, et à ce qu’on raconte, il faudrait avaler du thé brûlant pour tuer le virus. Tu parles. Le bilan s’alourdit. 21 morts de plus lundi. De drôles d’idées pas drôles nous rongent l’esprit. Et si nos proches étaient infectés, pères, mères, femmes et enfants. Si nos vies s’arrêtaient. On se touche le front, on s’inquiète d’une toux suspecte. Écho glaçant de ces mots : « détresse respiratoire ».
Hier matin, un attroupement devant le lycée Victor-Duruy. Un fleuriste avait déposé ses trésors de roses et de tulipes dans une grande poubelle. Cadeau. Pendant quelques secondes, les gens sont redevenus humains. Ils se sont approchés incrédules. Ont composé des bouquets. C’était avant le confinement. Cueillir des fleurs, est-ce un geste autorisé, en temps de guerre ?
Tous misanthropes ?
Par Éric Fottorino
16/03/2020
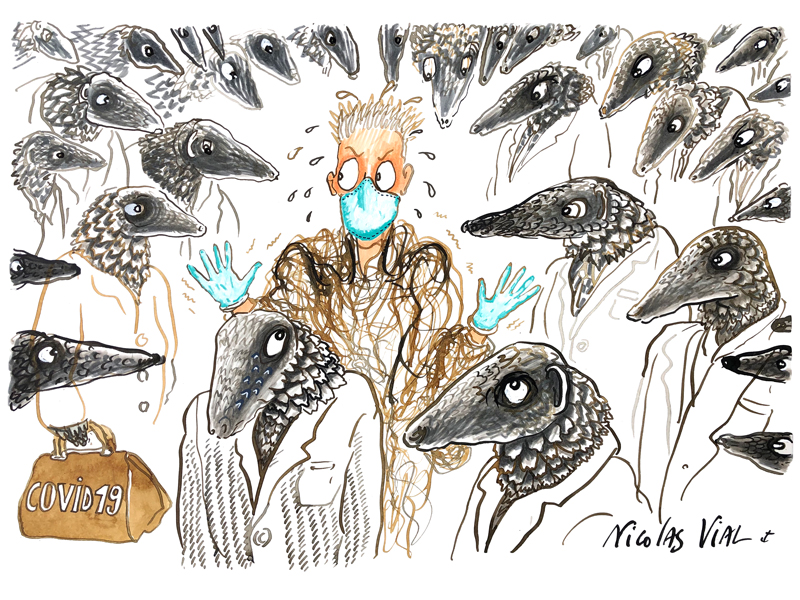
C’ÉTAIT AVANT. C’était il y a quelques jours. Hier ou presque. Une éternité. Ce coronavirus – dont je ne prononçais pas toujours le nom dans le bon ordre – me semblait lointain et, pour être honnête, assez anodin. Je n’avais jamais mangé de pangolin (ou fourmiller écailleux, l'animal un moment soupçonné d’avoir transmis le Covid-19 à l’homme). Je ne fréquentais pas de Chinois, sauf en traversant le rez-de-chaussée du rayon cuir du Printemps pour suivre un raccourci entre mon RER d’Auber et nos bureaux de Saint-Lazare. Tout allait pour le mieux et si par hasard quelqu’un éternuait près de moi sur le trottoir, je faisais ce que l’hypocondriaque que je suis fait depuis toujours : bloquer ma respiration et changer de direction pour ne pas inhaler ses miasmes !
Que s’est-il passé ? Non pas un saut d’espèce, plutôt un saut d’espace. De la Chine à l’Italie, le danger s’est rapproché d’un coup. Ensuite est survenu le confinement des chiffres avant le confinement des humains : pas de rassemblement de plus de 5 000 personnes ; puis de 1 000 personnes; puis de 100 ! Jeudi soir, le président a parlé fort. Tout en maintenant le premier tour des municipales, ce qui m’a troublé quant à la logique en vigueur au sommet de l’État. L’urgence sanitaire était à son comble, sauf pour se rendre aux urnes. Gérard Larcher en avait, du pouvoir, pour enfoncer un coin dans les gestes barrières ! Mais c’est vendredi dernier que je me suis surpris à entourer mon visage d’une mince écharpe changée soudain en gri-gri de fortune, comme si elle pouvait me protéger du virus ambulant et sournois qui avait gagné le Grand Est et conquis l’Île-de-France (j’entendais la chanson de Reggiani : « Les loups, les loups, sont entrés dans Paris »).
Devant un restaurant de Montparnasse, je suis tombé sur un grand petit garçon perdu, c’était Lambert Wilson. Il venait d’apprendre qu’il avait joué la veille pour la dernière fois son Misanthrope. Toutes les représentations étaient annulées. « Je n’ai pas dit au revoir à mon rôle », répétait-il avec un désarroi non feint. Le soir même je me suis mis à regarder les ados de travers, les tout petits avec suspicion, les autres sans aménité. Voilà qu’avec ce satané virus, on va tous piquer son rôle à Lambert Wilson. Tenir les gens à distance pour se protéger d’eux. Pour les protéger aussi. Misanthropes, mais pas trop.