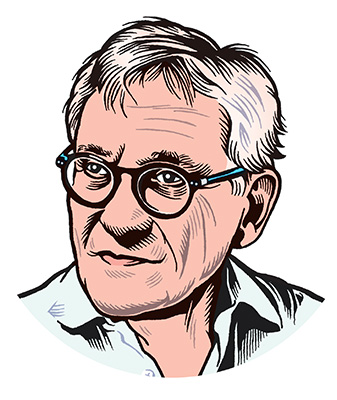
C’est en octobre 1979, au tout début de mon parcours au sein de Médecins sans frontières, que j’ai pour la première fois été confronté à une urgence authentique, vertigineuse. J’étais en Thaïlande, à la frontière du Cambodge, lorsque sont arrivés ceux qu’on appelait alors les « nouveaux réfugiés », c’est-à-dire des Cambodgiens qui fuyaient la guerre entre les Khmers rouges et les Vietnamiens. On m’avait prévenu de leur arrivée, je suis donc allé à leur rencontre au petit matin, dans cette région frontalière aride qui ressemblait presque à une steppe. J’y ai découvert une trentaine de milliers de personnes littéralement en train d’agoniser : épuisées par la chasse à l’homme dont elles avaient été victimes, malades d’avoir vécu en forêt pendant des semaines, dans un environnement hostile, souffrant de multiples parasites, de plaies infectées, du paludisme, de malnutrition aiguë. Le plus frappant dans cette scène de cauchemar était peut-être le silence. Entre ces dizaines de milliers d’humains, on n’entendait pas une parole. Seulement la toux et les râles. J’ai été confronté à de nombreuses « urgences » individuelles au long de ma formation médicale et chirurgicale. Mais ce jour-là, en Thaïlande, a été ma première expérience d’une véritable urgence collective, au sens le plus essentiel du terme.
Une suspension de la réflexion et de la délibération au profit de l’action
Aujourd’hui, dans le milieu humanitaire, on parle d’urgence pour tout. C’est un terme qui, dans son usage courant, recouvre tant de choses qu’il signifie désormais « quelque chose qu’il faut faire rapidement ». Or, à mes yeux, l’urgence est et doit rester une situation d’exception. Je la définirais ainsi : une situation de crise telle qu’elle implique de faire quelque chose immédiatement, sous peine de préjudice irréparable. Bien sûr, il est souvent difficile de distinguer la crise de l’urgence, en particulier dans le travail humanitaire qui, par définition, est confronté à des situations qui sortent de l’ordinaire : la disette, la famine, la violence, un quotidien où le normal – faire ses courses au marché, envoyer les enfants à l’école – s’interrompt et où l’anormal – se fournir sur le marché noir, ne plus sortir de chez soi – prend le relais. Tout cela relève de la situation de crise, et c’est déjà insupportable. Mais l’urgence, c’est une épidémie de choléra, l’arrivée massive de malades ou de blessés qu’il faut traiter immédiatement à grande échelle, comme ce matin d’octobre 1979 en Thaïlande ou, aujourd’hui, dans le contexte du tremblement de terre qui a frappé le Maroc ou des inondations qui ont ravagé la Libye.
Pourquoi est-ce important d’opérer la distinction entre crise et urgence ? Précisément pour conserver ce que l’urgence a de singulier. Quand vous êtes dans une situation d’urgence, qu’elle soit médicale, chirurgicale, ou bien humanitaire, la réponse se fait en fonction d’un protocole. Et heureusement ! Quand un blessé est en train d’agoniser, il n’y a pas de temps pour délibérer. Il faut agir vite, selon des règles bien établies. L’urgence implique une suspension de la réflexion et de la délibération au profit de l’action. L’urgence a quelque chose de tyrannique, elle dicte une réponse immédiate. C’est pour cela qu’il faut s’en méfier et réserver la catégorisation et les protocoles d’urgence aux situations, rares, qui le demandent.
Elle est également quelque chose qui évolue, ses conditions ne sont pas fixes dans le temps. Prenez l’exemple des tremblements de terre. Jusqu’aux années 2000, les soignants étrangers étaient inutiles, les blessés étant en petit nombre, pris en charge par les soignants locaux. Logisticiens et sanitariens étaient au premier plan des secours internationaux. Mais depuis deux décennies, le nombre de blessés graves lors des séismes a drastiquement augmenté. En cause, l’urbanisation accélérée. De plus en plus de gens quittent les campagnes pour s’installer dans les centres urbains, dans des habitations construites à la va-vite, avec des matériaux de mauvaise qualité. Lorsqu’un séisme frappe, ce sont des toits qui s’effondrent, des murs et des dalles qui tombent, causant des blessures par écrasement à un grand nombre de personnes. C’est ce qui s’est produit la première fois en 2005, lors du tremblement de terre au Cachemire, dans des agglomérations nouvellement créées, puis lors d’autres catastrophes semblables – notamment à Haïti, en 2010, et en Turquie, en février dernier. Les séismes comme urgences médico-chirurgicales, cela relève donc de l’histoire récente. Une histoire liée aux conditions de vie, à la qualité médiocre des matériaux et des bâtiments, et au mépris des normes parasismiques de construction. En l’occurrence, c’est donc la composante sociale d’une catastrophe naturelle qui va lui conférer sa dimension d’urgence.
Avec le changement climatique, nous nous retrouvons dans une situation inédite, qui conjugue urgence pressante, temporalité longue et dimension planétaire. Il s’agit donc de penser cette urgence de manière nouvelle, tout en constatant qu’une situation aussi effrayante induit des réflexes de dénégation et de refuge dans des slogans. La temporalité démocratique, courte par nature, se heurte ici, de plus, à la temporalité de la prévention, aux effets à long terme.
Rony Brauman, médecin humanitaire



