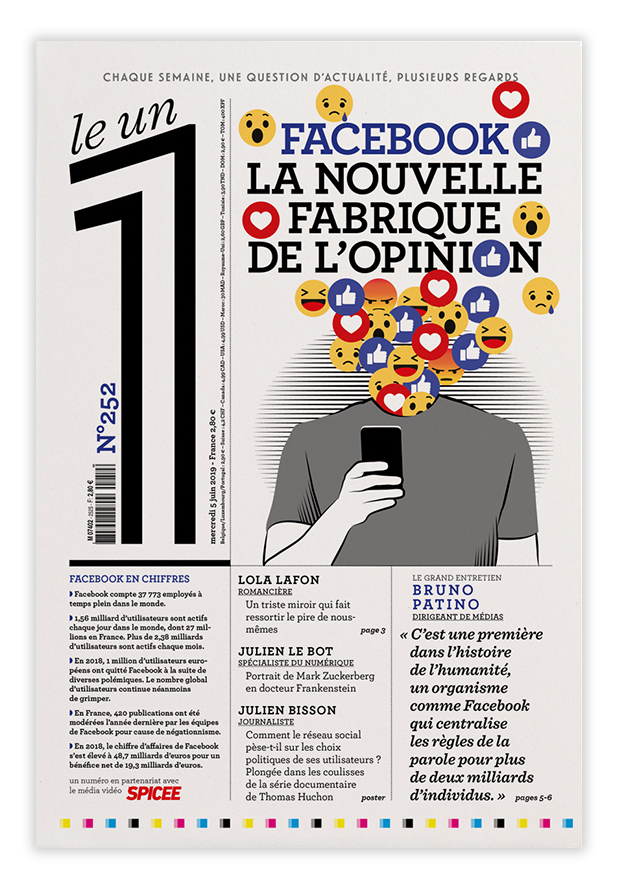Bruno Latour a placé l’écologie au cœur de ses réflexions. Alors qu’on est entré dans un « nouveau régime climatique », il a réuni des citoyens désireux de redéfinir leur territoire dans des ateliers, où chacun apprend à écouter l’autre. Pionnier de la sociologie des sciences, il estimait vivre un moment exceptionnel d’invention et de créativité, mais jugeait urgent de revoir en profondeur notre façon d’aborder les défis de l’époque.
Le penseur est décédé dans la nuit du 8 au 9 octobre 2022. Il avait accordé un entretien à Zadig publié en mars (voir le numéro). Nous vous invitons à le redécouvrir ici.
Vous êtes né à Beaune en 1947, dans une famille de négociants en vin, et vous avez grandi en Bourgogne. En quoi ces origines sont-elles importantes pour vous ?
Ma famille est particulièrement impliquée dans le vin, à commencer par mon père, ensuite mon frère aîné, et maintenant mon neveu ; et avant eux, mon grand-père et mon arrière-grand-père, Louis Latour1. Celui-ci a eu le génie de croire à la science, au moment du phylloxéra2, à la fin du xixe siècle. Alors qu’il n’était qu’un petit négociant, il a pu racheter un très important domaine aloxe-corton à un aristocrate qui ne croyait plus en l’avenir de la vigne. Ce domaine comportait une belle maison, où j’ai vécu. On vivait dans l’odeur des tonneaux. J’ai joué dans les caisses… Je suis pleinement lié à cette expérience du terroir. Dans la région, on parle de « climats » – c’est le terme technique pour décrire la variété incroyable des vignes. Quand je suis allé plus tard en Californie, j’ai découvert l’immensité des domaines viticoles américains. En Bourgogne, ils occupent de toutes petites superficies. Mais il y a eu une énorme spéculation. Cette flambée des prix est d’ailleurs un vrai problème pour beaucoup d’agriculteurs en France.
Avez-vous envisagé de reprendre l’affaire familiale ?
Non, non. J’étais effectivement destiné à entrer dans le business, mais j’ai dérivé vers la philosophie. Je garde malgré tout un attachement très fort à notre domaine. Je ne rate jamais la réunion de notre société parce que c’est passionnant. Viticulteur est un métier d’une très grande complexité, un peu comme libraire : il y a une multiplicité de « thèmes » différents à vendre, par année, par « climat »… Avec, en plus, des microbes et des maladies à combattre, des règles environnementales à observer, etc.
Ces climats de la Bourgogne continuent-ils à vous parler ?
Cela a un petit peu influencé mon intérêt pour l’écologie, mais il ne faudrait pas écrire l’histoire à l’envers. Mon père, qui était aussi conservateur de l’Hôtel-Dieu de Beaune, était proche d’architectes et d’artistes qui gravitaient autour de ce magnifique lieu d’une renommée aujourd’hui internationale. Il était très ami avec Jacques Copeau3. C’était assez étrange de pouvoir bénéficier ainsi d’un univers culturel si riche et de l’aura de Copeau. Nous avions donc une place exceptionnelle, avec d’un côté la haute culture, de l’autre ce négoce de vin, un mélange qui a fait la particularité de mes parents.
Votre famille vous a donné ce lien avec la terre, avec le terroir, bien sûr, mais aussi avec la culture. Et une forme de beauté est entrée en vous…
Disons que j’ai reçu une bonne éducation. J’avais en plus sept frères et sœurs qui habitaient dans un tas d’autres pays : une de mes sœurs était en Afrique, l’autre au Brésil ; j’ai une sœur religieuse qui a vécu dans le monde entier… Il y avait donc dans cette famille une dimension globalisée, mondialisée. Assez bizarrement, j’ai baigné dans une culture bourgeoise, locale et provinciale, mais en même temps très internationale, très ouverte. On se tromperait en pensant qu’il s’agissait d’une « province endormie » – c’est le cliché des articles de journaux. Nous, nous n’étions pas du tout endormis. Beaune était une ville qui pouvait se flatter, depuis les Gaulois, d’avoir beaucoup d’antennes partout dans le monde, à cause du vin. Ce marché était déjà global à l’époque. D’ailleurs, j’ai l’impression que l’idée du « local », opposée au « global », ne veut rien dire. C’est pour cela que j’ai proposé, bien plus tard, de définir le territoire non par l’emplacement cartographique, mais par la dépendance. On comprend tout bien mieux ainsi. Beaune dépend des Américains, des Anglais, des Allemands, des Suédois… Quand le responsable de l’achat de vin suédois venait à la maison, c’était tout un événement, et il fallait bien le traiter : il achetait du vin pour toute l’année et pour toute la Suède.
C’est aussi à travers le prisme du vin que vous avez perçu très concrètement combien le réchauffement climatique pouvait avoir un fort impact sur l’avenir de votre propre famille et sur notre agriculture…
Oui, comme pour tous les agriculteurs, pas simplement ceux de France, mais ceux du monde entier. Les œnologues m’ont toujours dit : « Avec une hausse de 2 degrés de la température, on peut encore s’en tirer. » Mais cela fait déjà trois ans que les gens souffrent beaucoup sur le plan climatique, et cette année, très chaude encore, a été horrible. Il faut s’adapter.
« Il y avait dans ma famille une dimension globalisée, mondialisée »
La Maison Latour a acheté des terres dans l’Ardèche et y fait un très bon vin, le Grand Ardèche. Ils ont aussi acquis un domaine entier dans le Haut-Var, le domaine de Valmoissine, où ils font du bourgogne de Haute-Provence. Mon frère avait déjà pris ces décisions il y a des années4. Maintenant, tout le monde travaille sur de nouveaux cépages. Un des enjeux est notamment de faire fleurir la vigne après les nouvelles formes de gel5. Mais celle-ci n’y est pas habituée, on ne l’a pas sélectionnée pour ça, donc il faut la resélectionner. On investit, je crois, dans un hectare de nouveaux cépages par an pour éviter que la vigne ne fleurisse trop tôt. Avant, c’était un avantage ; à présent, c’est un inconvénient… La Bourgogne travaille beaucoup sur ces questions. C’est une entreprise énorme, à laquelle ma famille participe.
François Mauriac, dans son Bloc-notes, écrivait qu’il n’était jamais autant lui-même que lorsqu’il était à Malagar, sa demeure de famille en Gironde. Vous qui avez travaillé aux États-Unis, séjourné un peu partout, été invité par beaucoup d’universités à travers le monde, considérez-vous ces origines bourguignonnes comme très importantes ?
Non, ce n’est pas au niveau de Malagar pour Mauriac, mais ce sont mes racines. Et ce qui est vrai, c’est que des gens comme moi, attachés au métier de la vigne, nous sommes sensibles au climat. Cela fait toujours rire mes enfants, qui me disent : « Tu habites à Paris, rue Danton, c’est une pure fable ! » Mais c’est pourtant vrai : c’était bien le grand sujet de mon père, pendant les vendanges… Et je comprends les paysans, car je sais ce que signifie dépendre du climat. Ça fait partie de l’expérience des deux tiers des Français de mon âge. Ils sont tous nés du sol. Depuis, le monde paysan s’est au fur et à mesure réduit. Il a été traumatisé par la modernisation à l’arraché pendant les années 1950 et 1960. Les jeunes, aujourd’hui, y sont moins sensibles, évidemment.
Avez-vous continué à suivre ces questions viticoles et agricoles ?
Non, car après j’ai passé beaucoup de temps en Amérique6, à m’intéresser à d’autres sujets techniques. Mais récemment, à cause des ateliers de description du territoire que nous avons organisés à la suite de la parution de mon ouvrage Où atterrir7, je me suis à nouveau penché sur ces questions.
Vous évoquez l’Amérique… Quand on regarde votre parcours intellectuel, on est tenté de dire que vous avez emprunté des chemins de traverse. Pourriez-vous retracer pour nous votre cheminement depuis l’agrégation de philosophie ?
Je n’ai jamais eu de propositions de l’Université française, la question ne s’est pas posée. J’ai d’abord enseigné dans une école d’ingénieur, le Conservatoire national des arts et métiers, de 1977 à 1982, ce qui était très bizarre, mais c’est parce que je m’intéressais aux sciences et à la sociologie des sciences. Puis j’ai été professeur à l’École des mines, parce que le sociologue Michel Callon8 travaillait sur des questions proches des miennes – nous sommes d’ailleurs devenus très amis. Ensuite, j’ai décidé d’aller à Sciences Po pour travailler avec Richard Descoings9. C’était une décision de l’âge mûr, je me disais : « Il faut travaille…