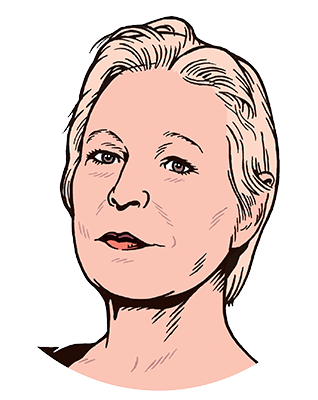Qui saura entendre ?
Temps de lecture : 4 minutes
Qui saura entendre l’inquiétude des classes dites populaires ?
Qui saura entendre leur aspiration à habiter dignement leur vie ?
Qui saura entendre leur désir d’avenir trop souvent confisqué ?
Qui saura entendre leur angoisse devant les injustices, devant le mépris, devant ce paradis de la haine, devant cette obsession de la productivité et cet attrait pour le désastre infligés par une économie marchande qui règne et colonise tous les aspects de l’existence ?
Qui saura entendre nos interrogations devant la façon biaise dont ce système, sous des abords attrayants et aimables, inocule des goûts, des besoins, des désirs qui peu à peu nous agrippent et nous deviennent aussi nécessaires qu’une drogue ?
Qui saura entendre nos réticences devant la prétendue « valeur travail », chantée avec lyrisme par ceux-là que le travail n’abîme guère puisqu’ils le fourguent à d’autres ?
Qui saura entendre qu’un labeur trop longtemps prolongé constitue pour certains un calvaire, qu’il les vide, qu’il les use, qu’il les déglingue, qu’il leur suce la moelle, qu’il les fane prématurément et qu’il les épuise au point qu’ils se demandent chaque soir s’ils pourront le lendemain reprendre le collier ?
La gauche, ce mot chargé de couleurs, de rêves et d’espérance
Et qui saura y répondre ?
Sûrement pas ces apologistes-du-travail-des-autres qui ne pensent que pour le Marché et considèrent le peuple comme une force tout juste bonne à turbiner, une force qu’il faut épuiser avec modération pour qu’elle dure suffisamment et ne finisse à la casse, une force à qui il faut bien accorder quelques discours aimables et quelques jours fériés pour qu’elle se requinque.
Déjà en 1932, dans son Éloge de l’oisiveté, le philosophe Bertrand Russell développait la thèse selon laquelle cette obsession du travail chez les apologistes-du-travail-des-autres s’expliquait en partie par les préjugés des classes bourgeoises, moralement choquées à l’idée que le peuple puisse jouir des mêmes loisirs qu’elles, et convaincues que l’inactivité de ce dernier, livré à ses instincts, ne pouvait que le mener droit à l’ivrognerie, à la débauche, ou pire ! Or, grâce aux progrès technologiques, expliquait calmement Russell, la somme de travail requise pour procurer les choses indispensables à la vie pouvait très bien se limiter à quatre heures par jour – je résume.
Solution confirmée par son ami l’économiste Keynes, lequel, avec des arguments extrêmement mathématiques, estimait qu’il n’était plus du tout indispensable de se rompre les os pour satisfaire nos nécessités, et jugeait que trois heures de travail par jour, équitablement réparties, seraient amplement suffisantes.
Mais ces projets économiquement viables selon ces deux penseurs et qui pouvaient changer radicalement la face du monde, ces projets se heurtaient aux intérêts de ceux-là mêmes qui tenaient à tout prix à faire tourner la machine à produire en vue d’augmenter sans cesse les besoins des humains et, concomitamment, leur fortune.
Je parle du travail, mais c’est tout un monde qu’il faudrait repenser
Système absurde, puisqu’il conduisait les uns à surtravailler et à surconsommer, et condamnait les autres au chômage et à l’indigence.
Depuis, de nombreux économistes ont imaginé de nouvelles formes de travail afin que les immenses quantités de temps et d’efforts épargnées grâce aux innovations technologiques soient plus justement réparties.
Qui aura le courage politique de décider leur mise en œuvre ?
Je parle du travail, mais c’est tout un monde qu’il faudrait repenser : pour que cesse à tout jamais la déconsidération de certains ; pour que cessent les inégalités entre ceux qui pètent dans la soie et ceux qui n’ont que leurs poings à ronger ; pour que cesse la honte des féminicides ; pour que cesse cette surproduction de besoins factices qui éreinte notre terre dont la splendeur nous émerveille encore ; pour que cesse la surproduction de plastoc et de mille autres saloperies qui s’immiscent dans les glaces du pôle Sud, dans les eaux de l’Arctique, dans l’estomac des chameaux, dans les palmiers de L.A., dans le lait maternel, dans le foie, dans le cerveau, dans les reins, dans la rate, dans les poumons et dans nos âmes ; pour que l’accès à la culture soit ouvert à tous ; pour que la police ne serve pas qu’à nous foutre la trouille ; pour tant et tant de choses encore.
Et pour que la gauche, ce mot chargé de couleurs, de rêves et d’espérance, ne reste pas de l’ordre du fantasme ou de la nostalgie, mais rejoigne enfin le sol ferme de l’expérience.
Vaines incantations, me direz-vous. Chapelet de grandes phrases faciles à égrener. Vagues songes romantiques dont l’irréalisation assure le prestige. Déclarations fleuries destinées à être applaudies par ces quelques esprits, friands de pâtée subversive, qui n’aiment rien tant, pour s’autopromouvoir dans les dîners mondains, que feindre de maudire le système afin de mieux en sauver les principes.
Bref, comme dit Hamlet : Des mots, des mots, des mots, des mots.
Peut-être. Mais il est des mots qui nous donnent à chanter, des mots qui, par le seul fait de nommer l’impensable, le mettent en perspective ; des mots trop longtemps dédaignés ou trahis dont la profération insuffle du courage. Et il nous en faudra (du courage) pour amener ces gauches divisées et jalouses à répondre à ceux qu’elles sont censées défendre, plutôt qu’à défendre pied à pied leur petit pré carré.
« Le peuple est une notion très composite »
Gérard Noiriel
Revenant sur les liens qu’entretient la gauche avec le peuple depuis la Révolution, l’historien Gérard Noiriel explique que ce dernier n’a jamais été homogène ni unanimement acquis à la gauche.
[Dans le poste]
Robert Solé
Le dernier duel télévisé de l’élection présidentielle ronronnait. D’un ton mesuré, parlant des dangers de la fracture sociale, François Ruffin cherchait à rassurer celles et ceux qui l’assimilaient encore à la France insoumise.
« Les petits pas et l’horizon »
François Ruffin
Venu à la politique par la question sociale, l’ancien journaliste François Ruffin, devenu député insoumis, se dit bien décidé à rabibocher la gauche avec le peuple des villes et des champs.