
S’informer ? Pas besoin, nous savons déjà tout !
Nous savons déjà tout, non ?
Le procès Johnny Depp contre Amber Heard, Ellen/Elliot Page en transition, la campagne publicitaire du Planning familial, Joe Biden qui semble ne pas comprendre ce qu’il lit sur son prompteur, mais aussi les massacres russes en Ukraine, ce qu’Hugo1, pour nous, décrypte de la politique française, les espèces animales menacées, les sécheresses en Afrique, la destruction de la forêt amazonienne, la répression des Ouïgours, les incendies de l’été, chaque instant nous apprend quelque chose. Tout nous arrive, via TikTok, Instagram, Reddit, YouTube, Facebook, Snapchat, Twitch, Brut, Konbini. Bref, sur notre téléphone.
On nous divertit, on nous scandalise, on nous interroge, on nous bouleverse, on nous alerte, on nous raconte, on nous explique.
Les influenceurs, les témoins, ceux qui « savent parce qu’on leur a dit », ceux qui « croient savoir parce que justement on ne leur a pas dit », les médias, les amis, les sites d’info, les comptes satiriques, les agences de presse, de parfaits inconnus, des illuminés notoires, des experts avérés, tout le monde parle.
Donc, au milieu de tout cela, on nous informe. Et comme ce que les autres apprennent, ils le partagent avec nous sur WhatsApp, nous avons l’impression que nous en savons déjà trop.
L’information, désormais, nous atteint sans que nous l’ayons demandé. Nous n’avons plus besoin d’aller la chercher.
La connexion permanente nous arrose de messages informatifs : une cinquantaine d’alertes en moyenne par jour. Dans ce grand mélange, rien de ce qui se passe ne peut nous échapper.
UN PEU FATIGUÉ ?
D’où vient cette impression, alors, que quelque chose cloche ? D’abord, il y a tous ces mots : faits alternatifs, hoax, fake news, désinformation, complot, deep fakes, les hashtags #onnousment, #commeparhasard, parmi des centaines d’autres. Et puis il y a ce sentiment d’être submergé par les informations contradictoires et les réalités divergentes. Alors, parfois, nous sommes fatigués et nous décidons de ne plus du tout prêter attention à la marche du monde, à ce qui se passe dans le pays, à ce qui arrive près de nous. Nous swipons, nous scrollons, mais nous ne voulons plus savoir.
La « fatigue informationnelle » (la news fatigue) n’est pas une vue de l’esprit, elle touche, en France, une personne sur deux, d’après la Fondation Jean-Jaurès.
Et notamment celles que l’on appelle les « hyperconnectées épuisées », c’est-à-dire les moins de trente ans qui passent beaucoup de temps sur les écrans, et qui alternent entre une pratique compulsive de l’information et l’arrêt par fatigue.
Les trois raisons évoquées sont toujours les mêmes :
1) la perte d’intérêt face au grand désordre des messages, si nombreux qu’ils font qu’il devient très difficile de suivre les événements ;
2) le découragement face à un monde devenu si complexe que l’on pense qu’il faut être un expert pour y comprendre quelque chose ;
3) le sentiment d’impuissance éprouvé face aux phénomènes dont parle l’information et auxquels nous pensons ne rien pouvoir changer.
Une quatrième raison est apparue à partir de 2020 : l’angoisse liée à la pandémie de la Covid. D’où ce paradoxe qui consiste à penser que les informations sont trop nombreuses aujourd’hui pour être vraiment utiles. Cela ressemble à la loi des rendements décroissants que connaissent les étudiants en économie que l’on explique souvent avec l’exemple de la mousse au chocolat : quand je mange de la mousse au chocolat, je suis de plus en plus satisfait à mesure que j’en mange, mais à partir d’une certaine quantité, je commence à être écœuré, et si je continue, je finirai par vomir. Dit de façon savante, l’utilité marginale d’un bien tend à décroître à partir d’un certain niveau de consommation.
Nous n’avons jamais eu autant d’informations, mais « trop, c’est trop ». Certains analystes appellent cela « l’infobésité ».
Nous sommes pris alors entre une certitude et une envie : la certitude, c’est que l’information finira par nous atteindre et qu’il n’est pas nécessaire de s’en préoccuper, et l’envie, c’est qu’en fait, si on pouvait s’en passer, ce serait mieux. Et nous ne sommes pas les seuls à penser cela : en 2022, la journaliste Amanda Ripley a avoué dans un long article du Washington Post qu’elle-même, désormais, évitait de s’informer depuis des années alors même que son métier consiste à informer les autres…
MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QU’UNE INFORMATION ?
Pourtant, nous sentons bien que l’information n’est pas inutile et qu’il ne faut pas qu’elle disparaisse.
Une scène de la série En thérapie (dans la deuxième saison) me vient à l’esprit. Chaque épisode raconte une séance chez un psy, le docteur Dayan. Dans l’un d’entre eux, Robin, un adolescent, semble développer une grande anxiété face à la Covid. Il se lave les mains de façon compulsive et ne veut plus sortir. Il finit par se tourner vers le docteur Dayan pour lui demander de valider ou d’invalider les informations contradictoires qu’il entend à propos de la pandémie. Il ne sait plus qui croire, et il sent bien qu’il lui faut bénéficier d’une information fiable s’il veut se protéger et protéger les autres. Dayan lui répond de faire preuve de discernement, c’est-à-dire de faire confiance à la capacité de son esprit à juger clairement et sainement les choses. Et que ce discernement doit, pour être efficace, ne pas se limiter au message, mais concerner l’émetteur du message, la source.
Dans le domaine de l’information, tous les messages ne se valent pas, et tous les émetteurs n’ont pas le même statut.
Sans s’y attarder, Dayan laisse entrevoir à son jeune patient ce qu’est une information : c’est une narration du réel, fondée sur des faits avérés, digne de confiance. Qui doit donc émaner de quelqu’un en qui on a confiance. Ce n’est pas seulement un message qui parlerait du réel, de quelque chose qui viendrait d’arriver. L’information ne se résume pas non plus à un simple témoignage. Pour que ce dernier devienne une information, il lui faut quelque chose en plus.
L’information est le résultat d’une transformation, d’une action humaine. Elle doit mettre en jeu un processus de vérification, par un individu ou une organisation désintéressée et responsable. Ce que les Anglo-Saxons résument en trois lettres : VIA (verified, independent, accountable).
Être désintéressé signifie qu’on ne possède pas un intérêt direct, personnel, dans l’information que l’on publie, et donc qu’on ne la rend pas publique pour obtenir un avantage personnel en termes d’argent ou de pouvoir.
Enfin, en transmettant cette information, on engage sa responsabilité : professionnelle, réputationnelle et juridique.
Un témoignage, pour devenir information, doit passer par ce processus de transformation. Il en est de même pour les dénonciations, utiles, des lanceurs d’alerte : quelqu’un doit intervenir sur cette matière. C’est le métier du journaliste. Et il le fait d’autant mieux qu’il le réalise en relation directe ou indirecte avec une organisation collective, que l’on appelle une rédaction, partie prenante d’un média. Et c’est ce collectif qui doit être indépendant et responsable, et ne pas prendre part à l’événement lui-même.

ET ÇA ME SERT À QUOI ?
Quand le jeune patient demande au docteur Dayan quelle information il doit croire, c’est parce que ça le concerne directement : il en va de sa santé et de la santé de ses proches. Il ne souhaite plus être ballotté entre les messages contradictoires qui émanent de toutes parts. Il veut savoir sur quelles bases solides construire sa réflexion et son comportement. On est dans le cadre d’une série, mais le réel n’est pas loin. Il y a eu un fort regain d’intérêt pour l’information et les médias pendant la crise liée à la Covid.
Quand cela me concerne, la fonction de l’information semble claire. Et si, en plus, elle est intéressante et me rapproche de mon environnement direct, elle remplit sa mission.
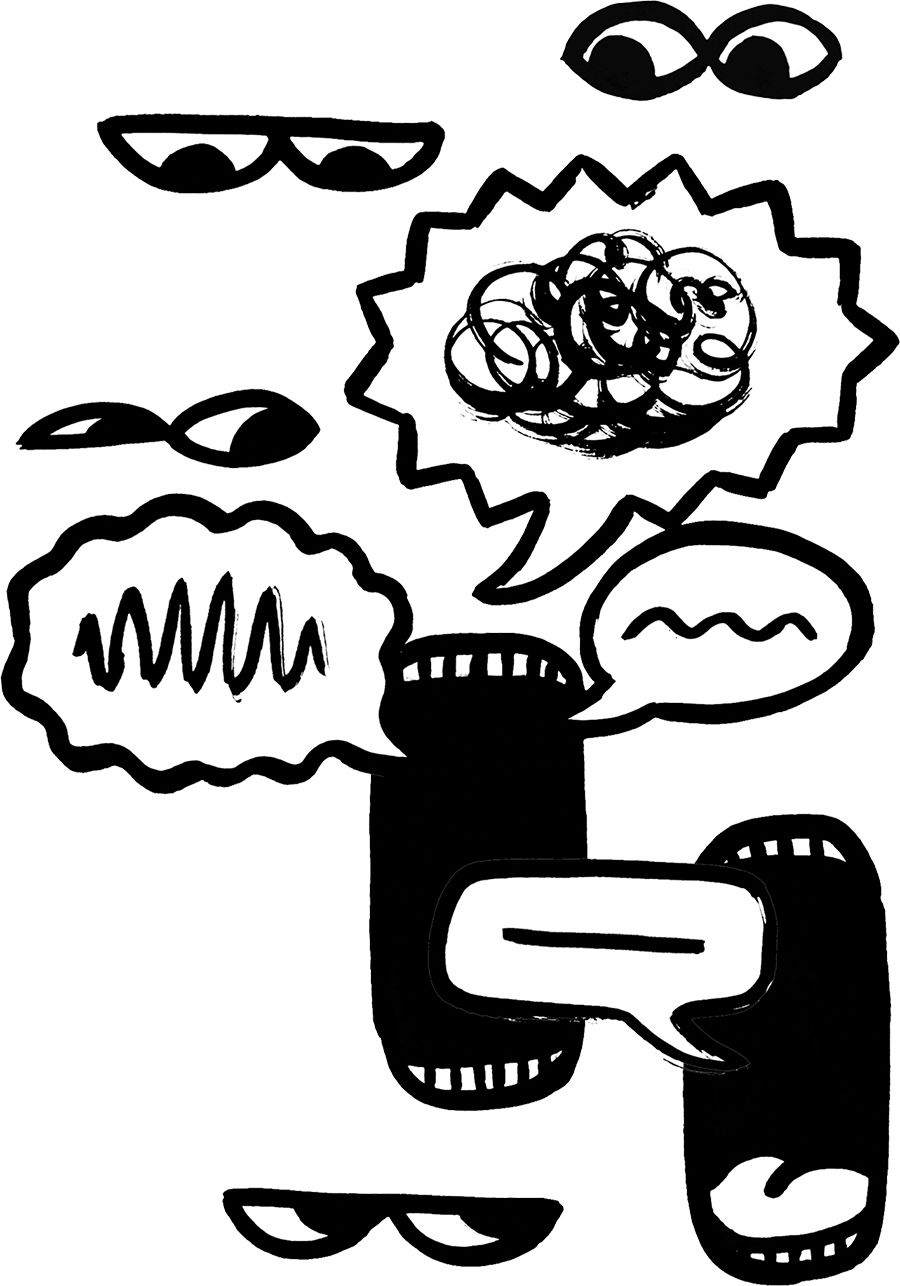
ET ÇA NOUS SERT À QUOI ?
Mais les deux effets les plus importants de l’information concernent la collectivité.
En premier lieu, informer permet de contrôler la façon dont les pouvoirs se comportent.
Non seulement les trois pouvoirs habituellement définis : le pouvoir législatif (le parlement), le pouvoir exécutif (le président, le gouvernement) et le pouvoir judiciaire, mais, en fait, toutes les autorités et sources d’influence sur nos vies : les pouvoirs locaux, économiques, administratifs…
Les médias sont un contrepouvoir (même si on les appelle parfois le « quatrième pouvoir »). Ils espèrent que la révélation d’une action contraire à la loi permettra d’y mettre un terme. C’est en cela également que la liberté de l’information est à la racine des autres libertés : elle permet, par la dénonciation de ce qui les menace, de les protéger.
En second lieu, l’information organise quelque chose que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelle « l’espace public ».
C’est-à-dire un ensemble de personnes rassemblées pour discuter des questions d’intérêt commun, un « lieu réel ou symbolique, dans lequel les idées circulent et sont discutées de manière rationnelle afin de se cristalliser en opinion publique ».
Les journalistes sont comme nous, ils vivent dans des sociétés où les débats et les controverses sont multiples et concernent tous les sujets. En plus de vérifier l’information, ils sélectionnent et hiérarchisent les sujets.
Certes, ils le font avec leurs propres idées, leurs propres préférences, leurs propres présupposés, mais, malgré cela, ils nous aident à faire le tri dans l’univers infini des discussions. Et ils préparent ainsi le débat politique, qui s’organise autour de quelques grands thèmes. Cette capacité à mettre en avant certains thèmes porte un nom : dicter l’agenda. En anglais, agenda setting.
Le premier à en avoir parlé est le sociologue français de la fin du XIXe siècle, Gabriel Tarde. Quand on parle d’agenda, il faut bien faire la distinction avec la propagande, ou même le prosélytisme : il ne s’agit pas, pour l’information produite par les rédactions, de dire au public ce qu’il doit penser, mais de l’aider à se mobiliser sur les sujets sur lesquels il faut penser.
La qualité et la fiabilité de l’information sont des données essentielles à la qualité du débat public.
Pour utiliser une image peut-être un peu caricaturale, dans le cadre d’un match de football qui ferait s’affronter deux équipes en présence, la qualité de l’information ressemble à la qualité du terrain et de ses repères au sol. Sans elle, pas de beau jeu, pas de partie possible qui puisse se dérouler de façon équitable.
Contrôler l’action des pouvoirs et organiser l’espace public : ces deux fonctions de l’information contribuent à permettre au « public » d’agir en citoyen.
C’est « dans l’intérêt du public », selon une expression couramment utilisée pour définir ce qui légitime la production d’information. Or, cet intérêt collectif n’est pas forcément évaluable par les individus. En économie, on appelle cela une externalité.
Cette externalité, cette transformation de l’utilisateur en citoyen, n’a pas de prix puisqu’elle permet au débat démocratique d’être vigoureux et dynamique. Elle justifie les politiques de soutien à l’information, comme les aides à la presse, ou l’existence de services publics d’information. Elle permet même à Jürgen Habermas (toujours lui) de considérer que l’information est un bien public qui appartient à tous.
L’information vaut donc plus que ce que nous sommes prêts à payer individuellement pour elle. Or elle n’est pas un don du ciel, un phénomène naturel qui nous tombe dessus comme la pluie. Elle n’a pas toujours existé. En quelques siècles, nous sommes passés de son invention à son accélération, pour aujourd’hui constater son engloutissement.
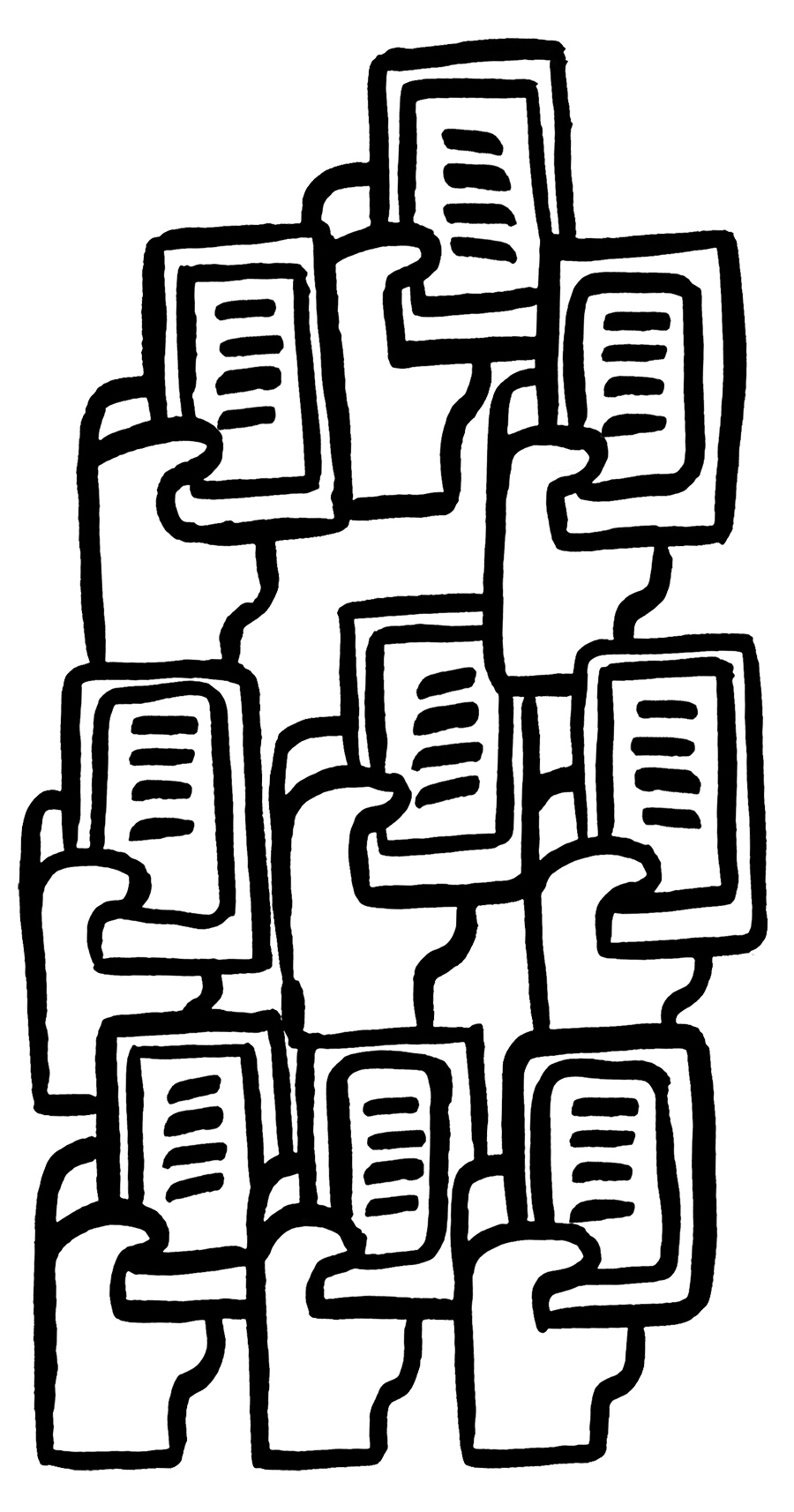
DE GUTENBERG… À ZUCKERBERG
L’Amérique a été découverte en 986 par le Viking Leif Erikson. Fils d’Erik le Rouge qui avait installé une colonie viking au Groenland, il a débarqué en Amérique continentale dans le Vinland, entre Terre-Neuve et l’anse du Saint-Laurent, et a exploré l’ensemble de la zone.
Vous ne le saviez pas ? C’est normal !

Seules quelques découvertes archéologiques récentes ont permis de l’établir avec certitude. Pour tout le monde, c’est en 1492 qu’a eu lieu la découverte de l’Amérique (même si le terme de découverte est inadapté, le continent étant habité par des peuples qui n’avaient nul besoin d’être « découverts »). 1492 va changer le destin de deux continents et constitue un événement majeur dans l’histoire du monde. Alors que 986 n’a produit aucun bouleversement.
Certes, de nombreux facteurs expliquent la différence de destin entre les deux dates, mais l’un d’eux retient notre attention : en 1455, Gutenberg a mis au point un système mécanique permettant d’imprimer des livres en grande quantité.
En « inventant » l’imprimerie, il a permis au savoir, à l’imaginaire, aux textes religieux et à l’information de circuler sans être limités par la lenteur de la copie, ou par les changements incessants et le manque de fiabilité de la transmission orale.
C’est le début de l’édition et des médias, qui vont produire la Réforme, les Lumières et, finalement, la démocratie moderne.
L’historien Pierre Nora l’a expliqué : les outils de transmission de l’information sont la condition d’existence de l’événement. Sans les médias, l’actualité passe sans qu’elle puisse se transformer en information. 1492 pouvait être un événement grâce à la technique de l’imprimerie désormais disponible. Pas 986.
Du XVIe siècle à aujourd’hui, l’histoire des médias et de l’information est celle d’une accélération vertigineuse.
Un moine copiste arrivait à fabriquer un livre par an. Dès 1455, l’atelier de Gutenberg imprimait 180 bibles par an. En 1500, 50 livres par semaine étaient produits en Europe, et il y avait plus de 15 millions de livres en circulation dans le monde en 1510. 1604 marqua la date de parution du premier journal à Anvers. Journaux, libelles et autres publications se multiplièrent dans le plus grand désordre et accompagnèrent tous les mouvements politiques des siècles suivants.
Lors de la seconde moitié du XIXe siècle apparurent les mass media, dont l’ère s’ouvrit avec les journaux à grand tirage, avant que n’arrivent la radio, qui connut le début de sa diffusion massive dans les années 1920, puis la télévision, dont le règne commença dans les années 1950. La fin du XXe siècle fut marquée par une multiplication des radios et des chaînes de télévision (grâce au signal numérique, au satellite et au câble), avant qu’Internet, au tout début du XXIe siècle, ne permette la transmission de l’information en tous lieux et à tous moments, puis que les réseaux sociaux, dès 2006, en assurent la circulation sans même qu’il soit nécessaire d’avoir directement accès aux médias qui les produisent.
D’un monde où l’information était rare, nous sommes passés à un monde où elle est surabondante, multiple, protéiforme et présente en permanence.
Il n’est plus possible désormais de quantifier les messages auxquels nous sommes soumis. Le flot ressemble à un tsunami quotidien, qui menace, à chaque instant, de nous engloutir. De Gutenberg à Zuckerberg (le créateur de Facebook), tout a changé.
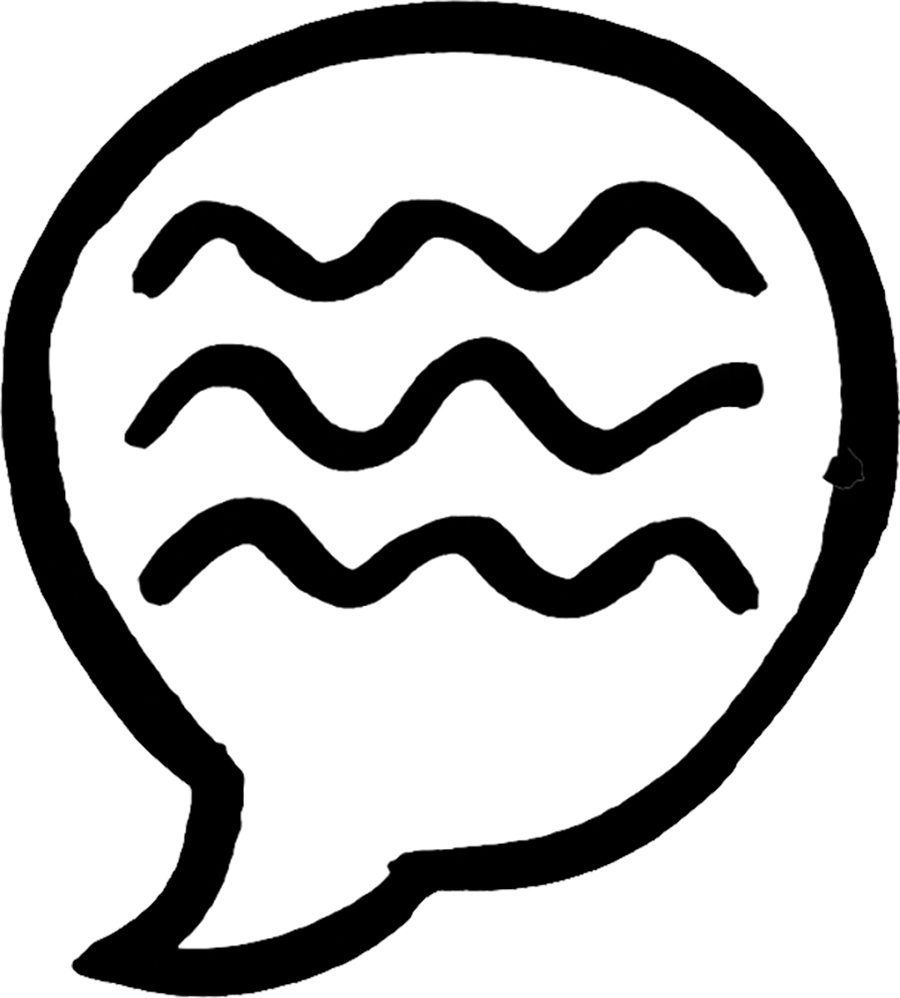
« THAT’S THE PRESS, BABY ! »
Plus personne, ou presque, ne regarde les vieux films hollywoodiens. Mais la mythologie qu’ils ont véhiculée reste imprimée dans nos cerveaux, quand bien même nous ne les connaissons pas. En matière d’information, Hollywood est une mine d’or. La presse, le ou la journaliste sont des héros à part entière, le quatrième pouvoir une force du bien. S’il ne fallait retenir qu’un film, mon choix se porterait sans doute sur Deadline USA (Bas les masques), un film de Richard Brooks de 1952. On y voit Humphrey Bogart, journaliste, dénoncer, à ses risques et périls, les crimes de gangsters tout-puissants. Jusqu’à la scène emblématique où le mafieux lui téléphone alors même qu’il se prépare à faire partir les presses rotatives. La menace est claire, s’il publie, sa vie sera en danger. Bogart ordonne de commencer le tirage. La sonnerie de mise en route retentit, le criminel lui demande ce qui fait un tel bruit. Réponse : « Ce son-là, c’est le son de la presse, baby, et il n’y a rien que tu puisses faire contre elle. »
Les Hommes du président, film d’Alan J. Pakula sorti en 1976, raconte une histoire similaire, cette fois-ci fondée sur des faits réels (le scandale des écoutes du Watergate1) et leur conséquence historique (la démission du président américain Richard Nixon en 1974). Même l’arrivée d’internet et des blogs qu’illustre en 2009 le film Jeux de pouvoir de Kevin Macdonald avec Russell Crowe et Rachel McAdams ne change pas la matrice de ces récits : quand il s’agit de lutter pour la vérité, les journalistes vont à l’encontre des puissants, de liens d’amitié, et même des intérêts économiques de leur journal. Comme le dit le slogan du Washington Post (adopté en 2017), « la démocratie meurt dans les ténèbres », et la presse est là pour apporter la lumière.
On l’oublie souvent, mais le vrai métier de Superman, c’est journaliste au Daily Planet, où son duo avec Lois Lane fait autant pour sauver l’Amérique que ses actions en cape rouge et collant bleu.
En 2021, le film Illusions perdues de Xavier Giannoli, d’après la deuxième partie du roman d’Honoré de Balzac, nous montre lui un tout autre visage de la presse, pendant la Restauration, au XIXe siècle : détenue par des partis ou des intérêts particuliers, elle hésite entre pure propagande et petites manipulations, et n’emploie que des professionnels dont le destin est de finir totalement corrompus.
En matière d’information, il n’existe ni âge d’or ni période maudite, et toutes les époques charrient leurs propagandistes et leurs enquêteurs.
Néanmoins, la généralisation du modèle de la rédaction indépendante soucieuse d’honnêteté et de neutralité est historiquement liée à un système industriel et économique précis. Ce qui veut dire que ce modèle peut être menacé par les évolutions de la technologie et de l’économie.
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE ?
Le milieu du XIXe siècle est marqué par trois inventions concomitantes qui vont bouleverser l’économie du journalisme et de l’information. Inventé en 1838 (dans sa version développée par Samuel Morse), le télégraphe permet de transmettre « un fait » de façon immédiate sur de très longues distances. C’est un changement majeur : auparavant, il pouvait se passer quelques mois ou quelques années avant qu’une « information » ne franchisse les frontières d’une région, d’un pays ou d’un continent (ainsi la mort de Simón Bolívar, à Caracas en 1830, ne fut-elle connue à Londres que huit mois plus tard, et à Madrid encore trois mois après). La rotative, brevetée en 1847 aux États-Unis, permet de produire des journaux vite et en grande quantité. Enfin, le chemin de fer, qui s’implante lors du « boom ferroviaire » des années 1840, devient un outil de diffusion des journaux sur l’ensemble d’un territoire.
L’industrie s’invite dans le domaine de l’information par l’invention des mass media : des médias qui ont les moyens de toucher un très grand nombre de personnes.
Et qui y ont intérêt, car le nombre de médias est limité en raison de ce qu’on appelle des barrières à l’entrée, qui rendent difficile leur multiplication. Pour les journaux, c’est le coût que représentent une presse rotative et la couverture d’un circuit de distribution. Plus tard, pour les radios et télévisions, ce sera la rareté des fréquences disponibles. Tout cela a une conséquence imprévue : pour toucher le plus de monde possible, il peut être intéressant d’aborder tous les sujets, et de ne pas se limiter à la défense d’un intérêt particulier. Voilà pour l’information générale et l’encouragement (sans caricaturer le processus, bien sûr) au journalisme factuel.
Par ailleurs, les médias, qui ne sont pas nombreux, ont un monopole d’accès à la population : ils deviennent donc un outil pour les petites annonces et la publicité, et un instrument essentiel lorsque arrive le phénomène de consommation de masse.
Le développement des journaux à grand tirage accompagne celui de l’industrie. L’essor économique des médias audiovisuels va de pair avec celui de la société de consommation. La mission d’amélioration de la démocratie devient désormais rentable.
Certains chercheurs en sciences politiques appellent ce hasard économique la démocratie industrielle. Le big bang numérique va faire exploser ce système de diffusion de masse pour promouvoir la multiplication des canaux et, pour l’information (mais pas que pour elle !), cela va tout changer.

LE BIG BANG
On date celui de notre univers à - 13,8 milliards d’années. Pour notre sujet, il est plus récent, et même tout proche : ce sont les années 2006-2007. Ces dernières voient se créer les réseaux sociaux, Twitter d’abord, Facebook ensuite, qui nous lient et relient aux autres et deviennent la porte d’entrée majeure de nos conversations. Surtout, Steve Jobs crée le smartphone avec l’iPhone et, avec lui, généralise la connexion de tous, à tout, tout le temps.
C’est l’écran total qui absorbe une partie croissante de nos existences via des applications qui entrent en concurrence les unes avec les autres.
Enfin, la publicité ciblée, inventée peu avant, débarque chez Facebook : les plateformes sociales savent beaucoup de choses de nous et de nos comportements, et se rémunèrent via la publicité proportionnellement au temps que nous leur consacrons. Se met alors en place ce que j’ai appelé « la civilisation du poisson rouge » : tous les messages sont en concurrence pour capter notre attention à tous moments de la journée, alors même que notre temps d’attention ne cesse de diminuer (8 secondes pour les poissons rouges, 9 pour nous). Dans cette économie de l’attention, l’universitaire Herbert Simon écrit dès 1969 :
« Un monde riche en messages est un monde pauvre en attention disponible. »
L’INFORMATION, NOYÉE DANS LE GRAND TOUT
Le numérique a fait subir à l’espace d’information deux changements majeurs. D’abord, sous l’effet de la technologie, il a cessé d’être linéaire : nous sommes passés de la relation en ligne directe entre la production d’information, la distribution et le public, à un système circulaire où le public peut produire et distribuer, les interfaces aussi, et ceux qui produisent de l’information peuvent distribuer et relayer ce qui est produit par le public.
Ensuite, c’est la fin des espaces organisés, qui résultaient d’une longue histoire politique, sociale et économique.
Dans le « monde d’avant », chaque espace social avait ses codes de conversation : un journal d’information ne produisait pas les mêmes messages qu’une conversation au bistrot, qu’un meeting politique, qu’un dialogue sur le canapé du salon lorsque l’on regardait la télévision, ou qu’une discussion en salle de classe. Et chaque message était reçu en fonction du lieu où il était produit. Notre téléphone bouleverse tout cela. En effet, un réseau social mélange tous les types de messages (information, commentaire, croyance, coup de gueule, humour, hypothèse, émotion à fleur de peau…), tous les contextes de conversations, et tous les degrés de langage. Dans un seul et même endroit et avec, le plus souvent, une règle unique.
Le mélange des messages, la confusion des rôles et la viralisation nourrissent le doute sur l’identité de celui qui parle et une incertitude sur la nature de ses propos.
L’endroit devient par nature instable et liquide. On est très loin de l’idée d’espace public proposée par Jürgen Habermas.
Il y a de quoi être fatigués !

LA MACHINE INFERNALE
C’est désormais le règne de l’émotion et de la croyance.
Les réseaux ont un principe d’organisation des messages tourné vers la rentabilité. Leur modèle d’affaires est celui de l’économie de l’attention, qui vise à nous faire rester le plus longtemps possible sur leur application ou leur site afin de développer leur chiffre d’affaires publicitaire. En conséquence, leurs algorithmes mettent en avant et font circuler les messages les plus « rentables », c’est-à-dire ceux qui attirent le plus notre attention (même quand on est en train de faire autre chose), et ceux que l’on va avoir le plus tendance à partager pour attirer l’attention de notre réseau d’« amis ».
Plus un message engage nos émotions, nos réactions « tripales », plus vite nous le regardons et plus nous le « viralisons ». Or, ce n’est pas parce que les réseaux n’ont pas d’idéologie qu’ils sont neutres.
Ils ont longtemps défendu l’idée qu’ils avaient le même lien avec les messages présents sur leur plateforme que le facteur avec le courrier qu’il transporte. Vous ne pouvez pas tenir pour responsable le facteur de la nature de la lettre que vous avez reçue. Mais il faut imaginer un facteur qui distribuerait certaines lettres mille fois plutôt qu’une, et qui par ailleurs en ferait la promotion auprès de certaines personnes à qui elles ne sont pas destinées !
C’est en cela que les réseaux sont des mécanismes d’accélération et d’amplification. Et ce qu’ils accélèrent et amplifient, c’est tout ce qui est en relation avec nos « tripes » : nos pulsions, nos émotions, la croyance, le complot, l’outrance… Tout cela est « mécaniquement » favorisé. L’information n’en fait pas partie, elle joue désormais un second rôle.
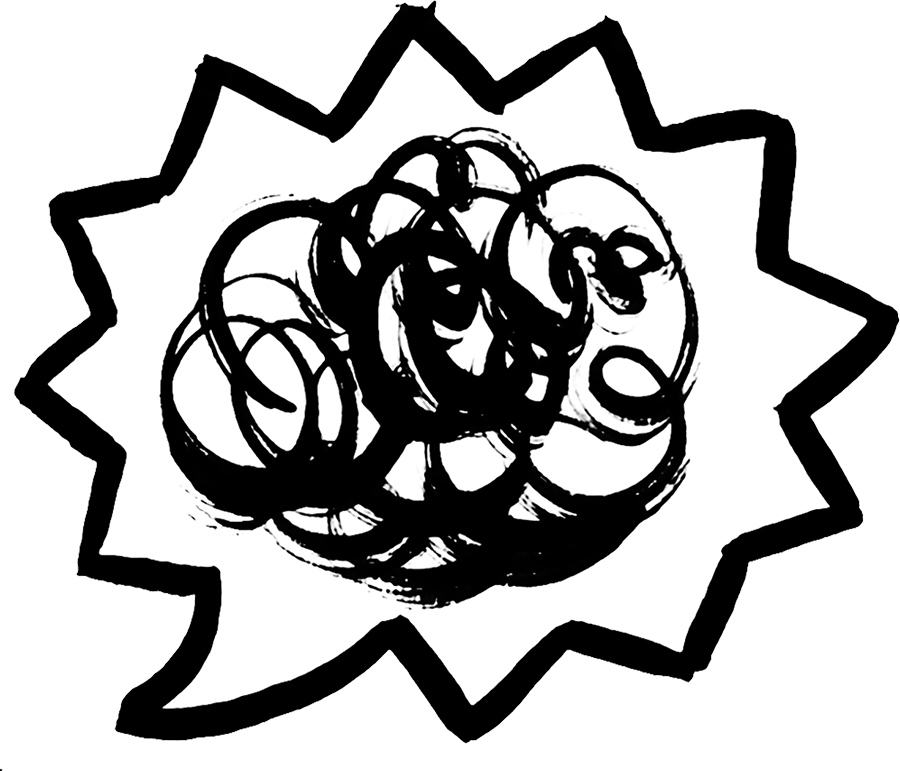
INNOCENTS, VRAIMENT ?
Nous sommes les victimes de ce système, bien sûr, mais des victimes consentantes. Nous ne sommes pas les objets des algorithmes, nous dansons le tango avec eux.
Prenons un exemple : chacun d’entre nous a partagé au moins une fois une vidéo d’animaux auprès des amis de son réseau. Bien plus que les messages de haine ou de désinformation, c’est ce type de contenu qui rencontre le plus de succès lorsque l’on est en ligne. Quoi de plus inoffensif que de viraliser la séquence d’un chien qui sauve un chat de la noyade, d’une souris et d’un chat qui se font un câlin, ou d’un canard qui repousse l’assaut d’un lynx pour sauver ses canetons ? Ces histoires ne sont-elles pas extraordinaires ? Elles le sont tellement que, la plupart du temps, elles n’ont aucun rapport avec la réalité et ne sont produites qu’avec force trucages.
Mais voilà, nous avons envie d’y croire.
En 2008, l’un des activistes de l’internet, Ethan Zuckerman, énonça la théorie du « chat mignon » (cute cat theory). Selon lui, les vidéos animalières étaient un moyen de véhiculer, en contrebande, des valeurs permettant la mobilisation sociale : attirés par les animaux, nous les admirions dans ces petits films, et ensuite, nous étions susceptibles de lire un message ou de regarder une vidéo plus engagés politiquement. Nous n’en sommes plus là. Les vidéos animalières « trop belles pour être vraies » sont partout, et elles nous habituent à voir ce que nous avons envie de croire, sans que nous nous posions la question de savoir si elles sont vraies.
Notre cerveau adore modifier notre comportement pour que nos croyances ne soient pas remises en cause.
Dès 1957, l’Américain Leon Festinger a expliqué comment nous produisons nous-mêmes des arguments pour contrer les faits qui bousculent nos certitudes. Il avait étudié à l’époque les membres d’une secte persuadés que la fin du monde était proche et qu’ils seraient sauvés, in extremis, par des extraterrestres. Que le monde soit toujours là et que personne ne soit venu de l’espace n’avait en rien diminué la conviction des membres que leur gourou disait vrai. Festinger appela cela la « dissonance cognitive ».
Une autre expérience, réalisée en 1967 et mentionnée par l’APA, l’Association des psychologues américains, démontrait même notre part de responsabilité dans ce mécanisme : plusieurs personnes furent soumises à un ensemble de discours qu’elles écoutaient au moyen d’un casque. Ces discours étaient difficilement audibles, car diffusés avec de nombreuses interférences. Néanmoins, il était possible pour l’auditeur d’appuyer sur un bouton pour rendre l’audition plus claire et faire disparaître toutes les scories. Le résultat fut implacable : chacun favorisait les messages allant dans le sens de ses convictions, et laissait brouillés les discours qui les fragilisaient. Par exemple, les fumeurs gardaient le brouillage sur les informations concernant le danger de la cigarette, mais interrompaient les interférences lorsque le locuteur parlait du plaisir de fumer. Les algorithmes ne sont pas les seuls à nous enfermer dans ce qu’Eli Pariser a appelé une bulle de filtre, un environnement de messages correspondant à nos ressentis. Nous contribuons à cette bulle.
Nous sommes entrés dans l’époque où la structure des réseaux (liés à leur modèle économique) et la nature humaine se font la courte échelle pour imposer, dans tous les domaines, la domination de l’émotion, de la croyance et des pulsions.
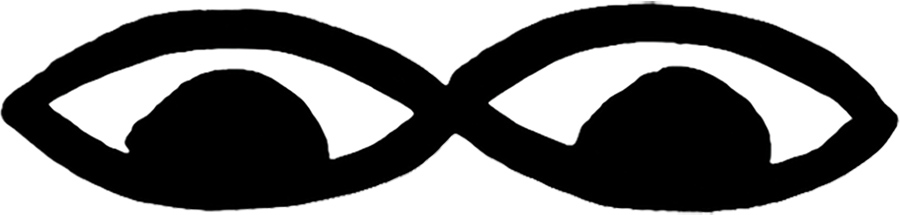
LA GUERRE DES RÉCITS
L’information de masse, du temps de sa prédominance, structurait la discussion publique. À défaut de récit unique, elle permettait qu’une partie importante de la conversation se fonde sur un même principe de réalité de faits partagés. Les opinions pouvaient être tranchées, les objectifs politiques opposés, mais il existait une sorte d’accord tacite pour parler des mêmes sujets, et à partir de tel ou tel fait vérifié, dont l’existence n’était pas niée. On s’aperçoit aujourd’hui à quel point c’était précieux.
Un espace public où tout le monde se croit prophète et, dans le même temps, doute de tous et de tout, nourrit un affrontement d’un nouveau genre : la guerre des récits.
Fake news (« une information fausse chargée en ressort émotionnel délibérément fabriquée pour la faire ressembler à une information crédible »), désinformation (« une information biaisée utilisée à des fins de propagande ») et mésinformation (« une information inexacte relayée par quelqu’un de bonne foi ») circulent dans le même espace que l’information, et tendent à être privilégiées de façon pulsionnelle.
À l’intérieur de chaque territoire, c’est le combat des arguments de tous contre tous, de toutes les opinions contre toutes les opinions, le combat qui remplace le débat.
Cette polarisation produit une démocratie émotionnelle, une « émocratie », qui tend vers l’ingouvernabilité.
Entre États peut apparaître ce que l’on appelle désormais la guerre hybride, qui commence par des campagnes de désinformation avant d’aboutir à l’offensive militaire.
Dans tous les cas, l’information est l’ennemie.
La guerre menée par la Russie en Ukraine donne une illustration parfaite de la guerre des récits : il s’agit, pour le Kremlin, d’utiliser l’ensemble des réseaux pour combattre chaque histoire, chaque fait recueillis sur le terrain par les journalistes : les cadavres ukrainiens deviennent des acteurs payés, les bombardements russes des incendies volontairement déclenchés par les militaires ukrainiens pour émouvoir l’opinion occidentale.
Ne pas s’informer, c’est laisser entrer la guerre des récits en nous, être son objet et son sujet.
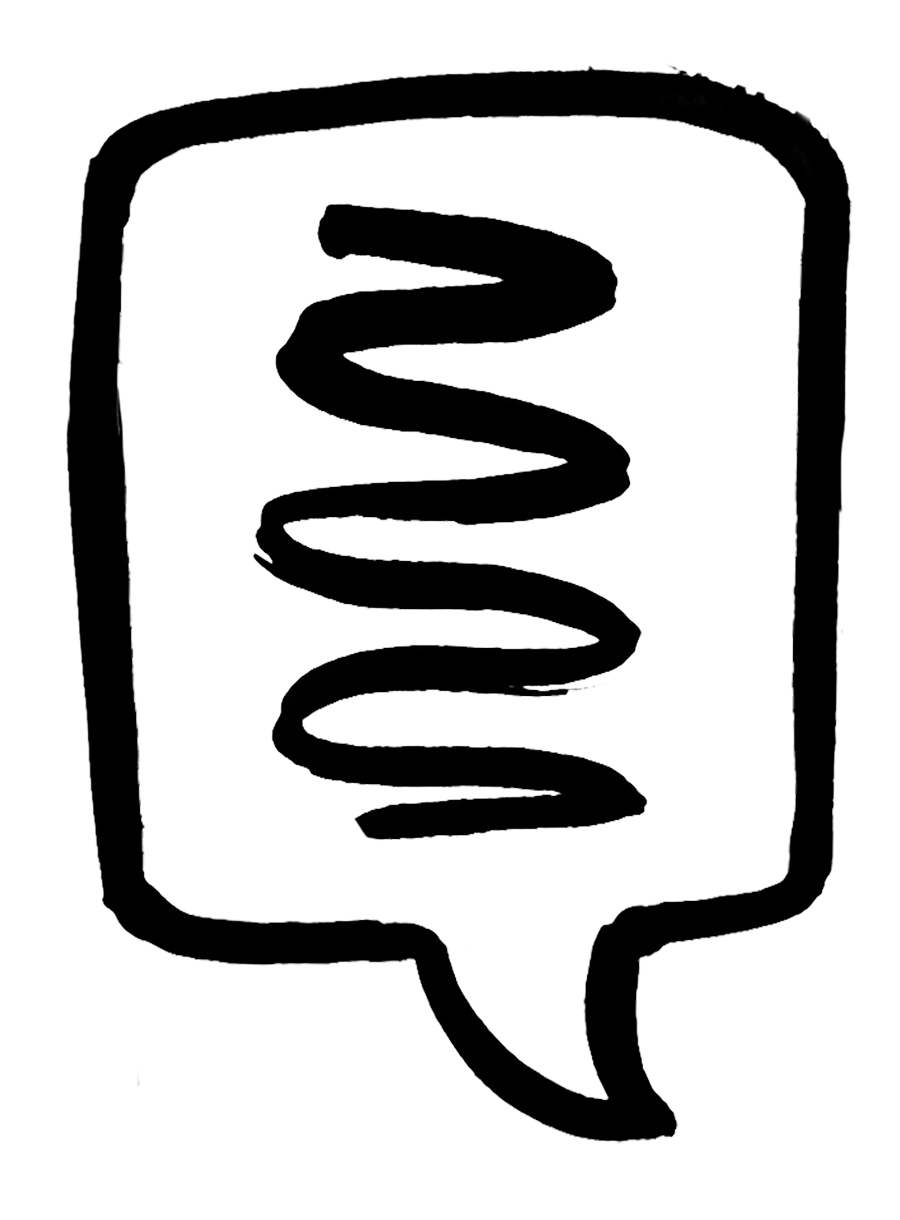
LA CONFIANCE
Finalement, personne ne gagne à cette déstabilisation produite par les réseaux et la relégation au second plan de l’information. La première victime n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la vérité et l’exactitude des faits : celles-ci sont toujours produites par les médias sérieux d’information, anciens ou nouveaux, qui continuent à faire leur travail, même s’ils ont été fragilisés économiquement, et ne sont plus que des acteurs marginaux quand on parle d’accès à la multitude. La première victime de la déstabilisation générale, c’est la confiance, entre institutions et entre citoyens.
L’absence d’information nourrit la défiance envers tout interlocuteur qui ne partage pas notre opinion et notre croyance, et elle nous laisse comme ballottés au rythme des buzz et des controverses.
La confiance est à la fois le produit de l’information, et la condition de sa réception. Elle est une construction permanente, qui permet la circulation de l’information.
ALORS, QUE FAIRE ?
S’informer, c’est contribuer au rétablissement de la confiance entre nous tous.
S’informer quotidiennement, c’est un peu comme les cinq fruits et légumes par jour : quelque chose qui nécessite une action de notre part, ce que les Anglo-Saxons appellent notre régime informationnel (news diet). Ce n’est pas une contrainte mais un outil d’émancipation individuelle, cela nourrit notre capacité à agir.
Ensuite, il est utile de comprendre que, quels que soient nos usages, ce qui compte n’est pas l’outil (le portable, l’imprimé…), ou l’interface (Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, ou une autre application), mais la source. « Je l’ai lu sur Twitter », cela ne veut rien dire. « Je l’ai lu sur le compte de l’Agence France Presse sur Twitter », c’est différent.
C’est pourquoi il faut, individuellement, se forcer à s’informer auprès de sources qui respectent les règles de la vérification, de l’indépendance (autrement dit, du désintéressement) et de la responsabilité.
Bien sûr, il y a des « marques » d’information qui ont leur histoire (ceux que l’on appelle les legacy media), et les nouveaux acteurs bien installés ; mais dans la fourmilière des comptes et des pages qui se créent chaque jour sur les réseaux, il nous faut essayer de discerner ceux qui ont une démarche journalistique, qui expliquent l’origine de leur information en donnant des explications sur sa fabrication, les sources utilisées et les difficultés rencontrées.
L’engagement pour une cause n’est pas forcément contraire à l’information.
Ce qui compte, c’est de savoir si ce qui est transmis respecte la rigoureuse exactitude des faits et ne ment ni par action ni par omission.
Enfin, on peut s’efforcer de ne partager sur les réseaux, à titre d’information, que ce qui nous semble avoir respecté la règle VIA. Ce qui nous confère, comme public, un rôle nouveau : celui de participer à la « validation » collective de l’information.
Voilà. Pas simple, mais important et, finalement, exaltant.
À vous de jouer !









