« Réparer et réinventer le service public »
Temps de lecture : 9 minutes
Certains moments clés ont-ils marqué la dégradation des services publics ?
Oui. De la même manière qu’il y a eu un moment 1945 à travers la Sécurité sociale, les nationalisations, on peut dire qu’au milieu des années 1990 se cristallise un moment de la réforme de l’État qui a été préparé par la vague idéologique Reagan-Thatcher. Rappelons les mots de Reagan : « L’État n’est pas la solution, il est le problème. » Des travaux académiques, dits du Public Choice (ou théorie des choix publics), vont étayer l’idée que le but des élus et des dirigeants d’administrations serait d’augmenter la dépense publique pour avoir plus de pouvoir. Critique qui conduit à adopter dans les administrations le New Public Management, la nouvelle gestion publique qui s’inspire du modèle de l’entreprise, dont elle va appliquer certaines recettes à l’intérieur de l’État : séparer la définition de la stratégie de son exécution, favoriser la contractualisation, instaurer des récompenses individuelles ou institutionnelles. Une pensée principalement portée par les consultants.
« La droite instaure un discours de réforme de l’État, alors que le mot de "réforme" est à l’origine de gauche »
En France, son succès fut d’abord d’ordre sociologique, comme Bourdieu le décrit dans La Misère du monde : les élites publiques et privées ont été sur les bancs des mêmes écoles et portent la même vision positive du monde de l’entreprise, avec, de plus, un enjeu de survie pour les hauts fonctionnaires.
Pourquoi ?
Dans les années 1990, l’Europe et les collectivités territoriales montent en puissance. Apparaît l’idée, entre elles, d’un État stratège – ce qui permet aux hauts fonctionnaires de reprendre la main : au lieu d’être des dirigeants de grandes troupes, ils vont prendre des postes de pilotage et retrouver un prestige par le haut, à travers des contractualisations, des objectifs de performance, la régulation de secteurs ouverts à la concurrence.
La gauche est alors au pouvoir en France avec Lionel Jospin, mais aussi en Europe, avec Gerhard Schröder et Tony Blair. Observe-t-on une fracture politique sur ces questions ?
Non, c’est étonnant. Au niveau européen, le consensus dominant est celui de la concurrence, notamment à travers la question du contrôle des aides d’État, lequel est unique au monde et d’inspiration ordolibérale : une spécificité de la construction européenne est de créer un marché commun ; si un État commence à subventionner son industrie, cela déséquilibre le fonctionnement concurrentiel ; Bruxelles a donc interdit les aides d’État aux entreprises. Mais qu’est-ce qu’une entreprise et qu’est-ce qu’un service public ? Chaque pays a dû démontrer à la direction de la Concurrence que telle activité relevait de ce dernier et non du marché. Cette approche a eu un effet puissant de démantèlement des services publics. Elle est toujours poussée par les ordolibéraux, néerlandais et allemands surtout.
Qu’entendez-vous par ordolibéraux ?
L’ordolibéralisme est une doctrine née au début du xxe siècle, qui sera mise en place en Allemagne de l’Ouest après la chute du nazisme, et qui considère que le but de l’exécutif est avant tout de garantir un marché libre et non faussé, que l’État doit se limiter à créer un environnement dans lequel l’initiative privée sera récompensée. Ce n’est pas un simple libéralisme passif : on agit positivement pour que le marché donne le meilleur de lui-même.
Quand cette doctrine est-elle arrivée en France ?
Deux phénomènes parallèles se sont produits : le libéralisme dans l’économie, et l’importation du logiciel libéral dans l’État, le New Public Management, dont on a déjà parlé. C’est cette deuxième branche qui s’est développée en France dans les années 1990, pour les raisons sociologiques évoquées, mais aussi pour des raisons politiques : on assiste à une inflation des dépenses publiques. La droite instaure un discours de réforme de l’État, alors que le mot de « réforme » est à l’origine de gauche. L’idée qu’il est nécessaire de juguler cet État jugé obèse est reprise en premier par Édouard Balladur. Entre 1993 et 1995, il commande deux rapports : le premier, dans le cadre de la préparation du 11e Plan, est dirigé par Christian Blanc et porte sur le service public de l’an 2000 ; le second, confié à Jean Picq, de la Cour des comptes, aboutira à un énorme travail – 700 pages, produites par cinquante rapporteurs, sur ce que doit être l’État du futur.
Quels services publics sont alors les plus visés ?
D’abord la Sécurité sociale. On met en place plusieurs dispositifs, dont la tarification à l’activité des hôpitaux, quintessence de ce système, instaurée sous Sarkozy : on fixe un prix pour chaque prestation. Deux effets s’ensuivent : la création d’une immense bureaucratie et l’instauration d’une mécanique de concurrence entre tous les acteurs – cliniques privées, médecine de ville et hôpitaux publics. On pousse à aller à la chasse aux prestations les mieux rémunérées, plutôt que de s’inscrire dans une logique de coopération.
Tous les services publics ont par ailleurs été concernés par les indicateurs de suivi de la performance. Cela s’est généralisé avec la systématisation d’environ 1 200 d’entre eux par la Lolf (Loi d’orientation des lois de finances), une loi organique votée en 2001, sous Lionel Jospin, par une majorité qualifiée – ce qui signifie qu’il y avait un consensus politique.
« Avec la Lolf, chaque administration a droit à un certain nombre d’emplois. Elle n’est pas autorisée à engager davantage de personnes »
Chaque politique publique doit ainsi être évaluée. Cette logique sera la source de beaucoup de mal-être chez les fonctionnaires de terrain. Ceux-ci ne se retrouvent pas dans les indicateurs censés représenter leurs résultats. Le street-level bureaucrat [le fonctionnaire en contact avec le public] fait un travail discrétionnaire : tout est dans la pâte humaine, comme l’a montré le sociologue américain Michael Lipsky. Le cas typique est le professeur des écoles : on ne peut jamais ramener son travail à un indicateur.
À quel moment est apparue la notion de rentabilité des services publics ?
On ne ressent pas à l’intérieur de l’État une injonction de rentabilité. Il y a eu en revanche des incitations à développer des ressources propres. Cela consiste, par exemple, à dire au personnel du Louvre : « Vous avez la Joconde, tirez bénéfice de cet actif public de manière intelligente. » Ce qui est fort surtout, c’est la pression mise sur les moyens. La Lolf instaure un pilotage très fin de la dépense publique, du personnel en particulier. C’est très important pour comprendre pourquoi la sous-traitance s’est beaucoup développée.
De quelle manière ?
Avec la Lolf, chaque administration a droit à un certain nombre d’emplois. Même si elle développe des ressources propres, elle n’est pas autorisée à engager davantage de personnes. Se rajoute ce qu’on appelle la fongibilité asymétrique : une administration peut puiser dans le budget voué à la masse salariale qui lui est alloué pour payer un prestataire, mais elle n’a pas le droit de faire l’inverse, d’utiliser les crédits avec lesquels elles payent des prestataires – de Capgemini ou autres – pour embaucher à la place des développeurs informatiques intégrés à ses propres équipes.
La conjonction de ces deux phénomènes fait que les administrations se sont beaucoup désarmées sur le plan humain, d’où des pertes de compétences. Le pilotage global de la dépense a des effets pervers, comme la logique des appels à projets, qui déstructure les services publics. On alloue aux administrations des fonds sur des périodes assez courtes, à condition qu’elles privilégient certaines options, qui peuvent n’être que des modes. On perd l’autonomie et le sens du long terme.
Ces tendances se sont-elles poursuivies ?
Le grand coup d’accélérateur s’est opéré sous Sarkozy avec la RGPP (Révision générale des politiques publiques), la tarification à l’activité des hôpitaux, la pression sur les statistiques de la délinquance, ou encore le recours aux consultants privés, qui n’existait pas avant. Sous Hollande le côté le plus agressif de ces évolutions a été gommé, comme les objectifs de réduction du nombre de fonctionnaires, sans remise en cause de la logique profonde. Le quinquennat précédent a débuté avec une approche plutôt New Public Management. À la suite de la crise des Gilets jaunes, il y a néanmoins eu une prise de conscience, incarnée par Amélie de Montchalin, qui a voulu recréer un désir de service public. Il y a eu un moment de bascule, que le Covid a confirmé.
Est-il possible de revenir en arrière ?
Oui, c’est réparable. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, veut faire de l’attractivité des métiers publics sa priorité, en misant sur leur sens, la rémunération et les conditions de travail. C’est essentiel. Dans une note coécrite avec Vincent Feltesse, nous proposons des états généraux du service public, pas seulement pour le réparer, mais pour définir ce qu’il doit être à l’avenir, le réinventer. Nous devons aujourd’hui effectuer plusieurs transitions. Ce n’est pas l’État qui va les opérer lui-même. C’est un problème de la société et du marché. On doit d’abord penser un État qui fixe un cap et puisse construire des alliances, avoir des effets d’entraînement pour donner de l’accélération aux forces économiques et sociales en mesure de résoudre les problèmes. Il faut trouver des manières de faire bouger la société, mais il y a un défi auquel on n’a pas suffisamment pensé : celui du passage à l’échelle.
C’est-à-dire ?
On a beaucoup de dispositifs pour amorcer, pour inciter, mais cela ne permet pas une bascule globale. Le casse-tête de la rénovation thermique des bâtiments l’illustre bien. Il faut réfléchir à de nouveaux modes d’intervention entre fonctionnaires, académiques, associations, entreprises, qui permettent vraiment de changer la vie des gens.
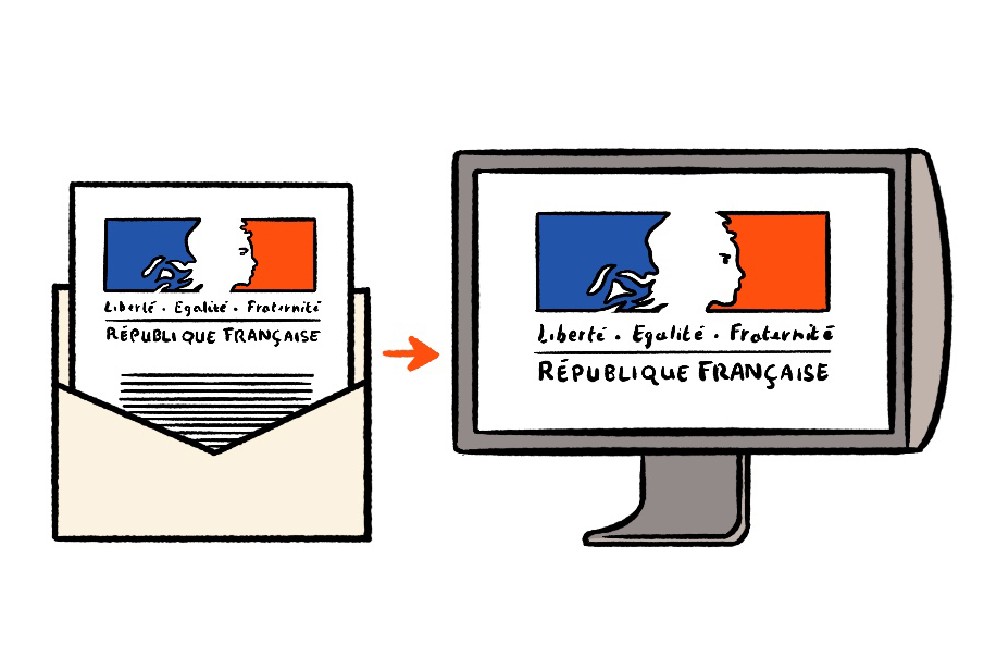
Tout ne dysfonctionne pas dans le service public…
Non, bien sûr. Et l’État est devenu plus efficace grâce à la dématérialisation. Il y a un paradoxe à regretter les guichets dont on désespérait ! Un grand progrès a été fait au niveau des impôts et de la délivrance des pièces d’identité. Est-on allé trop loin, trop vite ? La question est légitime. Mais il faut souligner qu’on a assisté à de petits miracles pendant la crise du Covid. Le ministère de la Santé a ainsi mis en place une procédure, SI-DEP, permettant de suivre en temps réel la remontée automatique de tous les tests antigéniques. Grâce à Vite ma dose ou Doctolib, sont apparues des solutions utiles qui n’étaient pas apportées par le service public, mais qui s’appuyaient sur lui.
Que faire pour redonner envie aux Français de s’engager dans les services publics ?
Il faut à la fois remettre cette notion sur un piédestal et inventer un nouveau service public. La manœuvre est difficile. On doit redonner de la fierté, du désir public, renouer avec une certaine radicalité du service public et, en même temps, changer son contenu. Il y a un momentum, une opportunité favorable, à créer. Le sens est un moteur majeur de l’engagement dans le service public. 55 % des agents continuent de penser à leur travail quand ils n’y sont pas – 19 points de plus que du côté des salariés du privé. Bourdieu disait que la main droite de l’État a complètement broyé la gauche : à droite les hauts fonctionnaires, à gauche les fonctionnaires de terrain. Quand je me suis mis à écrire mon livre (Un avenir pour le service public, Odile Jacob, 2020), j’ai réalisé que j’avais été complice voire acteur de cette maltraitance. Nous, technocrates, vivons dans une mythologie de la modernité. Cela cause des dégâts considérables. Le collectif Nos services publics a fait une enquête auprès de 4 500 fonctionnaires. Ressort le sentiment d’absurdité. Les gens sont mis face à des situations où ils doivent faire le contraire de ce que leur sens du devoir leur dicte.
Propos recueillis par JULIEN BISSON & ÉRIC FOTTORINO
« Réparer et réinventer le service public »
Sébastien Soriano
Le haut fonctionnaire Sébastien Soriano appelle à redorer le blason de la fonction publique mais souligne également la nécessité de repenser le rôle et la place de l’État.
Destins de fonctionnaires
Manon Paulic
Un greffier, une inspectrice des impôts, une aide-soignante, une ex-militaire... Témoignages de quatre fonctionnaires qui ont choisi de changer de carrière,
en quittant ou non le secteur public.
[Ronds-de-cuir]
Robert Solé
Le petit coussin destiné à soulager le postérieur des bureaucrates est devenu le sobriquet des gratte-papier des adminstrations.
Quitter l’Éducation nationale
Lou Héliot
Une enquête de notre journaliste Lou Héliot sur les difficultés de recrutement et les démissions dans l’Éducation nationale.








