« L’abeille récolte et féconde »
Temps de lecture : 6 minutes
Une enquête de l’université du Maryland montre que les apiculteurs américains ont perdu en moyenne 42,1 % de leurs colonies entre avril 2014 et avril 2015. Constatez-vous le même phénomène ici ?
C’est effectivement une tendance que j’ai constatée depuis le début de ma carrière, il y a une trentaine d’années. Les mortalités sont beaucoup plus importantes, même si on ne peut pas parler de disparition. En réalité, nous nous adaptons, c’est-à-dire que nous arrivons à trouver normales des choses qui ne le sont pas.
Dans votre livre, L’Abeille (et le) Philosophe, vous évoquez plusieurs facteurs pour expliquer la surmortalité des abeilles. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Parmi les causes étudiées, j’en distinguerai deux qui l’emportent, si je puis dire. Tout d’abord, il y a eu l’arrivée du varroa, un acarien venu d’Asie qui se reproduit à l’intérieur de la ruche, dans le couvain. Le varroa est ainsi protégé : il est du coup à l’abri des produits que nous utilisons pour nous en débarrasser.
L’autre cause majeure de surmortalité, c’est la généralisation dans les années 1990 des semences enrobées de pesticide, notamment une famille de produits qui s’appellent les néonicotinoïdes : Gaucho, Poncho, Cruiser, etc. Il en reste ensuite dans la fleur, et nous nous sommes rendu compte que ces produits déstabilisent l’abeille sur le plan neurologique. En butinant des fleurs contaminées, celle-ci voit sa capacité à s’orienter détériorée. L’abeille ne retrouve plus le chemin de la ruche et finit par mourir, incapable de vivre sans sa colonie. Bien que les pesticides ne tuent pas forcément l’abeille directement, ils affectent son comportement. Ils la rendent plus vulnérable à d’autres types d’agressions face auxquelles elle ne se débrouillait pas mal.
Après, il y a d’autres causes qui peuvent être plus ponctuelles, notamment une perte de la diversité florale dans certaines régions, due à l’uniformisation des cultures.
Tous ces phénomènes ne sont pas à mettre sur le même plan, en particulier pour les néonicotinoïdes. Ces derniers résultent d’une action humaine, alors que le varroa, nous n’y pouvons rien : c’est un effet de la mondialisation. Nous ne pouvons que le subir tandis que le traitement des semences est provoqué.
Est-ce que la manière d’élever des abeilles a changé ces dernières années ?
Chacun peut constater un changement important. Il y a encore quelques années, d’innombrables ruches émaillaient le territoire. Toutes les fermes, dans un coin du jardin, possédaient une petite ruche dont les propriétaires ne s’occupaient pas forcément. L’arrivée du varroa les a fait disparaître. Ensuite l’apiculture s’est concentrée : en dix ans, le nombre de ruches a baissé de 40 % sur l’ensemble du territoire.
La principale parade aux surmortalités est d’élever des abeilles. Donc les apiculteurs « élèvent » beaucoup plus d’essaims et de reines qu’auparavant pour maintenir les cheptels. Pour ma part, j’essaie de suivre les floraisons au fil des saisons. Nous nous sommes mis à transhumer beaucoup plus loin au sud, dans le but de raccourcir l’hiver le plus possible.
La fascination pour le destin de l’abeille est millénaire. Leur fragilité est-elle un phénomène ancien ? Ou bien s’agit-il seulement de la peur de leur perte ?
Je retiens plutôt la seconde explication. Ce que nous développons dans le livre, c’est cette histoire de communauté de destin entre l’homme et l’abeille, cet effet miroir qui fait que les malheurs qui peuvent arriver aux abeilles anticiperaient ceux des hommes. Dans le mythe grec d’Aristée, qui fait figure de premier apiculteur professionnel, l’équilibre entre la nature et la culture est rompu lorsque les abeilles disparaissent. C’est le premier colony collapse disorder : le syndrome d’effondrement des colonies, qui angoisse tant les apiculteurs d’aujourd’hui. Mais là, nous sommes davantage dans la métaphore et la symbolique.
Comme tout être vivant, l’abeille a été soumise à des prédateurs. En revanche, ce que nous constatons aujourd’hui prend une ampleur sans précédent. Il y a là quelque chose de tout à fait nouveau, qui nous renseigne aussi sur notre rapport à la nature, à la planète, à notre environnement.
L’abeille récolte du nectar, non seulement sans nuire à la fleur mais en la fécondant. C’est-à-dire qu’en butinant plusieurs fleurs d’une même espèce, elle déplace des grains de pollen, nécessaires à la reproduction. Par l’effet de pollinisation, l’abeille crée une valeur bien plus importante que celle de son propre miel. C’est une externalité positive, pour parler comme un économiste.
Il s’agit d’une réflexion majeure. Une fois que l’on a pris conscience de la finitude de la planète, des ressources limitées dont nous disposons, l’abeille peut fournir, par son rapport économique à son environnement, une piste de réflexion.
Comment réagit-on à la disparition entière de ruchers ?
La première réaction de l’apiculteur, c’est de se dire : « Je suis complètement nul, je ne sais pas faire. » Après, on rend visite aux collègues et l’on se rend compte que c’est une situation plus générale... J’ai connu deux années particulièrement difficiles.
Pensez-vous que le plan national proposé par Ségolène Royal, « France, terre de pollinisateurs », sera suffisant pour protéger ces insectes et particulièrement les abeilles ?
Il y a quelque chose qui me paraît très positif, c’est la prise en compte de tous les pollinisateurs. Il est vrai que l’abeille a tendance à occulter les autres espèces comme le bourdon, la mouche ou le papillon, car elle est responsable du travail de pollinisation à hauteur de 80 %.
Ensuite, il y a d’autres mesures d’ordre plus symbolique : le développement des abeilles dans les villes ; favoriser aussi la diversité le long des routes… Il reste que la question des néonicotinoïdes est la plus décisive. Le travail de sensibilisation est capital, mais j’ai peur qu’à trop vouloir sensibiliser, nous oubliions l’objectif principal : arriver à interdire ces produits.
Propos recueillis par JOSEPH BOJU


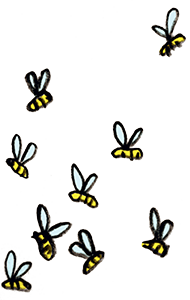
« Nous nous agressons lorsque nous agressons la nature »
Gilles Boeuf
Les abeilles sont-elles des vigies ou des thermomètres dans la relation entre l’homme et la nature ?
Je préfère le mot vigie. C’est un fait historique. Les abeilles pénètrent dans le Nouveau Monde en 1620 avec les …
Ruches
Robert Solé
Championnes de l’organisation, les abeilles ont toujours fasciné les humains. « Aucun peuple de la terre n’a autant de vénération pour son roi, affirmait Virgile. C’est lui qui surveille les travaux des mouches à miel, lui qu’elles es…
Morale et politique des abeilles
Luc Ferry
Dans la conception révolutionnaire du « gouvernement de la vertu » élaborée par les jacobins dans les années 1790, seule l’action désintéressée peut être dite moralement bonne. Par contraste, la sociét&…







