« Nous sommes passés des inégalités passives aux inégalités actives »
EntretienTemps de lecture : 6 minutes
Que vous inspire la vague de protestation soulevée par le projet de réforme du collège défendu par le gouvernement ?
Elle dit beaucoup sur la nature du système d’enseignement français. Ceux qui protestent tiennent à défendre et à maintenir des formes élitaires d’éducation. Il est intéressant de resituer ce phénomène dans l’histoire. J’ai commencé la sociologie de l’éducation dans les années 1960 avec Pierre Bourdieu. Dans Les Héritiers (ouvrage coécrit avec Jean-Claude Passeron), il avait mis en évidence nombre d’inégalités sociales et culturelles devant le système scolaire. Celles-ci n’ont pas diminué. À cette époque, l’opinion criait au scandale, convaincue que l’école devait forcément être égalitaire. En réalité, les inégalités se reproduisaient d’année en année, mais des inégalités passives : vous étiez né dans une famille de formation scolaire supérieure, avec une bibliothèque à la maison, des parents vous emmenant au musée, alors vous réussissiez à l’école. C’était discret et efficace. Les parents ne faisaient rien d’autre que reproduire et transmettre une culture qu’ils avaient eux-mêmes acquise « naturellement ». Ces inégalités se produisaient toutes seules. L’école était ainsi faite qu’elle s’adressait à la tête de classe plus qu’à la queue.
En quoi les inégalités se sont-elles aggravées ?
Depuis les chocs pétroliers des années 1970, avec la montée du chômage et la raréfaction des emplois, on s’est persuadé qu’un bon bagage scolaire vous protégeait du chômage. L’école est devenue un lieu de compétition et les inégalités sont devenues actives. Les dérogations à la carte scolaire se sont multipliées, les établissements se sont peu à peu spécialisés. On a vu apparaître une ghettoïsation d’écoles et de collèges, pas seulement en banlieue, avec le phénomène de désertion des enfants de familles favorisées. Dans les ghettos scolaires, la mixité sociale a disparu. Le phénomène s’est imposé dans les beaux quartiers, certains établissements sélectionnant les élèves dès le collège. Avec la crise, on s’est très bien habitué aux inégalités. L’école est devenue une question de consumérisme familial : comment assurer à nos enfants la meilleure scolarité possible. Avant, on voyait plus large. Maintenant, c’est un terrible chacun pour soi qui s’exprime dans la violence des réactions à la réforme. Certains acceptent les inégalités dès lors que leurs propres enfants sont bien lotis.
Comment expliquer cette rupture ?
Ce mouvement d’opinion très orchestré rappelle beaucoup la Manif pour tous, avec l’enseignement privé en soutien. Le courant protestataire est entièrement organisé autour de la sauvegarde des privilèges des catégories qui profitaient déjà pleinement du système scolaire et veillaient à maintenir son élitisme. Le collège n’a jamais été vraiment unique. Il a toujours connu des spécialisations par matières ou territoriales. Les responsables politiques ont proféré des énormités sur les dangers que pouvait faire courir la réforme au système, en modifiant l’enseignement des langues anciennes ou vivantes. Les changements en jeu ne sont pourtant pas considérables. On va apprendre à tout le monde une seconde langue vivante dès la cinquième. Ce qui pose problème, c’est ce « à tout le monde ». Or c’est un progrès considérable !
L’école française n’est pourtant pas un modèle de réussite…
On dispose depuis l’an 2000 de très bonnes statistiques scolaires pour le CE2, la sixième, la troisième, avec des comparaisons internationales, comme le classement PISA des pays de l’OCDE. On peut faire deux constats. D’abord, les performances de la France sont très moyennes, et elles se dégradent. On assiste à l’accroissement des écarts entre l’élite et le bas, avec un gonflement progressif du nombre d’élèves qui peinent à assimiler la base : lire, écrire, compter, raisonner. Il est certain que la part d’élèves en grande difficulté augmente. Les plus faibles se situent en dessous du niveau des élèves les plus défavorisés de l’OCDE, comme ceux de Turquie. Ensuite, c’est chez nous que le lien entre réussite scolaire et milieu social est le plus accentué. L’essentiel de l’enseignement en France se passe donc dans les familles et pas à l’école. C’est inquiétant !
Est-ce un mal français ?
Oui. La leçon majeure et la plus intéressante des statistiques comparées est celle-ci : les systèmes scolaires qui ont les meilleures performances sont très divers culturellement. On trouve le Canada, l’Europe du Nord, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Japon – donc pas de domination anglo-saxonne. Dans ces pays, les écarts entre les élèves forts et les élèves faibles sont réduits au minimum. Bien sûr, ils subsistent entre un fils d’ingénieur et un fils d’ouvrier. Mais dans des proportions bien moindres. Leur force est de savoir créer des niveaux de réussite assez homogènes.
De quelle manière ?
Les pratiques pédagogiques sont déterminantes. On connaît les recettes. Le pédagogue Célestin Freinet (1896-1966) l’avait dit : du travail en groupe, pas de compétition à tout prix. Les enquêtes de niveau en collège montrent que si on mélange forts et faibles, les forts réussissent toujours très bien, et les faibles réussissent beaucoup mieux. Par ailleurs, on en fait trop en France sur la notation. Résultat, à la question « Êtes-vous content d’aller à l’école le matin ? », on obtient les pires scores. Nombre d’élèves détestent l’école car on les abaisse, on les juge. Ils ont la boule au ventre. Pourtant le gai savoir peut s’organiser. Beaucoup d’expériences de terrain marchent très bien. Les équipes parviennent à faire réussir leurs élèves. Il faut leur donner les moyens de populariser leurs pratiques.
Pourquoi n’applique-t-on pas ces recettes ?
Notre système a été conçu depuis le sommet, avec une sélection croissante. Dès le CP, il s’agit de détecter les futurs polytechniciens, c’est une absurdité. L’élitisme domine. En réalité, comme en sport, plus la base est nombreuse et bien formée, plus l’élite est forte. On voit que si le bas s’étoffe dangereusement, avec de plus en plus de garçons en difficulté, l’élite est de plus en plus rare. Même le directeur du groupe des concours communs polytechniques (qui rassemble trente-quatre écoles d’ingénieurs) a du mal à recruter. Et pour cause : les meilleurs élèves en sciences cherchent à partir en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L’élitisme ne développe pas une bonne élite.
Que faudrait-il faire selon vous ?
Laisser des marges de liberté aux équipes pédagogiques. Étendre le socle commun. Nous avons spécialisé à outrance les différentes disciplines. Je défends l’idée d’un corps unique d’enseignants du CP à la troisième, des professeurs polyvalents comparables à ceux des écoles, qui puissent travailler en commun, ajuster les programmes au sein de l’établissement en fonction du contexte social, de l’intérêt des élèves. Beaucoup s’ennuient alors qu’ils ne demandent qu’à s’intéresser. L’expérience de « La main à la pâte » (programme lancé en 1996 à l’initiative de Georges Charpak) marche très bien avec les meilleurs scientifiques. On part des élèves comme ils sont pour leur enseigner le maximum et les faire s’élever le plus haut possible.
Quelle est la mission de l’école en 2015 ? À quoi sert-elle ?
On oppose la finalité économique, rendre les jeunes aptes à occuper un emploi, et le devoir de former des citoyens cultivés. Il faut bien sûr faire les deux, de façon plus efficace et plus vivante. Au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers par exemple, on développe un enseignement de l’anthropologie qui permet à des jeunes issus de toutes ethnies et religions de trouver des liens avec leurs racines. Et ça marche. Il faut se rapprocher des intérêts réels de la jeunesse multiculturelle qui peuple nos établissements.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO et LAURENT GREILSAMER
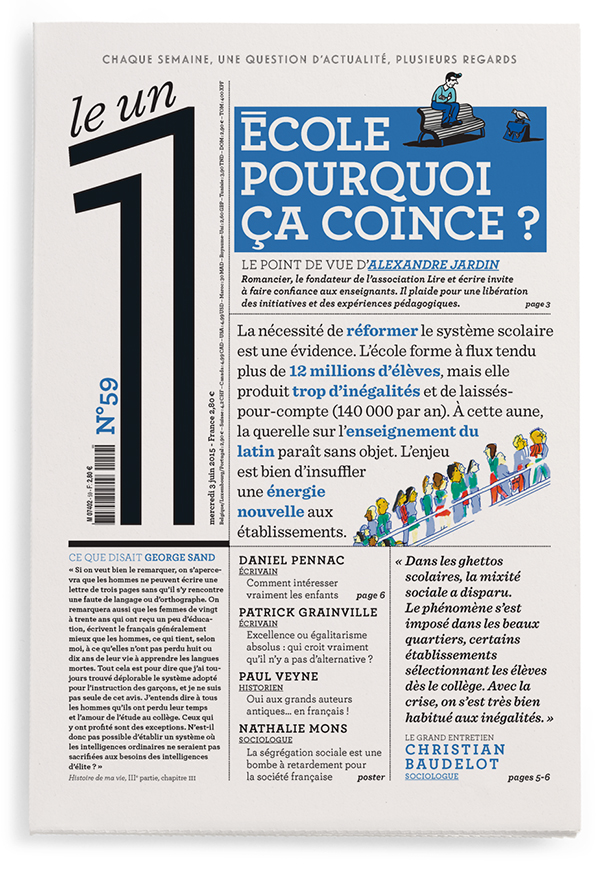
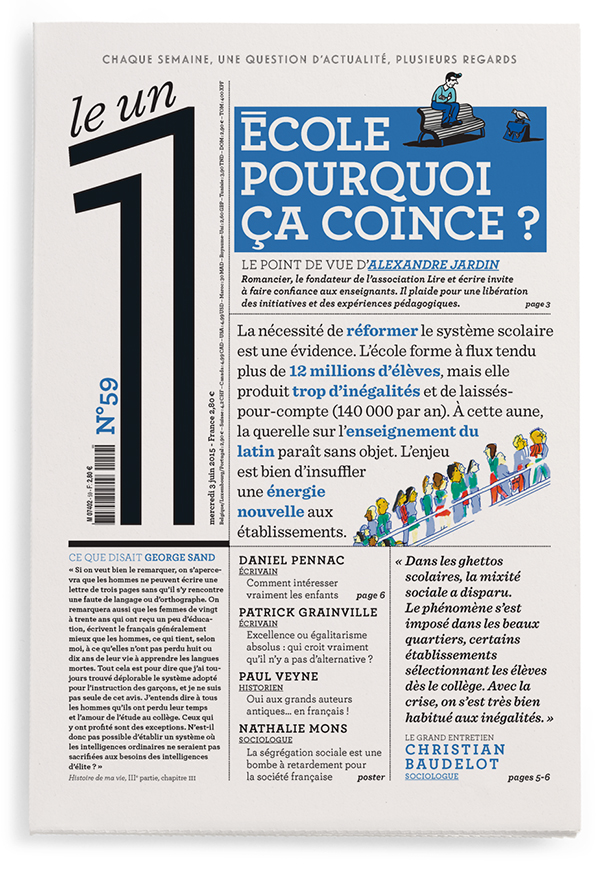

« Nous sommes passés des inégalités passives aux inégalités actives »
Christian Baudelot
Que vous inspire la vague de protestation soulevée par le projet de réforme du collège défendu par le gouvernement ?
Elle dit beaucoup sur la nature du système d’enseignement français. Ceux qui protestent tiennent à défendre et à maintenir des formes élitaires d’éducatio…
Une autre approche pédagogique
Clara Bellar
Dans la non-scolarisation ou l’instruction en famille, il y a deux tendances : le homeschooling, où les parents font l’école à la maison, et l’apprentissage autonome (parfois appelé unschooling), basé sur les ce…
Roman
Robert Solé
Pour enseigner l’histoire au collège, deux conceptions s’opposent. Ouvrons davantage les programmes sur le vaste monde, disent les uns. Finissons-en avec une mise en scène trompeuse, destinée à exalter la grandeur de la France, les sentiments identi…
La leçon de Vitruve
Daniel Pennac
Concrètement, quels sont les obstacles principaux à un bon enseignement ? Les dégâts effarants du système de notation, par exemple. Quel éternel quiproquo, cette affaire de notes ! Pour le professeur, la note est censée évaluer un s…







