« Nous devons réfléchir à un système plus redistributif »
EntretienTemps de lecture : 8 minutes
Les CDI règnent très largement sur le marché du travail et pourtant les CDD semblent former un univers en expansion permanente. Pouvez-vous confirmer cette photographie et expliquer ce paradoxe ?
La situation française est bien celle-là : d’un côté, les CDI, qui représentent 85 % du salariat et dont le volume est stable ; de l’autre, une explosion des contrats courts. Le phénomène date du début des années 2000. Les CDD très courts occupent une part de plus en plus importante dans certains secteurs d’activité comme la restauration, le tourisme, l’enseignement, l’audiovisuel, le déménagement, etc. L’opinion ignore souvent que les CDD peuvent y être légalement renouvelés sans contrainte et qu’un nombre important de salariés signent des contrats de moins d’un mois et souvent de moins d’une semaine. Ils ne cessent de travailler, de s’interrompre et de reprendre leur activité, la plupart du temps au sein de la même entreprise. Il s’agit d’une caractéristique très française, quasi institutionnelle, qui est en grande partie liée au système d’assurance chômage.
Environ 800 000 personnes vivent sous le régime dit de l’activité réduite sans limite : elles perçoivent une indemnité chômage à condition de travailler moins de 110 heures par mois. Dans ce cas, elles gardent 30 % de leurs gains salariaux en plus de leur indemnité et prolongent leurs droits à l’assurance chômage. Voilà la raison principale de cette singularité française du CDD.
Peut-on dire que le monde des CDI est un océan tranquille et celui des CDD un océan agité ?
Le monde des CDD est incontestablement le plus mouvementé. Vous avez là un turn-over énorme. Le flux d’entrées sur le marché du travail, hors intérim, est de 20 millions par an. Sur ces 20 millions, 90 % sont des CDD et 80 % d’entre eux signent des contrats de moins d’un mois. C’est un phénomène de grande ampleur qui a doublé en une décennie.
Sur le fond, le système est mal conçu. Les sociétés intérimaires, le secteur des contrats d’usage, avec l’exemple extrême des intermittents du spectacle, comptent sur l’indemnisation chômage pour payer de facto une partie de la rémunération du salarié. Certaines de ces entreprises versent en revanche des cotisations plus élevées à l’assurance chômage – jusqu’à 15,8 % au lieu de 4 % pour les entreprises qui emploient des intermittents du spectacle – sans pour autant éviter que le phénomène des CDD creuse le déficit de l’assurance chômage. Le régime des CDI est lui excédentaire.
Ces sujets très techniques, peu médiatisés, sont assez mal maîtrisés par les hommes politiques. Pour en sortir, il faudrait que le système d’assurance chômage repose sur un bonus-malus qui empêche ces sociétés, grosses ou petites, d’externaliser le coût de la main-d’œuvre sur l’assurance chômage. Ce n’est pas le cas. L’une des principales raisons, c’est que l’intérim profite beaucoup à l’industrie automobile par exemple, grosse consommatrice de contrats courts. Et en France, l’automobile est une vache sacrée.
Comment se positionnent les syndicats sur cette question de la précarité ?
Les syndicats sont arc-boutés sur la défense des CDI. C’est leur priorité. Certes, ils sont sensibles au thème de la précarité mais leur obsession, c’est d’éviter toute modification, même à la marge, du statut des CDI. Globalement, la protection de l’emploi améliore le bien-être des travailleurs protégés, mais dégrade celui des autres. Elle contribue à creuser les inégalités.
Ce monde des CDD constitue-t-il une trappe, un piège dont on ne sort pas, ou bien un tremplin ?
Nous sommes entre les deux ! C’est un tremplin, mais la barre est très haute. La probabilité d’accéder à un CDI quand on a un CDD est faible à court terme. C’est un processus lent, compliqué que de trouver un emploi stable. Il faut faire 4, 5 ou 6 CDD selon les données dont on dispose. Une période où l’accès au crédit bancaire et au logement est particulièrement difficile. D’où la réalité de la précarité.
S’il n’y a pas plus de CDI, c’est que les modalités de rupture de ces contrats sont très lourdes, que ce soit pour motif personnel ou économique. La preuve en est que les entreprises préfèrent payer des primes de précarité de 10 % plutôt que d’embaucher en CDI. D’une manière générale, un licenciement est toujours coûteux en raison de l’encadrement juridique qu’il suppose.
Allons-nous revenir au travail non salarié qui dominait jusqu’à la fin du xixe siècle ?
Non, le contrat de travail, et surtout le CDI, reste la forme de contrat majoritaire. La rotation très rapide des missions concerne une très petite partie de la population, assez stable, depuis une dizaine d’années. Sur 21 millions de salariés, on dénombre 3,2 millions de personnes en CDD, soit 13 à 14 % des actifs hors intérim. Il n’existe pas de tendance forte à la baisse des CDI.
Pour le moment. Mais demain ?
En France se développe le statut d’autoentrepreneur. L’Allemagne crée des emplois à statut précaire. La question se pose : doit-on chercher dans cette direction pour faire baisser le chômage ? Comment accompagner ces personnes en précarité ? Nous devons réfléchir à un système plus redistributif. Un responsable comme Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, estime que pour faciliter l’entrée sur le marché du travail, mieux vaut abaisser le niveau de protection. Cela permet de mieux cibler les poches de pauvreté car on peut alors verser des revenus additionnels liés à la situation familiale. S’il est bien géré, ce système assoupli est plus efficace que celui du salaire minimum élevé.
Dans l’un de vos livres, Les Ennemis de l’emploi, vous notez que les entreprises gèrent leurs mouvements de personnel en jouant sur les contrats à durée déterminée.
Lorsqu’une personne arrive au terme d’un CDD de 18 mois, l’entreprise a souvent envie de la garder davantage. Mais elle s’en débarrasse en estimant que ce sera trop compliqué. Et elle prend quelqu’un d’autre. On observe un énorme pic de sorties au bout de 18 mois d’ancienneté. Cela tient aux pesanteurs de la réglementation et à la réduction de l’activité économique.
Dans un rapport de 2004 rédigé avec l’économiste Francis Kramarz, vous préconisiez d’unifier le contrat de travail et de mieux accompagner le parcours des chômeurs. Pouvez-vous préciser votre approche ?
L’idée est de limiter les différences de statut entre CDD et CDI. Dans un monde idéal, les entreprises pourraient rompre le contrat de travail en CDI à leur propre initiative. En contrepartie, elles paieraient une contribution pour financer l’accompagnement des personnes licenciées. Mais l’environnement juridique ne le permet pas : en France, une entreprise doit justifier tout licenciement avec une cause réelle sérieuse. La jurisprudence, complexe, est source d’incertitude : on peut licencier pour « sauvegarder » sa compétitivité, pas pour l’« améliorer », un distinguo trop subtil en pratique. Cette incertitude est préjudiciable aux entreprises comme aux salariés.
La précarité est-elle la manifestation de ce que vous appeliez en 2007 la société de défiance ?
C’est l’une de ces manifestations. La situation est bloquée car nous vivons dans une société très corporatiste. Voyez la façon dont fonctionne le paritarisme français. Les groupes qui bénéficient d’avantages acquis les défendent bec et ongles, dans une transparence limitée. Il est difficile de mettre en place des négociations fondées sur une confiance mutuelle qui favoriserait un système plus sécurisant, un marché du travail plus fluide. Prenez le contrat unique. Les employeurs le refusent. À les écouter, ils vont se retrouver avec tous les inconvénients du CDI plus une taxe à payer. Du côté des syndicats, le refus d’aller de l’avant tient à leur méfiance envers les employeurs qui, selon eux, vont abuser de leurs prérogatives pour rompre le contrat de travail. Cette méfiance mutuelle nourrit la difficulté à réformer et, in fine, elle nourrit la précarité.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO et LAURENT GREILSAMER


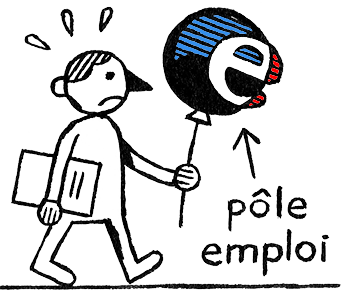
« Nous devons réfléchir à un système plus redistributif »
Pierre Cahuc
Les CDI règnent très largement sur le marché du travail et pourtant les CDD semblent former un univers en expansion permanente. Pouvez-vous confirmer cette photographie et expliquer ce paradoxe ?
La situation française est bien celle-l&agr…
Lexique
Robert Solé
Angoisse : Sentiment éprouvé par les CDD, et que seul peut comprendre un élu, lui-même affligé d’un mandat à durée déterminée (MDD). Il a parcouru des kilomètres, hanté les pré…
Contrats courts : Trappe ou tremplin…
Sabina Issehnane
François Roux
UNE RÈGLE IMPITOYABLE
Par Sabina Issehnane







