« la seule sortie possible est la croissance »
EntretienTemps de lecture : 8 minutes
La victoire de Syriza constitue-t-elle un danger pour la zone euro et pour la cohésion de l’Europe ?
Non. Il n’y a plus de danger systémique pour la zone euro comme il y en avait en 2008. De vrais murs ont été construits, écartant la possibilité d’un incendie venant de Grèce. Ce qui arrive est un événement politique, pas financier. Je n’en veux pour preuve que la réaction des marchés obligataires. Qu’ils soient aussi calmes signifie : pas de danger. Ils parient aussi sur un comportement raisonnable de Tsipras, ce qui dépitera Mme Le Pen et M. Mélenchon. Pour que leurs espoirs restent mesurés, il faut rappeler aux mouvements antieuropéens que ce parti nouveau, Syriza, ne veut pas sortir de l’Europe ni de l’euro. Mme Le Pen, qui salue cette victoire, n’est pas très cohérente.
Cet événement politique doit être interprété dans le contexte grec : il y a sept ans, ce pays était en faillite politique, économique, morale et financière. La solidarité européenne – vous et moi comme contribuables – lui a évité la faillite. Un premier réaménagement de la dette a été effectué à hauteur de 70 %, de l’argent frais a été versé, qui représente en gros les 300 milliards de dette qui subsistent.
Pas de banqueroute, mais pas de guérison non plus…
Sur le plan politique, économique et moral, la situation de banqueroute demeure. Le fait que des forces nouvelles apparaissent sur les décombres du système ancien, c’est la confirmation qu’une révolution est en marche. Les nouveaux dirigeants vont devoir reconstruire un pays sur ces décombres, et bonne chance ! Il faut se souvenir que l’histoire grecque est une histoire récente. C’est le seul pays européen qui a été aussi longtemps la colonie d’une puissance non européenne, à savoir l’Empire ottoman. Quelle autre nation sur notre continent a connu des siècles de domination coloniale ?
On évoque toujours l’absence de cadastre. Mais les Ottomans prélevaient un impôt sur les propriétés. Le moyen d’échapper à leur domination et de leur résister, c’était d’échapper à l’impôt et donc de faire en sorte que les Ottomans ne puissent repérer les propriétés… Le nationalisme grec est récent au regard de l’histoire de la France, de la Grande-Bretagne ou même de l’Italie.
Cela ne peut justifier aujourd’hui une absence de fiscalité.
Non, ils vont devoir faire payer des impôts. Il ne faut pas reconstruire un système fiscal en Grèce, il faut le construire ! Y compris pour l’Église orthodoxe et pour les armateurs présents dans le concert international qui ne paient pas d’impôt. À l’évidence, la Grèce se situe dans un ailleurs. Si les Grecs veulent rester dans l’Union européenne et dans la zone euro, il faut que cet « ailleurs » soit moins ailleurs…
Quel scénario est le plus probable ?
Aucun doute, ils vont se heurter au réel. Ils ont un problème majeur : tel qu’ils l’ont présenté, leur programme n’est pas applicable. Ils sont aujourd’hui en équilibre primaire [la somme des rentrées d’argent couvre les dépenses, hormis le remboursement de la dette]. S’ils refont du déficit public en augmentant les retraites, qui va le financer ? Ils ne peuvent aller sur les marchés pour boucler leurs fins de mois. La Banque centrale européenne (BCE) ne leur donnera pas de liquidités. Elle n’accepte les fonds souverains grecs que si Athènes reste dans un programme d’ajustement. Sur le plan de la politique économique, le couloir est étroit. Si la Grèce ne rembourse pas sa dette, c’est grave car c’est un défaut de paiement. S’ils se mettaient dans ce mauvais pas, ils sortiraient de fait de l’euro et devraient se financer à des conditions redoutables.
Mais la dette n’a cessé de s’alourdir malgré les sacrifices endurés par la population…
Elle a continué d’augmenter en proportion du produit national brut qui a baissé de 25 %. C’est un problème de croissance. Celle-ci est redevenue positive en Grèce fin 2014. Son économie rebondit. Des solutions sont possibles pour aménager le stock de dettes existant. Je ne dis pas quand ni comment : il y aura une dramaturgie autour de ce point, chacun va mettre ses peintures de guerre ! Mais je vous rappelle que le Club de Paris a rééchelonné des dettes pendant cinquante ans. [Ce groupe de créanciers publics réunit une vingtaine d’États, dont la France, l’Allemagne, les États-Unis, la Russie ou encore la Suisse.] Le réaménagement ou le rééchelonnement, on sait faire. Entre ne pas payer sa dette et honorer toutes ses échéances, la gamme de possibles est large. Les diplomates financiers vont pouvoir exercer leurs talents, même s’il y aura des postures… C’est une négociation !
Le rejet grec de l’austérité va-t-il faire tache d’huile en Europe ?
C’est un des signes de l’existence de l’Europe politique : sans parler de contagion, il y aura des interférences dans la chair politique que l’Europe a constituée avec ses États membres, en Espagne, au Portugal, en France, en Angleterre. L’exemple de Syriza va donner des arguments à ceux qui veulent renverser la table. À une réserve près : les très bonnes raisons qui existent en Grèce, n’existent nulle part ailleurs en Europe. Le plan grec a été mal fait, selon le mode FMI, c’est-à-dire à la hache, avec la réduction brutale des salaires dans la fonction publique. En réalité, on aurait dû envoyer la Banque Mondiale et l’OCDE, pas le FMI. L’approche a été trop comptable, pas assez structurelle.
Quand les Américains ont conçu le plan Marshall après la guerre, ils ont inventé l’OCDE pour transférer des méthodes d’organisation, de production, de transfert de technologie. Je n’ai rien vu de semblable dans le programme grec. Une grande partie des réformes de fond dont ce pays a besoin pour retrouver sa capacité de croissance restent à faire. Et ne confondons pas l’austérité à la grecque où les salaires baissent de 20 %, à une certaine rigueur en France où les salaires ne baissent pas.
Que va faire la Commission de Bruxelles après ce résultat ?
La Commission est tenue par des règles adoptées par les Européens et signées par les Grecs. Elle ne peut inventer un nouveau parcours. Il faut un consensus du Conseil, voire du Parlement. Il y aura des débats. L’investissement ne repartira que si les conditions minimales de confiance sont réunies.
Pouvait-on éviter cette situation ?
Rétrospectivement, on dira que comparée à la séquence américaine : politique monétaire-ajustement fiscal-plan de relance, les choses n’ont pas été bien menées en Europe. C’est un problème d’ordonnancement plus que de vision. On sait que pour sortir de cette crise, il faut une politique monétaire accommodante, de l’ajustement fiscal, des réformes structurelles et des investissements d’avenir. Ces quatre ingrédients doivent être réunis. Reste à déterminer quels pays sont concernés ? combien ? qui fait quoi ? qui a l’énergie politique pour réformer ? Ce n’est pas un hasard si la Banque centrale européenne est la seule institution fédérale qui a fait sa part. La puissance publique européenne ne s’incarne, au sens plein du terme, que dans la BCE. Son président Mario Draghi a dû travailler en profondeur avec son conseil pour obtenir une décision sans vote sur le rachat massif de dettes.
Au-delà du cas grec, comment l’économie européenne peut-elle s’en sortir ?
La seule sortie possible est la croissance. Toute chose égale par ailleurs, on aura 1,5 % au mieux en Europe, 3 % aux États-Unis, 6 % dans les pays émergents. 1,5 % ne suffit pas pour perpétuer le modèle social européen, avec une population vieillissante et s’amenuisant, sauf en France et en Irlande. Toutes les solutions prennent du temps. La solution à la question démographique, c’est l’immigration. Combattre le rétrécissement de la position européenne à la frontière de la technologie et de l’innovation, c’est du long terme. Cela ne se redresse pas en deux ans. Même chose pour les blocages structurels du marché du travail. Quand j’entends dire que la croissance va repartir car Draghi a fait son boulot, il suffit de regarder le Japon pour voir que ce n’est pas vrai. Le Japon a fait un énorme rachat de dette en tablant sur la discipline des ménages qui la détiennent. Il a mené une politique monétaire ultra-expansionniste, fait baisser le yen à gogo… Mais faute de réformes de structure, l’économie ne répond pas à ce stimulus. Il lui faut une certaine flexibilité, des espaces. Mario Draghi a fait ce qu’il fallait faire, mais Angela Merkel l’a dit : qu’il ait fait son job n’empêche pas les autres de faire le leur.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO


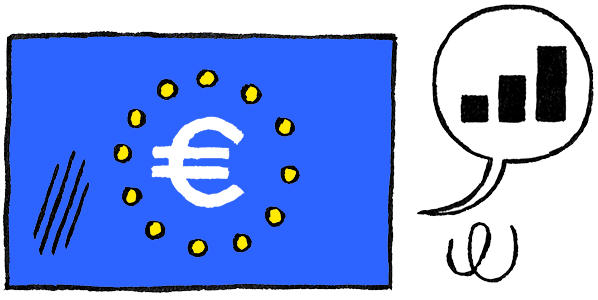
« la seule sortie possible est la croissance »
Pascal Lamy
La victoire de Syriza constitue-t-elle un danger pour la zone euro et pour la cohésion de l’Europe ?
Non. Il n’y a plus de danger systémique pour la zone euro comme il y en avait en 2008. De vrais murs ont été construits, …
Rilance
Robert Solé
Comment serrer les freins tout en lâchant du lest ? En juillet 2010, Christine Lagarde, ministre de l’Économie, avait dû faire preuve d’imagination. La rigueur lui paraissait nécessaire, mais il ne fallait surtout pas employer ce terme qui était t…
Les cobayes grecs
David Stuckler
Sanjay Basu
Les experts du FMI avaient calculé que les dépenses publiques de santé en Grèce devaient être ramenées à 6 % du PIB, quand la moyenne dans l’Union européenne se situe à 10 %. Le ministère de la Santé vit d…







