Le monde comme terrain de chasse
Temps de lecture : 8 minutes
« Predator », « Reaper »… Oiseaux de proie et anges de la mort, les drones « chasseurs-tueurs » portent bien leurs noms. Ils sont les emblèmes d’une nouvelle doctrine de la violence armée, développée ces dix dernières années aux États-Unis : la guerre comme chasse à l’homme. Contrairement à la définition classique donnée par Clausewitz, cette forme de guerre-là n’est plus centrée sur la notion fondamentale de combat singulier. Comme le soulignent les stratèges américains qui ont formulé les « principes théoriques de la chasse à l’homme », le paradigme n’est plus ici celui d’un face-à-face entre deux combattants, mais plutôt d’« une compétition entre ceux qui se cachent et ceux qui cherchent ».
L’usage des drones armés, actionnés à distance depuis le sol de bases militaires américaines, radicalise ce principe de non-confrontation. L’action, écartelée entre des points radicalement distants, perd son unité de lieu. Dans cette situation d’action disloquée, où la violence de guerre s’exerce depuis une zone de paix et où les corps n’ont plus de lieu commun, le combat devient impossible. La guerre dégénère en mise à mort.
Alors que le combat prend place là où se heurtent les forces, la traque suit une proie mouvante qui s’efforce de se rendre indétectable ou inaccessible. Or cette inaccessibilité, notent les théoriciens de la guerre-chasse, n’est pas seulement fonction des reliefs de la géographie physique – maquis touffu ou anfractuosités profondes – mais aussi des aspérités de la géographie politique. Le problème est, à leur point de vue, que « les frontières souveraines comptent parmi les meilleurs alliés » qu’un fugitif puisse avoir. Ce qui se profile alors, c’est un pouvoir invasif moins fondé sur un droit de conquête que sur un droit de poursuite universelle, qui autoriserait partout à courir sus aux suspects. Dans une telle conception, le principe d’intégrité territoriale attaché à la souveraineté des États tiers devient à la rigueur contingent. La pleine jouissance de celle-ci ne leur est reconnue que s’ils relaient la traque en leur sein. Au cas contraire, s’ils ne le peuvent – « États défaillants » – ou ne le veulent – « États voyous » –, leur territoire pourra être violé par l’État-chasseur.
Aux formes classiques de la souveraineté, fondées sur la clôture et la frontière, le drone oppose la continuité surplombante de l’air. Il prolonge en cela les grandes promesses historiques du pouvoir aérien. Indifférente aux reliefs du sol, l’arme aérienne, écrivait Giulio Douhet dans les années 1920, « se déplace librement dans une troisième dimension ». Elle trace dans le ciel ses propres lignes. La question revêt alors une dimension aéropolitique : qui détient le pouvoir sur l’air et sur les ondes ?
En devenant stratosphérique, le pouvoir impérial modifie son rapport à l’espace. Il s’agit moins d’occuper un territoire que de le contrôler par le haut en s’assurant la maîtrise des airs. L’architecte Eyal Weizman explique en ces termes, dans son essai À travers les murs (La Fabrique, 2008), tout un pan de la stratégie israélienne contemporaine qu’il décrit comme une politique de la verticalité. Dans ce modèle, il s’agit de « maintenir la domination sur les zones évacuées par d’autres moyens que le contrôle territorial ». À cette verticalisation du pouvoir correspond une forme d’autorité hors-sol, où tout, chaque individu, chaque maison, chaque rue, « même le plus petit événement sur le terrain, peut être surveillé, soumis à des mesures de police ou détruit depuis le ciel ».
Les analyses du juriste et philosophe Carl Schmitt (1888-1985) sur « la guerre aérienne autonome », où « l’absence de relation du belligérant avec le sol et la population ennemie qui s’y trouve devient absolue », valent encore aujourd’hui pour le drone armé : lui aussi « utilise ses armes contre la population du pays ennemi verticalement, comme saint Georges usant de sa force contre le dragon ». Carl Schmitt précise : « En transformant de nos jours la guerre en une opération de police contre des trublions, des criminels et des agents nuisibles, il faut bien aussi amplifier la justification des méthodes de ce police bombing. On se voit ainsi contraint de pousser la discrimination de l’adversaire jusqu’à des proportions abyssales. » La verticalisation de la violence armée implique une forme de négation politico-juridique absolue de l’ennemi. Celui-ci ne saurait être situé, à aucun sens du terme, sur le même plan que soi.
Lorsque les stratèges de l’armée américaine imaginent à quoi ressembleront les drones dans vingt-cinq ans, ils font dessiner à leurs infographistes l’image d’une ville arabe typique, avec sa mosquée, ses immeubles et ses palmiers. Dans le ciel, volettent des libellules. Il s’agit en fait de nanodrones, des robots-insectes autonomes capables de marauder en essaim et de « naviguer dans des espaces de plus en plus confinés ». Grâce à des engins de ce type, la violence létale pourrait s’exercer dans de tout petits espaces, dans des microcubes de mort (« kill box »). Plutôt que détruire un immeuble entier pour éliminer un individu, miniaturiser l’arme, passer dans les embrasures et confiner l’impact de l’explosion télécommandée à une seule pièce, voire à un seul corps. Votre chambre ou votre bureau devient une zone de guerre.
Sans attendre ces micromachines du futur, les partisans des drones, recyclant à l’envi la rhétorique éculée des « frappes chirurgicales », insistent sur la prétendue « précision » de leur arme. Mais cette justification technico-morale permet tendanciellement aussi d’étendre le champ de tir : c’est parce que nous prétendons viser nos cibles avec précision que nous pouvons, disent en substance les militaires et la CIA, les frapper où bon nous semble. Alors que la zone de conflit armé tend idéalement à se réduire au seul corps de l’ennemi, ce micro-espace mobile est en même temps réputé, au nom des nécessités de la traque, pouvoir être visé partout où il se trouve. Quand le corps devient un champ de bataille, le monde entier devient un terrain de chasse.
Pour l’État-chasseur, le lieu de la violence armée ne se définit plus selon les contours d’une zone délimitable, mais par la simple présence de l’ennemi-proie, qui transporte pour ainsi dire partout avec lui son petit halo mobile d’hostilité personnelle. De façon convergente, toute une frange de juristes américains affirme aujourd’hui que la notion de « zone de conflit armé » ne saurait plus être interprétée en un sens strictement géographique. À cette conception géo-centrée, supposément périmée, ils en opposent une autre, ciblo-centrée, attachée aux corps des individus ennemis, selon laquelle le droit de tuer « va où ils vont, sans plus aucun égard pour la géographie ».
Mais l’un des problèmes posés, comme le pointe le géographe Derek Gregory, est que « la logique juridique par laquelle le champ de bataille est étendu bien au-delà de la zone de combat déclarée, est en elle-même infiniment extensible ». Où cela s’arrêtera-t-il ? En 2010, l’ONG Human Rights Watch posait la question au président des États-Unis : l’administration américaine considère-t-elle que l’usage de la force létale est « légalement permis contre un terroriste présumé dans un appartement de Paris, dans une galerie commerciale à Londres ou à un arrêt de bus à Iowa City » ?
En mai 2013, dans un discours remarqué sur les drones, Barack Obama réaffirmait le droit autoproclamé des États-Unis à conduire des frappes préventives en dehors de toute zone de conflit armé, y compris contre ses propres citoyens, sur la base d’une notion très élastique de « menace imminente » – une dangerosité individuelle dont l’évaluation pourrait être confiée à des « tribunaux spéciaux » chargés de prononcer secrètement des sentences de mort contre des accusés absents… « Sans l’égalité du droit de tuer, a pu avertir le philosophe Michael Walzer, la guerre disparaîtrait en tant qu’activité soumise à des règles pour être remplacée par le crime et le châtiment, de sombres machinations et l’application de la loi par les militaires. » Nous en prenons très dangereusement le chemin.


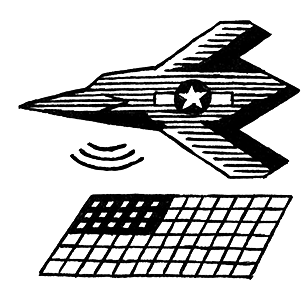
« Les États-Unis et Israël dominent le marché des drones »
Camille Grand
Ce spécialiste brosse un tableau mondial de la production et de l’usage militaire des drones, une arme qui est pour lui moins une révolution qu’une nouvelle étape dans un long processus de mise à distance de l’adversaire.
Le monde comme terrain de chasse
Grégoire Chamayou
Ils sont les emblèmes d’une nouvelle doctrine de la violence armée, développée ces dix dernières années aux États-Unis : la guerre comme chasse à l’homme. Contrairement à la définition classique donnée p…
Sans
Robert Solé
En anglais, drone désigne le faux bourdon, c’est-à-dire le mâle de l’abeille. La nature n’a pas vraiment gâté cet insecte ventripotent : deux fois plus lourd qu’une butineuse, privé de dard et affecté d…
Les yeux sans visage
Ollivier Pourriol
– Je ne comprends pas votre hésitation, mon général. C’est pour sauver des vies. Le drone est l’arme de demain.

Nous vous proposons une alternative à l'acceptation des cookies (à l'exception de ceux indispensables au fonctionnement du site) afin de soutenir notre rédaction indépendante dans sa mission de vous informer chaque semaine.






