« Je ne peux pas laisser dire que l’homme est un animal comme les autres »
Temps de lecture : 8 minutes
À quand faites-vous remonter la grande rupture entre les hommes et les animaux ?
Je fais remonter la première rupture – rupture symbolique – au Christ qui s’est offert en sacrifice comme l’agneau pascal. C’est dit et redit dans les Évangiles. Agnus dei, c’est fondamental. C’est la première grande rupture. Auparavant, chez les Grecs et les Hébreux, de grandes immolations d’animaux étaient organisées. Il existait une relation triangulaire entre l’animal offert en sacrifice, le sacrifiant, l’homme, et les dieux ou Dieu. Il y avait une grande circulation du sang et du sens dans cette triangulation. L’animal était un élément à part entière de ce triangle sacrificiel. Il était respecté. Et brusquement, à travers la crucifixion, les animaux sont exclus de la grande chaîne signifiante du sacrifice. En sa personne, le Christ est tout à la fois le dieu auquel on offre le sacrifice, le sacrifiant et l’animal. Il réunit les trois pôles du sacrifice. Cela a des conséquences sur le statut des animaux en général. Je le dis sans vouloir choquer les chrétiens.
Par la suite, l’Église sera toujours extrêmement dure concernant la condition animale. Le clergé bénissait les chasses à courre et cela continue. On donne des messes à la Saint-Hubert. De ce point de vue, le pape François fera peut-être évoluer les mentalités.
Il y a une seconde rupture, plus décisive, avec Descartes. Il réduit l’animal à une machine. Avec lui, on assiste à la mécanisation du vivant. C’est Descartes qui formule le plus précisément cette pensée mais il n’est pas seul. Ce « moment » galiléo-cartésien se heurtera à de vives oppositions. Pourtant il reste fondateur. Descartes fut l’acteur décisif d’une chosification des vivants non humains.
Ce moment-là, ouvert il y a quatre siècles, dure-t-il toujours ?
Oui, nous sommes toujours dans ce cycle maudit. Il suffit de penser aux pratiques zootechniques d’élevage et d’abattage industriels qui sont mécanicistes. Quand on se préoccupe aujourd’hui du bien-être animal, le propos est seulement de conduire des bêtes moins stressées à l’abattoir. Pour éviter la panique dans le troupeau. Nous avons réalisé la vision de Descartes, opéré la transformation des animaux en machines. Des animaux sont manipulés génétiquement par une véritable ingénierie du vivant.
Quel regard portez-vous sur la production industrielle de viande ?
Je suis dans une position très paradoxale parce que je ne suis ni végétarienne ni végétalienne. Je ne suis pas capable d’une position si radicale. Pour quelles raisons ? Je l’ignore puisque je ne suis pas une grande consommatrice de viande. Mais c’est un fait, je ne suis pas capable de franchir ce pas, je ne suis pas capable de m’exclure socialement en refusant toute viande, tout laitage. J’ai donc cette position dont je ne suis pas fière, mais dont je ne suis pas non plus honteuse. Cela ne m’empêche pas d’être implacable dans ma critique des modes d’élevage et d’abattage industriels. Nous sommes confrontés à une barbarie : la recherche exclusive du profit sans aucune considération pour les animaux. Il y a une négation de la douleur animale dans toutes ces pratiques.
Comment résolvez-vous votre contradiction ?
J’en ajoute une autre ! Je suis farouchement hostile à l’élevage industriel, avec sa cruauté, comme celui de la « ferme des mille vaches » dans la Somme. J’aimerais que l’élevage artisanal soit privilégié. Cet élevage-là est quelque chose de magnifique, c’est une pratique profondément humaine et la transhumance est particulièrement belle. Elle a façonné les paysages de nos campagnes. En fait, il ne s’agit pas tant de conserver cet élevage, ou d’un retour nostalgique, mais d’aller vers une rupture. Autre contradiction : ces pratiques respectueuses de l’animal produisent une viande pour les riches. Mais les autres ? Je condamne la multiplication des pratiques zootechniques qui permettent la mise en vente de viande sous cellophane dans les supermarchés, la viande pour tous, et j’ai du mal à concilier ce refus avec mon engagement à gauche…
Alors qu’on assiste dans nos sociétés à une prise de conscience de la souffrance des animaux, comment expliquez-vous justement l’explosion de la consommation de viande industrielle ?
Cette prise de conscience est réelle. De plus en plus d’étudiants américains sont végétariens. Un livre comme celui de Jonathan Safran Foer, Faut-il manger les animaux ?, a rencontré un immense écho aux États-Unis. Mais la coexistence entre cette indignation de plus en plus forte et cette exploitation industrielle qui ne cesse de croître, je reconnais ne pas savoir comment la penser. Vous avez là des populations dissociées : les bouffeurs de viande rabelaisiens, les nouvelles classes populaires qui exigent le droit de consommer de la viande tous les jours, et cette élite utopique, les végétaliens, très radicale et culpabilisante. Je pense profondément que tout animal, tout mammifère, est « sujet d’une vie », pour reprendre le mot du philosophe Tom Regan. Mais à partir de ce moment, on n’a pas le droit de le tuer pour le manger. Je suis, vous le voyez, très écartelée entre mes convictions profondes, philosophiques, et le fait que je continue à manger de la viande. Je n’ai pas ce rapport aux animaux qu’ont les végétariens et les végétaliens. Dans mon enfance, la chasse a fait partie de mon horizon. Les chiens, les chevaux, la chasse de mon père, c’est mon environnement initial. Avec mes cousins, nous jouions aux rabatteurs. J’étais choquée quand mon père ramenait à la maison du gibier. Tous ces cadavres d’animaux, je n’aimais pas cela. Mais la prise de conscience a été bien plus tardive.
Vous venez de citer Tom Regan : « Tout animal est sujet d’une vie ». En prenant en considération la diversité du monde animal, iriez-vous jusqu’à dire qu’ils sont tous égaux ?
C’est une question fondamentale. Je dirais d’abord que l’évolution est buissonnante, elle n’est pas linéaire. Sans parler de hiérarchie, il y a une diversité animale étonnante. Les uns possèdent une organisation rudimentaire, les autres extrêmement élaborée. Il ne s’agit pas d’avoir la même considération pour tous les animaux.
Ensuite, aussi darwinienne que je puisse être, je ne peux pas laisser dire que l’homme est un animal comme les autres. Je n’accepte pas cette idée de l’égalité d’intérêt entre tous les vivants.
Il existe une singularité, une différence anthropologique. L’apparition de l’homme est une déviation accidentelle dans l’évolution et cette émergence provient bien sûr du langage, de la parole. L’homme est capable, en parlant, d’agir. La parole est un acte. C’est ce qu’on appelle le performatif. En déclarant : « La séance est ouverte », on ouvre effectivement la séance. C’est parce qu’il y a cette possibilité de changer les choses par la parole publique, politique, que le genre humain s’est constitué. Je tiens à la sociologie, à l’histoire en tant que telle. La position antihumaniste des antispécistes (défenseurs d’une égalité entre les espèces animales et l’homme) est intenable. Qui arriveront-ils à convaincre avec ce discours ?
Que répondez-vous à ceux qui placent les grands singes à l’égal de l’homme ?
(Soupir) Vous connaissez les travaux de Frans de Waal, ce grand primatologue ? Il explique que si nous avions les capacités de réconciliation des chimpanzés, nous saurions mettre fin à nos guerres. Ce sont des sottises. Travailler avec les grands singes fait surgir des comportements terriblement émouvants. Mais réclamer l’extension des droits de l’homme aux chimpanzés, comme le fait le philosophe australien Peter Singer, est exorbitant. Naturellement, il faut préserver les grands singes, protéger leurs espaces, les soustraire aux expérimentations. Mais attention au piège du narcissisme.
Ils nous ressemblent tellement qu’on voudrait leur accorder nos droits. C’est irresponsable. L’argument consistant à mettre en avant la ressemblance de nos structures ADN – 99 % de nos structures sont identiques – est une instrumentalisation. Car dans le 1 %, il y a tout ! L’histoire. La culture. C’est-à-dire l’épigénèse, tout ce qui n’est pas génétique. Les progrès, les évolutions, bref la civilisation. Dans cet argument, il y a une dénégation de la réalité humaine. Et une dénégation du tragique car la réalité humaine est tragique.
Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER
![Ces bêtes que nous aimons tant [manger]](https://le1hebdo.fr/medias/articles/numeros/maq33_1488208381.jpg)
![Ces bêtes que nous aimons tant [manger]](https://le1hebdo.fr/medias/articles/numeros/maq33_1488208381.jpg)
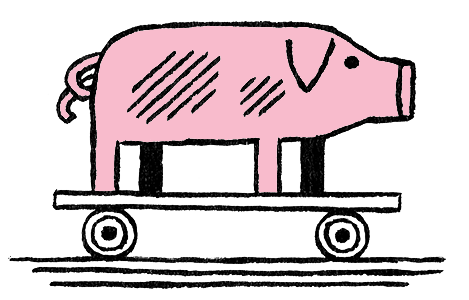
« Je ne peux pas laisser dire que l’homme est un animal comme les autres »
Élisabeth de Fontenay
À quand faites-vous remonter la grande rupture entre les hommes et les animaux ?
Je fais remonter la première rupture – rupture symbolique – au Christ qui s’est offert en sacrifice comme l’agneau pascal. C’est dit…
Zoologie
Robert Solé
Au pays des droits de l’homme et de l’animal, il est normal de se soucier des chiens, des chats ou des chevaux. Mais est-ce une raison de négliger les grands fauves ? N’avons-nous pas aussi à défendre les Sarkozy, les Copé, les Montebourg, les Royal o…
Le goût des autres
Ollivier Pourriol
– On va où, mon lieutenant ?
– Une vieille dame qui vit seule avec ses chats et qui ne répond plus depuis une semaine. On peut s’attendre au pire.
– On a le temps de s’arrêter pour acheter à manger, mon l…







