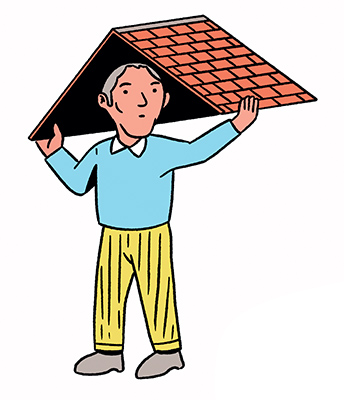L’inquiétude est dans le pré
Temps de lecture : 9 minutes
SAINT-BONNET-LE-TRONCY (Rhône). Le soleil de midi réchauffe les pâturages, balayés par ce vent du nord qui menace la repousse printanière. Indifférentes, trois génisses paissent. En contrebas, la forêt de douglas renvoie par intermittence l’écho d’une tronçonneuse. Un paysan à la retraite fait son bois, sans trop se soucier du confinement. On ne sait pas de quoi le prochain hiver sera fait. Le godet de son tracteur rempli, il disparaît. Le silence est total, si ce n’est ce fichu vent. Mais bientôt les montbéliardes se redressent : le son qui leur parvient est inhabituel par ici. La sirène des pompiers retentit sur la petite route qui mène au bourg.
Au début de l’épidémie, les habitants de Saint-Bonnet-le-Troncy (313 habitants pour 15 km2) étaient convaincus que le virus ne grimperait pas jusqu’à eux, dans ce bout du monde du Beaujolais vert situé entre 490 et 900 mètres d’altitude, où personne ne passe jamais vraiment par hasard. Alors quand l’un d’entre eux, âgé d’à peine 70 ans, a été placé sous assistance respiratoire à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône, même les plus gaillards ont compris qu’on n’était pas plus protégé ici qu’ailleurs. La femme du malade vivait seule depuis une semaine, dans l’attente de nouvelles. Ce sont des voisins du couple qui, la voyant s’affaiblir, ont alerté le maire pour envoyer une ambulance. Elle ne voulait pas laisser le chien.
Certes, les maisons ici ont presque toutes un jardin, voire un petit chemin qu’accaparent les enfants pour y faire des allers-retours à vélo. C’est un confinement au grand air, comme en rêvent les Lyonnais, enfermés dans leurs petites surfaces à 70 kilomètres au sud-est de ce village. Mais, dans la mairie déserte, autour de la table du conseil où trône une solution hydroalcoolique faite maison, le maire Pascal Touchard tempère : « Nous sommes confinés comme les autres. Les avantages de la campagne, en l’occurrence, ne compensent pas les inconvénients que nous supportons toute l’année. Il n’y a plus que deux médecins dans toute la vallée d’Azergues, pour six mille habitants. Les services publics sont loin d’ici à force de fermetures. » Depuis le 17 mars, la commune se débrouille pour maintenir une certaine présence sociale. La cantinière, qui fait habituellement déjeuner les enfants de la classe unique, s’occupe de la livraison de repas à domicile pour cinq habitants isolés. Une camionnette dépose chaque nuit les barquettes cellophanées dans un frigo de la salle des fêtes, qu’elle récupère à 11 heures. Avec l’Atsem (l’aide maternelle), elle garde aussi les deux enfants d’une infirmière, habitante du village et employée dans un Ehpad à 13 kilomètres de là. « Et pour ceux qui sont en télétravail, on n’est pas mal desservis en réseau, se félicite Pascal Touchard, à condition de ne pas être en bout de ligne. » Ce qui est son cas. Professeur de techno au collège de Tarare, il doit partager l’ADSL avec son épouse, prof également, et leurs quatre enfants. Quand sa fille a dû rendre un devoir sous forme de vidéo de huit minutes à son lycée, sa tablette a tourné pendant trente heures.
Pour entrer chez Bernadette Philippe, un peu plus loin, on passe par une véranda où s’alignent les chaussures. Pas question de les garder dans la maison, le virus pourrait s’être accroché aux semelles lors des ventes de fromages. Sur une chaise s’entassent les derniers numéros du Progrès. Le beau-père, abonné, les apporte pour le feu. « Hôpitaux publics et privés unis contre le Covid-19 », « Ces entreprises en première ligne », « Les tests sont-ils fiables ? » : toutes les unes tournent autour d’un seul et même sujet. Bernadette ne lit que les avis de décès.
Pour le reste, la vie suit son cours. Avec son mari, Jean-Luc, ils élèvent des vaches laitières et quelques chèvres, et fabriquent des fromages. Si les marchés ont fermé, Bernadette n’a en revanche jamais autant travaillé pour les épiceries. « À chaque livraison je constate qu’il y a la queue dehors », dit-elle. « On y croise des clients qu’on n’avait jamais vus. Hier, j’ai vendu trois cents fromages au lieu d’une centaine en temps normal. » Et un supermarché lui a demandé d’installer un jour par semaine un petit stand de vente directe sur son parking. Pour répondre à cette demande imprévue qui lui donne le sourire, Bernadette prélève un peu plus de lait sur la production journalière. Le laitier, lui, continue à passer tous les trois jours. Les consignes sont strictes : masque, gants, solution désinfectante près du tank. On se salue de loin, on ne se parle guère. La collecte est donc toujours assurée, mais le couple craint de subir bientôt une baisse des prix. La coopérative dont il dépend a déjà écrit pour prévenir d’une très probable situation de surproduction, puisque de nombreuses fromageries, n’ayant plus de débouchés dans la restauration collective, reversent le lait dans les citernes. Pour éviter un effondrement des cours, il faudra peut-être jeter le surplus. Se lever à 5 heures, traire les vaches comme d’habitude, puis ouvrir les vannes et tout jeter. Un crève-cœur.
Dédé Raquin a dû le faire une fois en quarante-cinq ans de métier et, à trois mois de la retraite, il espère ne pas avoir à le revivre. L’œil rusé et le sourire en coin, Dédé évite de se poser trop de questions. En ce début d’après-midi, il se réveille d’un court somme : « J’ai calé ma sieste sur le journal de 13 heures, je ne veux pas regarder les infos. Le soir aussi, je rentre à 20 h 30 pour en voir le moins possible. » Pour l’instant, il travaille comme il l’a toujours fait, en espérant ne pas tomber sur une tuile. Techniciens et vétérinaires ont été sommés de rester chez eux, à moins d’une urgence, un vêlage difficile. « Comment je fais si une de mes bêtes attrape une infection et a besoin d’un antibiotique ? Il ne faudrait pas non plus que j’aie une panne de matériel : l’autre jour, un joint a lâché sur la roue avant de mon tracteur, et le réparateur n’était pas chaud pour faire travailler ses gars. Je le comprends, mais heureusement que j’ai deux tracteurs, sinon c’était foutu. »
Cette crise, relève-t-il, aura peut-être eu un effet bénéfique : celui de revaloriser la profession. « Comme je l’ai dit il y a quelques semaines à un de ces contrôleurs de la direction départementale d’agriculture : il y a un con qui se lève tous les matins à l’aube pour vous nourrir. Les pâtes et le riz, ça va bien un moment… » Mais si la situation venait à durer, il s’inquiète de la tournure que pourraient prendre les choses… Si les magasins ne pouvaient plus se réapprovisionner ? Si la pénurie s’installait ? Il y a quelques années, dans la région, des vaches ont été retrouvées dépecées. Quelqu’un, ou un groupe, les avait anesthésiées puis leur avait découpé les cuisses. Pour les manger. Dans cette région dure, peuplée de survivalistes qui s’ignorent, on en viendrait à imaginer ce genre de scénario.
En haut du pré où paissent toujours les trois génisses apparaît en trombe une petite camionnette blanche. C’est celle de Didier Plasse et de son fils Sylvain, installés en Gaec (groupement agricole d’exploitation en commun) depuis 2018, année où l’exploitation familiale est passée en bio. Une exception dans le coin. Comme ils le font régulièrement, père et fils viennent rendre visite aux trois montbéliardes indolentes. Peu soucieuses de la « distanciation sociale », elles s’approchent, reniflent. Didier, tout en retirant une tique sur l’une d’elles, s’amuse de l’invitation faite aux Français par le ministre Didier Guillaume à « rejoindre la grande armée de l’agriculture » : « Qu’est-ce que je ferais d’un citadin ? J’aurais juste peur qu’il se fasse mal ! sourit-il. À quelques kilomètres d’ici, les clients d’une Amap viennent régulièrement donner un coup de main au maraîcher. Et régulièrement, en nettoyant les parcelles, ils tirent les carottes plutôt que les mauvaises herbes… »
La voix douce et le même sourire timide, père et fils s’interrogent sur le choix qu’ils ont fait il y a deux ans : « L’idée que nous avions en nous lançant dans le bio, c’était de proposer un produit respectueux de l’environnement, dans une exploitation à taille humaine. Cela correspondait aussi à une attente de la société. Mais cette crise pourrait réorienter les choses. Les consommateurs auront-ils toujours les moyens d’aller vers le bio quand ils seront déconfinés ? L’important, bientôt, ne sera-t-il pas simplement de manger ? Quelle place aurons-nous dans le monde d’après ? » Un peu à l’abri d’une crise qui ne les touche pas frontalement, les agriculteurs se posent des questions. Si Bernadette se réjouit de voir les grandes surfaces faire davantage appel aux agriculteurs locaux dans une conjonction heureuse d’intérêts, Didier, lui, se méfie de leurs intentions. « Si elles veulent du paysan juste pour faire beau dans le pot, c’est pas la peine. » Dédé, qui lui aussi est en train de transmettre son exploitation à son fils, renchérit : « Faut déjà voir si les coopératives vont maintenir nos prix. » Une certaine fatalité paysanne empêche d’imaginer une issue heureuse à cette crise. Il faut dire qu’à Saint-Bonnet comme ailleurs, les agriculteurs ont appris à déchanter. Sur le pré où les montbéliardes s’allongent maintenant pour ruminer, on ne voit rien au-delà des crêtes.
L’inquiétude est dans le pré
Julie Gacon
SAINT-BONNET-LE-TRONCY (Rhône). Le soleil de midi réchauffe les pâturages, balayés par ce vent du nord qui menace la repousse printanière. Indifférentes, trois génisses paissent. En contrebas, la forê…
[Confinements]
Robert Solé
Personne n’y échappe. Même Boris Johnson l’a attrapé. Le Covid-19 est un virus démocratique.
– Vous plaisantez ! L’épidémie révèle les inégalités…
L’inquiétude est dans le pré
Julie Gacon
SAINT-BONNET-LE-TRONCY (Rhône). Le soleil de midi réchauffe les pâturages, balayés par ce vent du nord qui menace la repousse printanière. Indifférentes, trois génisses paissent. En contrebas, la forê…