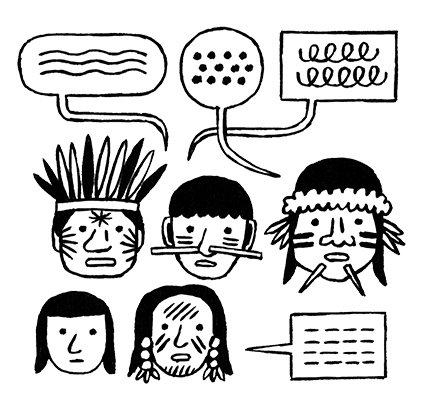« Les Achuar traitent plantes et animaux comme des partenaires »
Temps de lecture : 10 minutes
Pourquoi avoir choisi de consacrer vos travaux d’anthropologue à l’Amazonie ?
Cette région du monde m’intriguait. J’avais lu les textes classiques : on écrit sur les basses terres de l’Amérique du Sud depuis que Christophe Colomb est arrivé chez les Taïnos ! Les chroniqueurs voyaient dans les Indiens soit des enfants du paradis – des « philosophes nus », comme disait Montaigne – menant une existence idyllique dans une forêt qui pourvoyait à tous leurs besoins, soit, au contraire, des brutes cannibales qui vivaient dispersées dans une forêt dont ils se distinguaient à peine. Dans un cas comme dans l’autre, il y a l’idée que ce sont des êtres « naturels ». Ils ne possédaient aucun des signes distinctifs auxquels pouvait se reconnaître une société moderne, telle qu’on l’entendait depuis la Renaissance : ils n’avaient ni pouvoir politique, ni religion, ni régime de lois. « Sans foi, sans loi, sans roi », disait-on en français à l’époque. Ils vivaient en habitat dispersé sur un très vaste territoire, ils n’avaient pas, ou peu, de groupes de filiation – clans ou lignages –, leurs chefferies étaient très peu marquées. Ce défaut d’institutions avait conduit à les considérer comme à peine plus que des animaux ou comme des « automates impuissants », selon l’expression de Buffon.
Longtemps, l’Amazonie a été l’enfer vert, le monde des coupeurs de têtes, des cannibales, des serpents et des araignées venimeuses. Cette vision terrifiante a commencé à se dissiper il y a une cinquantaine d’années pour être remplacée par la version idyllique : les Indiens sont tous des botanistes, des conservateurs de la nature… Ce qui m’intéressait, quand j’ai débuté mes recherches, c’est que ces deux visions se soient maintenues avec une telle constance chez des gens dont certains étaient des observateurs avisés. Il y avait une incapacité de la pensée européenne à appréhender des institutions qu’on ne parvenait pas à percevoir, parce qu’elles ne correspondaient à rien qui nous soit familier. Mon hypothèse avant de partir sur le terrain était que, si cette société nous semblait évanescente, c’était qu’elle était beaucoup plus ample qu’une simple association d’humains – ce que nous appelons société. Elle devait englober autre chose…
Vous avez travaillé avec un peuple de l’Amazonie équatorienne, les Achuar, plus connus sous le nom de Jivaros.
Je suis parti en 1976, avec mon épouse, également anthropologue, pour étudier ce que j’appelais encore la socialisation de la nature. C’est-à-dire comment une société qui venait d’accepter les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, et qui avait donc conservé la plupart des techniques et des modes de connaissance traditionnels, s’adaptait à son environnement. Très vite, j’ai constaté que cette approche était complètement erronée. Les Achuar ne s’adaptaient pas à l’environnement et surtout pas à la « nature », dans la mesure où ils ne conçoivent pas les non-humains comme une totalité.
Ils ne voient pas la nature comme un tout ?
Nous sommes les seuls dans le monde à le faire ! En philosophe défroqué et élève de Lévi-Strauss que j’étais, il me semblait évident que, partout dans le monde, il y avait d’un côté la nature et de l’autre la culture, avec tout au plus des conceptions qui différaient selon les lieux. Je me suis aperçu que, pour les Amérindiens, la nature n’existait pas comme telle, en tout cas pas comme un concept. Les Achuar entretenaient au quotidien une multiplicité de liens avec les non-humains qu’ils traitaient comme des personnes. Ce qui ne les empêchait pas de manger les animaux qu’ils chassaient ou les plantes qu’ils cultivaient. Mais ils les considéraient comme des partenaires sociaux dotés d’une âme.
Chaque plante et chaque animal est un partenaire social ?
Oui, ce sont des individus avec qui on négocie constamment, par l’intermédiaire de chants magiques qui sont chantés mentalement. J’ai évidemment mis un certain temps à découvrir et à me faire expliquer ces chants, les anent, que les Achuar fredonnent tout bas. Ce sont des discours de l’âme adressés soit à un humain éloigné dans l’espace, soit à un non-humain, un esprit, une plante, un animal, à qui on donne des injonctions. On agit sur son âme, c’est une sorte de télécommande.
S’adresse-t-on ainsi aux vivants ou bien aux morts, aux ancêtres ?
Il n’y a pas d’ancêtres en Amazonie. Les Amérindiens sont des sages, ils ne se sont pas encombrés avec ça. Un jour, les vivants disparaissent, et c’est fini. Non, ces chants mentaux sont un moyen de communication. Il faut réaliser qu’après la Conquête, c’est une région du monde qui a perdu 90 % de sa population à cause des maladies infectieuses apportées par les Européens. Dans certaines zones, il y a à peine 0,1 habitant au kilomètre carré. Les humains ne sont pas les êtres qu’on rencontre le plus souvent, ce sont les non-humains qui abondent !
Les rêves sont un autre moyen de communiquer avec ces derniers. Ils viennent vous visiter en rêve, sous la forme humaine qu’ils se sont choisie, pour vous délivrer des messages. Au petit matin, on se réunit autour du feu pour discuter des rêves de la nuit. Il y a des techniques d’interprétation, des clefs des songes : si on a rêvé d’une harde de pécaris, c’est qu’on va rencontrer une bande de guerriers ; si on a rêvé de la pêche, c’est de bon augure pour la chasse.
Une femme racontait un jour ce rêve : une jeune fille la visite et lui reproche de vouloir la tuer. La femme l’interprète ainsi : dans son jardin forestier, elle a planté du manioc trop près d’une plante toxique dont se servent les Indiens pour asphyxier les poissons dans la rivière. La jeune fille est le plant de manioc qui vient se plaindre à sa maîtresse : on ira déplacer son voisin gênant. Progressivement, je me suis rendu compte que le monde des non-humains était aussi social que le monde des humains. En Europe, on se sent à l’abri dans la maison et vulnérable dans la forêt. Les Achuar, eux, vivent en continuum avec la forêt.
Sont-ils nomades ?
Les Indiens d’Amazonie sont pour la très grande majorité des sédentaires. Les Achuar habitent de grandes maisons qui ont des toits et des piliers, mais pas de murs. Ces maisons sont construites pour durer environ vingt ans, ensuite ils les déplacent. Les quelques populations nomades d’Amazonie sont souvent des chasseurs-cueilleurs « régressifs » : d’anciens horticulteurs qui, sous la pression de la colonisation ou de groupes amérindiens ennemis, ont adopté un mode de vie itinérant de chasse, de pêche et de cueillette.
On ne prend pas suffisamment en compte les conséquences de l’épouvantable période qu’a été le boom du caoutchouc à la fin du XIXe siècle. Pour saigner les hévéas, les barons du caoutchouc recrutaient des malheureux dans les Andes ou le Nordeste brésilien, qu’ils réduisaient en servitude par le système de l’endettement perpétuel. Leurs milices contraignaient les Amérindiens au travail forcé dans des conditions si atroces – villages brûlés, femmes violées, hommes torturés – que beaucoup ont fui en s’enfonçant très loin dans la forêt. On fait tout un cinéma aujourd’hui autour de ces tribus amérindiennes isolées qui ignorent tout de la civilisation. Moi, j’assimile ça à des survivants d’un camp de concentration qui n’ont pas envie de revoir leurs bourreaux.
Les Achuar ont-ils gardé la mémoire de ces exactions ?
Les Jivaros ont la chance d’être des guerriers et d’avoir une réputation de férocité. Pendant quatre siècles, ils ont réussi à repousser toutes les tentatives d’invasion et ont préservé, entre l’Équateur et le Pérou, l’intégrité d’un territoire grand comme la Belgique. Autre chance : la variété d’hévéa qui poussait sur leur territoire était de qualité médiocre, donc moins convoitée. Ils se sont assez tôt procuré des fusils pour se défendre, et puis, ils sont relativement nombreux : l’ensemble des Jivaros représente plus de 100 000 personnes qui parlent des dialectes mutuellement intelligibles, au sein d’un groupe linguistique isolé. Ailleurs en Amazonie, des groupes plus petits se sont amenuisés au point de disparaître. On considère qu’il faut au minimum 500 locuteurs pour qu’une langue perdure, sinon les individus finissent par se fondre avec d’autres et, en l’occurrence, par devenir ce qu’on appelle des Indiens invisibles : deux ou trois générations auparavant, ils étaient de culture amérindienne et désormais ils parlent espagnol ou portugais, cultivent du manioc… Ils forment la population générique des bords de fleuve. Aujourd’hui, la moitié des Amérindiens d’Amazonie habitent dans des villes.
J’étais sur place il y a quelques mois, j’ai pu constater que les petits-enfants de mes contemporains étaient pour certains allés à l’université, qu’ils étaient à l’aise avec les techniques modernes. Ils ont même fondé une compagnie aérienne, avec des petits avions monomoteurs, si bien qu’ils ont gardé le contrôle de l’accès à leur territoire. Comme partout en Amazonie au sein des groupes autochtones, il y a des débats interminables entre ceux qui veulent des routes pour accéder à l’éducation, à la santé, à la commercialisation des produits, et ceux qui savent que les routes ouvrent la voie à la petite colonisation et à l’accaparement progressif des terres. Les plus familiers du monde moderne sont les plus opposés aux routes, parce qu’ils en connaissent les conséquences.
Y a-t-il des différences entre les pays, de ce point de vue ?
Bien sûr ! Il y a neuf pays en Amazonie, neuf législations différentes. On l’ignore souvent, mais la Colombie est la nation qui a concédé la plus grande part de territoire aux Amérindiens, avec le Resguardo, un système de réserves et de protection légale – même durant les pires années de violence. En Équateur, on procédait autrement, en donnant soit des territoires communaux à des groupes amérindiens qui les réclamaient, soit des terres à cultiver à des familles. Mais tout ça varie avec le temps. Ces dernières années, les conflits tournent autour des compagnies pétrolières et des compagnies aurifères chinoises. Il y a cinquante ans, on aurait bombardé des villages en toute discrétion, et personne n’en aurait rien su. Aujourd’hui, tout se sait et les appareils répressifs des États ne sont plus en mesure d’imposer leur volonté. Ce sont plutôt des milices privées qui font le sale boulot, comme au Brésil. Et l’État peut s’impliquer activement – ou non – dans la recherche des coupables…
Certains Amérindiens restent-ils volontairement à l’écart ?
L’exemple des Achuar le montre, être combatif permet de choisir : soit rester délibérément à l’écart, soit accepter les contacts, les communications, le tourisme. Rien n’est monolithique, ni à l’échelle d’une ethnie ni, évidemment, à l’échelle de l’Amazonie !
Propos recueillis par Sophie Gherardi
« Les Achuar traitent plantes et animaux comme des partenaires »
Philippe Descola
Pourquoi avoir choisi de consacrer vos travaux d’anthropologue à l’Amazonie ?
Cette région du monde m’intriguait. J’avais lu les textes classiques : on écrit sur les basses terres de l&rsquo…
[Raoni]
Robert Solé
C'est la figure emblématique du combat pour la préservation de la forêt amazonienne. Raoni Metuktire, chef des Kayapos, a pris l’avion à plusieurs reprises – lui qui déteste les innovations techniques des « Blancs », su…
La forêt vierge n’existe pas
Stéphen Rostain
L’Amazonie n’est pas un simple océan houleux de verdure, un monotone brocoli géant ou le poumon essoufflé de la planète, mais bien un trésor de biodiversité longtemps ignoré. Rendons donc le mot « exotique &ra…