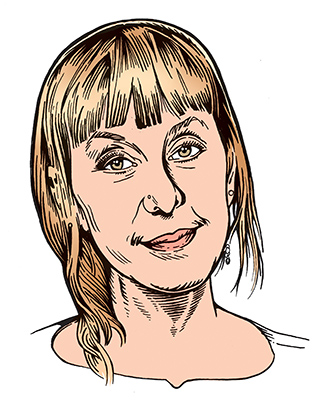Fini de pleurnicher
Temps de lecture : 5 minutes
Comme une grande partie de ma génération, j’ai été sous-payée par de sympathiques patrons « de gauche » qui m’imploraient de tenir compte de leurs difficultés financières ; j’ai écouté des garçons « de gauche » m’expliquer doctement le féminisme ; mes poumons ont été saturés de lacrymos lancées par des flics républicains, certains affirmant aux manifestants qu’ils comprenaient leur cause, étant eux-mêmes « plutôt de gauche » ; j’ai adoré des chanteurs « de gauche », lesquels ont cogné, parfois à mort, leur compagne ; j’ai vu des films « de gauche » raconter de très haut le parcours d’ouvriers analphabètes, racistes et fatalistes.
Qu’on m’autorise donc à entourer cette gauche de ce qu’elle mérite : des guillemets qui nous en protègent.
Car « la gauche » aujourd’hui est un pop-up store schizophrène. On y vend une apologie de la jeunesse tout en envoyant des CRS matraquer les lycéens aux portes de leurs établissements, on y promeut de jolis jardins partagés dans lesquels crèvent des réfugiés qu’on refuse d’héberger, on recycle un vieux monde, celui d’avant le Code du travail, on le repeint en vert : ils ne polluent pas, ces esclaves adolescents qui risquent leur vie à vélo pour nous livrer des petits plats vegan à toute heure. Quant au nucléaire raisonné, sans doute donnera-t-il lieu à des apocalypses raisonnables. « La gauche » tangue mais elle ne perd pas le nord : elle traque l’air du temps comme un animal en fin de vie à qui il ne reste que ça, le flair.
Il semble bien qu’aujourd’hui, à l’image de la profession de foi catholique, il suffise de se proclamer « de gauche » pour l’être. « De gauche », les DRH qui se targuent de licencier avec humanité et bienveillance grâce à leur pratique assidue du yoga ; « de gauche », ceux qui se réapproprient des pratiques collectives et gratuites en les commercialisant – ces créateurs de sites de covoiturage payants, d’échanges de services entre voisins payants, d’espaces de coworking où chacune des minutes passées assis à une table se paye. Les cœurs penchent « à gauche » avec désinvolture et les vies à droite sans aucun état d’âme, la parole déconnectée du geste, on négocie chaque instant du quotidien, évaluant ce qui mérite qu’on s’y arrête ; on enjambe sans ciller les corps laissés sur les trottoirs, estimant d’un coup d’œil lequel méritera sa piécette, on se fait directeur journalier d’un casting de la misère, on coache son enfant sans répit pour qu’il s’en sorte, on veut du sélect, de la maternelle aux petits corps choisis. On se targue de ne jamais se faire avoir, fier de connaître le juste prix de son existence, autoentrepreneur de soi, son temps, sa chambre, ses talents de bricoleur, son sexe et sa voiture. Pourvu de toutes les fonctions en même temps, on participe à ce qu’on dénonce, obéissant en ça à une « gauche » qui promeut notre souplesse, notre adaptabilité.
S’il est tentant d’imaginer qu’il y eut un âge d’or de la gauche parlementariste, j’en doute : après tout, c’est Maurice Thorez qui a prononcé le célèbre « Il faut savoir terminer une grève », s’adressant ainsi aux ouvriers qui, à l’époque, se voyaient privés d’une partie de leur salaire par les contremaîtres sous n’importe quel prétexte. Et si 1936 nous évoque les congés payés, c’est cette même année que le gouvernement Blum a créé l’arbitrage, une façon de neutraliser les conflits sociaux : « Nous avons fait voter un texte qui leur interdirait la grève tant que les tentatives de conciliation prévues par la loi suivraient leur cours. »
La « gauche » va mal ? Eh bien, peut-être est-il temps qu’elle décède. La mise en scène de son agonie n’a que trop duré. Les spectateurs sont lassés d’assister à ses cris de douleur, ses longues introspections télévisuelles les soirs d’élections perdues. Elle pleurniche : pourquoi ne la rejoint-on plus ? Peut-être parce qu’elle n’a d’autre ambition que d’être une alternative. Et si on s’en réfère à l’étymologie, un chemin alternatif n’est qu’une proposition d’aller autrement au même endroit. Une route parallèle à la broyeuse libérale, qui ne s’en écarte jamais tout à fait.
Les partis de « gauche » se meurent et ça n’est pas une mauvaise nouvelle car la gauche, elle, est pleinement vivante. Zones à défendre contagieuses et obstinées, de clairières en hameaux, cortèges de têtes et de joies dans les manifestations confisquées aux syndicats comme aux partis, collectifs informels qui germent spontanément dans les quartiers des grandes villes, les villages. Une gauche du geste, de l’acte, sans programme ni promesse de résultats, au sein de laquelle se renoue le fil d’une conversation qu’on a cru égarée dans le brouhaha du reste. Des ensembles, des regroupements, ces amitiés de terrain qui se reconnaissent comme désirant offrir, accueillir, entendre, défaire ce qui nous défait et partager des oasis, « des fontaines qui dispensent la vie, qui nous permettent de vivre dans le désert sans nous réconcilier avec lui » (Hannah Arendt).
« La gauche du XXIe siècle sera anticapitaliste »
Enzo Traverso
Comment qualifieriez-vous la situation de la gauche en France aujourd’hui ?
En France et ailleurs, la situation de la gauche est mauvaise mais pas désespérée. Plusieurs signes indiquent que quelque chose est en train de bouger, un processus moléculaire qui n’a pas encore…
[Audition]
Robert Solé
En effet, la gauche est inaudible. Cela tient-il à sa façon de s’exprimer ? Au fait qu’elle mange ses mots et n’articule pas assez ? Le son socialiste passe mal. Ou alors ce qui entre par une oreille sort aussitôt par l’autre. No…
Aux abonnés absents
Laurent Greilsamer
Ce sont deux mots qui ont servi de bannière à des générations de Français : la gauche. On se sentait de gauche. On était de gauche. Et d’un coup de baguette magique, on pensait avoir rejoint l…