Toujours debout
Temps de lecture : 6 minutes
Si je devais définir l’essence et le caractère de ma ville en une seule phrase, je choisirais, paradoxalement, une sentence de l’un de ses ennemis. « Il faut bombarder Barcelone tous les cinquante ans. » Tout est dit. Barcelone, berceau et patrie du conflit. Ou plutôt des conflits. Éternellement d’actualité, heureusement non résolus.
Pourquoi tout au long de l’histoire, le Pouvoir, avec une majuscule, a-t-il manifesté tant de haine, une telle furie et une telle répulsion contre la pauvre Barcelone ? Avant de répondre, hâtons-nous d’introduire une nuance : pour le visiteur occasionnel de tels conflits demeurent invisibles. « Les étrangers, affirmait un auteur français, connaissent Paris et ses recoins beaucoup mieux que nous. » Rien de tel malheureusement pour le touriste que Barcelone attire. De nos jours la ville s’obstine à battre tous les excès de masses étrangères transitoires ; des foules à la fois évanescentes et lourdes comme le plomb. Contempler ces torrents humains en short et à la peau grossièrement rougie génère, admettons-le, un certain malaise anthropologique. Ils forment d’authentiques légions, dont l’attitude rappelle les bovidés et la discipline l’insecte : ainsi que les fourmis, ils suivent toujours le même parcours, exact, sans la moindre inquiétude de ce qu’il peut y avoir à quelques mètres à peine. Mais pourquoi, nous demandons-nous, Barcelone a-t-elle fini par s’ériger en berceau et volcan de tant de rébellions et tant de révolutions ?
À partir du xve siècle, les capitales des puissances sont reliées les unes aux autres par la mer. Elles disposent toutes d’un port, qu’il soit maritime ou fluvial : Rome, Lisbonne, Londres, Saint-Pétersbourg, Paris… Toutes ? Non. Il y en eut une qui, à cause de la mentalité castillane centrée sur les steppes de la Meseta, refusa les bienfaits de la mer. Sans concurrence, Barcelone devint la grande porte du commerce avec l’Europe, ouverte à toutes sortes de biens et marchandises, notamment aux idées et aux idéologies.
C’est ainsi que les masses barcelonaises, grotesquement entassées dans un centre urbain riquiqui, furent les premières de la péninsule Ibérique à découvrir qu’elles n’étaient pas de la racaille, mais des prolétaires. À ce processus, habituel sous toutes les latitudes, s’ajouta – voici les circonstances aggravantes qui font toute la différence – un second vecteur. Les séditieux étaient Catalans. Le raisonnement des élites espagnoles a toujours suivi un tour étrange. Le fait que les Catalans se sentent aussi catalans que les Espagnols espagnols, ou les Birmans birmans, est considéré comme quelque chose d’aussi fragile que pernicieux. Ainsi, n’importe quelle manifestation de catalanité qui dépasse le stade folklorique est suspecte, ou plutôt condamnable. C’est-à-dire susceptible d’être bombardée. Barcelone se divise en trois grands univers architecturaux. Il suffit de jeter un coup d’œil fugace sur un plan pour le discerner. Le premier, sur la mer, Ciutat Vella (« la vieille ville »), inclut le noyau romain et médiéval. On a peine à croire que ses remparts ont contenu la ville jusqu’au xixe siècle. Comme nous l’avons mentionné, ses foules agglomérées déclenchaient des révoltes périodiques. De la vieille ville, j’ai toujours aimé les ruelles, les coins étroits, les cicatrices, les dévastations : elle recèle un endroit qui n’apparaîtra jamais dans les guides touristiques et qui m’a toujours captivé. Il se trouve au croisement des rues de la Boqueria et des Banys Nous (« les nouveaux bains »), un immeuble insignifiant, mais qui m’a toujours attiré par son pouvoir hypnotique. Sur sa façade apparaît en énormes caractères la date « 1716 ». Il faut bien dire que la tradition de bombarder la ville est très antérieure à la citation du général dément. En fait, l’année zéro pour les Catalans fut 1714, lorsqu’une coalition franco-espagnole soumit Barcelone à un siège et la bombarda. Ce fut apocalyptique. J’ai toujours eu l’intuition que cet immeuble fut l’un des premiers que l’on construisit ou reconstruisit après la défaite. Et que ses habitants voulurent le proclamer haut et fort. 1716 : « Malgré tout, nous sommes toujours là. »
Le deuxième espace architectural qui définit Barcelone est ce que l’on appelle en catalan l’Eixample, en espagnol el Ensanche , réussite, merveille et exploit du xixe siècle. Le labyrinthe chaotique de la vieille ville cède le pas à une immense mosaïque de rues dans un rigoureux ordre géométrique. Un Manhattan à échelle humaine. Qu’y a-t-il de plus remarquable ? L’Eixample a été conçu pour que des ouvriers y habitent. Tout y transpire la splendeur du génie discret, de l’œuvre humaine pensée pour le bien-être de l’homme. Ses rues salubres, ses coins de rues tronqués, les énormes cours intérieures, ses jardins touffus pour l’agrément des résidents modestes. Tandis que la plupart des métropoles du xixe siècle ont été conçues pour séparer les riches des pauvres, l’Eixample abolissait toutes les différences de classes. Quelle grande utopie urbaine! Elle échoua, naturellement. Mais ses ennemis surent toujours voir les racines égalitaires du quartier. On dit qu’en 1939 quand les troupes fascistes occupèrent la ville – après l’inévitable et habituelle série de bombardements – un officier ennemi contempla Barcelone depuis une colline, et après un bref moment de réflexion, s’exclama : « Comment avons-nous pu laisser cela grandir autant ? » Je n’ai pas d’endroit favori dans l’Eixample. Le charme de l’Eixampletient au quartier lui-même.
Le troisième espace urbain se trouve au nord de l’Eixample. Le modèle de la dictature franquiste fut le chaos, comme le démontre cet ensemble de rues désordonnées aux croisements tordus – des quartiers trop riches pour accéder au caractère épique des favelas, trop neufs pour aspirer à la gloire et au martyre que concède l’Histoire.
Le général, auteur de la phrase sur les bombes, eut heureusement une agonie douloureuse. Alors qu’il était sur son lit de mort, son confesseur lui demanda s’il pardonnait à ses ennemis. Vexé, il répondit : « Moi, je n’ai pas d’ennemis. Je les ai tous fait fusiller. » Il se trompait. Barcelone était toujours debout.
Traduit de l’espagnol par Joan-Daniel Bezsonoff


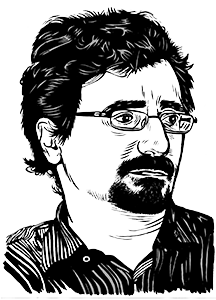
« Le tourisme est une bête destructrice »
Oriol Clos
Oriol Clos, architecte en chef de Barcelone de 2006 à 2011, décrypte le modèle urbanistique de la ville catalane.
Le Cafè del Centre
Mathias Énard
L’écrivain nous invite dans un café où le charme mélodique de la Catalogne continue d’opérer, à l’ombre des touristes...
Rambla
Laurent Greilsamer
Laurent Greilsamer se remémore sa première rencontre avec La Rambla.
La légende de Joan-Hans Gamper
Catherine Clément
Catherine Clément nous conte la légende de Joan-Hans Gamper.







