Un amour contrarié
Temps de lecture : 5 minutes
Istanbul est une amante difficile. Vous pouvez en tomber fou amoureux, mais impossible de lui faire entièrement confiance. Même si vous vivez avec elle pendant des années, chaque jour sera différent du précédent. Vous ne pourrez ni la contrôler, ni la posséder.
Istanbul est une ville-femme. Quand vous arrivez, vous voyez sans doute plus d’hommes que de femmes dans ses rues, mais cela ne change rien au fait que l’âme de cette ville est féminine. « La vierge qui a survécu à mille maris », disaient les poètes ottomans…
Les amoureux d’Istanbul (dont je suis) se répartissent en deux catégories : ceux qui y sont nés, et ceux qui arrivent ici plus tard dans leur vie, pour une raison ou pour une autre. En d’autres termes, les locaux et les étrangers.
Les locaux considèrent Istanbul comme allant de soi. Ils pensent la connaître si bien qu’ils ne font plus attention à ses complexités, à ses nouveautés. Mais Istanbul est pleine de surprises. Ville aux multiples couleurs et aux multiples conflits, elle n’est jamais tranquille, jamais stable. Si bien que parfois, il faut un étranger pour la voir véritablement. Les étrangers remarquent les détails (les odeurs, les sons, les images) ignorés des locaux. C’est pourquoi quand je rencontre un étranger qui vient d’arriver à Istanbul, je lui dis toujours : « si vous restez ici suffisamment longtemps, vous saisirez sans doute mieux et plus rapidement l’esprit de cette ville que des millions de Stambouliotes ».
Il fut un temps où j’étais moi-même une étrangère. Je ne suis pas née ici. En fait, j’avais plus de vingt ans quand j’ai décidé de m’y installer. Mes raisons ? Il n’y en avait aucune. Je pensais, non, je croyais de tout mon cœur qu’Istanbul m’appelait, m’invitait dans mes rêves. Je ne connaissais pas âme qui vive à Istanbul. Je n’avais ni maison, ni travail, aucune base, aucun passé ici. Et pourtant j’étais convaincue que la ville m’appelait de loin. J’ai donc tout quitté pour émigrer à Istanbul avec la foi aveugle des fous ou des amants, voire des deux.
Je suis arrivée ici le premier jour de septembre. Les restaurants de poisson de la ville commençaient tout juste à servir la bonite – c’était sa meilleure saison – ; l’air sentait le sel, les algues et les gaz d’échappement. Je trouvai un petit appartement. Il était si exigu qu’après une douche même brève, la buée recouvrait non seulement le miroir mais tout l’appartement. La cuisine était tout aussi minuscule. Mon salon donnait sur une rue très escarpée, la rue des Chaudronniers. En se tordant le cou, par temps clair, on arrivait à apercevoir le Bosphore, au loin. C’était un appartement avec vue, comme me l’avait précisé l’agent immobilier.
L’histoire de cette rue était riche mais perturbante. Ce quartier était jadis peuplé de minorités – principalement des Arméniens et des Juifs. Au fur et à mesure, nombre de ces familles ont dû partir, elles ne s’y sentaient plus à l’aise, plus les bienvenues. Leur départ a laissé un grand vide dans la mémoire de la ville, dans sa conscience aussi.
Puis dans les années 1970, une nouvelle strate culturelle est venue habiter le quartier – les minorités sexuelles. Homosexuels, travestis, transsexuels… Nombre d’entre eux étaient des parias. De chacun de ces groupes de résidents, seuls quelques-uns étaient demeurés dans le quartier. C’est pourquoi parmi mes chers voisins on comptait une veuve américaine, une vieille dame juive, un travesti d’âge mûr… Tous parlaient du passé, même s’il était douloureux ; ils me montrèrent des photographies jaunies. J’écoutais, je buvais chacune de leurs paroles. J’ai toujours aimé écouter les histoires d’Istanbul.
Je suis tombée amoureuse d’Istanbul. Je suis tombée amoureuse à Istanbul. Amoureuse de la solitude et de l’amitié, de la compassion et de la cruauté. J’en ai trouvé en abondance. C’est ici que je suis parvenue à passer du statut d’apprenti-écrivain à celui d’auteure reconnue. Istanbul m’a brisé le cœur et me l’a réparé à chaque fois. Istanbul m’a faite telle que je suis aujourd’hui. Livre après livre, roman après roman, j’ai écrit sur Istanbul. Pas comme une toile de fond immuable mais comme une créature dotée d’une personnalité propre.
J’étais à Istanbul quand le tremblement de terre a eu lieu, causant plus de 15 000 morts. J’ai vu la ville en temps de crise comme en temps de paix. J’ai visité ses nombreux quartiers, retranscrit des centaines de graffitis car rien ne reflète mieux l’humour noir de cette ville. Mes deux enfants sont nés à Istanbul. Mon mari, mes amis les plus proches, mes souvenirs, mes lecteurs, la moitié de mon cœur sont à Istanbul. Pourtant je ne peux être avec elle tout le temps parce qu’elle est exigeante, suffocante, possessive.
Le grand mystique Rumi parle de la vie comme d’un compas. Je lui emprunte cette métaphore. L’une des branches du compas est statique, plantée dans un certain endroit. L’autre trace un cercle autour de la première ; elle tournoie, cherche, explore sans relâche. J’aime à considérer ma fiction comme un compas. Une branche est ancrée à Istanbul, elle est stambouliote tandis que l’autre branche s’en tient à l’écart, mondiale dans l’âme.
Traduit de l’anglais par Charlotte Garson


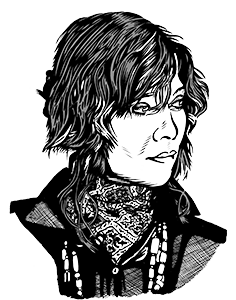
Des villes sous la ville
Aksel Tibet
À Istanbul cohabitent des strates historiques qui vont de la préhistoire à la période ottomane. Sur la Corne d’Or, la péninsule historique, dès que vous creusez 50 cm vous tombez sur des vestiges ! Mais il n’y a pas de place pour fouiller car …
La fascination du Bosphore
François Simon
Il y a mille cafés à Istanbul, le long du fleuve à l’heure du couchant, le Bosphore dans toute sa magnificence. C’est ici que le monde peut vous sauter à la gorge, vous extirper de vos rêveries et vous catapulter dans l’ailleurs.
Énergie
Daniel Rondeau
Istanbul est une ville-volcan (et la répétition des troubles récents, après tout, manifeste une vitalité démocratique, et laïque, hors du commun), l’une des mégapoles qui montre une inlassable force dans l’action et dans sa vie quo…
La métamorphose d’Istanbul
Elsa Delaunay
Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre turc aurait-il la folie des grandeurs ? Les projets pharaoniques lancés par son gouvernement semblent attester cette hypothèse. Mais au-delà d’un vertige des apparences, ces équipements témoignent de la complexit&e…







