Pourquoi le travail désorganise nos vies
Temps de lecture : 8 minutes
Toute sortie, amicale ou mondaine, confronte au thème du travail : « Et vous travaillez dans quel domaine ? » Banale curiosité d’une sociabilité ordinaire où s’incarnent des siècles d’histoire. Longtemps indigne et méprisé, le travail s’est imposé, au cours des trois derniers siècles, comme un marqueur fort de l’identité. Véritable épine dorsale de la vie selon Nietzsche, le travail est une façon de s’identifier et d’être identifié ; il est le lieu de prédilection, avec la famille, de la construction de l’estime de soi.
Les Français sont d’ailleurs, de tous les Européens, ceux qui accordent la plus grande importance au travail : selon les dernières enquêtes, 70 % d’entre eux considèrent qu’il est très important, contre 40 % pour les Britanniques. Attachement au travail dont témoigne également le fait que 60 % des Français déclarent qu’ils continueraient à travailler même s’ils n’avaient pas besoin d’argent.
Le travail est une source de satisfaction, de motivation, d’émulation pour de nombreux salariés que j’ai pu rencontrer à travers des missions en entreprise, même quand les contextes professionnels sont délétères. Il procure des raisons d’exister, des joies, voire du bonheur. Il reste assurément un lieu d’expression de la créativité humaine, même si ces attributs positifs concernent avant tout les franges supérieures et les plus diplômées du salariat.
Pour autant, dans sa dure réalité, l’histoire récente du travail est celle d’une double débâcle. Depuis près de 40 ans, le travail est devenu un bien rare pour des millions de travailleurs. Sorties d’un modèle de prospérité où croissance se conjugue avec plein emploi, les sociétés européennes, et en particulier la France, subissent depuis les années 1970 un chômage endémique qui frappe prioritairement les jeunes, les seniors et les moins diplômés. Aujourd’hui, dans certaines zones urbaines défavorisées, le taux de chômage peut atteindre 50 %. Le travail a de fait cessé de jouer ce rôle de grand intégrateur à la collectivité. Le manque d’emploi est une donnée structurelle des sociétés contemporaines à laquelle se heurtent les objectifs à court terme d’inversion des courbes du chômage.
Le développement du précariat symbolise cette faillite intégratrice du travail. Contrats temporaires à répétition et temps partiels sont devenus une réalité permanente. Dans une période économiquement atone, la flexibilité permet sans doute de lutter contre le chômage et facilite parfois l’accès aux situations les plus stables, mais pour les individus qui y sont soumis, travailler reste alors synonyme d’incertitude du lendemain, de bouleversement des rythmes de la vie privée et professionnelle et, pour les travailleurs pauvres (7 % des actifs en France), de difficultés à vivre de son travail. J’ai ainsi croisé des caissières de la grande distribution à l’existence totalement désorganisée par leurs horaires décalés, dont les maris étaient eux-mêmes astreints, dans les usines de la région, à un travail posté en trois-huit ; seule la solidarité familiale leur permettait de gérer le quotidien de leurs enfants.
Mais le phénomène nouveau, depuis quelques années, est ailleurs : désormais la crise du travail ne se cantonne plus aux frontières du salariat. Elle se joue au sein même des entreprises. Le chômage de masse a longtemps occulté les conséquences des transformations profondes et radicales des organisations du travail. Il a fallu des crises aussi dramatiques que celle traversée par France Télécom pour rendre visible le mal-être au travail d’un nombre croissant de salariés.
à partir des années 1990, de nouvelles formes d’organisation du travail s’imposent, plus complexes, flexibles, polyvalentes, qui prônent une gestion individualisée des salariés. Le paradigme libéral remet en cause les conceptions intégrées des entreprises à la faveur des théorisations de célèbres économistes américains, comme Oliver Williamson ou Alfred Chandler. Pour faire face à un contexte de diversification et optimiser leur profitabilité, elles sont aujourd’hui gérées comme une collection de petites unités où les centres de coût et de profit entretiennent en interne des liens de clients/fournisseurs. Les coups de rabot des cost-killers se traduisent par une mise sous tension des organisations du travail et une intensification du travail.
Dans le même mouvement, le modèle du « salarié-entrepreneur » devient la norme et les entreprises se vident de leur substance sociale et relationnelle régulatrice. Hormis pour une petite aristocratie de salariés, identifiée comme des « talents » qui peuvent bénéficier d’un traitement de faveur, la mobilité, l’évolution et le développement des compétences ne sont en général plus pris en charge par l’organisation. Ils sont du ressort de la volonté individuelle, des anticipations et des stratégies personnelles. Je me confronte ainsi régulièrement à l’incompréhension de salariés qui m’expliquent qu’en dépit de leurs années d’ancienneté ils doivent rédiger curriculum vitae et lettres de motivation pour changer de poste dans leur entreprise, comme tout chômeur sur le marché de l’emploi. Remplacées par des centres de services partagés qui gèrent à distance et anonymement les personnels (congés, maladies, payes), les ressources humaines des grandes entreprises ont déserté le soutien de proximité pour devenir des business partners. Les managers sont, quant à eux, absorbés par les tâches de contrôle de l’activité (reporting), corollaire d’une autonomie dans le travail qui est célébrée, tout en étant de plus en plus encadrée.
La conséquence immédiate de ces nouvelles formes d’organisation a été l’explosion des maux du travail. L’espace médiatique est saturé de témoignages sur le malaise ou le silence des cadres, la souffrance et les suicides au travail, l’épuisement professionnel et le stress des uns, les troubles musculosquelettiques des autres. Les données disponibles sont édifiantes et attestent d’un malaise profond : les salariés français battent des records en matière de stress professionnel par rapport à ceux des autres grands pays européens et le sentiment de pénibilité est bien plus fréquent qu’ailleurs.
Les témoignages que j’ai pu recueillir sont sans appel : la nouvelle donne organisationnelle a altéré la confiance fondamentale des salariés envers leur entreprise et sonné l’heure de la grande désillusion à l’égard du travail. L’entreprise contemporaine ne répond plus que partiellement aux aspirations fortes des salariés français à se réaliser et s’épanouir grâce au travail.
Pris en étau entre le risque du chômage et de l’exclusion et la transformation de son entreprise, qui est synonyme pour lui de dégradation et d’intensification du travail, le salarié contemporain est assigné à sa position professionnelle et à une perte de sens dans son activité. Je pourrais citer ici ces ingénieurs informatiques, passionnés par leur métier, qui pâtissent de la taylorisation des tâches et sont conduits à développer, sans vision d’ensemble, des morceaux de programme, que d’autres équipes dans d’autres pays assemblent ; ou encore ces conseillers clientèle transformés en conseillers commerciaux préoccupés par la vente de produits additionnels plutôt que par la satisfaction de leurs clients. Je peux aussi évoquer les hôpitaux où le sous-effectif et la surcharge chroniques ne permettent plus aux personnels d’être au service des patients, comme ils le souhaiteraient et comme les règles de l’art de leurs professions les y invitent.
Quand le travail se dérobe, se délite, se précarise, se flexibilise, quand il n’est plus capable de répondre aux promesses de réalisation de soi et d’épanouissement personnel, les identités vacillent, se fragilisent, et s’exprime alors une forte insatisfaction. On observe ainsi un décrochage des salariés par rapport aux discours de leur direction et un recentrage sur les dimensions instrumentales du travail (travailler pour vivre) ainsi que sur des enjeux plus locaux. S’organiser, créer, partager, échanger avec les collègues devient la principale source de motivation au quotidien. L’ambiance de travail est ainsi souvent évoquée par les salariés sous la forme d’un salutaire : « Heureusement, on s’entend bien entre collègues » qui n’est pas sans rappeler la tradition ouvrière de la camaraderie qui aidait à supporter la dureté de l’environnement productif.


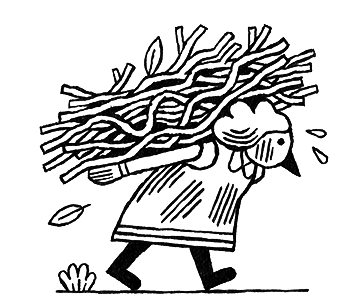
Pourquoi le travail désorganise nos vies
Xavier Zunigo
Toute sortie, amicale ou mondaine, confronte au thème du travail : « Et vous travaillez dans quel domaine ? » Banale curiosité d’une sociabilité ordinaire où s’incarnent des siècles d’histoire. Longtemps indigne …
Travail
Erik Orsenna
Pourquoi un même mot pour dire deux réalités différentes, voire contradictoires ? Quelqu’un, en haut lieu, voudrait-il embrumer les humains ? Les mots ont le double pouvoir d’enflammer et d’endormir. Tantôt ils sonnent la révolte, tant&oci…
Free-lance
Ollivier Pourriol
– Donc si je résume, monsieur... ?
– Potter. Harry.
– Vous êtes à la recherche d’un emploi... ?
– De magicien.
– Magicien, magicien. Voilà. J’ai peut-être quelque chose dans un VVF, ou sur une…







