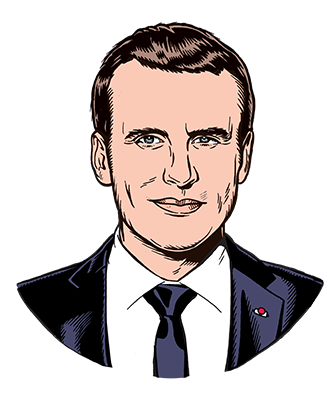Un héros français
Le 11 novembre dernier, à l’occasion des célébrations autour du premier conflit mondial, le président de la République a souhaité rendre hommage à Georges Clemenceau. Il revient ici sur cette figure politique marquante. Une manière d’honorer l’homme qui a su remobiliser une population désemparée. Un clin d’œil, aussi, au tenant d’une politique sociale pragmatique visant avant tout l’intérêt général.Temps de lecture : 4 minutes
Dans notre mémoire collective, la figure de Clemenceau chef de guerre tend à se réduire à quelques formules (« je fais la guerre »), à quelques images (la visite dans les tranchées), à quelques idées reçues (il aurait pu, croient encore certains, arrêter la guerre en 1917). Ce qui pourtant continue de fasciner, c’est ce que lui-même, inlassablement, a placé au cœur de sa venue au pouvoir, de sa stratégie, de sa politique de guerre : un amour inconditionnel de la France.
Les propos de Clemenceau pendant cette période décisive ne sont pas ceux d’un va-t-en-guerre et encore moins ceux d’un ambitieux dont le rêve de pouvoir serait enfin assouvi dans des circonstances dramatiques qui le rendent plus beau encore. Ils sont d’abord l’affirmation constante d’une conscience française. Française par l’attachement à l’histoire : « Je suis le fils d’une vieille histoire qui sera continuée », écrit Clemenceau dès mars 1918, pour formuler les raisons de faire la guerre aux « hordes » germaniques. Et partout cette idée que la France porte une histoire à la fois séculaire et singulière, qu’il importe de ne pas interrompre, apparaît comme un socle, comme une certitude infrangible qui alimente la volonté de vaincre : « Ces hommes-là meurent pour le plus grand idéal […], pour la continuation d’une histoire qui sera la première entre toutes les histoires des peuples civilisés » (8 mars 1918).
Cet attachement, du reste, n’a rien de nationaliste. Au nationalisme allemand, Clemenceau oppose au contraire l’universalisme français. Et c’est pour cela que la guerre doit être gagnée : parce qu’elle n’est pas seulement la guerre entre deux nations, mais entre deux conceptions de l’humanité. Entre une conception clanique sinon raciale, et une conception idéaliste et humaniste : « La France représente une conception d’idéalisme, d’humanité, qui est celle qui a prévalu dans le monde et on ne peut pas servir l’humanité aux dépens de la France », écrit-il le 5 novembre 1918. Et l’on sait son appel du 17 septembre 1918, lorsque la victoire enfin apparaît à portée de main après le succès de la contre-offensive de juillet : « Allez donc, enfants de la patrie, allez achever de libérer les peuples des dernières fureurs de la force immonde ! »
C’est cette conception de la France que Clemenceau ne cessa de brandir devant tous ses interlocuteurs, et c’est dans cette conception qu’il trouva l’espoir d’une victoire qui souvent aurait pu se décourager. C’est dans cette certitude que la France était moins une patrie qu’un idéal qu’il trouva viscéralement des raisons d’espérer. Et dans cette certitude aussi que les soldats de France portaient en eux, comme une lueur, cet idéal.
C’est pourquoi, dur avec les haut gradés, Clemenceau fut clément et bienveillant avec les soldats, les défendant dans les pires moments de doute face à la représentation nationale, s’interdisant de jamais perdre confiance en eux. « Demeurer avec le soldat, vivre, souffrir, combattre avec lui » : telle fut sa devise, non point par militarisme, mais par amour profond, charnel, de ce peuple de France dont toutes les classes et toutes les origines étaient réunies sur le champ de bataille et qui incarnait l’idéal de la nation française. De là un amour et un respect du soldat se confondant avec son amour de la France. C’est bien ce Clemenceau qu’on disait hostile aux militaires qui écrivit : « J’affirme que la victoire dépend de nous […], à condition que les pouvoirs civils s’élèvent à la hauteur de leur devoir, parce qu’il n’y a pas besoin de faire cette recommandation aux soldats. »
On se gardera donc de voir une simple formule rhétorique dans la péroraison de son discours à la Chambre pour annoncer l’armistice. Lorsqu’il s’écrie : « Grâce [aux soldats], la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, sera toujours le soldat de l’idéal », il décrit cela même qui pendant cette année terrible l’a fait croire, tenir, espérer, agir.
De Clemenceau chef de guerre, c’est cela que je retiens en premier lieu. C’est qu’il eut de la France une idée, une idée élevée, une idée noble, mais aussi une idée enracinée et réelle : au croisement des deux, il s’est forgé cet idéal charnel, rendant la victoire aussi indispensable qu’inévitable. Ainsi y avait-il chez ce Père la Victoire obstiné et bougon, infatigable et querelleur, quelque chose de mystérieusement chevaleresque. Une sorte d’idéalisme des temps anciens se colletant avec la réalité la plus rude et la plus cruelle, et y trouvant de quoi s’exalter. C’est ainsi sans doute que se gagnent les guerres qui semblent perdues.
Le pays, que Clemenceau avait trouvé fin 1917 découragé, prêt à accepter une paix honteuse, démotivé, reprit espoir dès le début 1918. La France comprit que la victoire était la seule solution. Elle regardait ce petit homme tonner à la Chambre, houspiller ses généraux, se ruer sur les champs de bataille, et partout le pays comprenait qu’une flamme renaissait, et que malgré l’extrême difficulté des temps, une forme d’idéal pouvait le mener à la victoire. La France crut en lui, parce qu’il croyait en la France. Ce fut sa force et son secret. C’est cela, aujourd’hui encore, qui le rend unique, et l’installe de plein droit aux côtés de tous ceux qui, dans notre longue histoire, ont ramassé le flambeau que d’autres avaient laissé choir. C’est cela qui aujourd’hui fait de lui, par-delà les clichés et les zones d’ombre, un authentique héros français.
« C’est un exemple de fermeté, de constance dans l’intransigeance »
Michel Winock
Avant d’essayer de comprendre le rôle de Clemenceau durant la guerre de 14-18, pouvez-vous nous dire quelques mots sur son parcours politique ?
C’est un radical au sens fort du mot. Il commence sa vie politique à l’extrême gauche. Jules Ferry, q…
Clemenceau et le docteur Faust
Sylvie Brodziak
Dans l’esprit et le cœur du Tigre, la guerre de 1870 a définitivement terni l’image de l’Allemagne. Mais avant celle-ci, sous le Second Empire, la Prusse bismarckienne fut vécue par Georges Cl…
Clemenceau et le docteur Faust
Sylvie Brodziak
Dans l’esprit et le cœur du Tigre, la guerre de 1870 a définitivement terni l’image de l’Allemagne. Mais avant celle-ci, sous le Second Empire, la Prusse bismarckienne fut vécue par Georges Cl…